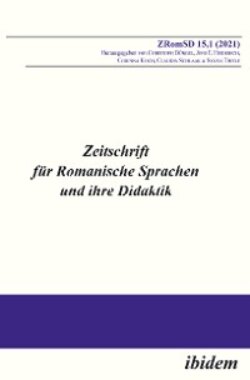Читать книгу Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre Didaktik - Группа авторов - Страница 6
Expressions préformées et apprentissage des langues étrangères
ОглавлениеGünter Schmale (Lyon)
1. Introduction
Dans le domaine francophone, depuis longtemps, les affinités électives langagières1 sont reconnues depuis longtemps, dès l’évocation de groupes articulés par Bréal (1872), de séries phraséologiques ou de groupements usuels par Bally (1909a), d’agglutinations ou de locutions toutes faites par Saussure (1916), de locutions par Sèchehaye (1921) ou du phénomène du figement langagier par Frei (1929), développé dans sa Grammaire des fautes en tant que principe affectant les syntagmes frappés par la « brachysémie ou brièveté sémantique » (id., 109).
L’observation est confirmée par les études anglophones et germanophones : Paul (1880) souligne le rôle fondamental de la reproduction langagière pour la communication,2 Jespersen (1924) différencie les « free combinations » et les « formulae », Porzig (1934) évoque les « relations déterminantes de sens »,3 sans oublier les observations de Bloomfield (1933), Firth (1937) ou de Sapir (1921) relatives aux phénomènes de figement langagier.
Plus récemment, Bolinger (1976), par le biais de la jolie métaphore de construction d’un bâtiment à l’aide d’éléments préfabriqués, constate :
[...] our language does not expect us to build everything starting with lumber, nails, and blueprint, but provides us with an incredibly large number of prefabs, which have the magical property of persisting even when we knock some of them apart and put them together in unpredictable ways (Bolinger, 1976, 1).
Constatant un nombre toujours croissant d’études sur le figement langagier, François & Mejri (2006, 7) soulignent que toutes les disciplines, en linguistique comme en didactique, ont à ce jour découvert l’importance du phénomène :
L’importance du figement n’est plus à démontrer : toutes les théories linguistiques l’intègrent d’une manière ou d’une autre ; les différentes disciplines (syntaxe, sémantique, morphologie, phonologie, analyse du discours, etc.) en tiennent compte ; les diverses applications linguistiques lui réservent une place de plus en plus grande comme c’est le cas dans l’apprentissage des langues et la traduction.
Legallois & Gréa (2006, 5) vont même jusqu’à stipuler un « tournant phraséologique de la linguistique » qui culmine actuellement en une étude tous azimuts de structures lexicogrammaticales par la construction grammar (CxG).
Plus récemment, on observe un « tournant empirique » des recherches en phraséologie et, dans une acception élargie, des expressions préformées (= EP), qui se fondent sur des corpus de manifestations langagières en contexte naturel. Les recherches examinent, d’une part, d’un point de vue quantitatif, la fréquence d’utilisation des EP, et d’autre part, dans une perspective qualitative, les EP dans leurs environnements séquentiels afin d’élucider leurs fonctions communicatives ou conversationnelles.
Les travaux d’analyse menés dans une perspective quantitative, recensant un nombre d’expressions préfabriquées bien plus élevé qu’un locuteur convaincu de s’exprimer avec créativité voudrait bien admettre, constatent en effet un taux d’emploi élevé d’expressions préformées. Wray & Perkins (2000) constatent qu’une proportion allant jusqu’à 70 % de la production langagière d’un adulte peut être « formulaic » (Wray & Perkins 2000, 1-2), Erman & Warren (2000) trouvent 58 % d’expressions préformées dans la production orale et 52 % dans la production écrite dans leur corpus anglais, van Lancker-Sidtis & Rallon (2004) ont calculé que 25 % des « phrases » du scénario du film Some like it hot sont composées de « speech formulas, idioms, proverbs and other formulaic expressions ». Indépendamment d’une vérification indispensable des critères définitoires de la préformation au sein des études évoquées, insuffisamment différenciés et transparents d’après Donalies (2009, 29), le principe d’une présence significative d’EP dans le discours écrit et oral peut être considéré comme acquis. Toutefois, cette certitude ne dispense en aucune façon le chercheur d’une analyse fondée sur des corpus suffisamment larges en se basant sur des catégories distinctives d’EP dans l’objectif d’élucider les formes préfabriquées qui sont effectivement employées et de décrire leurs fonctions en contexte « naturally occurring ».
Charles Bally avait souligné dès 1909 l’impératif de l’apprentissage des « groupements phraséologiques » par le locuteur non-natif (= LNN) en quête d’un maniement compétent d’une langue :
L’étude des séries, et en général de tous les groupements phraséologiques, est très importante pour l’intelligence d’une langue étrangère. Inversement, l’emploi de séries incorrectes est un indice auquel on reconnaît qu’un étranger est peu avancé dans le maniement de la langue […] (Bally 1909, 73).4
Notamment sous l’impulsion de Kühn (1987) pour l’allemand, de Galisson (1984) pour le français et de Widdowson (1989) pour l’anglais, la didactique des langues étrangères s’est réveillée de sa « douce torpeur »5 depuis.6 Widdowson (1989) souligne que
[…] communicative competence is not a matter of knowing rules for the composition of sentences and being able to employ such rules to assemble expressions from scratch as and when occasion requires. It is much more a matter of knowing a stock of partially pre-assembled patterns, formulaic frameworks, and a kit of rules, so to speak, and being able to apply the rules to make whatever adjustments are necessary according to contextual demands (id., 135).
La recherche actuelle en didactique des langues, maternelles comme étrangères, constate unanimement que la maîtrise des expressions figées, phraséologiques, toutes faites ou, dans notre acception plus large, préformées, constitue un élément fondamental de la compétence communicative. Les avis sont cependant partagés ou encore insuffisamment différenciés, sans que cela justifierait de mettre face-à-face, de manière quelque peu caricaturale, « phraséophiles » et « phraséophobes » (Gonzalez Rey 2010, 3), pour ce qui est de ce qu’un apprenant doit apprendre ou, de préférence, acquérir,7 en tenant compte de tous les paramètres afférents à la didactisation des EP.
Aussi le présent article portera sur les aspects clés qui devraient se situer au cœur de toute considération phraséodidactique. Il s’agira dans un premier temps de délimiter précisément les catégories d’EP qui sous-tendront toute réflexion didactique ultérieure (section 2). Il s’ensuivra une présentation de la compétence phraséologique préconisée par la phraséodidactique (section 3). À la suite d’une esquisse de collections de phrasèmes pour l’apprentissage des LE (section 4), les EP indispensables à la constitution d’une compétence phraséologique en LE seront présentées sur la base de considérations (phraséo)didactiques (section 5). Les types d’EP réservés à la compétence passive de l’AP-LE seront introduits en section 6. En guise de conclusion, des propositions relatives aux supports et aux méthodes adéquats à l’apprentissage institutionnel des EP seront esquissées (section 7).
2. Vers une classification des expressions préformées
2.1 La tradition des recherches phraséologiques
Nous fondons nos réflexions didactiques à propos de l’apprentissage-acquisition des EP sur la classification mixte de Burger (2010) qui intègre aussi bien les paramètres syntaxiques que sémantiques et pragmatiques (cf. 52), permettant de définir des catégories phraséologiques élémentaires (« Basisklassen ») et spécifiques (« Spezialklassen »). Il sera ponctuellement fait référence à la Typologie universelle des phrasèmes de Mel’čuk (2011), là où ses classes de phrasèmes, définies de manière a priori sémantique, concordent avec celles de Burger. Toutefois, étant donné que la classification de Burger, très largement répandue à travers l’Europe, semble avoir fait ses preuves et nous est familière, elle constituera le point de départ de nos réflexions. Burger différencie trois types d’expressions phraséologiques ou de phrasèmes selon les termes qu’il emploie :
Les phrasèmes référentiels, au centre du dispositif de Burger, désignent des objets, des procès ou des états de choses. On différencie les phrasèmes nominatifs, qui ont une valeur de syntagme ou de partie d’énoncé, des phrasèmes propositionnels possédant une valeur d’énoncé. Il existe trois classes de phrasèmes nominatifs : les expressions idiomatiques ou idiotismes dont le sens est sémantiquement non compositionnel voire opaque (passer l’arme à gauche, kick the bucket, den Löffel abgeben) ;8 les expressions partiellement idiomatiques avec une partie sémantiquement compositionnelle, l’autre non, p. ex. les phrasèmes comparatifs – fumer comme un pompier, smoke like a chimney, rauchen wie ein Schlot – où le verbe revêt son sens dictionnairique, la compréhension de l’élément de comparaison, qui sert de graduatif, relevant du savoir commun ou encyclopédique, et finalement les collocations dont le sens global représente la somme de la signification des unités lexicales les constituant (se laver les dents, brush one’s teeth, sich die Zähne putzen).9 Les phrasèmes propositionnels à valeurs d’énoncé comprennent trois classes : les proverbes sémantiquement non compositionnels (Tout ce qui brille n’est pas or. – All that glitters is not gold. – Es ist nicht alles Gold, was glänzt.), les lieux communs à sens compositionnel (Tout est bien qui finit bien ; All’s well that ends well ; Ende gut, alles gut) ainsi que les « phrases fixes » caractérisées par la présence d’un élément déictique exophorique (Ça c’est le comble/la meilleure ; That’s the last straw/That takes the biscuit ; Das schlägt dem Fass den Boden aus).
Les phrasèmes communicatifs, aussi intitulés formules de routine, idiomes pragmatiques ou pragmatèmes (Mel’čuk 2013), servent à réaliser des actes de langage dans de très nombreux domaines : en tant que salutations (au revoir, bye bye, auf Wiedersehen), excuses (pardon, I’m sorry, tut mir leid), remercie-ment (grand merci, thanks a lot, danke schön) ou félicitations (toutes mes félicitations, congratulations, herzlichen Glückwunsch), etc.10
Les phrasèmes structuraux permettent l’établissement de relations syntagmatiques du type et… et, ni…ni, aussi bien A que B en français ; sowohl… als auch, weder…noch, entweder…oder en allemand ; A as well as B, neither… nor, either… or en anglais. Nous considérons que chaque bonne grammaire répertorie ces structures dans le chapitre ‘conjonctions de coordination’ et nous dispensons de ce fait d’une discussion sur ce thème. En revanche, nous notons l’absence d’une recherche sur corpus de leur emploi.
D’un autre côté, Burger établit la catégorie des classes spécifiques (« Spezialklassen ») qui sont perpendiculaires aux catégories de base : les modèles phraséologiques (Quel + N ! : Quel bazar !; What a + N !: What a mess !; Was für ein + N : Was für ein Quatsch !) ; les binômes (peu ou prou, bel et bien ; by and large ; mit Kind und Kegel) ; les phrasèmes comparatifs (blanc comme un linge ; as white as a sheet ; weiß wie eine Wand) ; les kinégrammes (hausser les sourcils ; knit one’s brows ; die Stirn runzeln) ; les citations (célèbres) (L’homme est un loup pour l’homme (Plaute) ; to be or not to be… ; der Mohr hat seine Schuldigkeit getan)11 ; les phrasèmes onymiques à fonction de noms propres (la Croix Rouge ; the Red Cross ; das Rote Kreuz), mais aussi les termes phraséologiques dans le domaine du droit, de la philosophie, de la politique, etc., p. ex. l’impératif catégorique, the categorical imperatif, der kategorische Imperativ ; verser des dividendes, distribute the dividend, eine Dividende ausschütten.
La nature perpendiculaire de ces dernières implique qu’elles peuvent revêtir en même temps les caractéristiques des catégories de base et des classes spécifiques. Aussi blanc comme un linge serait un idiotisme partiel et en même temps un phrasème comparatif. Ou encore hausser les sourcils serait un kinégramme appartenant à la catégorie de base des idiotismes de par son caractère sémantiquement non compositionnel.
2.2 Élargissement du champ de recherche sur les EP – textes préformés, genres discursifs, constructions lexicogrammaticales
Cependant, la recherche actuelle sur les EP dépasse la classification phraséologique présentée. Il convient de mentionner d’une part les textes préformés (cf. Gülich 1997) tels les faire-part ou les remerciements au sein de thèses de doctorat, de lettres commerciales (renseignements, doléances), les notes de service ou les convocations qui revêtent une structure préformée, aussi bien au niveau langagier que de la mise en forme et du graphisme. La portée de la préformation textuelle est encore étendue par le concept des genres discursifs de Luckmann (1988), p. ex. les cérémonies de mariage, les procès en justice ou les examens oraux. Ces genres vont bien au-delà des énoncés ou des textes préfabriqués pour intégrer des suites d’activités communicatives ritualisées, se situant aussi au niveau multimodal, embrassant aussi bien la prosodie que le langage corporel, certaines configurations spatiales, peut-être tenant compte de tenues vestimentaires ou de repas festifs.
Même si la classification spécifique incluait d’ores et déjà des modèles phraséologiques, i. e. des cadres lexicogrammaticaux (cf. supra), c’est à la suite de l’article fondateur de Fillmore & Kay & O’Connor (1988)12 que la recherche sur les CONSTRUCTIONS, les « form-meaning-function-pairs », a pris un essor considérable. Les « formal idioms », i. e. les cadres syntaxiques plus ou moins lexicalement pourvus, dépassant ce qui a été auparavant traité en tant que modèle phraséologique, sont particulièrement enrichissants pour la didactique des langues étrangères.13 Des recherches sur corpus révèlent la présence récurrente d’un grand nombre de constructions lexicogrammaticales. Ce fait permet de conclure à un « entrenchment », un enracinement mémoriel chez les utilisateurs d’une langue qui sont en mesure de réactiver ces CONSTRUCTIONS en les adaptant à l’objectif communicatif et à la situation de communication. Une ‘construction’ se caractérise de la manière suivante (cf. Schmale 2020) :
Elle est polyfactorielle, c’est-à-dire déterminée par des facteurs (morpho)syntaxiques, lexicaux, prosodiques, corporels, co- et contextuels, etc. Même si elle est le plus souvent composée de plus de deux unités lexicales, elle peut être monolexicale, ceci pourrait être le cas pour l’emploi de participes, d’adverbes ou de substantifs utiles à la formulation d’injonctions, p. ex. Assis ! Assez ! Silence ! liant une unité monolexicale à une fonction.
Elle est employée sous une forme conventionnalisée, reconnaissable sur la base d’un dénominateur minimal, sans être totalement figée. Sa forme d’utilisation récurrente est déterminée par des études fondées sur de grands corpus qui en établissent l’usage. Elle est le plus souvent sémantiquement compositionnelle, par suite facilement décodable, mais, comme les collocations, aucunement automatiquement encodable sous la forme majoritairement réalisée.
Elle possède un caractère à la fois cognitif et conceptuel, conséquemment une forme de base correspondant à une combinaison syntaxe-lexique-fonction mémorisée. Elle doit toutefois être mise en œuvre au sein de contextes langagiers pouvant nécessiter des adaptations, et est sujet à des modifications ou changements.
En outre, les CONSTRUCTIONS sont de nature interactive et par là-même émergente, processuelle et dialogique, n’équivalent donc pas à un « produit prêt à l’emploi » qui serait le fait du seul locuteur. Les constructions collaboratives d’un seul énoncé par deux interlocuteurs constituent par excellence l’exemple de l’interactivité de la production langagière et, en même temps, de l’existence d’une forte prévisibilité de certaines structures langagières. Il s’agit là d’un cas idéal d’interactivité. Toutefois, celle-ci joue systématiquement un rôle car chaque énoncé se trouve dans un environnement séquentiel comportant des activités précédentes et suivantes du partenaire d’interaction, et parallèlement dans un contexte thématique, qui tout comme la situation de communication peut avoir une incidence sur la forme émergente de la CONSTRUCTION en surface de la communication. Les CONSTRUCTIONS sont dotées par conséquent d’une structure plus ou moins prévisible qui n’est pas pour autant figée.
Comme indiqué, que ce soit en linguistique ou en didactique, la recherche sur les CONSTRUCTIONS est en plein essor (cf. p. ex. Gonzalez Rey, dir., 2015). En voici quelques exemples :
La ‘construction’ « réponse dubitative » – [pronom personnel + GN ou verbe] : Lui avocat ? Moi abandonner ? Elle s’excuser ?
La ‘construction’ « exclamation/emphase » – [qu’est-ce que c’est + Adj !] : Qu’est-ce que c’est bête/nul/idiot/moche !
La ‘construction’ « expression du désespoir, de l’emphase » – [c’est à + infinitif + complément !] : C’est à désespérer/pleurer/à se taper la tête contre le mur ! C’est à mourir de rire !
La ‘construction’ « mécontentement/reproche » – [qu’est-ce qu’il a à + infinitif ?] : Qu’est-ce qu’il a à me regarder comme ça ? Mais qu’est-ce qu’il a à vouloir tout changer ? Qu’est-ce qu’elle a à pleurer comme ça ?
Ces exemples ont ici pour seule vocation d’illustrer des types de CONSTRUCTIONS possibles en faisant abstraction de leur pertinence dans l’apprentissage du FLE ; il s’agit tout simplement de démontrer des exemples de combinaisons lexicogrammaticales composées de cadres syntaxiques et d’éléments lexicaux aussi bien fixes que libres. Dans nos travaux, nous partons de phénomènes langagiers de l’allemand, particulièrement difficiles à maîtriser par l’apprenant francophone, afin de les décrire de manière « corpus-based », p. ex. l’emploi des verbes de modalité sollen et müssen (devoir en français pour les deux), du passif processuel et bilan à l’aide de werden et sein (à nouveau un seul verbe – être – en français pour exprimer les deux) ou encore de la particule modale denn (pas d’équivalent lexical en français) (cf. Schmale, à par. b).
3. La compétence phraséologique préconisée par la phraséodidactique
A l’instar de Bally, qui a attiré l’attention sur la question dès 1909 (cf. supra),14 de nombreux phraséologues et didacticiens insistent sur la nécessité de l’apprentissage des expressions phraséologiques. Choisissons comme point de départ l’assertion suivante de Mel’čuk (1993) :
Un natif parle en phrasèmes. Si ce postulat crucial est accepté, et nous l’acceptons, il apparaît alors clairement que l’apprentissage systématique des phrasèmes est indispensable dans l’enseignement d’une langue, que ce soit la langue maternelle de l’apprenant ou une langue étrangère, et indépendamment de l’âge ou du niveau d’éducation de l’apprenant (Mel’čuk 1993, 84).
Sans qu’il ne soit utile et possible d’effectuer une analyse détaillée de cette citation, il s’impose néanmoins de clarifier certains points relatifs à la didactisation des EP face aux suppositions, qui sous-tendent nombre de travaux dans le champ de la phraséodidactique, et qui nécessitent un regard critique, approfondi et différencié relatif aux formes de préformation langagière pertinentes pour l’apprentissage d’une langue étrangère (= LE) :
Le postulat stipulant qu’un « natif parle en phrasèmes » doit être nuancé. S’il n’y a aucun doute que tout locuteur natif (= LN) recourt à des phrasèmes, dont il faudrait toutefois obligatoirement spécifier la nature en amont, toutes ses productions langagières ne sont pas pour autant régies exclusivement par le « idiom principle » de Sinclair (1991).
The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semi-preconstructed phrases that constitute single choices, even though they might appear to be analysable into segments (Sinclair 1991, 110).
Un locuteur peut et doit également recourir au « open choice principle » qui lui permet de construire un énoncé « librement », tout en appliquant règles et dictionnaire. Les études sur grands corpus établissant dans quelles proportions les locuteurs s’appuient réellement sur la préformation langagière sont à ce jour insuffisamment développées ou encore non régies par des critères bien distincts (cf. supra).
En même temps, il est primordial de procéder à une étude différenciée, fondée sur des corpus suffisamment larges et variés, des catégories de phrasèmes mis en œuvre dans la communication, tout en prenant en compte leur emploi à l’écrit ou à l’oral, du type de texte, du thème traité, de la situation de communication, de l’âge du sujet parlant, etc. Tous les phrasèmes ne se situent pas au même niveau d’importance communicative : il y a des EP indispensables et d’autres qui le sont moins ou pas du tout, ni pour le LN ni pour le LNN ! Il faudrait dès lors délimiter les « tournures » véritablement incontournables à l’aide d’études de corpus suffisamment larges.
Il est en outre pédagogiquement inconcevable de mettre sur le même plan l’apprentissage de la langue maternelle en contexte naturel et l’apprentissage d’une langue étrangère en contexte institutionnel. Indépendamment de la nécessité de conditions vraiment exceptionnelles pour permettre à un non-natif d’atteindre un niveau de (quasi) natif,15 il n’est pas forcément souhaitable qu’un non-natif essaie de s’exprimer comme un natif pour des raisons qui seront développées plus avant.
Probablement influencé par des travaux tel celui cité de Mel’čuk, le Cadre Européen de Référence pour les Langues (CERCL – Conseil de Europe, 2001) préconise à partir du niveau C1 une « [b]onne maîtrise d’expressions idiomatiques et familières. » (id., 88) dans le cadre des « compétences lexicales » à développer chez l’AP-LE. On y distingue, sans fournir de définition distincte, « expressions toutes faites » et « locutions figées » :16
« expressions toutes faites » : « indicateurs des fonctions langagières,17 les proverbes, les archaïsmes » (id., 87) ;
« locutions figées » : « métaphores figées, procédés d’insistance,18 des structures figées apprises et utilisées comme des ensembles […], d’autres expressions figées verbales (faire avec…) ou prépositionnelles (au fur et à mesure), des collocations figées (faire un discours) » (id., 88).
Le CERCL pourrait avoir eu une incidence sur de nombreux travaux en phraséodidactique dont ci-après deux citations, l’une émanant d’une germaniste, l’autre d’une spécialiste du FLE :
Nous sommes convaincus que la phraséologie mérite une place attitrée dès les premiers stades de l’apprentissage d’une langue […]. Le développement systématique de la compétence – passive comme active – phraséologique est nécessaire afin d’atteindre le but déclaré de l’enseignement des langues étrangères, notamment la compétence communicative […] (Jesenšek 2006, 138 ; notre traduction libre de l’allemand).
La phraséodidactique cherche sa place dans la didactique des langues vivantes en misant sur l’enseignement des expressions figées en tant qu’éléments incontournables du discours. S’appuyant sur le principe qui soutient que seule la maîtrise de ces tournures déclare un locuteur performant en langue étrangère, elle préconise de les introduire dans les méthodes pédagogiques au même titre que le reste des items à apprendre dès le début de l’apprentissage (González Rey 2010, 1).
Or ce qui fait défaut dans toutes ces approches, c’est un traitement véritablement différencié des différentes manifestations d’EP indiquant quels types de « phrasèmes », de « tournures », d’« expressions figées », etc., un apprenant doit acquérir et à quel stade de son apprentissage de la LE,19 pour poursuivre ses objectifs communicatifs sur quel thème et dans quelle configuration sociale, pour ne nommer que quelques éléments essentiels relatifs à l’emploi des EP.
4. Les phrasèmes retenus par les collections existantes
Permettre à l’AP-LE de développer une compétence langagière véritablement opérationnelle nécessite non seulement de procéder en fonction de ses futurs besoins langagiers et communicatifs, mais également en fonction de ses capacités langagières. Aussi le choix des structures lexicogrammaticales mises à sa disposition doit se fonder sur ce qui est absolument nécessaire à la mise en œuvre des stratégies communicatives à sa portée au moment x et non pas sur les éventuelles expressions dont un locuteur natif « équivalent » disposerait. En outre, indépendamment du fait évoqué stipulant que la compétence du LNN ne peut en aucun cas se mesurer à la compétence d’un LN, une étude empirique sur fond de grand corpus de l’usage des EP fait à ce jour défaut.
On constate toutefois que les expressions idiomatiques recueillies dans les collections de phrasèmes et les dictionnaires spécialisés figurent très rarement dans les grands corpus écrits et notamment oraux. Siepmann & Bürgel (2019) démontrent, sur la base du vaste Corpus de Référence du Français Contemporain (CRFC) que les idiotismes sont négligeables d’un point de vue quantitatif. En revanche, les bigrammes du type un peu, parce que, par exemple, en plus, etc., sont très fréquents. On peut vraisemblablement dresser un constat identique pour l’anglais:
[…], a corpus search of the final total of 103 ‘core idioms’ was carried out in the British National Corpus (BNC). The search revealed that none of the 103 core idioms occurs frequently enough to merit inclusion in the 5,000 most frequent words of English (Grant 2005, 429).
Quant à nos propres recherches sur l’allemand, elles révèlent que l’emploi des expressions idiomatiques rassemblées dans les listes du type Phraseologisches Optimum ou Minimum est extrêmement limité dans les corpus oraux (cf. Schmale 2009). Serait-il logique de transmettre à des apprenants non-natifs des idiotismes auxquels les locuteurs natifs eux-mêmes ne font guère appel ?
Il s’impose de ce fait de déterminer tout d’abord les types d’EP à transmettre à l’AP-LE. Si on regarde les collections et répertoires d’expressions phraséologiques existants destinés aux LE, on a toutefois l’impression que les auteurs visent à transmettre au non-natif une compétence communicative proche de celle du locuteur natif capable de maitriser « idéalement » tout le lexique de sa langue maternelle. Aussi met-on l’accent sur l’apprentissage des expressions idiomatiques, sémantiquement celles sans aucun doute les plus riches, mais également les plus difficiles à manier adéquatement compte tenu des nombreuses connotations et conditions d’utilisation – de surcroît toujours encore insuffisamment décrites par les dictionnaires. Bardosi et al. (2003, 50) listent par exemple l’idiotisme « prendre/ramasser/remporter une veste (fam.) : subir un grave échec <surtout dans une compétition> », traduit en allemand par « keinen Erfolg haben ; mit etwas hereinfallen ; scheitern ; einen Reinfall erleben ; eine Schlappe einstecken » et donnent comme équivalent stylistique allemand « auf die Nase fallen (ugs.) ».20 Or on déplore le manque d’exemples illustratifs tout comme d’indications nécessaires pour qu’un non-natif puisse s’approprier avec succès un tel idiotisme. De plus, il n’est pas certain que l’équivalent allemand fourni soit vraiment adéquat. Une description exhaustive de toutes les caractéristiques de cet idiotisme s’imposerait en fonction des occurrences détectées au sein d’un grand corpus de communications en contexte naturel.
A l’instar de la collection d’idiotismes (assortie d’exercices d’application) de Bardosi et al. (2003) pour le français, plusieurs tentatives ont été effectuées afin de rassembler des répertoires d’EP du type « phraseologisches Optimum » (cf. Hallsteinsdottir et al. 2006, 133-136)21 pour l’allemand, regroupant les 143 expressions phraséologiques considérées comme les plus importantes pour l’AP-LE.22 Pour le français, on note les compilations d’idiotismes de Gonzalez Rey (2018), Galisson (1984 ou 1991), ou encore, pour l’anglais, celles du Cambridge International Dictionary of Idioms (McCarthy & Walter 1998). Toutefois, sans pouvoir mener ici une discussion approfondie quant à la méthodologie employée et la subséquente validité empirique des listes de phrasèmes proposées, il convient de soulever certains points qui mettent en doute leur pertinence générale dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères :
Il n’est pas certain que des corpus de manifestations langagières en contexte naturel soient à l’origine des phrasèmes retenus, par conséquent, que les phrasèmes listés soient véritablement les plus fréquemment employés et, surtout, les plus utiles pour l’apprenant d’une LE. En effet, il est avéré que la sélection des locutions du Duden 11 (Dudenredaktion 2013) est intégralement fondée sur un énorme corpus écrit faisant toutefois abstraction de la langue orale, trop difficile à intégrer dans sa spécificité selon la responsable de la rédaction.23
De surcroît, si on a eu recours à des corpus, ces derniers, comme celui du Duden 11, sont le plus souvent d’ordre écrit, provenant de genres textuels particulièrement riches en phrasèmes tels les articles issus de la presse, les publicités ou les productions littéraires. On peut alors se demander si ce sont là des EP à la portée d’un AP-LE, même d’un niveau avancé. Ne faudrait-il pas plutôt – tout au moins à la même échelle que l’écrit – étudier des corpus oraux d’autant plus que les instructions officielles pour les LE stipulent une priorité de l’oral ? L’emploi langagier que ce soit aux niveaux syntaxique, lexical, textuel de la langue parlée, en particulier dialogique, diffère dans une large mesure de la langue écrite. Il en résulte que la recherche linguistique et didactique doive obligatoirement en tenir compte !
En outre, la majorité des phrasèmes retenus au sein des collections évoquées sont des expressions idiomatiques imagées alors que leur adéquation à la compétence du locuteur non-natif mérite réflexion ; nous y reviendrons.
5. EP indispensables à la compétence communicative du locuteur non-natif
Nous partons du constat que la compétence phraséologique du locuteur natif n’a à ce jour pas encore été évaluée de manière véritablement différenciée selon l’âge, le thème traité, le registre, la situation, etc. Indépendamment du fait que la compétence phraséologique de l’AP-LE ne pourrait en aucun cas s’inspirer de celle d’un locuteur natif compétent, nous ne disposons donc pas de données de comparaison pouvant servir à la détermination de types et de « tokens » de phrasèmes ou d’EP à transmettre à l’AP-LE. En se fondant sur les développements des sections 2, 3 et 4 de la présente contribution, on peut néanmoins affirmer l’importance de situer au centre de l’apprentissage d’une langue étrangère les types suivants : les formules de routine (5.1), les collocations (5.2) et les CONSTRUCTIONS (5.3) (y compris les phrasèmes structuraux).
5.1 Les formules de routine
Dès le début de l’apprentissage d’une LE, c'est-à-dire sans attendre un niveau intermédiaire (B1 ou B2) ou même avancé (C1 ou C2), il est indispensable de familiariser l’apprenant avec les formules de routine, les phrasèmes communicatifs, les pragmatèmes, vitaux à l’exécution de multiples actes de parole nécessaires et irremplaçables afin d’interagir de manière adéquate dans pratiquement toutes les situations de communication récurrentes. Ces formules de routine primordiales pour saluer, remercier, s’excuser, féliciter, se renseigner, etc., sont normalement des formules conventionnalisées et attendues (cf. Coulmas 1981 pour une nomenclature très développée des formules de routine). Ce dernier différencie les types suivants dont le caractère distinctif resterait à prouver :24
les formules de gestion discursive englobant les formules de salut, d’accueil, d’introduction et d’ouverture (bonjour, salut, bienvenue, j’ai l’honneur de vous accueillir au 30e congrès de l’association…) ; d’interpellation (excusez-moi, un instant svp, hé ho…) ; de défense du droit de parole (je termine, j’en ai pour deux minutes, encore deux phrases) ; de reprise de la parole (je reprends, j’en étais où ?, continuons…) ; de clôture, de prise de congé (au revoir, salut, je clos la séance, on s’arrête là pour le moment…) ;
les formules de politesse comprenant celles destinées au respect des conventions (toutes mes condoléances, félicitations, je suis désolé, pardon, bon appétit, nous avons l’immense tristesse de vous annoncer…) ; les formules d’adresse (monsieur le proviseur, chère x, madame/monsieur…) ; des formules d’atténuation (si je puis dire, on va dire, sans vouloir être offensant…) ; les cadres d’actes de parole indirects (pourriez-vous… ?, serait-il possible… ?, puis-je me présenter, auriez-vous l’amabilité… ?) ;
les formules métadiscursives de commentaire (comme dirait l’autre, le soi-disant, pour le dire franchement…), de correction (ou plutôt…, pardon…) et celles qui assurent la compréhension (pardon ? c’est clair ? tu peux répéter ? ok ?) ;
les formules signalant l’émotion ou l’état d’esprit du locuteur regroupant les formules d’évaluation positive du thème traité (c’est super, etc. ! génial ! j’adore !) ou encore les formules négatives (je suis dans le regret de te dire, ce n’est pas vrai ! c’est nul, etc. !) ;
les formules d’hésitation se divisant en trois types : les locutions adverbiales interrogatives, les « tag questions » (hein ? n’est-ce pas ? non ?) ; les signaux de réception (absolument ! tout à fait ! je suis d’accord avec toi ! pas du tout !…) ; les formules « bouche-trous » pour combler une éventuelle pause (euh, n’est-ce pas, comment dirais-je, bon ben…).
Il va de soi que ces pragmatèmes, appartenant majoritairement au registre oral, mais pas exclusivement, ne sont pas indistinctement destinés à l’AP-LE. D’une part, il convient de déterminer les phrasèmes communicatifs nécessaires en fonction des activités ou situations communicatives à réaliser, d’autre part, ces dernières sont à décrire sur la base d’études de corpus ciblés afin d’en saisir toutes les conditions d’utilisation. Il s’avère en effet que les dialogues des manuels sont encore trop souvent fondés sur les intuitions des auteurs, et non pas sur une étude de corpus de conversations en contexte naturel (cf. p. ex. Schmale 2004) ce qui permettrait le développement de situations correspondant à la réalité communicative.
Un dialogue du manuel Atelier A1 (Cocton et al. 2019) et quelques pragmatèmes permettant la réalisation de la fonction saluer quelqu’un doivent suffire pour démontrer que les formules de routine ont leur place dès les premières étapes de l’apprentissage. Au sein de l’unité « S’exprimer poliment », les auteurs présentent, sous forme audio, le mini-dialogue suivant, que nous avons transcrit, qui comprend les formules bonjour, excusez-moi, s’il vous plaît, voilà, merci, je vous en prie, et qui est presqu’intégralement composé d’EP :25
Au Café (C = cliente; S = serveur)
C Un café
S Bonjour
C Euh, excusez-moi, un café s’il vous plaît
S Et voilà !
C Merci
S Je vous en prie
(Cocton et al. 2019, 26)
Ou encore dans l’unité « Souhaiter quelque chose à quelqu’un » (id., 40) où les pragmatèmes Bonne journée/soirée/nuit ; Bonne chance/courage ; Bonne année/santé/fête ; Bon voyage/vacances ; Joyeux anniversaire/Noël ; Bon appétit sont introduits.
Étant donné le fait que ces formules ne peuvent en aucun cas être remplacées par des structures non phraséologiques, construites librement selon un « open choice principle », elles se situent au cœur de l’apprentissage d’une LE dès le début.
5.2 Les collocations
Le constat dressé pour les formules de routine vaut également pour les collocations, les combinaisons lexicales usuelles et conventionnalisées, indispensables pour s’exprimer adéquatement dans une langue.26
Une collocation est un phrasème lexical semi-contraint : une de ses composantes est sélectionnée par le locuteur librement, juste pour son sens ; c’est l’autre qui doit être choisi en fonction du sens à exprimer et de la première composante. La première composante s’appelle la base de la collocation […], et l’autre est le collocatif […] (Mel‘čuk 2013, 7).
Tout comme Burger (2010), Mel‘čuk (2013, 7)27 considère les collocations, dont le nombre est d’après lui « astronomique […] : quelques millions » (id., 9), comme phrasèmes lexicalement compositionnels dont la base est en règle générale un groupe nominal et le collocatif un verbe, moins souvent un adjectif (gravement malade) ou un autre substantif (salve d’applaudissements). Cependant, Hausmann (1997, titre), qui postule que « [T]out est idiomatique dans les langues » pour l’AP-LE, différencie décodage, a priori transparent pour le non-natif, et encodage d’une collocation28 qui ne l’est pas du fait que le collocatif relève d’un choix arbitraire le plus souvent différent de la langue maternelle de l’apprenant. Si un apprenant sélectionne donc le verbe de la collocation de la langue cible en traduisant celui de sa propre langue, il est souvent induit en erreur.29 S’il est (très) rare que le français, l’allemand et l’anglais disposent du verbe correspondant dans l’autre langue, il existe cependant des exceptions p. ex. avoir l’impression/den Eindruck haben/have the impression ou encore perdre (le) contrôle/die Kontrolle verlieren/lose control. Plus fréquemment, les trois langues recourent à trois verbes différents ou encore deux des langues emploient un verbe similaire, la troisième un lexème autre (cf. tableau 1).30
| Françaises | Allemandes | Anglaises |
| Trois verbes différents | ||
| se laver les dents | sich die Zähne putzen | brush one’s teeth |
| prendre une décision | eine Entscheidung treffen | make a decision |
| prendre contact | sich in Verbindung setzen | get in touch |
| toucher à sa fin | zu Ende gehen | come to an end |
| taper sur les nerfs | auf die Nerven gehen | get on one’s nerves |
| donner l’alerte | Alarm schlagen | raise the alarm |
| suivre les conseils de quelqu’un | einen Rat befolgen | take someone’s advice |
| Verbe similaire dans deux langues, différent dans la 3e | ||
| faire sa valise | die Koffer packen | pack one’s bags/suitcases |
| prendre un risque | ein Risiko eingehen | take a risk |
| mettre en danger | in Gefahr bringen | put into danger |
| avoir une conversation | ein Gespräch führen | have a conversation |
| faire des efforts | sich Mühe geben | make an effort |
| mettre/jeter en prison | ins Gefängnis werfen | put into prison |
| ouvrir grand la porte | die Tür weit öffnen | throw the door wide open |
| serrer la main | die Hand schütteln | to shake hands |
Tab. 1 : Collocations divergentes en français, allemand, anglais
Il n’est par conséquent guère surprenant que les apprenants rencontrent, même à un niveau universitaire après quelque dix années d’apprentissage d’une LE, des difficultés pour ce qui est du choix du bon verbe dans leurs productions langagières en LE. De toute évidence, ils n’ont pas appris la combinaison d’un GN avec un verbe spécifique en tant que choix conventionnalisé, quasi fixe, et font l’erreur de choisir un verbe correspondant à celui de leur langue maternelle.
Lüger (2019, 70) préconise de ce fait une introduction des collocations au premier stade de l’apprentissage de LE, une décision totalement logique car une collocation doit s’apprendre en tant que EP polylexicale plus ou moins figée devant être mémorisée d’emblée. Une traduction du verbe de la langue maternelle dans une collocation de la LE s’explique probablement par un non-respect de ce principe qui induit l’apprenant à un recours injustifié à sa propre langue.
Bénigno et al. (2015) considèrent que l’enseignement des LE attache insuffisamment d’importance à l’apprentissage des collocations faisant pourtant partie du « noyau lexical ».
L’apprentissage des collocations fait partie des acquisitions langagières défaillantes des programmes à tous les niveaux d’enseignement et d’apprentissage du FLE, qu’ils soient imposés ou non. En effet, absentes des manuels, des dictionnaires, des grammaires au niveau débutant, intermédiaire, voire avancé, les collocations sont une partie non négligeable du langage quotidien employé ; elles font partie du noyau lexical, c’est-à-dire du vocabulaire fondamental dont chaque locuteur dispose pour ses actes communicatifs, élémentaires et quotidiens (id., 83).
L’espace nous manque pour discuter de cette affirmation qui semble surprenante face à l’existence de maints dictionnaires et collections dans les trois langues citées.31 Une étude de manuels existants s’avérerait nécessaire pour l’étayer.
D’un autre côté, Benigno & Kraif (2016) soulignent à très juste titre que la fréquence ne doit pas être le seul critère guidant le choix des collocations à enseigner aux non-natifs, l’utilité communicative pour l’apprenant et la dispersion à travers différents types de conversation d’un corpus étant des critères tout aussi importants. Il se pourrait qu’une collocation soit extrêmement fréquente dans un nombre plus ou moins limité des conversations d’un corpus et soit considérée comme quantitativement fréquente, tout en étant absente d’une majorité des autres. Ou encore, il se pourrait qu’une collocation soit très utile au sein de situations qu’un AP-LE est amené à rencontrer, comme prendre rendez-vous, et soit très peu représentée au sein d’un corpus. Il en découle que les procédures quantitatives de la linguistique de corpus ne s’avèrent pas suffisantes afin de décrire les collocations, bref : les EP en général, utiles à l’AP-LE. Il est indispensable de les compléter par celles nécessaires à la maîtrise de situations de communication récurrentes auxquelles un locuteur non-natif sera confronté. En attendant un relevé systématique à travers de larges enquêtes, on pourrait peut-être consulter les manuels récents et déterminer s’ils ont bien pris en compte les collocations les plus pertinentes.
5.3Les CONSTRUCTIONS
Mises à part les formules de routine, étroitement liées à des situations de communication, et les collocations, les combinaisons lexicales usuelles, l’apprentissage de constructions lexicogrammaticales s’avère extrêmement efficace pour l’AP-LE, et représente même, à notre sens, l’avenir de la didactique des LE (cf. supra, pt. 2.2., pour une définition).
Bien que les approches phraséologiques fissent d’ores et déjà état des modèles phraséologiques, c’est-à-dire des cadres lexico-syntaxiques du type ‘x c’est x’ (la retraite c’est la retraite ;32 Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps ;33 money is money), c’est à la suite des travaux séminaux de Fillmore & Kay & O’Connor (1988) et de Goldberg (1995) sur la grammaire de construction, que la recherche sur les « form-meaning-function-pairs » a pris un essor remarquable. Si les « substantive idioms » dont « lexical make-up is […] fully specified » correspondent grosso modo aux expressions phraséologiques connues, les « formal idioms » sont des cadres lexicosyntaxiques plus ou moins lexicalement pourvus qui dépassent le périmètre des modèles phraséologiques. La linguistique de corpus, effectuant ses recherches sur la base de grandes collections de manifestations langagières en contexte naturel, révèle qu’il existe un nombre considérable de constructions lexicogrammaticales convoquées de manière récurrente par les utilisateurs d’une langue. On peut de ce fait partir du principe qu’elles sont enracinées en tant que structures mémorielles cognitives prêtes à être réactivées au besoin, afin de poursuivre des objectifs communicatifs dans des situations de communication avec tout ce qu’elle implique (relation sociale avec l’interlocuteur, niveau stylistique).
Les CONSTRUCTIONS jusqu’aujourd’hui décrites par la recherche, p. ex. la construction « réponse dubitative » du type Lui avocat ? Moi abandonner ? Elle s’excuser ? ou encore la construction « expression du désespoir », C’est à désespérer/pleurer/se taper la tête contre le mur !34 ne semblent guère destinées à l’apprentissage par un AP-LE, à moins que ce dernier n’ait atteint un niveau de « near native ». Aussi nous proposons en guise de première étape d’étudier les 34 modèles phrastiques du Duden 4 (« Satzbaupläne » ; Dudenredaktion 2009, 922-924)35 pour l’allemand, notre domaine de recherche principal, ou encore des modèles valenciels, dans de grands corpus conversationnels en essayant de relever l’éventuelle présence récurrente de certaines unités lexicales dans les « slots » de la structure syntaxique en question. Nous avons la conviction qu’il existe virtuellement pour chaque modèle des réalisations lexicales récurrentes qui pourraient servir de base à la didactisation. En même temps, l’approche orientée vers les corpus permettrait la description des conditions d’utilisation en contexte naturel, indispensable pour tout futur usage par l’apprenant non-natif.
Pour l’instant, nous avons entrepris la définition de phénomènes langagiers de l’allemand, particulièrement difficiles à maîtriser pour l’apprenant français, sous forme de CONSTRUCTIONS, choisissant une approche semi-inductive. Il s’agit des trois structures suivantes :
Les verbes de modalité sollen et müssen dont l’emploi différencié pose des problèmes majeurs même à des apprenants d’un niveau (très) avancé, sans doute du fait que le français ne dispose que d’un seul verbe, devoir, pour exprimer le sens des deux, différenciant l’obligation que le locuteur s’impose lui-même en raison de contraintes situationnelles et l’obligation imposée par un tiers (cf. Schmale, 2012a). D’une étude de corpus résultent trois CONSTRUCTIONS élémentaires avec müss- et soll- (cf. ibid.) :
(1) – müssen pour l’expression d’une obligation qui découle de la situation et/ou que le locuteur s’impose, la trace d’une tierce instance étant absente : [pronom personnel + muss-/müss- + infinitif ou groupe prépositionnel] : Ich muss einkaufen/arbeiten/lernen//in die Uni/ins Bett/zur Arbeit. La forme interrogative est possible.
(2) – sollen à l’indicatif afin d’exprimer l’obligation émanant d’une tierce instance (personne, légale, morale, religieuse) imposée au destinataire désigné par le pronom personnel, la trace du tiers étant présente en cotexte ou contexte immédiat : [(appellatif ou verbe introductoire) + pronom personnel + soll- + (adverbes) + (G Prép) + infinitif] : Peter, (deine Mutter hat gesagt), du sollst sofort nach Hause kommen ; Der Vater sagt zu den Kindern : Ihr sollt jetzt endlich ins Bett gehen. La forme interrogative est possible afin de s’enquérir de la volonté d’un tiers.
(3) – sollt- au subjonctif II pour donner ou demander des conseils à la forme affirmative ou négative : [pron. pers. + sollt- + (nicht) + (GN/G Prép./adv., etc.) + infinitif + !], Du solltest abends früher ins Bett gehen ! Ihr solltet nicht so viel trinken! La demande de conseil est possible avec le verbe en première position.
Le passif processuel [werden + participe II] et le passif bilan [sein + participe II] pour lesquels le français n’emploie à nouveau qu’un seul verbe, i.e. [être + participe II] (cf. Schmale 2016). Sans doute en raison d’une traduction à partir du français, les locuteurs non-natifs confondent, même après 10 ans d’apprentissage de l’allemand, les deux formes. Ce danger serait écarté si on enseignait, sans recours à des explications grammaticales théoriques et surtout à la traduction, des constructions lexicogrammaticales avec le passif processuel. Une étude de corpus révèle que le passif bilan est extrêmement rare et peut sans risque être remplacé par le passif processuel dans la plupart des cas. Le modèle fondamental suivant serait en conséquence suffisant jusqu’à un niveau avancé : [NPpron./Det+n + werd- + {comp.} + part. II], p. ex. Sie/die Schülerin wird vom Bahnhof abgeholt.
La particule modale denn, sans équivalent lexical en français, est destinée de prime abord à obtenir une réponse approfondie relative à une première information insuffisante et, à condition que cette première condition soit donnée, à atténuer la force illocutoire de la question (cf. Schmale, à par. b). Il s’avère que cette particule est trop souvent didactisée de manière erronée et utilisée à mauvais escient quasi systématiquement et indistinctement pour toutes les questions, même en position initiale d’une séquence d’échange, alors qu’aucune connexion avec une information précédente n’est présente. D’une étude sur corpus résultent six types majeurs de CONSTRUCTIONS avec denn, la première étant [was + sei-/hab-/soll + {comp1} + denn + {comp2}], p. ex. was ist/war denn das ? L’étude de 326 occurrences (sur 1056 sélectionnées de manière aléatoire par AntConc) permet en outre de décrire des facteurs d’utilisation (morpho)syntaxiques, sémantiques, prosodiques, pragmatiques, discursifs et non verbaux, plus ou moins étroitement liés à l’emploi de la particule.
6. Expressions préformées réservées à la compétence passive de l’AP-LE
Comme démontré (cf. pt. 3.), nombre de linguistes et de didacticiens prônent la nécessité d’enseigner des phrasèmes de tous genres dès les stades initiaux de l’apprentissage d’une LE sans différencier compétence réceptive et productive.36 En renvoyant à nos réflexions antérieures (cf. Schmale 2012b et 2014 en particulier), nous résumons ci-après les points essentiels guidés par notre conviction que les proverbes, lieux communs, expressions même partiellement idiomatiques, mais aussi certaines formules de routine ne sont pas destinés à la compétence active de l’AP-LE, peu importe le niveau de maîtrise de la langue en question. Voici un rappel des trois arguments principaux :
Il n’existe pas à ce jour de preuve empirique démontrant que les locuteurs natifs d’un âge correspondant à celui des apprenants, aient massivement ou même régulièrement recours aux types de phrasèmes « incriminés » dans les types discursifs pertinents pour l’AP-LE. Bien au contraire, leur emploi des proverbes, idiotismes et autres lieux communs dans la conversation « de tous les jours » est statistiquement négligeable (cf. pt. 4). Pourquoi enseigner à des LNN ce que les LN n’utilisent pas et, très souvent, ne connaissent même plus ?
La maîtrise des conditions d’utilisation et des nombreuses connotations des expressions idiomatiques en particulier, absolument indispensable pour un emploi adéquat des phrasèmes,37 ne peut être acquise dans un environnement institutionnel artificiel face aux nombreuses modalités d’emploi à respecter. De surcroit, ces conditions et connotations semblent aujourd’hui insuffisamment recherchées sur la base de manifestations langagières en contexte naturel au sein de grands corpus. Mis à part le fait que l’on ne dispose pas d’acquis empiriques quant à la fréquence d’utilisation en différenciant le type de locuteur, de situation, de thème, la description linguistique des modes d’emploi prenant en compte systématiquement tous les facteurs (morpho)syntaxique, prosodique, sémantique, pragmatique, discursif, co- et contextuel, etc., fait défaut.
Afin d’étayer notre jugement, prenons un exemple tiré de l’ouvrage de Bardosi & Ettinger & Stölting (2003, 88), où l’on trouve dans la rubrique « conversation » les expressions idiomatiques imagées : « parler dans sa barbe » (no. 12) accompagnée de l’explication « ~ à voix très basse et de manière indistincte » ; ou encore « tailler une bavette (fam.) » définie en tant que « bavarder » (id., 89). Dans les deux cas, on ne mentionne ni le niveau stylistique, ni les connotations, ce qui peut être surtout préjudiciable dans le deuxième cas, ni le type de situation accueillant un tel énoncé. Un AP-LE qui emploierait tailler une bavette à la place de bavarder serait certainement induit en erreur. Rares sont les cas où une explication dictionnairique suffirait pour garantir un usage adéquat d’un idiotisme par un AP-LE, même si la définition fournie permettrait la compréhension en contexte.
Or même si des descriptions exhaustives, fondées sur des études de grands corpus, existaient, une sérieuse réserve devrait être opposée à l’emploi des phrasèmes « incriminés » par des AP-LE peu importe leur niveau langagier, à moins qu’ils ne soient véritablement bilingues, statut difficilement atteignable par le biais d’un apprentissage en contexte scolaire. La raison réside dans l’existence de « culturèmes » (cf. Poyatos 1976 et Oksaar 1988), des types de comportement spécifiques au sein d’une culture. Alors qu’il semble exister des activités fortement attendues – les formules de routine, la correction grammaticale, les manières à table, les activités non verbales (distance, embrasser, serrer la main), etc. –, d’autres seraient réservées aux locuteurs natifs et rejetées voire même sanctionnées si produites par le non-natif. Les proverbes, lieux communs et idiotismes métaphoriques font partie de ces culturèmes réservés aux LN. Ces expressions fortement imagées et marquées pourraient en effet appartenir au domaine des culturèmes dont l’emploi par un LNN, peu importe son niveau de maîtrise, susciterait la prise d’une « position haute » sous forme de commentaires ou, au pire, de réactions négatives. Aussi Dobrovol’skij & Lubimova (1993) constatent :
En tant que locuteur non-natif on doit jouer un double jeu selon le principe : Je me sens chez moi dans cette culture tout en acceptant qu’il s’agit pour moi d’une culture étrangère (id., 156 ; notre traduction).
Bref, le LNN ne doit à aucun moment prétendre faire partie de la culture de son pays d’accueil, recourir à des phrasèmes idiomatiques prétendrait à une assimilation culturelle qu’un LN, peu importe son propre niveau langagier, qui pourrait même être inférieur à celui du LNN, pourrait rejeter et même sanctionner. Dans l’impossibilité d’étayer ce jugement de manière empirique, nous revendiquons sa véracité à travers les observations de multiples ressortissants étrangers après plus de trente-cinq ans passés en France.
7. Principes didactiques pour la sélection et transmission des EP
L’exclusion de l’apprentissage actif des proverbes, lieux communs et expressions idiomatiques n’implique en aucune manière l’impératif d’épurer tous les supports de cours employés de ce genre de phrasèmes. Il s’agit tout simplement de ne pas sélectionner les supports en fonction de leur richesse idiomatique et sémantique, et encore moins de proposer des listes d’idiotismes, etc., à mémoriser. Or si les supports choisis en comprennent « naturellement », il convient bien entendu de les traiter et les expliquer tout en mettant l’apprenant en garde contre leur utilisation active pour les raisons évoquées. Le même principe que celui gouvernant l’emploi d’expressions vulgaires devrait gouverner celui des EP métaphoriques : Les comprendre sans les utiliser ! Par ailleurs, toutes les formules de routine ne sont probablement pas destinées à l’utilisation par un LNN, notamment celles qui pourraient être interprétées comme une prise de « position haute », p. ex. la formule je termine pour défendre son droit de parole.
Sans que cette contribution soit le lieu de présentation d’une unité pédagogique détaillée, nous présentons ci-après l’esquisse des principes linguistiques et (phraséo)didactiques devant guider tout enseignement des phrasèmes et EP dans un sens plus large :
L’enseignement se concentre sur les formules de routine, les collocations et les constructions lexicogrammaticales, notamment, tout au moins jusqu’au niveau B1/2, celles relevant de l’oralité des conversations « au quotidien ».
Leur description doit être fondée sans exception sur de grands corpus tenant compte d’un maximum de caractéristiques structurales aussi bien que de conditions d’utilisation afin d’élaborer des situations d’apprentissages réalistes, non pas naturalistes.
Toutes les EP sont présentées systématiquement en contextes inspirés de situations retrouvées dans les corpus de manifestations communicatives naturelles (cf. Lüger 2019, 69) en respectant leurs cotextes et leur séquentialité.
Les EP sont à différencier sans exception en fonction du futur usage, en distinguant compétence passive (compréhension) et active (production) de l’apprenant.
Le niveau d’apprentissage de l’AP-LE et surtout son âge sont à prendre en compte. Un élève de 11 ans en 6ème n’a pas vocation à employer les mêmes pragmatèmes ou collocations qu’un élève de terminale de 17/18 ans ayant bénéficié de 7 ans d’apprentissage d’une LE en LV1.
Les EP sont à choisir en fonction des besoins communicatifs de l’AP-LE, principe qui prévaut du reste pour tout choix de supports de cours.
Une fiche de saisie pourrait être utile afin de sensibiliser l’apprenant à la prise en compte de la polyfactorialité (conditions d’utilisation, connotations…) d’EP introduites ou rencontrées dans les textes étudiés (cf. Lüger 1997, 118-119).
Si les manuels ont fait des progrès considérables pour ce qui est de l’authenticité des matériaux présentés, notre constat reste inchangé, les auteurs des manuels se basent encore trop souvent sur leurs propres opinions et intuitions lorsqu’ils confectionnent dialogues et textes à moins que ces derniers proviennent de sources avérées. Or ce n’est que la linguistique de corpus qui est à même de produire des résultats véritablement naturels. On ne peut pas faire autrement que de suivre le conseil de John Sinclair (2004, titre) : « Trust the text ! »
Références
BALLY, Charles. 1909a. Traité de stylistique française, Volume I. Heidelberg : Winter.
BALLY, Charles. 1909b. Traité de stylistique française, Volume II. Heidelberg : Winter.
BARDOSI, Vilmos, ETTINGER, Stefan, STÖLTING, Cécile. 32003, 1992. Redewendungen Französisch/Deutsch. Thematisches Wörter- und Übungsbuch. Tübingen/Basel : Francke.
BENIGNO, Veronica & KRAIF & Olivier. 2016. « Core vocabulary and core collocations: combining corpus analysis and native speaker judgement to inform selection of collocations in learner dictionaries », dans : Orlandi, Adriana & Giacomini, Laura. edd. Defining Collocations for Lexicographic Purposes: From Linguistic Theory to Lexicographic Practice. Berne et al. : Lang, 237-270.
BENIGNO, Veronica & GROSSMANN, Francis & KRAIF, Olivier. 2015. « Les collocations fondamentales : Une piste pour l’apprentissage lexical », dans : Revue française de linguistique appliquée 20/1, 81-96.
BLOOMFIELD, Leonard. 1933. Language. London : Allen and Unwin.
BOLINGER, Dwight. 1976. « Meaning and Memory », dans : Forum Linguisticum 1, 1-14.
BRÉAL, Michel. 1872. Quelques mots sur l’instruction publique en France. Paris : Hachette.
BURGER, Harald. 42010. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen (= Grundlagen der Germanistik; 36). Berlin : Erich Schmidt.
COCTON, Marie-Noëlle et al. 2019. L’atelier A1. Méthode de français. Paris : Didier.
CONSEIL DE L’EUROPE. 2001. Cadre Européen de Référence pour les langues. Paris : Didier.
COULMAS, Florian. 1981. Routine im Gespräch. Zur pragmatischen Fundierung der Idiomatik. Wiesbaden : Athenaion.
DE SAUSSURE, Ferdinand. 1916. Cours de linguistique générale. Paris : Payot.
DOBROVOL’SKIJ, Dmitrij. 1997. Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung. Trier : Wissenschaftlicher Verlag.
DOBROVOL’SKIJ, Dmitrij & LUBIMOVA, Natalia. 1993. « ‚Wie man so schön sagt, kommt das gar nicht in die Tüte‘ – Zur metakommunikativen Umrahmung von Idiomen », dans : Deutsch als Fremdsprache 30, 151-156.
DONALIES, Elke. 2009. Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen/Basel : Francke Attempto.
DUDENREDAKTION. edd. 82009. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 8., überarbeitete Auflage. Duden Band 4. Berlin : Dudenverlag.
DUDENREDAKTION. edd. 42013. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 4. neu bearbeitete u. aktualisierte Auflage. Berlin : Dudenverlag.
ERMAN, Britt & WARREN, Beatrice. 2000. « The Idiom Principle and the Open Choice Principle », dans : Text 20/1, 29-62.
ETTINGER, Stefan. 2007. « Phraseme im Fremdsprachenunterricht », dans : BURGER, Harald, DOBROVOL’skij, Dmitrij & KÜHN, Peter & NORRICK, Neil R. edd. Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Berlin & New York : de Gruyter, 893-908.
FILLMORE, Charles J. & KAY, Paul & O’CONNOR, Mary C. 1988. « Regularity and Idiomaticity in Grammatical Construction. The Case of Let Alone », dans : Language 64/3, 501-538.
FIRTH, John R. 1937. The Tongues of Men and Speech. Oxford : OUP.
FRANÇOIS, Jacques & MEJRI, Salah. 2006. « Introduction », dans : François, Jacques & Mejri, Salah. edd. Composition syntaxique et figement lexical. Caen : PU de Caen, 7-13.
FREI, Henri. 1929. La grammaire des fautes. Rennes : Ennoia.
GALISSON, Robert. 1984. Les expressions imagées. Paris : Clé International.
GALISSON, Robert. 1991. Dictionnaire de compréhension et de production des expressions imagées. Paris : Clé International.
GOLDBERG, Adele E. 1995. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago : University of Chicago Press.
GONZÁLEZ REY, Isabel. 2010. « La phraséodidactique en action : les expressions figées comme objet d’enseignement », dans : La Clé des Langues [en ligne] ; http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/langue/traduction/la-phraseodidactique-en-action-les-expressions-figees-comme-objet-d-enseignement, consulté le 21.05.2020.
GONZÁLEZ REY, Isabel. ed. 2015. Phraseology, Phraseodidactics and Construction Grammar(s). Numéro thématique du Journal of Social Sciences 11/3.
GONZÁLEZ REY, Isabel. 2018. « Phraséotext – Le Français Idiomatique : une méthode d’enseignement-apprentissage en phraséodidactique du FLE », dans : Soutet, Olivier & Mejri, Salah, Sfar, Inès. edd. La Phraséologie : théories et application. Paris : Honoré Champion, 301-318.
GRANT, Lynn E. 2005. « Frequency of ‘core idioms’ in the British National Corpus (BNC) », dans : International Journal of Corpus Linguistics 10/4, 429-451.
GÜLICH, Elisabeth. 1997. « Routineformeln und Formulierungsroutinen. Ein Beitrag zur Beschreibung formelhafter Texte », dans : Wimmer, Rainer & Berens, Franz-Josef. edd. Wortbildung und Phraseologie. Tübingen : Narr, 131-175.
HALLSTEINSDÓTTIR, Erla & SAJÁNKOVÁ, Monika & QUASTHOFF, Uwe. 2006. « Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchungen », dans : Linguistik online 27/2, 117-136.
HAUSMANN, Franz-Josef. 1997. « Tout est idiomatique dans les langues », dans : Martins-Baltar, Michel. ed. La locution entre langues et usages. Paris : ENS, 277-290.
JESENŠEK, Vida. 2006. « Phraseologie und Fremdsprachenlernen. Zur Problematik einer angemessenen phraseodidaktischen Umsetzung », dans : Linguistik online 27/2, 137-147.
JESPERSEN, Otto. 1924. La philosophie de la grammaire. Traduit par A. M. Léonard. Paris : Minuit.
KÜHN, Peter. 1987. « Deutsch als Fremdsprache im phraseodidaktischen Dornröschenschlaf », dans : Fremdsprachen lehren und lernen 16, 62-79.
LEGALLOIS, Dominique, Gréa, Philippe. 2006. « La Grammaire de Construction », dans : Cahier du CRISCO 21, 5-27.
LUCKMANN, Thomas. 1988. « Kommunikative Gattungen im kommunikativen ‘Haushalt’ einer Gesellschaft », dans : Smolka-Koerdt, Gisela et al. edd. Der Ursprung von Literatur – Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650. München : Fink, 279-288.
LÜGER, Heinz-Helmut. 1997. « Anregungen zur Phraseodidaktik », dans : Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 32, 69-120.
LÜGER, Heinz-Helmut. 2004. « Idiomatische Kompetenz – ein realistisches Lernziel? Thesen zur Phraseodidaktik », dans : Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 7, 121-169.
LÜGER, Heinz-Helmut. 2019. « Phraseologische Forschungsgelder – Impulse, Entwicklungen und Probleme aus germanistischer Sicht », dans : Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 61, 51-82.
MCCARTHY, Michael J., WALTER, Elizabeth. edd. 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge : CUP.
MEL‘ČUK, Igor. 1993. « La phraséologie et son rôle dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère », dans : Études de Linguistique Appliquée 92, 82-113.
MEL‘ČUK, Igor. 2011. « Phrasèmes dans le dictionnaire », dans : Anscombre, Jean-Claude & Mejri, Salah. edd. Le figement linguistique : la parole entravée. Paris : Honoré Champion, 41-61.
MEL’ČUK, Igor. 2013. « Tout ce que nous voulions savoir sur les phrasèmes, mais… », dans : Cahiers de lexicologie 102/1, 129-149. Cité d’après la version téléchargeable sur Research Gate ; https://www.researchgate.net/publication/327830942, consulté le 31.05.2020.
OKSAAR, Els. 1988. Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht.
PAUL, Hermann. 1880. Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen : Niemeyer.
PORZIG, Walter. 1934. « Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen », dans : Beiträge zur Geschichte und Sprache der deutschen Literatur 58, 70-97.
POYATOS, Fernando. 1976. Man beyond Words: Theory and Methodology of Nonverbal Communication. Oswego, New York : New York State English Council.
ROULET, Eddy. 1989. « Des didactiques du français à la didactique des langues », dans : Langue française 82, 3-7.
SAJANKOVA, Monika. 2005. « Auswahl der Phraseologismen zur Entwicklung der aktivenphraseologischen Kompetenz », dans : Jankoviãová, Milada et al. edd. Frazeologicke studie IV. Bratislava : Veda, 325-340.
SAPIR, Edward. 1921. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York : Harcourt and Brace.
SCHMALE, Günter. 2004. « Kommunikative Kompetenz durch Fremdsprachenunterricht ? – Zum Nutzen konversationsanalytischer Erkenntnisse und Verfahren für die Fremdsprachendidaktik », dans : Lüger, Heinz-Helmut & Rothenhäusler, Rainer. edd. Linguistik für die Fremdsprache Deutsch. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 7, 257-281.
SCHMALE, Günter. 2009. « Phraseologische Ausdrücke als Bestandteil des Fremdsprachenerwerbs. Überlegungen zur Phraseodidaktik auf der Grundlage einer korpusbasierten Analyse deutscher Talkshows », dans : Bachmann-Stein, Andrea & Stein, Stephan. edd. Mediale Varietäten. Gesprochene und geschriebene Sprache und ihre fremdsprachendidaktischen Potenziale. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 15, 149-179.
SCHMALE, Günter. 2012a. « Morpho-Syntax oder präformierte Konstruktionseinheiten – Welcher linguistische Ansatz für das Fremdsprachenlernen? », dans : DAAD. ed. Zukunftsfragen der Germanistik. Beiträge der Germanistentagung 2011 mit den Partnerländern Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Göttingen : Wallstein, 195-209.
SCHMALE, Günter. 2012b. « Formulaic Expressions for Foreign Language Learning », dans : Tinnefeld, Thomas et al. edd. Hochschulischer Fremdsprachenunterricht – Anforderungen, Ausrichtung, Spezifik. Saarbrücken : HTW, 161-178.
SCHMALE, Günter. 2013. « Qu’est-ce qui est préfabriqué dans la langue ? – Réflexions au sujet d’une définition élargie de la préformation langagière », dans : Legallois, Dominique & Tutin, Agnès. edd. Vers une extension du domaine de la phraséologie. Langages 189, 27-45.
SCHMALE, Günter. 2014. « Idiomatic Expressions for the Foreign Language Learner? », dans : Tinnefeld, Thomas et al. edd. Fremdsprachenunterricht im Spannungsfeld zwischen Sprachwissen und Sprachkönnen. Saarbrücken : htw, 41-57.
SCHMALE, Günter. 2016. « Konstruktionen statt Regeln », dans : Bürgel, Christoph & Siepmann, Dirk. edd. Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik: Zum Verhältnis von sprachlichen Mitteln und Kompetenzentwicklung. Baltmannsweiler : Schneider, 1-24.
SCHMALE, Günter. 2018. « Überlegungen zu einer Neudefinition präformierter Konstruktionseinheiten », dans : Schmale, Günter. ed. Lexematische und polylexematische Einheiten des Deutschen. Tübingen : Stauffenburg, 79-97.
SCHMALE, Günter. A par. a. « Constructions vs règles – L’approche constructiviste à l’enseignement de la grammaire de l’allemand », dans : La Clé des Langues, ENS Lyon.
SCHMALE, Günter. A par. b. « Modalpartikeln als lexikogrammatische Konstruktionseinheiten? Versuch einer Beschreibung von denn als Konstruktion », dans : Bürgel, Christoph & Gévaudan, Paul & Siepmann, Dirk. edd. Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik : Konstruktionen und Konstruktionslernen. Baltmannsweiler : Schneider, 251-278.
SÈCHEHAYE, Albert. 1921. Essai sur la structure logique de la phrase. Paris : Champion.
SIEPMANN, Dirk & BÜRGEL, Christoph. 2019. « Les unités phraséologiques fondamentales du français contemporain », dans : Kauffer, Maurice & Keromnes, Yvan. edd. Theorie und Empirie in der Phraseologie – Approches théoriques et empiriques en phraséologie. Tübingen : Stauffenburg, 189-212.
SINCLAIR, John. 1991. Corpus, Concordance, and Collocation. Oxford : OUP.
SINCLAIR, John. 2004. Trust the Text : Language, Corpus, and Discourse. Edited with Ronald Carter. London & New York : Routledge.
VAN LANCKER SIDTIS, Diana & RALLON, Gail. 2004. « Tracking the Incidence of Formulaic Expressions in Everyday Speech: Methods for Classification and Verification », dans : Language & Communication 24/3, 207-240.
WIDDOWSON, Henry G. 1989. « Knowledge of Language and Ability for Use », dans : Applied Linguistics 10, 128-137.
WRAY, Alison & PERKINS, Michael R. 2000. « The Functions of Formulaic Language : An Integrated Model », dans : Language & Communication 20, 1-28.
1 En nous référant à Charles Bally (1909a) qui compare ces groupements usuels à des « combinaisons chimiques » (id., 74-5).
2 « C’est seulement là où parler et comprendre reposent sur la reproduction, que se trouve la langue. » Notre traduction de « Erst wo sprechen und verstehen auf reproduction beruht, ist sprache da (sic). » (Paul 1880, 196).
3 Notre traduction de « wesenhafte Bedeutungsbeziehungen ».
4 Dans le deuxième volume de son Traité de stylistique, Bally (1909b) propose même des exercices : au sein du numéro 54 traitant des collocations, il s’agit de trouver des contextes d’emplois pour p. ex. courir un danger ou brûler la politesse à qn. et de les paraphraser par un « mot simple ou une périphrase » (59)
5 En traduisant, avec l’aide de LEO, le « Dornröschenschlaf » allemand, i.e. le sommeil de la belle au bois dormant (cf. Kühn 1987 , titre).
6 En témoignent aussi les nombreuses réflexions très nuancées de Heinz-Helmut Lüger (p. ex. 1997, 2004) et notamment son état des lieux publiés en 2019.
7 Nous y reviendrons plus avant.
8 Le sens ‘mourir’ étant partagé par les trois expressions, leur niveau stylistique étant toutefois très différent.
9 Mel’čuk (2013, 4) différencie locution forte, semi-locution et quasi-locution, cette dernière étant très proche de la collocation dont la compositionnalité sémantique peut néanmoins être sujet à discussion. Nous y reviendrons plus avant. Les proverbes sont chez lui un « type particulier » (cf. 7).
10 Cf. Coulmas (1981) pour une classification et discussion des formules de routine omniprésentes dans pratiquement tous les domaines de la communication.
11 Célèbre citation du drame La conjuration de Fiesque à Gênes (1783) de Friedrich Schiller traduit par pons.de en tant « on presse l’orange et on jette l’écorce ».
12 Nous faisons ici abstraction de l’approche de Goldberg (1995) du fait de son acception extrêmement large de la notion de ‘construction’.
13 Les « substantive idioms » de Fillmore et al. dont « lexical make-up is […] fully specified » correspondent grosso modo aux phrasèmes.
14 Il propose même des exercices dans le 2ème volume de son Traité de Stylistique (Bally 1909b).
15 Le CERCL (2001) asserte du reste explicitement que l’atteinte du niveau de « (near) native » n’est nullement l’objectif de l’enseignement des langues étrangères.
16 Les deux appellations sont employées par la recherche pour désigner des EP dans leur globalité.
17 Correspondant sans doute aux formules de routine ou phrasèmes communicatifs.
18 Sont listés ici les phrasèmes comparatifs du type blanc comme neige où l’élément de comparaison sert à renforcer le sens de l’adjectif.
19 L’affirmation de Jesenšek (2006) que l’apprentissage doit avoir lieu « dès les premiers stades » ne peut guère s’appliquer sans préciser le type de phrasème visé.
20 ugs. = umgangssprachlich = familier.
21 Dobrovol’skij (1997, 263-288) revendique environ 1000 idiotismes couramment employés en allemand ; Sajankova (2005) liste également quelque 1000 expressions idiomatiques.
22 Parmi celles-ci figurent aussi quelques collocations.
23 Entendu le 09 août 2020 à l’occasion d’une interview portant sur la nouvelle édition du Duden intégrant 3000 nouvelles unités lexicales, p. ex. RI = Reproduktionsindex (index de réproduction).
24 Que nous traduisons de l’allemand.
25 Il nous importe ici de démontrer la présence de formules de routine à ce stade initial de l’apprentissage sans discuter de l’adéquation de celles choisies par les auteurs et des dialogues les accueillant.
26 Lüger (2019, 69) souligne également la nécessité de transmettre prioritairement les formules de routine et les collocations aux AP-LE. Gonzalez-Rey (2018, 309) préconise l’apprentissage des « formules routinières » et des « collocations » à partir du niveau B1, mais en même temps des « expressions idiomatiques » et « parémies » (cf. infra).
27 Mel‘čuk (2013, 7) : « Une collocation est un phrasème lexical compositionnel. »
28 Fait également évoqué par Cavalla (2018, 6).
29 Lors de nos cours de traduction, les corrections nécessaires portent dans une grande mesure sur les collocatifs de la LE.
30 Les collocatifs (dans ce cas, les verbes) sont présentés en italiques.
31 Cf. p. ex. pour les collocations françaises : http://www.tonitraduction.net, consulté : 05/09/2020.
32 Entendu lors d’une grève des routiers français.
33 La bière c’est la bière et la gnôle c’est la gnôle.
34 Les mêmes types de construction existent en allemand et anglais.
35 P. ex. [sujet + V + comp. à l’accusatif] : Wir bauen ein Haus. (Dudenredaktion 2009, 922).
36 D’autres chercheurs adoptent bien entendu un point de vue plus différencié : Ettinger (2007) ou Lüger (2004, 2019), pour ne citer que deux éminents phraséologues, distinguent type de compétence (active ou passive), niveau d’apprentissage ou genre de phrasème.
37 Cf. Roulet (1989) qui souligne que l’acquisition d’une expression idiomatique ne peut être utile à l’apprenant que lorsque ce dernier connait les variables situationnelles, le registre et le niveau de la langue.