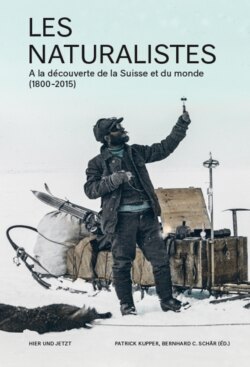Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 14
COLLECTIONNER ET ÉTUDIER – IMPULSIONS DE L’ÉTRANGER
ОглавлениеAux alentours de 1800, ce n’est toutefois pas l’inaccessibilité des collections d’histoire naturelle qui faisait obstacle à une modernisation de la recherche en sciences naturelles. Il manquait également de possibilités de formation pour les futurs naturalistes. En effet, en Suisse, à la différence des autres pays européens, les sciences naturelles n’étaient même pas enseignées dans les universités, et, jusqu’au XIXe siècle, aucune chaire de sciences naturelles ne sera créée, que ce soit dans les académies de Genève, de Lausanne et de Berne ou à l’université de Bâle.10 Seule la botanique était représentée dans l’enseignement scientifique et la recherche, en tant que section de la médecine, toutefois, les médecins s’intéressaient plus à l’utilisation des plantes comme remèdes qu’à leur classification, leur physiologie ou leur taxinomie. Ce n’est que vers 1778 que l’on trouve les premiers indices prouvant la constitution de collections d’histoire naturelle dans les établissements universitaires suisses. A Bâle, le gouvernement achète notamment l’important cabinet d’antiquités et de curiosités de Daniel Bruckner (1707-1781). L’un des arguments motivant cette acquisition était qu’il pouvait être d’une grande utilité pour la ville et l’Université, au cas où «l’histoire naturelle y serait, avec le temps, publiquement enseignée».11 La collection fut installée dans la Bibliothèque publique et universitaire de Bâle, toutefois, il fallut encore attendre plusieurs décennies jusqu’à ce qu’elle puisse remplir ses fonctions scientifiques. A Genève, Henri Boissier (1766-1845) réclama en 1794 la création d’un cabinet d’histoire naturelle pour faciliter l’enseignement dans cette discipline. Sur ce, le Gouvernement genevois vota un crédit pour l’acquisition d’instruments de physique et du cabinet de naturalia du pharmacien Pierre-François Tingry (1743-1821). Les professeurs ne firent toutefois guère usage de ces collections et, les rémunérations prévues n’ayant pas été versées, la collection dut être rendue à son propriétaire.12 La première chaire de sciences naturelles sera créée à l’Académie de Berne, nouvellement constituée, en 1805, et occupée par le naturaliste Karl Friedrich Meisner (1765-1825).
La majeure partie de la recherche en sciences naturelles avait toutefois lieu loin des établissements universitaires, dans des «sociétés savantes» qui avaient été créées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C’est le cas notamment des sociétés de physique et de sciences naturelles à Zurich (fondées en 1746), de la Societas Physico-Medica Basiliensis (1751-1787), de la «Société privée des amis des sciences naturelles» de Berne (fondée en 1786) ou la Société des Naturalistes Genevois (fondée en 1791, qui devint Société de physique et d’histoire naturelle de Genève à partir de 1799). Certaines géraient aussi leurs propres collections et cabinets de naturalia, pour lesquels elles aménagèrent des locaux spécialement à cet effet, comme la Société de physique à Zurich. Toutefois, il fallut encore quelques années pour que d’autres cercles puissent profiter des intérêts privés des naturalistes et de leurs collections.13 Les circonstances politiques n’étaient pas vraiment favorables. Avec l’entrée des troupes françaises sous Napoléon en 1798, les villes-républiques helvétiques tombent sous le contrôle de la France. Durant cette période de troubles, les activités des établissements universitaires suisses seront pratiquement interrompues. Quiconque souhaitait faire des études sérieuses en médecine, en histoire naturelle ou en botanique et disposait des moyens financiers nécessaires partait étudier dans une université à l’étranger. Les universités de Göttingen, de Paris ou de Leyde étaient particulièrement renommées. Dans ces établissements modernes, les cours n’avaient pas seulement lieu dans les auditoriums; pour l’enseignement académique et la recherche, ils disposaient déjà de leurs propres musées, jardins botaniques et de vastes collections provenant de tous les domaines des sciences naturelles. Le programme d’études comprenait également des excursions et des voyages de recherche.14 Les étudiants venus de Suisse apprenaient ainsi à connaître les avantages des collections scientifiques. On n’y collectionnait pas pour l’usage privé, mais dans un but «plus élevé», celui de servir la science. Après leur séjour d’étude, les étudiants rapportèrent, outre leurs connaissances, l’idée d’un nouveau genre de formation en Suisse.