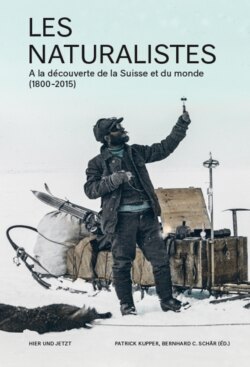Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 28
«…ONE OF THE CLEVEREST AND ODDEST WOMEN IN EUROPE …»
ОглавлениеAinsi que le suppose Joy Harvey, Clémence Royer aurait entendu parler pour la première fois de l’ouvrage de Darwin, On the Origin of Species, en 1860 à Genève, où elle avait accompagné Duprat et où elle donnait des cours. A la différence de leurs confrères parisiens, les naturalistes romands réagissaient assez positivement à l’ouvrage de l’Anglais.21 Mais le plus enthousiaste était l’émigrant allemand Carl Vogt (1789-1861). Le futur fondateur et premier recteur de l’Université de Genève, qui était aussi le représentant de la ville au Conseil des Etats, deviendra l’un des partisans les plus radicaux du darwinisme.22 Si les circonstances qui ont amené Clémence Royer à devenir la traductrice de Darwin n’ont pas été éclaircies, on sait en revanche que ce dernier avait des relations familiales à Genève. Il est possible que son nom ait été évoqué dans ce contexte. Darwin avait cherché jusque-là, en vain, à faire traduire son ouvrage. Les connaissances de l’anglais de la jeune femme, mais aussi le fait qu’elle avait un éditeur français (il avait publié son ouvrage consacré à l’impôt sur le revenu et était disposé à publier sa traduction de l’ouvrage de Darwin) plaidaient en sa faveur. En outre, elle avait non seulement lu, dans le domaine des sciences naturelles, les ouvrages de référence sur lesquels reposaient les thèses de Darwin, mais aussi le livre de l’économiste britannique Thomas Robert Malthus (1766-1834), qui joua un rôle important pour la théorie darwinienne. Darwin fit parvenir à Clémence Royer une copie de son ouvrage le 10 septembre 1861. Elle le traduira rapidement. Darwin reçoit la version imprimée à peine douze mois plus tard, à l’été 1862. Amusé, mais aussi impressionné par le style de sa traductrice, et en particulier par sa préface et ses nombreux commentaires dans les notes en bas de page, Darwin parle d’elle en ces termes à un ami américain: « … Madlle [sic] Royer, qui doit être l’une des plus intelligentes et des plus originales femmes en Europe: […] Elle envoie quelques sarcasmes curieux et intéressants qui portent […]».23 Lui-même aurait écrit qu’il eût été un «homme perdu» s’il avait tiré des conclusions aussi explicites que cette dernière.
Ill. 4: Portrait de la jeune Clémence Royer, datant vraisemblablement des années 1860.
La collaboration entre Clémence Royer et Darwin durera jusqu’en 1869. Puis, elle se terminera sur un éclat. Auparavant déjà, certaines difficultés étaient survenues. Le fait que, étant femme, elle n’avait pas pu suivre une formation universitaire classique constituait un problème. Cette théoricienne autodidacte avait certaines lacunes, notamment au niveau des expériences pratiques, comme la dissection d’animaux dans un laboratoire. Cela conduira à des malentendus dans la traduction. Afin de les limiter le plus possible, Clémence Royer se fera conseiller par le zoologue romand Edouard Claparède (1832-1871), qui s’était illustré par une recension très favorable et bien documentée de l’ouvrage de Darwin.24 Claparède était toutefois de santé fragile, et, comme il l’écrira à Darwin après la publication de la première édition française, il ne réussit pas à juguler le besoin de Clémence Royer d’ajouter des commentaires et des développements de son cru.25
Qu’une traductrice ne se contente pas de transposer les textes d’une langue dans une autre, mais qu’elle y ajoute sa propre interprétation et sa vision du monde n’avait cependant rien de curieux au XIXe siècle. Le même phénomène s’était produit avec la première traduction allemande de Darwin.26 Ce qu’il y avait, toutefois, de particulier dans le cas de Clémence Royer, c’est qu’elle considérait avant tout l’ouvrage de Darwin comme une confirmation empirique de sa propre philosophie de l’évolution – une philosophie qui se fondait sur un anticléricalisme radical et qu’elle avait élaborée à la Bibliothèque de Lausanne, notamment grâce à la lecture des ouvrages du naturaliste Jean-Baptiste Lamarck (1744-1828), quelque peu tombé dans l’oubli entre-temps. Elle voyait par conséquent en Darwin un allié, dont elle voulait faire mieux connaître la théorie au plus grand nombre possible de lecteurs français au moyen de sa préface et de ses commentaires. Ainsi que ses deux biographes l’ont fait ressortir, la lecture de Clémence Royer s’écarte de la théorie de Darwin sur deux points. Le premier concerne la filiation à Lamarck. Effectivement, ce dernier avait déjà parlé de la possibilité qu’avaient les espèces animales de s’adapter à leur environnement et de se transformer au fil des générations. Mais les idées de Lamarck étaient d’ordre purement spéculatif. Et surtout, Clémence Royer négligeait le fait qu’avec sa conception de la sélection naturelle, Darwin introduisait un mécanisme fondamentalement nouveau, qui non seulement postulait et décrivait l’évolution des espèces, mais pouvait aussi l’expliquer – d’une autre manière que Lamarck. La deuxième différence par rapport à Darwin était que, comme bien d’autres intellectuels de son temps, elle considérait la théorie de l’évolution comme une loi (naturelle) du progrès, ainsi qu’en témoigne sa traduction du sous-titre de l’ouvrage – des Lois du progrès chez les êtres organisés. Dans la conception de Darwin, le processus de l’évolution n’avait toutefois pas d’orientation clairement définie.27
Pour la deuxième édition française, Darwin exigera de nombreuses adaptations, notamment, de renoncer au terme de progrès dans le sous-titre, et il supprimera l’un des commentaires de la traductrice. Mais il conservera la préface. Bien qu’il redoute que cela ne nuise à la réception, déjà difficile, de sa théorie en France, il appréciait que Clémence Royer ait remarquablement saisi les principaux éléments de sa théorie, non seulement sur le plan stylistique, mais au niveau du contenu, ainsi que des amis français le lui avaient assuré. Pour la troisième édition, Clémence Royer commettra toutefois, selon les termes de Joy Harvey, «l’énorme faute»28 de rédiger une nouvelle préface, dans laquelle elle attaque directement Darwin. Sa critique ne concerne pas L’Origine des espèces, mais sa toute nouvelle théorie des lois de l’hérédité. Dans une perspective historique, il ne s’agit là que d’un élément secondaire.29 Pour Darwin lui-même, ce nouvel élément constitutif de sa construction théorique était toutefois très important, et ce sera la raison pour laquelle il se montrera particulièrement irrité par la critique de Clémence Royer. Le fait qu’elle ait en même temps négligé d’intégrer dans sa traduction les rectifications et les compléments apportés dans les éditions anglaises les plus récentes renforcera sa colère. Darwin refusera de donner son aval pour la troisième édition de la traduction de Clémence Royer et il chargera quelqu’un d’autre de réaliser une nouvelle traduction de l’ouvrage.
Ill. 5: Lausanne dans les années 1860: la promenade du lac et l’Hôtel Beau-Rivage. Peinture de Rudolf Dickmann.
Ill. 6: Vue sur les villages du vignoble de Lavaux, Pully (au premier plan) et Cully (à l’arrière-plan) au bord du Léman, avec, au loin, les Alpes valaisannes. Peinture de William-Henry Bartlett, 1835.
Malgré la fin de cette collaboration, Clémence Royer reste sans doute la plus influente médiatrice de la théorie de Darwin en France. En 1869, elle s’installe à Paris avec son compagnon, Pascal Duprat. Elle sera la première femme admise dans la Société d’anthropologie – la seule société savante française qui s’intéressait sérieusement au darwinisme. A sa direction, on trouvait un groupe d’intellectuels radicaux rassemblés autour de Paul Broca (1824-1880), dont Carl Vogt, qui habitait Genève. Grâce à l’influence de Clémence Royer, les anthropologues français acceptèrent peu à peu la théorie de Darwin. Avec sa traduction, elle marquera également la réception de Darwin en Italie, en Espagne et en Amérique latine, où le français était la principale langue scientifique.30