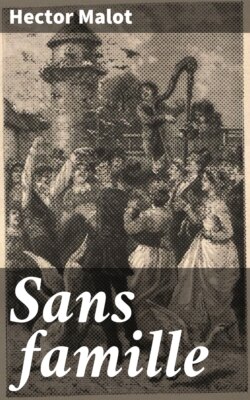Читать книгу Sans famille - Hector Malot - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
J’APPRENDS A LIRE
ОглавлениеC’étaient assurément des comédiens du plus grand talent, que ceux qui composaient la troupe du signor Vitalis, — je parle des chiens et du singe, — mais ce talent n’était pas très varié.
Lorsqu’ils avaient donné trois ou quatre représentations, on connaissait tout leur répertoire; ils ne pouvaient plus que se répéter.
De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville.
Trois jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route.
Où allions-nous? Je m’étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question.
«Tu connais le pays? me répondit-il en me regardant.
— Non.
— Alors pourquoi me demandes-tu où nous allons?
— Pour savoir.
— Savoir quoi?»
Je restai interloqué, regardant, sans trouver un mot, la route blanche qui s’allongeait devant nous au fond d’un vallon boisé.
«Si je te dis, continua-t-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux et de Bordeaux sur les Pyrénées, qu’est-ce que cela t’apprendra?
— Mais vous, vous connaissez donc le pays?
— Je n’y suis jamais venu.
— Et pourtant vous savez où nous allons?»
Il me regarda encore longuement comme s’il cherchait quelque chose en moi.
«Tu ne sais pas lire, n’est-ce pas? me dit-il.
— Non.
— Sais-tu ce que c’est qu’un livre?
— Oui; on emporte les livres à la messe pour dire ses prières quand on ne récite pas son chapelet; j’en ai vu, des livres, et des beaux, avec des images dedans et du cuir tout autour.
— Bon; alors tu comprends qu’on peut mettre des prières dans un livre?
— Oui.
— On peut y mettre autre chose encore. Quand tu récites ton chapelet, tu récites des mots que ta mère t’a mis dans l’oreille, et qui de ton oreille ont été s’entasser dans ton esprit pour revenir ensuite au bout de ta langue et sur tes lèvres quand tu les appelles. Eh bien, ceux qui disent leurs prières avec des livres ne tirent point les mots dont se composent ces prières de leur mémoire, mais ils les prennent avec leurs yeux dans les livres où ils ont été mis, c’est-à-dire qu’ils lisent.
— J’ai vu lire, dis-je tout glorieux, comme une personne qui n’est point une bête, et qui sait parfaitement ce dont on lui parle.
— Ce qu’on fait pour les prières, on le fait pour tout. Dans un livre que je vais te montrer quand nous nous reposerons, nous trouverons les noms et l’histoire des pays que nous traversons. Des hommes qui ont habité ou parcouru ces pays ont mis dans mon livre ce qu’ils avaient vu ou appris; si bien que je n’ai qu’à ouvrir ce livre et à le lire pour connaître ces pays; je les vois comme si je les regardais avec mes propres yeux; j’apprends leur histoire comme si on me la racontait.»
J’avais été élevé comme un véritable sauvage qui n’a aucune idée de la vie civilisée. Ces paroles furent pour moi une sorte de révélation, confuse d’abord, mais qui peu à peu s’éclaircit. Il est vrai cependant qu’on m’avait envoyé à l’école. Mais ce n’avait été que pour un mois. Et, pendant ce mois, on ne m’avait pas mis un livre entre les mains, on ne m’avait parlé ni de lecture, ni d’écriture, on ne m’avait donné aucune leçon de quelque genre que ce fût.
Il ne faut pas conclure de ce qui se passe actuellement dans les écoles, que ce que je dis là est impossible A l’époque dont je parle, il y avait un grand nombre de communes en France qui n’avaient pas d’écoles, et parmi celles qui existaient il s’en trouvait qui étaient dirigées par des maîtres qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu’ils ne savaient rien, ou bien parce qu’ils avaient autre chose à faire, ne donnaient aucun enseignement aux enfants qu’on leur confiait. Ils gardaient les enfants, croyant que c’était le principal.
C’était là le cas du maître d’école de notre village. Savait-il quelque chose? c’est possible, et je ne veux pas porter contre lui une accusation d’ignorance. Mais la vérité est que, pendant le temps que je restai chez lui, il ne nous donna pas la plus petite leçon ni à mes camarades, ni à moi. Étant de son véritable métier sabotier, c’était à ses sabots qu’il travaillait, et, du matin au soir, on le voyait faire voler autour de lui les copeaux de hêtre et de noyer. Jamais il ne nous adressait la parole, si ce n’est pour nous parler de nos parents, ou bien du froid, ou bien de la pluie; mais de lecture, de calcul, jamais un mot. Pour cela il s’en remettait à sa fille, qui était chargée de le remplacer et de nous faire la classe. Mais, comme celle-ci de son véritable métier était couturière, elle faisait comme son père, et, tandis qu’il manœuvrait sa plane ou sa cuiller, elle poussait vivement son aiguille.
Il fallait bien vivre, et, comme nous étions douze élèves payant chacun cinquante centimes par mois, ce n’était pas six francs qui pouvaient nourrir deux personnes pendant trente jours; les sabots et la couture complétaient ce que l’école ne pouvait pas fournir. On n’a de tout que pour son argent. Je n’avais donc absolument rien appris à l’école, pas même mes lettres.
«C’est difficile de lire? demandai-je à Vitalis après avoir marché assez longtemps en réfléchissant.
— C’est difficile pour ceux qui ont la tête dure, et plus difficile encore pour ceux qui ont mauvaise volonté. As-tu la tête dure?
— Je ne sais pas, mais il me semble que, si vous vouliez m’apprendre à lire, je n’aurais pas mauvaise volonté.
— Eh bien, nous verrons; nous avons du temps devant nous.»
Du temps devant nous! Pourquoi ne pas commencer aussitôt? Je ne savais pas combien il est difficile d’apprendre à lire, et je m’imaginais que tout de suite j’allais ouvrir un livre et voir ce qu’il y avait dedans.
Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître se baisser et ramasser sur la route un bout de planche à moitié recouvert par la poussière.
«Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire,» me dit-il.
Un livre, cette planche! Je le regardai pour voir s’il ne se moquait pas de moi. Puis, comme je le trouvai sérieux, je regardai attentivement sa trouvaille.
C’était bien une planche, rien qu’une planche de bois de hêtre, longue comme le bras, large comme les deux mains, bien polie; il ne se trouvait dessus aucune inscription, aucun dessin.
Comment lire sur cette planche, et quoi lire?
«Ton esprit travaille, me dit Vitalis en riant.
— Vous voulez vous moquer de moi?
— Jamais, mon garçon; la moquerie peut avoir du bon pour réformer un caractère vicieux, mais, lorsqu’elle s’adresse à l’ignorance, elle est une marque de sottise chez celui qui l’emploie. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d’arbres qui est là-bas; nous nous y reposerons, et tu verras comment je peux t’enseigner la lecture avec ce morceau de bois.»
Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d’arbres et, nos sacs mis à terre, nous nous assîmes sur le gazon qui commençait à reverdir et dans lequel des pâquerettes se montraient çà et là. Joli-Cœur, débarrassé de sa chaîne, s’élança sur un des arbres en secouant les branches les unes après les autres, comme pour en faire tomber des noix, tandis que les chiens, plus tranquilles et surtout plus fatigués, se couchaient en rond autour de nous.
Alors Vitalis, tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il polit cette lame sur ses deux faces, dans toute sa longueur, puis, cela fait, il la coupa en petits carrés, de sorte qu’elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d’égale grandeur.
Je ne le quittais pas des yeux, mais j’avoue que, malgré ma tension d’esprit, je ne comprenais pas du tout comment avec ces petits morceaux de bois il voulait faire un livre, car enfin, si ignorant que je fusse, je savais qu’un livre se composait d’un certain nombre de feuilles de papier sur lesquelles étaient tracés des signes noirs. Où étaient les feuilles de papier? Où étaient les signes noirs?
«Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai demain, avec la pointe de mon couteau, une lettre de l’alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres, et, quand tu les sauras bien sans te tromper, de manière à les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre.»
Bientôt j’eus mes poches pleines d’une collection de petits morceaux de bois, et je ne tardai pas à connaître les lettres de l’alphabet; mais, pour savoir lire, ce fut une autre affaire, les choses n’allèrent pas si vite, et il arriva même un moment où je regrettai d’avoir voulu apprendre à lire.
Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m’inspira ce regret, ce fut l’amour-propre.
En m’apprenant les lettres de l’alphabet, Vitalis avait pensé qu’il pourrait les apprendre en même temps à Capi; puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête, pourquoi ne s’y mettrait il pas les lettres?
Et nous avions pris nos leçons en commun; j’étais devenu le camarade de classe de Capi, ou le chien était devenu le mien, comme on voudra. Bien entendu Capi ne devait pas appeler les lettres qu’il voyait, puisqu’il n’avait pas la parole; mais, lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l’herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait.
Tout d’abord j’avais fait des progrès plus rapides que lui, mais, si j’avais l’intelligence plus prompte, il avait par contre la mémoire plus sûre: une chose bien apprise était pour lui une chose sue pour toujours; il ne l’oubliait plus, et, comme il n’avait pas de distractions, il n’hésitait ou ne se trompait jamais.
Alors, quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire:
«Capi saura lire avant Rémi.»
Et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d’un air de triomphe.
«Plus bête qu’une bête, c’est bon dans la comédie, disait encore Vitalis, mais dans la réalité c’est honteux.»
Cela me piqua si bien, que je m’appliquai de tout cœur, et, tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom, en triant les quatre lettres qui le composent parmi toutes les lettres de l’alphabet, j’arrivai enfin à lire dans un livre.
«Maintenant que tu sais lire l’écriture, me dit Vitalis, veux-tu apprendre à lire la musique?
— Est-ce que, quand je saurai la musique, je pourrai chanter comme vous?»
Vitalis chantait quelquefois, et sans qu’il s’en doutât c’était une fête pour moi de l’écouter.
«Tu voudrais donc chanter comme moi?
— Oh! pas comme vous, je sais bien que cela n’est pas possible. mais enfin chanter
— Tu as du plaisir à m’entendre chanter?
— Le plus grand plaisir qu’on puisse éprouver; le rossignol chante bien, mais il me semble que vous chantez bien mieux encore. Et puis ce n’est pas du tout la même chose; quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez, j’ai envie de pleurer ou bien j’ai envie de rire, et puis je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bête: quand vous chantez un air doux ou triste, cela me ramène auprès de mère Barberin, c’est à elle que je pense, c’est elle que je vois dans notre maison; et pourtant je ne comprends pas les paroles que vous prononcez, puisqu’elles sont italiennes.»
Je lui parlais en le regardant, il me sembla voir ses yeux se mouiller; alors je m’arrêtai et lui demandai si je le peinais de parler ainsi.
«Non, mon enfant, me dit-il d’une voix émue, tu ne me peines pas, bien au contraire, tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps; sois tranquille, je t’apprendrai à chanter, et, comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer et tu seras applaudi, tu verras....»
Il s’arrêta tout à coup, et je crus comprendre qu’il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinai point. Ce fut plus tard seulement que je les ai connues, beaucoup plus tard, et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi, que je raconterai lorsqu’elles se présenteront au cours de mon récit.
Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu’il avait déjà fait pour la lecture, c’est-à-dire qu’il recommença à tailler des petits carrés de bois, qu’il grava avec la pointe de son couteau.
Mais cette fois son travail fut plus considérable, car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l’alphabet.
Afin d’alléger mes poches, il utilisa les deux faces de ses carrés de bois, et, après les avoir rayées toutes deux de cinq lignes qui représentaient la portée, il inscrivit sur une face la clé de sol et sur l’autre la clé de fa. Puis, quand il eut tout préparé, les leçons commencèrent, et j’avoue qu’elles ne furent pas moins dures que ne l’avaient été celles de lecture. Plus d’une fois Vitalis, si patient avec ses chiens, s’exaspéra contre moi.
«Avec une bête, s’écriait-il, on se contient parce qu’on sait que c’est une bête, mais toi tu me feras mourir!»
Et alors, levant les mains au ciel dans un mouvement théâtral, il les laissait tomber tout à coup sur ses cuisses où elles claquaient fortement. Joli-Cœur, qui prenait plaisir à répéter tout ce qu’il trouvait drôle, avait copié ce geste, et, comme il assistait presque toujours à mes leçons, j’avais le dépit, lorsque j’hésitais, de le voir lever les bras au ciel et laisser tomber ses mains sur ses cuisses en les faisant claquer.
«Joli-Cœur lui-même se moque de toi!» s’écriait Vitalis.
Si j’avais osé, j’aurais répliqué qu’il se moquait autant du maître que de l’élève, mais le respect autant qu’une certaine crainte vague arrêtèrent toujours heureusement cette repartie; je me contentai de me la dire tout bas, quand Joli-Cœur faisait claquer ses mains avec une mauvaise grimace, et cela me rendait jusqu’à un certain point la mortification moins pénible.
Enfin les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine, et j’eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier.
Ce jour-là il ne fit pas claquer ses mains, mais il me donna deux bonnes petites tapes amicales sur chaque joue, en déclarant que, si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur.
Bien entendu, ces études ne se firent pas en un jour, et, pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois.
D’ailleurs, mon travail n’était pas régulier comme celui d’un enfant qui suit les classes d’une école, et c’était seulement à ses moments perdus que mon maître pouvait me donner mes leçons.
Il fallait chaque jour accomplir notre parcours, qui était plus ou moins long, selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres; il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette; il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à M. Joli-Cœur; il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner, et c’était seulement après tout cela qu’il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte, au pied d’un arbre, ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois.
Cette éducation ne ressemblait guère à celle que reçoivent tant d’enfants, qui n’ont qu’à travailler, et qui se plaignent pourtant de n’avoir pas le temps de faire les devoirs qu’on leur donne. Mais il faut bien dire qu’il y a quelque chose de plus important encore que le temps qu’on emploie au travail, c’est l’application qu’on y apporte; ce n’est pas l’heure que nous passons sur notre leçon qui met cette leçon dans notre mémoire, c’est la volonté d’apprendre.
J’EUS LA SATISFACTION DE SOLFIER UN AIR. (PAGE 66.)
Par bonheur, j’étais capable de tendre ma volonté sans me laisser trop souvent entraîner par les distractions qui nous entouraient. Qu’aurais-je appris, si je n’avais pu travailler que dans une chambre, les oreilles bouchées avec mes deux mains, les yeux collés sur un livre comme certains écoliers? Rien, car nous n’avions pas de chambre pour nous enfermer, et, en marchant le long des grandes routes, je devais regarder au bout de mes pieds, sous peine de me laisser souvent choir sur le nez.
Enfin j’appris quelque chose, et en même temps j’appris aussi à faire de longues marches qui ne me furent pas moins utiles que les leçons de Vitalis. J’étais un enfant assez chétif quand je vivais avec mère Barberin, et la façon dont on avait parlé de moi le prouve bien; «un enfant de la ville,» avait dit Barberin, «avec des jambes et des bras trop minces,» avait dit Vitalis; auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air, à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent, mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa, et je devins capable de supporter, sans en souffrir, le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues.
Et ce me fut un grand bonheur que cet apprentissage; il me mit à même de résister aux coups qui plus d’une fois devaient s’abattre sur moi, durs et écrasants, pendant ma jeunesse.