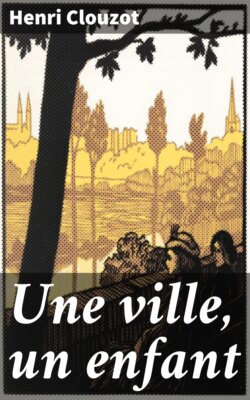Читать книгу Une ville, un enfant - Henri Clouzot - Страница 5
MONSIEUR DIDIER
ОглавлениеLA librairie s’ouvrait «sous» les Halles. Ainsi les bonnes gens, avant qu’une municipalité mal inspirée eût placé sous le vocable de Victor Hugo une rue où on n’eût pas trouvé un seul électeur capable de dire cent vers du poète, désignaient-elles la grande voie qui avait pris la place des anciennes halles, construites par Alphonse, frère de saint Louis, et démolies par les généraux républicains à l’approche des Vendéens.
Pour la maison qu’occupait la librairie, la désignation de «sous les Halles» n’avait rien d’anachronique, car elle datait du XVIIIe siècle, du XVIIe dans quelques parties, du temps où un banc dans le rang des bouchers ou des merciers du grand marché se transmettait de père en fils, comme une boutique du Palais-Royal à Paris. Les immeubles voisins, reconstruits, en avaient profité pour s’avancer sans vergogne de plusieurs mètres. La vieille maison restait modestement en arrière-plan, à l’ancien alignement, et tout embarrassée de sa façade. Elle avait eu sans doute fort bon air sous la toiture des halles, mais, privée de son abri, elle apparaissait désuète et gauche, comme un bernard-l’ermite sorti de sa coquille.
Dans le magasin, où l’on descendait par deux marches, en agitant au passage une grêle sonnette dont la porte vitrée déclanchait le ressort épileptique, M. Didier avait sa table de teneur de livres à gauche de l’entrée, en face du bureau où mon père donnait ses ordres aux employés, conversait avec les clients et expédiait lettres sur lettres de sa grande écriture, qu’on eût dit d’un élève de Brard et de Saint-Omer, et qu’il saupoudrait de flots de sciure de bois.
Le coin où régnait M. Didier était bizarrement disposé, même dans cette demeure où tout allait de guingois. Il trônait sous une arcade de pierre, reste sans doute d’une allée voûtée, qui descendait des Halles au Merdusson, et les désœuvrés, qui venaient bavarder avec lui en l’absence de mon père, avaient l’air de s’approcher d’un confessionnal. La balance de ses opérations devait se ressentir de ces dérangements incessants, car je ne me représente la venue de Didier dans l’appartement paternel qu’annonciatrice d’une erreur de caisse.
Qui était Didier? Je l’ai toujours ignoré et je m’en voudrais comme d’une profanation de faire à son sujet la moindre recherche d’état civil. Mes parents éludaient sur son compte mes questions d’enfant et savaient, si elles se prolongeaient, imposer silence à mon insistance. 11 était pour moi «Monsieur Didier» et c’était suffisant, car, dans cette cité des livres, il figurait le génie qui ouvrait les tiroirs défendus et me laissait jeter un coup d’œil sur les vignettes des cartonnages gaufrés et dorés. Ce veuf, aux cheveux rares et ramenés en couronne, n’ayant pas d’enfants, avait fait un peu les siens de ceux de son patron, de même que la librairie était devenue son domaine et son héritage.
L’amour du changement, au siècle dernier, ne troublait guère les employés. Didier était entré dans la maison au temps de la guerre de Crimée. Il avait écrit à M. de Lamartine pour lui envoyer des abonnements au Cours de Littérature et au père d’Anatole France pour lui annoncer traite. Les autres sous-ordre étaient des conscrits, en comparaison, mais des conscrits chevronnés. On ne renvoyait personne, dans notre maison. Mon père tempêtait à longueur de journée contre la négligence ou l’incapacité de ses employés, mais quand l’un d’eux venait lui annoncer son départ, il en était outré comme si on lui faisait une injure personnelle.
Je puis dire que j’ai connu un de ces commis d’autrefois, comme on en voit dans Balzac, un Anselme Popinot, qui n’avait d’autre dieu que son patron et d’autre ambition que la prospérité de la maison. Beaucoup plus que mon père, peu expansif avec ses enfants, comme on l’était alors dans notre classe de bonne bourgeoisie où l’on tenait plus au respect et à l’obéissance qu’aux démonstrations affectueuses (je pense avec quelle stupeur il verrait l’intimité proche de la camaraderie où j’ai élevé mes filles!), Didier était mon confident et mon guide. Je lui dois tous les petits tours de main qui m’ont depuis facilité mes besognes d’écrivain. Il m’enseigna entre autres à tailler les crayons et à compter les feuilles de papier en les disposant en éventail par une adroite pression des doigts, et ce n’est pas peu de chose.
C’est autour de Didier, beaucoup plus que de personne de ma famille, que se groupent mes plus lointains souvenirs; sans doute parce qu’il représentait pour moi la puissance bienfaisante et exorable en face des rigueurs paternelles. Je me vois — à moins qu’il ne s’agisse d’une tradition orale tant de fois contée qu’elle finit par s’incruster dans les terrains quaternaires de la mémoire — faisant le tour du comptoir rond, au milieu de la librairie, un carton sous le bras, et bien qu’encore en jupe, tel que le photographe Bourgoin, place du Temple, m’a représenté sur un gros mouton aux cornes dorées, faisant l’important en répétant: «Toto va au Lycée!»
Ceci, naturellement, se passait avant la Guerre. La Guerre! se peut-il qu’il faille ajouter: de 1870-71, et qu’un cataclysme de cinq ans ait fait oublier l’Année terrible? Où sont-ils les enfants d’alors, habillés en mobiles par leurs parents, gardes nationaux comme mon père, et faisant comiquement l’exercice sur le trottoir? En est-il qui se souviennent, comme moi, d’avoir vu passer dans la nuit, au-dessus de la Brèche, une lumière à peine plus visible qu’un ver luisant, fanal d’un ballon du Siège qui allait se perdre en mer? En est-il même qui se rappellent avoir été tirés de leur lit pour contempler le spectacle unique d’une aurore boréale, motif à rapprochement entre le ciel érubescent et le sang répandu sur les champs de bataille? La guerre de 1914-1918 a tué un million et demi d’êtres humains et on n’a vu aucune aurore boréale éclater sur nos têtes.
Dans ce magasin prestigieux, qui me faisait penser au vaisseau inépuisable de Robinson, un ordre minutieux assignait une place à chaque chose. Didier m’en découvrait un à un les mystères. Je savais où se trouvaient les romans à couverture jaune, les livres «poitevins», les classiques, les registres. Crayons et porte-plume avaient leurs cases, comme les pains à cacheter et les morceaux de colle à bouche, qui sont bien près de disparaître, et les papiers à lettres bordés de dentelle, qui ne sont plus qu’un souvenir. Les paroissiens et les livres d’étrennes aux tranches dorées avaient leur vitrine. Les grands tiroirs du comptoir servaient à ranger les cartes, les papiers à dessin et, ô joie! les images d’Epinal où j’ai découpé mes premiers soldats de carton, encore vêtus des uniformes de Malakof et de Solférino.
Derrière mon père, dans une vitrine, étaient rangés les encres de couleur, les encriers de cristal, les garnitures de bureau. Chaque fois qu’un client demandait un de ces articles, mon père devait se lever de son fauteuil pour permettre à l’employé d’ouvrir le vitrage. Telle était chez nous la force de la tradition que toute sa vie mon père conserva cette disposition sans en apercevoir la servitude. Il persista à se lever jusqu’au jour où il ne vint plus s’asseoir à cette place ni à aucune autre.
Notre maison était spacieuse et incommode. La salle à manger, au rez-de-chaussée, prenait jour sur une cour humide. On déjeunait à onze heures, on dînait à six.
Un long couloir pavé, fermé par une porte cloutée de trois pouces d’épaisseur, conduisait à la sortie, rue des Acacias. La cuisine, où régnait Mélie, avait d’énormes barreaux de fer, comme au temps où il fallait se protéger contre les malandrins. Dans la cheminée de pierre, monumentale, on eût pu rôtir un mouton. A côté, le potager, carrelé de faïence bleue, et dans un coin l’évier, garni de la buire et du seau surmonté de sa «coussotte». Cette pièce sombre était pour moi un séjour d’un divertissement perpétuel, depuis la venue quotidienne du boulanger, qui déposait ses pains chauds et dorés et cochait d’un trait décisif du couteau les «tailles» dans la marque en bois de châtaignier, jusqu’au passage intermittent du chasseur qui venait à la saison offrir une carnassière pleine d’oiseaux au plumage soyeux.
Je n’ai pas gardé mémoire des chambres à coucher. Si je revois encore mon berceau en forme de nacelle, avec ses rideaux montés sur col-de-cygne, — comme celui du Prince impérial, — c’est que ma mère l’avait soigneusement mis de côté pour l’usage de mes frères et sœurs à venir.
Je me souviens seulement que la chambre où je couchais avait ses fenêtres au midi, sur la calme petite rue des Acacias. Dès le matin, le soleil apparaissait avec le dialogue des pigeons sur le rebord des toits, et j’étais éveillé par leur friselis d’ailes quand le chien de l’épicier leur donnait la chasse dès qu’ils descendaient picorer sur le pavé. Vaine poursuite, éternellement reprise d’un bout à l’autre de la journée, du mois, de l’année. Puis la voix des cloches résonnait toute proche, annonçant les offices de Notre-Dame. Elles égrenaient aussi les heures et le beffroi du Pilori répétait les coups, sans que ces deux horloges se missent jamais d’accord, l’une ayant sans doute l’heure anglaise des Plantagenets et l’autre la vieille heure française du duc de Berry.
Des bruits humains mesuraient aussi le temps matinal. La ruelle était traversée par les cris des petits marchands. La vendeuse de caillebottes venait offrir son laitage: «Caillebottes fraîches!», le marchand de brioches criait: «Brioches... toutes chaudes!», le marchand d’oranges lançait en poussant sa voiture: «La Valence, la belle Valence!» Les jardinières sonnaient à la porte ou se faisaient reconnaître en disant: «V’lez-vous de moi, aujourd’hui?» Le poissonnier faisait:
«Court’marée, court’marée!». Puis, on entendait:
«Raccommodeur de faïence et de porcelaine!»,
«Vitrier!». Le chiffonnier, sa voiture attelée d’un petit âne, chantait:
J’agète la guenille,
Vieux habits, vieux souliers.
Le marchand les agète
Quoiqu’ils soient galonnés.
Et, pour ponctuer ces bruits, montait le tapage des marteaux du chaudronnier voisin, plus bruyants que les forges de Vulcain.
Si je n’ai pas souvenir des chambres, le salon «de compagnie», au premier étage, est d’autant plus vivant pour moi que son meuble de velours rouge, fauteuils, chaises et canapé, a été conservé par ma mère au cours de sa longue existence. Il me reporte, quand j’en effleure l’acajou, à nos élégances bourgeoises. Je revois la cheminée de marbre blanc, avec l’inévitable garniture de bronze doré, candélabres et pendule, dans le goût de l’Exposition de 1855, et ces ustensiles familiers que nos enfants ignoreront, les pincettes, le garde-étincelles et le soufflet. Le sujet qui surmontait le cadran était pathétique et ridicule. L’infortunée Henriette d’Angleterre, en robe à collerette Louis XIII, le visage encadré de boucles, comme sur un dessin de Devéria ou de Paul Delaroche, recommandait son âme à Dieu, sur un navire prêt à sombrer. Elle entourait de son beau bras nu un tronçon de mât, où pendait un lambeau de toile, grand comme un mouchoir de poche, tout ce qui restait de la grand’voile! A côté des candélabres plus ou moins pompéiens, deux cornets en porcelaine peints et dorés — de Jacob Petit peut-être — s’accolaient de sauvages armés d’arcs qui ne pouvaient être qu’Atala et Chactas.
On harmonisait alors les nuances dans l’appartement. Le velours des meubles était rouge, rouge le tapis moquette du milieu, rouges les draperies encadrant les rideaux de vitrage en mousseline, rouges les coussins à glands du canapé et les tabourets de pied. Seul le papier de tapisserie, à ramages dorés sur fond blanc, échappait à la règle. Mais les bordures, en papier velouté, étaient cramoisies. Pas plus que le décor officiel de la Troisième République, le luxe bourgeois ne se comprenait alors sans l’éclat du rouge et de l’or.
Une table de milieu ovale, à patins, occupait le centre, avec quelques chaises volantes autour, créations charmantes des ébénistes de l’Impératrice qui, sous une apparence de fragilité, offraient une solidité à toute épreuve. Au centre, dans un cristal à monture dorée, quelques fleurs et l’inévitable album de photographies, que l’on me laissait feuilleter pour récompenser ma sagesse. Le canapé était adossé au mur et les fauteuils formaient un cercle autour du foyer, mais je les voyais le plus souvent sous des housses, et je ne sais si je ne les aimais pas mieux ainsi.
Cette grande pièce, éclairée sur la rue des Halles par une fenêtre et une porte-fenêtre, tirait son charme de la terrasse sur laquelle elle s’ouvrait. Le retrait de notre maison sur les immeubles voisins avait permis d’établir une plate-forme au-dessus du magasin. Du haut de cet observatoire, garni par ma mère, infatigable jardineuse, de capucines et de volubilis, d’hémérocalles et d’anthémis, j’ai jeté mes premiers regards sur le monde. J’ai contemplé de prestigieux spectacles: la cavalcade du Cirque Américain, avec ses éléphants et ses chars; les processions de la Fête-Dieu, toutes paroisses réunies, sur le passage desquelles je lançais des roses effeuillées qui jonchaient tout juste les chapeaux des passants; le cortège du bœuf gras, avec ses tambours et ses sapeurs en bonnet à poil, la hache sur l’épaule, occasion pour les garçons bouchers de présenter à leurs clientes des bouquets de violettes et de «clochettes», ces blanches jacinthes rustiques qui annoncent le printemps dans les jardins niortais; le défilé des chamoiseurs, à la Saint-Jean, portant sur un brancard un putto plus frisé que l’agneau qui partageait avec lui les honneurs du pavois.
Sur notre terrasse, les soirs d’été, je guettais les notes de la retraite militaire, signal de la rentrée pour les cuirassiers et du coucher pour mon humble personne. Les trompettes s’entendaient de très loin. Elles partaient du Marché, suivaient la rue des Halles, puis la rue du Minage, la Brèche, pour rentrer au quartier par la rue des Douves. Do, sol, mi, do, do, mi, sol, do... Le refrain devenait de moins en moins distinct, à mesure qu’au-dessous de moi l’allumeur de gaz épinglait la rue déserte de clous d’or, et je faisais ainsi connaissance avec la tristesse du jour finissant.
Mais le coin de la vieille maison que j’affectionnais par-dessus tout, c’était le grenier qui servait de réserve aux marchandises. Je suis encore hanté, après plus d’un demi-siècle, par le parfum de cèdre et de vernis qui se dégageait, dans cette pièce surchauffée par le soleil, des boites de crayons, de porte-plume, de pots de gomme, et se mélangeait à celui des rames de papier entassées jusqu’à faire fléchir les vieux planchers sous leur poids.
La veille de Noël, après la fermeture du magasin, un branle-bas général s’organisait. On surmontait le meuble du milieu, réservé en temps ordinaire aux périodiques et aux nouveautés, d’une pyramide étagée. On dressait sur le comptoir des gradins recouverts d’andrinople rouge. Les montres elles-mêmes se garnissaient de panneaux écarlates. Didier, marteau en main, faisait «sa chapelle». Ainsi nommait-t-il ses préparatifs pour recevoir les livres d’étrennes, reposoir pompeux où allaient briller pendant trois semaines les ors des reliures, triomphe symbolique des œuvres de l’esprit sur les pralines, les chocolats et les jouets, cérémonie traditionnelle où les incroyants eux-mêmes sacrifiaient en achetant leur seul livre de l’année. L’autel dressé, on déballait les cartonnages, verts, jaunes, bleus, rouges, les reliures amateur en demi-maroquin, les Jules Verne, les albums de Stahl, illustrés par Frœlich, les volumes de la Bibliothèque rose, et c’est sans doute de ce moment que date ma passion invétérée pour le Général Dourakine et les pantalons brodés si comiques des Petites Filles modèles. J’offrais mon aide pour tenir en main ces trésors et glisser un coup d’œil sur les vignettes, enivrement d’un enfant sage qui ne rêvait — et pour cause — ni de tennis ni d’automobile!
J’ai peine à vous admirer, vitrines des grands magasins parisiens. Je trouve toujours quelque imperfection dans l’agencement ou le décor. C’est que j’ai connu, dès mes premiers pas dans la vie, l’enchantement d’un palais féerique et que la chapelle de M. Didier efface pour moi vos ingénieuses créations, ô Maurice Dufrêne, ô Paul Follot!