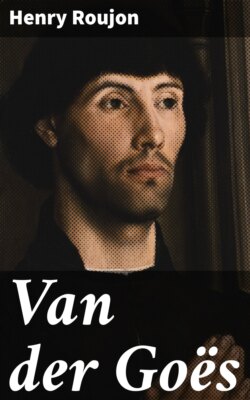Читать книгу Van der Goës - Henry Roujon - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHUGO VAN DER GOËS
Table des matières
(1420-1482)
Table des matières
L’ABSENCE, en tête de ce livre, de la vignette habituelle, dit assez la pénurie des documents en ce qui concerne Van der Goës. Nul peintre, nul graveur ne nous ont transmis son image. Dans la vie de cet artiste qui fut célèbre, les obscurités abondent. On ignore la date précise et même le lieu de sa naissance. Son œuvre elle-même a suscité les controverses. A perte de vue les critiques ont épilogué pour lui attribuer ou lui contester les tableaux incertains dont il eut pu être l’auteur. Tour à tour, suivant les opinions, on charge son nom d’une œuvre immense ou l’on réduit son bagage authentique au seul tryptique de Florence.
Certains musées s’enorgueillissent de tableaux de Van der Goës qu’on a d’excellentes raisons de considérer comme apocryphes; d’autres, au contraire, possèdent des œuvres où tout, même la signature, trahit la main du grand Flamand et n’osent pas en certifier l’authenticité. Une atmosphère de doute plane sur le peintre et sur sa peinture.
Comment expliquer les ténèbres dont s’enveloppe ce personnage, réputé cependant pour avoir tenu, de son vivant, le sceptre de la peinture dans les Flandres? Est-ce une simple ironie de la Destinée ou n’y a-t-il pas plutôt ingratitude flagrante de la postérité ?
Pour décider en pareille matière, il faut d’abord connaître l’époque à laquelle vécut Van der Goës et le pays auquel il appartint.
Et d’abord, constatons que ce peintre ne fut pas seul à subir cette disgrâce; il la partage avec bon nombre d’artistes du XVe siècle, même les plus illustres, tels que les frères Van Eyck et Rogier van der Weyden. Que savons-nous d’Hubert van Eyck? Avons-nous un portrait de lui? Sommes-nous bien certains que les deux têtes coiffées du bonnet d’hermine des électeurs, qui figurent dans un groupe de l’Adoration mystique, sont bien celles d’Hubert et de son frère? Pouvons-nous affirmer seulement qu’Hubert est bien l’auteur de ce tryptique ou tout au moins d’une partie de cette œuvre fameuse? Nous nous croyons mieux renseignés sur son cadet, mais qui peut dire si les toiles qui lui sont attribuées sont bien de lui et si au contraire il n’est pas le véritable auteur de bon nombre d’autres qu’on lui conteste? Van der Weyden, à première vue, semble moins énigmatique sans que, pour lui non plus, la critique arrive à s’accorder parfaitement.
L’explication de cette énigme, on la trouverait assez facilement dans la condition toute particulière qui était faite aux peintres de cette époque. Généralement attachés à quelque puissant seigneur, vivant dans les cours fastueuses de princes amis des arts, les peintres abdiquent en quelque sorte leur personnalité en même temps que leur indépendance. Ils sont appointés, défrayés, à l’abri du besoin, mais, quelque enviable qu’il paraisse, leur sort est l’ennemi de leur propre gloire. Ils vivent à la cour de leur protecteur, mais ils n’y figurent que comme de minces personnages; quel que soit leur génie, ils y jouent un rôle subalterne et ne s’égalent jamais aux gentilshommes ignorants et brutaux de l’entourage princier. On leur témoigne des égards, on apprécie leur mérite, et rien de plus; ils ne sortiront pas de la classe inférieure où les relègue leur naissance.
Pour comble de malechance, il ne leur reste plus aucun point de contact avec les roturiers dont ils se sont éloignés. Le peuple ne les connaît pas, ou, s’il les connaît, ils les assimile à cette noblesse détestée qui le pressure; leurs œuvres, quand il les voit, ne peuvent rien pour leur réputation, car elles n’éveillent que de vagues sentiments dans l’âme fruste et primitive des paysans. Connus des grands mais dédaignés d’eux, ignorés du vulgaire, leur existence reste anonyme et leur mémoire, après quelques générations, s’enveloppe d’obscurité. Egalement anonyme est leur labeur: travaillant pour le compte et sous les ordres de leur patron, ils n’affirment pas leur personnalité en signant leurs toiles; elles ne lui appartiennent pas. C’est pour cela que la plupart des œuvres de cette époque ne portent pas de signature et déroutent aujourd’hui la perspicacité des critiques.
LE TRYPTIQUE PORTINARI (Partie centrale)
(Musée des Offices, Florence)
La partie centrale de ce tryptique fameux représente la Vierge adorant l’Enfant Jésus. Ce trytique est, avec le célèbre rétable de Saint-Bavon, peint par les frères Van Eyck, l’une des œuvres artistiques les plus considérables du XVe siècle. Dans ce sujet tant de fois traité par les peintres de tous les pays, Van der Goës a déployé une science, une habileté que peu de ses successeurs ont égalée. La minutie du détail, poussée à l’extrême, loin de nuire à la beauté de l’ensemble, ajoute un charme de plus à cette scène biblique.
Il semble, malgré cela, que la tradition orale ou écrite devrait laisser des traces de ces hommes qui furent grands par leur génie. Les primitifs flamands n’eurent pas ce bonheur. Durant des siècles, leur art charmant a été méprisé. La Renaissance a feint d’ignorer ces “ gothiques ” naïfs et anachroniques qui paraient leurs Vierges de grandes robes de velours et qui habillaient les rois Mages de pourpoints et de chausses.
Plus équitable et moins exclusive, la critique moderne a fait un retour vers ces belles peintures du XIVe et du xv° siècle; elle en a compris le sentiment profond, l’inspiration réelle et la beauté sereine. Mais quand il s’est agi de faire, à chacun de ces délicieux artistes, la part de gloire qui lui revient, elle s’est heurtée aux incertitudes.
Pour Van der Goës, la destinée fut plus injuste encore, si possible. Van Eyck, lui, fut le familier de la Cour de Bourgogne; traité avec honneur par les gentilshommes, il possédait la faveur du duc lui-même qui, à plusieurs reprises, lui confia des missions diplomatiques importantes. Le patronage de ce prince éclairé et aimable n’était pas, d’ailleurs, très exigeant: Van Eyck vivait à Bruges le plus souvent et y exécutait de nombreux travaux pour les riches marchands de la ville ou pour les chapitres des paroisses. Il touchait, malgré cela, l’allocation annuelle attachée à son titre de peintre et de valet de chambre de Philippe le Bon.
Un jour, le trésorier de la cour imagina de supprimer la pension de Jean van Eyck sous le prétexte qu’il était toujours absent et qu’il n’accomplissait aucune peinture pour le compte du duc. Surpris de ne point recevoir les quartiers de sa pension, Van Eyck s’informa du motif et, l’ayant connu, s’adressa directement à Philippe le Bon et lui témoigna respectueusement mais fermement, son intention de renoncer à un honneur qui lui valait un tel affront. Cela ne faisait point l’affaire du duc qui mettait une coquetterie particulière à s’entourer d’artistes de talent et qui ne voulait en aucune façon se séparer de Jean van Eyck, qu’il estimait. Il morigéna sévèrement son argentier et veilla lui-même à ce que les arrérages impayés fussent exactement comptés. Il y ajouta même un cadeau.
Van der Goës ne bénéficia d’aucun avantage de ce genre. Sa vie fut modeste, retirée, et il ne connut ni la faveur des grands ni les douceurs de la renommée. Seuls, quelques bourgeois et quelques chanoines apprécièrent son art et confièrent au peintre l’exécution de tableaux religieux. Mais que valait cette gloire restreinte, comparée à l’éblouissante mémoire laissée par les Van Eyck, comparée surtout à l’espèce de dictature artistique que Rogier van der Weyden exerça si longtemps sur les pays de Flandre? Lorsque celui-ci eut disparu, Van der Goës réussit, après de nombreuses années de labeur, à se pousser au premier rang; ses compatriotes le considérèrent un moment comme le plus grand peintre de l’époque, mais cet éclat fut éphémère. Le génie s’éteignit brusquement, anéanti par une de ces catastrophes où sombre l’esprit avant le corps. Il devint fou.