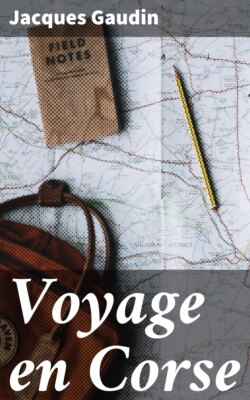Читать книгу Voyage en Corse - Jacques Maurice Gaudin - Страница 4
DISCOURS
ОглавлениеCE n’est point comme Ouvrage Littéraire que l’Auteur prétend recommander le Voyage au Niolo, en prose&en vers. Il ne fut dans l’origine destiné qu’à l’amusement de la Société qui l’avoit entrepris. On avoit droit de compter sur son indulgence, le Public a sans doute celui de le juger avec plus de sévérité. Je n’appellerai point de son arrêt, quel qu’il soit: s’il est favorable, je le devrai sans doute à la nature de mon sujet, à la nouveauté&à la variété des objets qu’il présente. D’autres auroient pu les embellir: je ne me suis piqué que de les rendre avec vérité.
Bachaumont&Chapelle, avec l’art précieux de répandre sur tous les sujets la gaîté qui les animoit, ont mérité de servir de modèle en ce genre. Leur facilité, quelquefois même d’heureuses incorrections, prêtent à leur ouvrage des graces charmantes, que plus de régularité auroit fait disparoître; l’air de négligence sied bien au milieu des désordres. d’un voyage: l’esprit ne doit pas y avoit plus de parure que l’ajustement, il ne doit être que facile&naturel; c’est ainsi qu’il se montre chez ces deux Auteurs. C’est le plaisir qui semble rendre compte lui-même de la route qu’il a suivie,&qui n’a cherché& apperçu que les objets qui pouvoient l’exciter.
Je n’avois point leurs talens, heureusement mon sujet ne les exigeoit pas. Il ne pouvoit guère intéresser que la curiosité, aussi c’est elle principalement que j’ai cherché à satisfaire. Je n’ai pas craint par cette raison de multiplier les détails&les observations; &quoique le goût pût m’objecter, mon premier but a été d’ être utile.
La Corse est la dernière acquisition dont notre Monarchie se soit accrue; elle étoit peu’connue de nous avant cette époque;&ce n’est pas dans le cours de la conquête qu’on a pu s’en former une juste idée. Car de quoi s’occupe-t-on alors? des marches, des campemens. Les dispositions belliqueuses du peuple, les moyens les plus sûrs de le réduire, voilà les seuls objets sur lesquels l’attention se porte. Ce n’est pas le tems d’avoir des vues d’amélioration, la guerre n’a jamais su que détruire. Quand on agite les quatre élémens renfermés dans le même vase, toutes les matières bouleversées ne présentent que confusion&désordre. Qu’attend-on pour les étudier? que le mouvement ayant cessé, chacune vienne à se rasseoir&à prendre sa place.
Les tems qui suivent immédiatement la guerre, ne peuvent aussi être employés qu’à reparer les ravages, sur-tout dans un pays nouvellement assujetti,& qu’on n’a pas eu encore le tems de connoître. Les corps&les esprits y font long-tems en mouvement; il faut les laisser rasseoir, les plier insensiblement à de nouvelles habitudes. L’étude des ressources d’un pays,&des moyens de les préparer, est nécessairement lente; tout systême d’amélioration est prématuré, s’il n’a l’expérience pour guide: c’est à elle feule à nous marquer le moment de la maturité.
Le long séjour que j’ai fait en Corse ma persuadé que nous sommes arrivés à cette époque: ayant–recueilli avec soin, toutes les lumières que pouvoient me fournir les Naturels,&les François les plus sages, je me fuis fait un devoir de rassembler ces observations,&d’y joindre les miennes. La mission qui m’avoit appellé dans cette Isle n’ayant pu être remplie, c’étoit pour moi le seul moyen de payer ma dette à ma patrie,&mon tribut de reconnoissance au peuple qui m’a accueilli.
J’ai cru d’ailleurs que la curiosité qui nous fait lire avec empressement,& qui a si fort multiplié parmi nous les relations étrangères, ne devoit pas moins s’intéresser à la description d’une de nos Provinces qui nous est peut-être encore plus inconnue. Que nous importe cette multitude de détails sur l’Amérique septentrionale, sur la Suisse, sur la Sicile,&tant d’autres pays qui n’ont que peu de liaison avec nous?, Dans la Corse au contraire, tout ce que nous découvrons peut être converti à notre usage.
Je fais que ces traits épars des diverses Sociétés servent à perfectionner l’étude de l’esprit humain; mais à cet égard le caractère Corse n’offre peut-être pas des traits moins originaux. Ce peuple livré depuis tant de siècles à des guerres destructives&toujours les. armes à la main, , soit contre ses tyrans, soit contre lui-même, a dû prendre des habitudes qui lui font propres. Cette longue anarchie éloignant la civilisation, &l’aspérité de sa situation le concentrant davantage dans sa demeure, peut-être est-il resté plus près de la nature que la plupart des peuples de l’Europe. Son extrême sobriété, son mépris du luxe, son assurance que ne peut intimider ni le rang ni la puissance, font des traits perdus depuis long-tems chez les Nations les plus civilisées.
On a beaucoup décrié sa passion pour la vengeance, on auroit dû placer à côté sa sensibilité pour les bienfaits: selon qu’il a été prévenu, son ame se porte vers l’une ou vers l’autre avec la même énergie; c’est la forme originelle de l’homme. Si les scènes de vengeance ont été plus multipliées dans cette Isle, ce n’est point la faute du peuple, mais celle des circonstances Le foible despote qui s’épuisa si long-tems pour l’asservir, ne pouvoit y parvenir qu’en le divisant: son étude constante fut de femer par-tout des haines, dont il recueilloit le fruit en empêchant la Nation de se réunir. Ses graces toujours assurées aux crimes qu’il avoit fait naître, perpétuoient dans tous les cœurs l’ardeur de la vengeance. Le peuple n’ayant point de justice à obtenir de son Gouvernement, étoit donc réduit à se la faire lui-même. Il rentroit ainsi dans l’état de nature. Il n’est pas étonnant que la passion, alors feule arbitre de son ressentiment, l’ait presque toujours porté à excès.
De-là dérivoit un état perpétuell de guerre de famille à famille, de particulier à particulier; ce qui est sans doute, pour une société, le dernier degré de misère&de dépravation: mais c’étoit le Gouvernement qui dépravoit le peuple; car dès qu’il a cessé d’avoir de l’influence, dès qu’à sa place s’est montrée une autorité régulière, impartiale, se chargeant feule de la vengeance publique, distribuant avec équité les peines&les récompenses, ces crimes ont absolument dispatu, l’ordre même s’est établi avec une facilité qu’on ne devoit pas attendre:& peut-être y a-t-il peu d’exemples chez les les Nations policées, d’une société où le vol, le meurtre,&tous les grands attentats contre la fûreté publique, soient plus rares qu’ils ne font aujourd’hui en Corse: jamais on ne s’assujettit si promtpement au frein des loix, après les avoir si long-tems méconnues.
Ce changement seul prouve ce qu’on peut attendre de ce peuple, si on a foin de préparer les réformes qu’on y voudra introduire. On ne peut y apporter plus de disposition; au génie ardent,&à l’imagination vive des pays méridionaux, il joint cette énergie de l’ame qui fut toujours le partage des insulaires&des habitans des montagnes. Que ne pourroit donc pas se promettre une instruction sage chez un peuple ainsi disposé&presque neuf, dans un tems où toutes les sciences se font doublement enrichies,&par les lumières qu’elles ont acquises,& par les préjugés qu’elles ont perdus. Combien d’essais heureux d’éducation pourroient-être tentés, qui serviroient peut-être à perfectionner la nôtre!
Ce dégoût du travail,&cette inertie qu’on leur reproche, ne font–ils pas encore la fuite inévitable de cette longue habitude, qui ne leur a appris qu’à manier les armes,&de cette malheureuse position qui les place toujours à une si grande distance de leurs biens. Mais ces obstacles peuvent se vaincre, quand les tems font arrivés, il dépend toujours de l’Administration de donner un autre cours aux esprits; elle a dans ses mains tous les ressorts qui en disposent: je vois même déjà un germe précieux de ce changement: la lassitude que le Corse commence à sentir de ses privations, depuis qu’il a eu fous les yeux le spectacle de nos jouissances.
Si du moral nous passons au physique, combien de détails propres à piquer notre curiosité,&auxquels la propriété doit ajouter un nouvel intérêt. Un terrain susceptible de toutes les cultures, sur-tout de celles qui font les plus rares dans nos climats; toutes les richesses de l’Histoire Naturelle, dispersées ou enfouies dans ses montagnes, si on a le courage d’aller les chercher; la situation de l’Isle qui la met également à portée de la France&de l’Italie, qui la plaçant sur le chemin du riche commerce du Levant, semble lui en donner les clefs; une multitude de ports creusés par la nature, ou que l’art pourroit y joindre; tous ces avantages presque également importans, soit que nous voulions en faire usage, soit que les laissant dans l’inaction, nous empêchions feulement nos rivaux d’en jouir.
Ils ont, il est vrai, été achetés à grands frais; l’or de la France n’a cessé de couler dans la Corse, soit pendant la Conquête, soit pendant les premières années qui l’ont suivies,&aujourd’hui même ces dépenses excèdent de beaucoup son produit; malheureusement ces dépenses ne font pas même un principe d’amélioration, parce que l’Isle n’en est que le dépôt passager, d’où elle ne cesse de les verser en Italie, pour affurer sa propre subsistance. Mais n’y a-t-il pas des moyens de les y fixer,&ne peut-on pas même tirer de son fond toutes les richeises qui lui font nécessaires?
La Corse peut être divisée en deu parties, l’une dont le fol est abondant, fertile, susceptible de toute espèce de culture: ce font les plaines&: en général presque tous les vallons. Cette partie est entièrement inhabitée,&presque inculte; l’autre ne présente que des montagnes, des rochers, des précipices. C’est-là qu’est répandue la population. De ce singulier partage, il résulte que tous les villages font pauvres&misérables, parce que le terrain voisin ne peut fournir à leur subsistance; que là où il est le plus productif, il demande une culture excessivement pénible,& qu’il est rare que l’Habitant ne soit pas obligé d’aller chercher dans les fonds &loin de sa demeure le supplément nécessaire à ses besoins. De-là le dégoût pour un travail que l’éloignement rend si laborieux,&que la différence de température peut rendre aisément funeste. Point de peuple qui placé dans les mêmes circonstances, ne fût également rebuté par ces deux obstacles; &ne devînt indolent&paresseux; c’est le vice radical qu’il faut guérir. Tous les remèdes qui ne l’attaqueront pas ne font que des palliatifs: ils peuvent prolonger la langueur; mais c’est une réfurreaion dont on a besoin.
La plupart de ces vallons nous offrent encore aujourd’hui quelques traces d’une ancienne habitation: la grande plaine d’Aléria, occupée par deux Colonies Romaines, devoit contenir une population nombreuse. Tout a disparu. Les guerres des Sarrasins, auxquelles succédèrent d’autres brigandages, forcèrent les Habitans de se réfugier sur les hauteurs. Ces terrains délaissés changèrent alors de nature; exposés au choc de tous les élémens, sans qu’aucun travail réparât leurs ravages, ils se couvrirent de plantes nuisibles,&d’eaux croupissantes. Ils sont ainsi devenus le siége d’une intempérie funeste. Mais l’infalubrité n’est-elle pas toujours le partage des pays inhabités?&l’absence des causes qui l’ont introduite, ne peut-elle pas la faire disparoître? que ne peut le travail de l’homme quand la prudence dirige ses moyens!
Je me suis permis d’exposer toutes les vues que la connoissance du pays m’a suggérées,&plus encore celles qui m’ont été indiquées par des hommes qui avoient plus de lumières&d’expérience que moi. J’ai pensé que si mon voyage pouvoit intéresser par la nouveauté des objets, des plans d’amélioration sur ce pays fatisferoient encore davantage. J’ai pu me tromper sans doute, mais mes erreurs ne pouvant nuire à personne, elles feront suffisamment rachetées s’il se trouve parmi elles une ou deux observations qui apportent quelque fruit. Un Ecrivain tire au moins cet avantage de son obscurité, que ne pouvant donner aucun poids à ses opinions, la vérité feule les accrédite,&que ses erreurs restent sans influence. Cette considération m’a enhardi à présenter les miennes.
Je l’ai fait d’autant plus volontiers; que j’ai cru n’appercevoir dans tous ceux qui m’ont parlé de la Corse, que des préjugés ou des idées peu justes sur le caractère des Habitans, sur leur état actuel,&sur les ressources du pays. C’est l’ancienne réputation qu’a laissé la conquête;&l’on veut toujours juger d’après elle: car dans tous les genres, les réputations, sur-tout en mal, survivent aux causes qui les ont fait naître, elles semblent exclure toute idée de changement: il est triste qu’on soit si léger à les établir, lorsqu’il est si difsicile de les détruire.
Enfin une dernière raison ma décidé: il m’a paru que le tems des réformes étoit arrivé, parce que le peuple se trouve au point de maturité qui le rend propre à les recevoir. Après une si longue anarchie, on avoit besoin d’un intervalle qui pût préparer le règne des loix&de l’ordre. Un peuple impatient du joug, , ne pouvoit rompre tout-à coup ses anciennes habitudes; il se seroit fait un point d’ honneur de sa résistance à de nouveaux usages: avant de le forcer de travailler à son bonheur, il falloit lui apprendre à le desirer.
Cette heureuse révolution a été l’ouvrage d’un seul homme. M. le Comte de Marbœuf, couvert de tous les lauriers militaires pour avoir préparé avec tant de sagesse&si bien secondé la conquête de la Corse, étoit destiné à recueillir sur ce théâtre toutes les espèces de gloire. Chargé du commandement de cette Province, il ne lui restoit plus qu’à y faire fleurir les vertus pacifiques; personne n’étoit plus propre à les y appeller par son exemple. Toujours calme&inaccessible aux passions, il contint les esprits ardens de ce peuple par deux ressorts auxquels on ne résiste point, une intelligence qui savoit tout prévoir,&une patience que rien ne pouvoit lasser. Non moins Citoyen que Militaire, il leur inspira pareillement le respect pour les loix, parce qu’il ne cessa jamais de les respecter lui-même.
–Sans rien ôter à sa dignité, il fut conserver dans lé commandement des mœurs simples, une vie éloignée de tout luxe&de toute ostentation, une facilité d’accès que peut–être jamais homme en place ne porta au même dégré; c’étoit l’indice de la bonté de son ame, les Corses en étoient également étonnés&attendris; d’un autre côté, cette affabilité servoit à éclairer sa vigilance. Encouragés par elle, souvent ils le prenoient pour arbitres de leurs différens,&se dépouilloient pour lui seul de leur défiance naturelle.
Par-là il prévenoit la naissance des troubles, que d’ailleurs il étoit toujours prêt à dissiper par son activité; c’est ainsi que dans le cours de peu d’années il les accoutuma au joug d’une dépendance régulière. Sans paroître avoir rien fait, M. le Comte de Marbœuf acheva l’ouvrage le plus important& le plus difficile, celui d’introduire le règne des loix&de l’ordre à la place de la licence,&de préparer ainsi le succès de toutes les institutions salutaires qui peuvent faire le bonheur de ce pays: ensorte que sa gloire se trouve d’avance liée avec celle de tous ses successeurs.
Il reçut le prix le plus noble de ses travaux&de ses services. Son nom écrit dans toutes les pages de la Réduction de cette Isle, le fut pareillement dans le cœur de tous les Habitans. De son vivant, ils s’étoient empressés de lui en donner des marques; elles ont encore plus éclaté à sa mort,&rien de plus touchant que le spectacle de la douleur universelle que la Nation a montrée après l’avoir perdu. Ce sentiment ne l’honore pas moins elle-même que celui qui en étoit l’objet,&présente le plus bel encouragement à ceux qui doivent courir la même carrière,