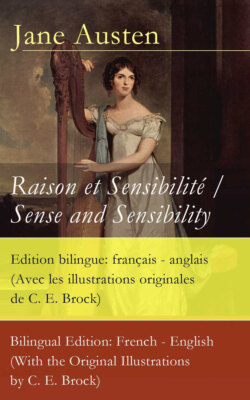Читать книгу Raison et Sensibilité / Sense and Sensibility - Edition bilingue: français - anglais - Jane Austen - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XXIII.
ОглавлениеTable des matières
Quelque peu de confiance qu’eût en général Elinor dans la véracité de Lucy, il lui était impossible de la suspecter dans cette occasion, ni de comprendre quel motif aurait pu l’engager d’inventer cette histoire. Il y avait non-seulement des probabilités, mais des preuves ; et rien ne contredisait Lucy, excepté son propre désir. Leur liaison presqu’au sortir de l’enfance dans la maison de M. Pratt ; et la visite d’Edward près de Plymouth ; et sa mélancolie, et l’inégalité de sa conduite avec Elinor ; et la grande connaissance que mesdemoiselles Stéeles avaient de Norland, et de toutes les relations de la famille Dashwood, ce qui l’avait souvent surprise ; et le portrait, et la lettre, et l’anneau : tout cela lui fournissait des preuves si convaincantes, que sa raison ne pouvait se refuser à la croire. Au premier moment, lorsqu’elle fut forcée d’admettre la parfaite vérité de tout ce que Lucy venait de lui dire, son ressentiment contre Edward, son indignation d’avoir été trompée l’emportèrent même sur sa douleur. Mais bientôt d’autres idées, d’autres considérations s’élevèrent. Edward avait-il eu l’intention de la tromper ? avait-il feint avec elle un sentiment qu’il n’avait pas ? Son cœur était-il de moitié dans ses engagemens avec Lucy ? Non ; et s’ils ont été une fois dictés par un amour de jeunesse, elle ne peut croire que cet amour existe encore à présent. elle a trop bien vu que c’était elle qu’il aimait pour n’en être pas convaincue. Un homme peut tromper avec de fausses paroles ; Edward n’a pas prononcé le mot d’amour à Elinor ; mais tout chez lui l’a prouvé, et son trouble, et ses regards, et le son tremblant de sa voix, et ses attentions si soutenues. Non, ce n’est point une erreur ; ni son cœur ni son amour-propre ne l’ont égarée. Sa mère, ses sœurs, Fanny, tout ce qui l’entourait à Norland s’en est aperçu. Certainement elle est aimée ; et cette persuasion console son cœur, calme ses peines et la dispose à pardonner. Il était blâmable cependant, hautement blâmable d’être resté à Norland lorsqu’il sentit qu’il l’aimait plus qu’il ne devait l’aimer. À cet égard elle ne pouvait le justifier ; mais s’il lui avait fait du mal par cette imprudence, combien ne s’en était-il pas fait davantage à lui-même ! La situation d’Elinor était triste sans doute, mais celle d’Edward était sans espoir. Elle était bien malheureuse dans ce moment, mais la raison guérirait peut-être la plaie de son cœur ; tandis qu’Edward en détachant le sien de la femme à qui il était engagé, s’était privé lui-même de tout espoir de bonheur. Elle retrouverait sa tranquillité, mais lui serait pour la vie livré à l’infortune. Pouvait-il espérer d’être heureux avec une femme telle que Lucy Stéeles ? À présent que le bandeau de l’amour était levé, même en mettant son inclination pour Elinor hors de la question, pouvait-il avec sa loyauté, sa délicatesse, son esprit cultivé être heureux avec une compagne ignorante, artificieuse, sans éducation, vaine, flatteuse, intéressée ? À dis-huit et dix-neuf ans il est si facile à un homme d’être entraîné par la beauté, par les prévenances d’une jeune fille qui peut-être cherchait à l’attirer, et d’être aveuglé sur ses défauts. Mais les quatre années suivantes, pendant lesquelles il avait acquis chaque jour plus de connaissances, plus d’expérience, une raison plus éclairée, devaient avoir ouvert ses yeux sur les vices de caractère de cette jeune personne, augmentés sans doute par la pauvre société où elle avait vécu, par un goût vif de plaisir et de frivolité, qui peut-être lui avait ôté cette simplicité de la première jeunesse, qui donne un caractère si intéressant à une jolie figure. Si, comme Elinor devait le croire d’après les insinuations de sa belle-sœur, il y avait des difficultés du côté de la mère d’Edward pour l’épouser, combien en trouverait-il davantage lorsqu’il serait question d’une personne qui lui est aussi inférieure en naissance, en bonne éducation, et probablement même en fortune ? Ces difficultés, il est vrai, ne devaient pas l’effrayer beaucoup ; mais quel triste sort que d’attendre peut-être sa liberté du mécontentement de sa mère et de son opposition à ses volontés.
Ces pensées, ces réflexions qui se succédaient les unes aux autres augmentèrent beaucoup sa tristesse. Elle pleura sur lui plus que sur elle même. Soutenue par la conviction de n’avoir rien fait pour mériter son malheur, et consolée par la croyance qu’Edward était encore digne de son estime, elle espéra qu’elle pourrait actuellement supporter ce cruel chagrin avec courage, et prendre assez de force sur elle-même pour le cacher à sa mère et à sa sœur. Elle en était si capable que, deux heures après avoir perdu pour jamais tout espoir d’être unie à celui qu’elle aimait si tendrement, elle parut à dîner avec un tel calme qu’on n’aurait jamais soupçonné, en la voyant à côté de la mélancolique Maria, que c’était elle qui était séparée pour toujours de l’objet de son amour, et que Maria convaincue de posséder en entier les affections de celui qu’elle aimait, espérait le voir arriver d’un moment à l’autre.
La nécessité de cacher à sa famille l’important secret que Lucy lui avait confié, fut un motif de plus pour elle de s’exercer à cacher en même temps le sien. Ce fut aussi une consolation de leur épargner ce qui leur aurait sûrement donné beaucoup d’affliction, et, à elle-même celle d’entendre blâmer Edward. Elles ne l’aimaient pas comme elle. Il n’aurait pas trouvé autant d’indulgence ; et prendre son parti, le défendre avait bien aussi son danger. Elle voulait chercher peu-à-peu à s’en détacher, au lieu de nourrir son sentiment ; elle savait qu’elle ne trouverait auprès d’elles ni conseil, ni aide pour une peine de cette nature. Leur chagrin, leur colère ajouteraient à son malheur ; et son courage ne pourrait que s’affaiblir. Elle était plus forte seule ; sa propre raison la servait mieux ; et sa fermeté se soutint si bien qu’on n’aperçut pas chez elle le moindre changement, et qu’elle fut invariablement aussi gaie, aussi sereine en apparence, quoique ses regrets et sa douleur intérieure fussent chaque jour plus poignants.
Mais plus elle avait souffert de sa première conversation avec Lucy, plus elle désirait connaître mieux en détail les particularités de leurs engagemens, découvrir ce que Lucy sentait réellement au fond de son cœur, si son amour pour Edward était vraiment tendre et sincère, et s’il y avait pour lui quelque chance de bonheur dans celle union. Alors elle aurait moins souffert. Elle voulait aussi prouver à Lucy par sa promptitude à parler d’Edward la première avec calme, qu’elle ne le regardait que comme un ami. Elle craignait que son agitation involontaire dans leur entretien du matin n’eût découvert en entier à Lucy ce qui jusqu’alors avait du moins été incertain. Il lui paraissait tout-à-fait probable que Lucy fût jalouse d’elle. Sans doute Edward lui avait parlé d’Elinor avec éloge, avec intérêt ; Lucy elle-même en était convenue. Les railleries de sir Georges sur les lettres initiales de son nom, devaient aussi avoir éveillé les soupçons ; et d’ailleurs Elinor était elle-même trop sûre d’être aimée d’Edward pour ne pas l’être de la jalousie de Lucy dont la confiance était une preuve. Quel autre motif donner pour excuser la révélation d’un secret important, et jusqu’alors si bien gardé, que celui de lui apprendre que Lucy avait des droits plus anciens et plus sacrés, et de l’engager à éviter à l’avenir la société d’Edward. Il était facile à Elinor de comprendre les intentions de sa rivale. Mais décidée comme elle l’était à se conduire d’après les principes que l’honneur et la délicatesse lui dictaient, elle résolut de combattre son affection pour Edward, de le voir aussi peu qu’il lui serait possible. Elle ne pouvait se refuser la consolation de tâcher de convaincre Lucy que ce sacrifice lui coûtait peu, et qu’elle ne regardait M. Ferrars que comme un ami de la famille. Elle ne pouvait plus rien entendre qui lui fit plus de peine que ce qu’elle avait déjà entendu ; elle n’aurait plus l’émotion de la surprise, et elle se croyait sûre d’apprendre sans trop d’agitation ce qu’elle ignorait encore.
Mais il lui fut impossible de satisfaire immédiatement sa curiosité ; quoique Lucy fût aussi bien disposée à parler encore qu’elle-même l’était à l’entendre. Une suite de mauvais temps empêcha de se promener, et quoiqu’elles se vissent tous les jours soit au Parc soit à la Chaumière, c’était au salon en présence de tout le monde. Elles n’avaient aucun prétexte pour se retirer à l’écart ; sir Georges ne l’aurait pas permis, à peine tolérait-il quelques momens de conversation générale. On se réunissait pour manger et rire ensemble, pour jouer aux cartes, danser, chanter, faire du bruit et des folies.
On s’était déjà rencontré plusieurs fois de cette manière, sans qu’Elinor eût la moindre occasion d’engager avec Lucy un entretien particulier, quand sir Georges vint un matin à la Chaumière, et demanda aux dames Dashwood comme une charité de venir dîner avec lady Middleton. Il était obligé pour une affaire d’aller à Exeter, et lorsqu’il n’était pas là, tout languissait au Parc, et ces dames couraient le risque de mourir d’ennui. Elinor espérant trouver plus de moyens d’arriver à son but et de causer avec Lucy dans l’absence de sir Georges, accepta d’abord l’invitation. Madame Dashwood aimait toujours mieux rester chez elle avec ses livres et sa petite Emma ; et Maria qui aurait préféré rester aussi dans sa romanesque solitude, ne put refuser d’accompagner sa sœur aînée.
Elles allèrent donc au Parc, et lady Middleton fut heureusement préservée de l’effrayante solitude qui la menaçait. L’insipidité de cette journée fut telle que mesdemoiselles Dashwood l’avaient prévu. Comme il n’y avait rien pour l’amour et le mariage, madame Jennings fut plus silencieuse qu’à l’ordinaire, et mesdemoiselles Stéeles encore plus prodigues de flatteries. Les enfans vinrent au dessert faire leur tapage accoutumé, et pendant qu’ils furent là, Lucy s’en occupa toute seule. Ils restèrent jusqu’après le thé, qui fut remplacé par la table de jeu. Elinor commençait à désespérer d’être un instant seule avec Lucy. On proposa un jeu général, et toutes les dames se levèrent pour se placer autour de la table.
— Je suis charmée, dit lady Middleton à Lucy, que vous ne finissiez pas le panier de ma pauvre petite Selina cette soirée ; vous seriez fatiguée en travaillant à ce petit filigramme à la lumière. La chère petite pleurera peut-être un peu demain matin lorsqu’elle ne le trouvera pas fini ; mais nous lui donnerons quelqu’autre chose et j’espère qu’elle se consolera. Ce mot était assez pour faire sentir à l’humble cousine ce que la faible mère attendait d’elle ; aussi répondit-elle à l’instant : vous vous trompez, milady ; pour rien dans le monde, je ne manquerai de parole à ma chère petite amie. J’attendais avec impatience que tout le monde fût au jeu pour me mettre à l’ouvrage ; je ne voudrais pas chagriner mon doux petit ange pour tous les plaisirs possibles. Il n’y en a pas de plus vif pour moi que de travailler pour elle ; et j’ai résolu de finir ce soir son panier.
— Vous êtes trop bonne, chère Lucy : sonnez, je vous prie pour qu’on vous donne des lumières ; ménagez vos yeux, je vous en conjure. Combien ma petite fille sera contente ! je lui ai dit que je ne croyais pas qu’il fût fini ; et elle m’a répondu en secouant sa petite tête, que je ne savais ce que je disais, et que sa chère Lucy lui ferait sûrement son panier.
Lucy courut auprès de la table d’ouvrage avec vivacité et gaîté, comme si le plus grand bonheur de sa vie eût été de faire un panier de filigramme pour une enfant gâtée.
Lady Middleton proposa alors de faire un wisk. Personne ne fit d’objection que Maria, qui avec son impolitesse ordinaire demanda qu’on voulût bien l’excuser. Milady, dit-elle, sait que je déteste le jeu ; je préfère si vous le permettez toucher du piano ; et sans attendre la réponse, sans aucune cérémonie, elle alla s’asseoir devant l’instrument. Lady Middleton leva les yeux au ciel comme pour le remercier de ce qu’elle était plus polie et mieux élevée que Maria. Elinor avait espéré de pouvoir se dispenser de jouer pour causer avec Lucy ; le refus de sa sœur la contrariait donc plus que personne, et cependant elle chercha à l’excuser auprès de lady Middleton. Ma sœur, lui dit-elle, ne sait pas résister quand elle vient au Parc au plaisir de jouer sur votre piano ; c’est le meilleur, dit-elle, qu’elle ait jamais rencontré ; et lady Middleton enchantée d’avoir le meilleur des pianos, fut tout-à-fait remise.
On n’était plus que quatre pour la partie. Elinor allait se soumettre à son sort ; lorsque Lucy s’écria tout-à-coup : ah ! comme je suis fâchée que mademoiselle Emma ne soit pas ici ; elle m’aurait aidée à rouler le papier. Je crains fort que malgré mon désir, je ne puisse pas achever ce soir mon panier.
— Si je n’étais pas obligée de jouer, dit Elinor, je m’offrirais bien volontiers pour cet ouvrage, d’autant plus que j’aurais désiré apprendre de vous à faire ces jolis paniers.
— Eh bien, ma chère, nous vous laisserons libre, dit lady Middleton, qui tremblait que sa petite Selina n’eût pas tout ce dont elle avait envie. N’est-ce pas, mesdames, nous jouerons fort bien nous trois, en laissant un jeu découvert ? Puisque vous voulez bien aider à Lucy, ma chère Elinor, Selina en sera fort reconnaissante. Je n’aime pas à la faire pleurer ; cela dérange sa jolie physionomie… Ne le trouvez-vous pas ?
Les choses s’arrangèrent ainsi : la partie à trois commença gaîment. Maria touchait son piano comme si elle eût été seule dans le salon. La table d’ouvrage était assez éloignée pour qu’Elinor pût espérer de n’être pas entendue ; les deux belles rivales s’assirent donc à côté l’une de l’autre dans la plus touchante harmonie pour travailler ensemble au panier de Sélina.