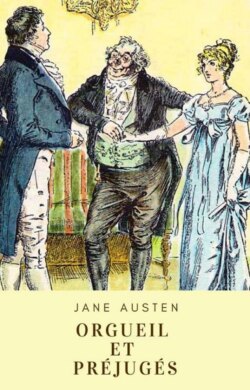Читать книгу Jane Austen : Orgueil et préjugés - Jane Austen - Страница 19
Chapitre 16
ОглавлениеAucune objection n’ayant été faite à la partie projetée, la voiture emporta le lendemain soir à Meryton Mr. Collins et ses cinq cousines. En entrant au salon, ces demoiselles eurent le plaisir d’apprendre que Mr. Wickham avait accepté l’invitation de leur oncle et qu’il était déjà arrivé. Cette nouvelle donnée, tout le monde s’assit et Mr. Collins put regarder et louer à son aise ce qui l’entourait. Frappé par les dimensions et le mobilier de la pièce, il déclara qu’il aurait presque pu se croire dans la petite salle où l’on prenait le déjeuner du matin à Rosings. Cette comparaison ne produisit pas d’abord tout l’effet qu’il en attendait, mais quand il expliqua ce que c’était que Rosings, quelle en était la propriétaire, et comment la cheminée d’un des salons avait coûté 800 livres à elle seule, Mrs. Philips comprit l’honneur qui lui était fait et aurait pu entendre comparer son salon à la chambre de la femme de charge sans en être trop froissée. Mr. Collins s’étendit sur l’importance de lady Catherine et de son château en ajoutant quelques digressions sur son modeste presbytère et les améliorations qu’il tâchait d’y apporter et il ne tarit pas jusqu’à
l’arrivée des messieurs. Mrs. Philips l’écoutait avec une considération croissante ; quant aux jeunes filles, qui ne s’intéressaient pas aux récits de leur cousin, elles trouvèrent l’attente un peu longue et ce fut avec plaisir qu’elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans le salon.
En voyant paraître Mr. Wickham Elizabeth pensa que l’admiration qu’il lui avait inspirée à leur première rencontre n’avait rien d’exagéré. Les officiers du régiment de Meryton étaient, pour la plupart, des gens de bonne famille et les plus distingués d’entre eux étaient présents ce soir-là, mais Mr. Wickham ne leur était pas moins supérieur par l’élégance de sa personne et de ses manières qu’ils ne l’étaient eux-mêmes au gros oncle Philips qui entrait à leur suite en répandant une forte odeur de porto.
Vers Mr. Wickham, – heureux mortel, – convergeaient presque tous les regards féminins. Elizabeth fut l’heureuse élue auprès de laquelle il vint s’asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama la conversation, bien qu’il ne fût question que de l’humidité de la soirée et de la prévision d’une saison pluvieuse, lui fit sentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénué d’intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et le charme de l’interlocuteur.
Avec des concurrents aussi sérieux que Mr. Wickham et les officiers, Mr. Collins parut sombrer dans l’insignifiance. Aux yeux des jeunes filles il ne comptait certainement plus, mais, par intervalles, il trouvait encore un auditeur bénévole dans la personne de Mrs. Philips et, grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesse en prenant place à la table de whist.
— Je suis encore un joueur médiocre, dit-il, mais je serai heureux de me perfectionner. Un homme dans ma situation…
Mais Mrs. Philips, tout en lui sachant gré de sa
complaisance, ne prit pas le temps d’écouter ses raisons.
Mr. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilli avec joie à l’autre table où il prit place entre Elizabeth et Lydia. Tout d’abord on put craindre que Lydia ne l’accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucoup les cartes et son attention fut bientôt absorbée par les paris et les enjeux. Tout en suivant la partie, Mr. Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Elizabeth. Celle-ci était toute disposée à l’écouter, bien qu’elle ne pût espérer apprendre ce qui l’intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec Mr. Darcy. Elle n’osait même pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouva cependant très inopinément satisfaite car Mr. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s’informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton et, sur la réponse d’Elizabeth, demanda avec une légère hésitation depuis quand y séjournait Mr. Darcy.
— Depuis un mois environ, et, pour ne pas quitter ce sujet elle ajouta : – J’ai entendu dire qu’il y avait de grandes propriétés dans le Derbyshire.
— En effet, répondit Wickham, son domaine est splendide et d’un rapport net de 10 000 livres. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre, car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de Mr. Darcy.
Elizabeth ne put retenir un mouvement de surprise.
— Je comprends votre étonnement, miss Bennet, si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d’hier. Connaissez-vous beaucoup Mr. Darcy ?
— Très suffisamment pour mon goût, dit Elizabeth avec vivacité. J’ai passé quatre jours avec lui dans une maison amie, et je le trouve franchement antipathique.
— Je n’ai pas le droit de vous donner mon opinion
sur ce point, dit Wickham ; je connais Mr. Darcy trop bien et depuis trop longtemps pour le juger avec impartialité. Cependant, je crois que votre sentiment serait en général accueilli avec surprise. Du reste, hors d’ici où vous êtes dans votre famille, vous ne l’exprimeriez peut-être pas aussi énergiquement.
— Je vous assure que je ne parlerais pas autrement dans n’importe quelle maison du voisinage, sauf à Netherfield. Personne ici ne vous dira du bien de Mr. Darcy ; son orgueil a rebuté tout le monde.
— Je ne prétends pas être affligé de voir qu’il n’est pas estimé au-delà de ses mérites, dit Wickham après un court silence ; mais je crois que pareille chose ne lui arrive pas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par sa fortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur de ses manières, et le voient tel qu’il désire être vu.
— D’après le peu que je connais de lui, il me semble avoir assez mauvais caractère.
Wickham hocha la tête sans répondre.
— Je me demande, reprit-il au bout d’un instant, s’il va rester encore longtemps ici.
— Il m’est impossible de vous renseigner là-dessus, mais il n’était pas question de son départ lorsque j’étais à Netherfield. J’espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région.
— Pour cela non. Ce n’est point à moi à fuir devant Mr. Darcy. S’il ne veut pas me voir, il n’a qu’à s’en aller. Nous ne sommes pas en bons termes, c’est vrai, et chaque rencontre avec lui m’est pénible mais, je puis le dire très haut, je n’ai pas d’autre raison de l’éviter que le souvenir de mauvais procédés à mon égard et le profond regret de voir ce qu’il est devenu. Son père, miss Bennet, le défunt Mr. Darcy, était le meilleur homme de l’univers et l’ami le plus sincère que j’aie jamais eu : je ne puis me trouver en présence de son fils sans être ému jusqu’à l’âme par mille
souvenirs attendrissants. Mr. Darcy s’est conduit envers moi d’une manière scandaleuse, cependant, je crois que je pourrais tout lui pardonner, tout, sauf d’avoir trompé les espérances et manqué à la mémoire de son père.
Elizabeth de plus en plus intéressée ne perdait pas une seule de ces paroles, mais le sujet était trop délicat pour lui permettre de poser la moindre question.
Mr. Wickham revint à des propos d’un intérêt plus général : Meryton, les environs, la société. De celle-ci, surtout, il paraissait enchanté et le disait dans les termes les plus galants.
— C’est la perspective de ce milieu agréable qui m’a poussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà de réputation et mon ami Denny a achevé de me décider en me vantant les charmes de sa nouvelle garnison et des agréables relations qu’on pouvait y faire. J’avoue que la société m’est nécessaire : j’ai eu de grands chagrins, je ne puis supporter la solitude. Il me faut de l’occupation et de la compagnie. L’armée n’était pas ma vocation, les circonstances seules m’y ont poussé. Je devais entrer dans les ordres, c’est dans ce but que j’avais été élevé et je serais actuellement en possession d’une très belle cure si tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlions tout à l’heure.
— Vraiment !
— Oui, le défunt Mr. Darcy m’avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J’étais son filleul et il me témoignait une grande affection. Jamais je ne pourrai trop louer sa bonté. Il pensait avoir, de cette façon, assuré mon avenir ; mais, quand la vacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice.
— Grand Dieu ! Est-ce possible ? s’écria Elizabeth. Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de ses dernières volontés ? Pourquoi n’avez-vous pas eu recours à la justice ?
— Il y avait, par malheur, dans le testament un vice de forme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyal n’aurait jamais mis en doute l’intention du donateur. Il a plu à Mr. Darcy de le faire et de considérer cette recommandation comme une apostille conditionnelle en affirmant que j’y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu’il y a de certain, c’est que le bénéfice est devenu vacant il y a deux ans exactement, lorsque j’étais en âge d’y aspirer, et qu’il a été donné à un autre : et il n’est pas moins sûr que je n’avais rien fait pour mériter d’en être dépossédé. Je suis d’une humeur assez vive et j’ai pu dire avec trop de liberté à Mr. Darcy ce que je pensais de lui, mais la vérité c’est que nos caractères sont radicalement opposés et qu’il me déteste.
— C’est honteux ! Il mériterait qu’on lui dise son fait publiquement.
— Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l’autre, mais ce n’est point moi qui le ferai. Il faudrait d’abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père.
De tels sentiments redoublèrent l’estime d’Elizabeth, et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plus séduisant.
— Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ont donc pu le pousser, et le déterminer à si mal agir ?
— Une antipathie profonde et tenace à mon égard, – une antipathie que je suis forcé, en quelque mesure, d’attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins d’affection pour moi, le fils m’aurait sans doute mieux supporté. Mais l’amitié vraiment peu commune que son père me témoignait l’a, je crois, toujours irrité. Il n’était point homme à accepter l’espèce de rivalité qui nous divisait et la préférence qui m’était souvent manifestée.
— Je n’aurais jamais cru Mr. Darcy aussi vindicatif. Tout en n’éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne le jugeais pas aussi mal. Je le supposais bien
rempli de dédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pas capable de s’abaisser à une telle vengeance, – de montrer tant d’injustice et d’inhumanité.
Elle reprit après quelques minutes de réflexion :
— Je me souviens cependant qu’un jour, à Netherfield, il s’est vanté d’être implacable dans ses ressentiments et de ne jamais pardonner. Quel triste caractère !
— Je n’ose m’aventurer sur ce sujet, répliqua Wickham. Il me serait trop difficile d’être juste à son égard.
De nouveau, Elizabeth resta un moment silencieuse et pensive ; puis elle s’exclama :
— Traiter ainsi le filleul, l’ami, le favori de son père !… Elle aurait pu ajouter « un jeune homme aussi sympathique » ! Elle se contenta de dire : – et, de plus, un ami d’enfance ! Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble ?
— Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l’enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Mon père, à ses débuts, avait exercé la profession où votre oncle Philips semble si bien réussir, mais il l’abandonna pour rendre service au défunt Mr. Darcy et consacrer tout son temps à diriger le domaine de Pemberley. Mr. Darcy avait pour lui une haute estime et le traitait en confident et en ami. Il a souvent reconnu tous les avantages que lui avait valus l’active gestion de mon père. Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de se charger de mon avenir et je suis convaincu que ce fut autant pour acquitter une dette de reconnaissance envers mon père que par affection pour moi.
— Que tout cela est extraordinaire ! s’écria Elizabeth. Je m’étonne que la fierté de Mr. Darcy ne l’ait pas poussé à se montrer plus juste envers vous, que
l’orgueil, à défaut d’un autre motif, ne l’ait pas empêché de se conduire malhonnêtement – car c’est une véritable malhonnêteté dont il s’agit là.
— Oui, c’est étrange, répondit Wickham, car l’orgueil, en effet, inspire la plupart de ses actions et c’est ce sentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de la vertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avec nous-mêmes, et, dans sa conduite à mon égard, il a cédé à des impulsions plus fortes encore que son orgueil.
— Pensez-vous qu’un orgueil aussi détestable puisse jamais le porter à bien agir ?
— Certainement ; c’est par orgueil qu’il est libéral, généreux, hospitalier, qu’il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L’orgueil familial et filial – car il a le culte de son père – est la cause de cette conduite. La volonté de ne pas laisser se perdre les vertus traditionnelles et l’influence de sa maison à Pemberley est le mobile de tous ses actes. L’orgueil fraternel renforcé d’un peu d’affection fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur, et vous l’entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus dévoué.
— Quelle sorte de personne est miss Darcy ?
Wickham hocha la tête.
— Je voudrais vous dire qu’elle est aimable, – il m’est pénible de critiquer une Darcy, – mais vraiment elle ressemble trop à son frère : c’est la même excessive fierté. Enfant, elle était gentille et affectueuse, et me témoignait beaucoup d’amitié. J’ai passé des heures nombreuses à l’amuser, mais, aujourd’hui je ne suis plus rien pour elle. C’est une belle fille de quinze ou seize ans, très instruite, m’a-t-on dit. Depuis la mort de son père elle vit à Londres avec une institutrice qui dirige son éducation.
Elizabeth, à diverses reprises, essaya d’aborder d’autres sujets mais elle ne put s’empêcher de revenir au premier.
— Je suis étonnée, dit-elle, de l’intimité de Mr. Darcy avec Mr. Bingley. Comment Mr. Bingley, qui semble la bonne humeur et l’amabilité personnifiées, a-t-il pu faire son ami d’un tel homme ? Comment peuvent-ils s’entendre ? Connaissez-vous Mr. Bingley ?
— Nullement.
— C’est un homme charmant. Il ne connaît sûrement pas Mr. Darcy sous son vrai jour.
— C’est probable, mais Mr. Darcy peut plaire quand il le désire. Il ne manque pas de charme ni de talents ; c’est un fort agréable causeur quand il veut s’en donner la peine. Avec ses égaux il peut se montrer extrêmement différent de ce qu’il est avec ses inférieurs. Sa fierté ne l’abandonne jamais complètement, mais, dans la haute société, il sait se montrer large d’idées, juste, sincère, raisonnable, estimable, et peut-être même séduisant, en faisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur.
La partie de whist avait pris fin. Les joueurs se groupèrent autour de l’autre table et Mr. Collins s’assit entre Elizabeth et Mrs. Philips. Cette dernière lui demanda si la chance l’avait favorisé. Non, il avait continuellement perdu et, comme elle lui en témoignait son regret, il l’assura avec gravité que la chose était sans importance ; il n’attachait à l’argent aucune valeur et il la priait de ne pas s’en affecter.
— Je sais très bien, madame, que lorsqu’on s’assied à une table de jeu l’on doit s’en remettre au hasard, et mes moyens, c’est heureux, me permettent de perdre cinq shillings. Beaucoup sans doute ne peuvent en dire autant, mais, grâce à lady Catherine de Bourgh, je puis regarder avec indifférence de pareils détails.
Ces mots attirèrent l’attention de Mr. Wickham et, après avoir considéré Mr. Collins un instant, il demanda tout bas à Elizabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh.
— Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du tout
comment Mr. Collins a été présenté à cette dame mais je suis certaine qu’il ne la connaît pas depuis longtemps.
— Vous savez sans doute que lady Catherine de Bourgh et lady Anne Darcy étaient sœurs et que, par conséquent, lady Catherine est la tante de Mr. Darcy.
— Non vraiment ! J’ignore tout de la parenté de lady Catherine. J’ai entendu parler d’elle avant-hier pour la première fois.
— Sa fille, miss de Bourgh, est l’héritière d’une énorme fortune et l’on croit généralement qu’elle et son cousin réuniront les deux domaines.
Cette information fit sourire Elizabeth qui pensa à la pauvre miss Bingley. À quoi serviraient tous ses soins, l’amitié qu’elle affichait pour la sœur, l’admiration qu’elle montrait pour le frère si celui-ci était déjà promis à une autre ?
— Mr. Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de bien de lady Catherine et de sa fille. Mais, d’après certains détails qu’il nous a donnés sur Sa Grâce, je le soupçonne de se laisser aveugler par la reconnaissance, et sa protectrice me fait l’effet d’être une personne hautaine et arrogante.
— Je crois, répondit Wickham, qu’elle mérite largement ces deux qualificatifs. Je ne l’ai pas revue depuis des années mais je me rappelle que ses manières avaient quelque chose de tyrannique et d’insolent qui ne m’a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement mais je crois qu’elle doit cette réputation pour une part à son rang et à sa fortune, pour une autre à ses manières autoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu qui a décidé que tous les membres de sa famille étaient des êtres supérieurs.
Elizabeth convint que c’était assez vraisemblable et la conversation continua de la sorte jusqu’à l’annonce du souper qui, en interrompant la partie de cartes, rendit aux autres dames leur part des attentions de Mr. Wickham. Toute conversation était
devenue impossible dans le brouhaha du souper de Mrs. Philips, mais Mr. Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu’il disait était si bien exprimé, et tout ce qu’il faisait était fait avec grâce.
Elizabeth partit l’esprit rempli de Mr. Wickham. Pendant le trajet du retour elle ne pensa qu’à lui et à tout ce qu’il lui avait raconté ; mais elle ne put même pas mentionner son nom car ni Lydia, ni Mr. Collins ne cessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur la partie de cartes, sur les fiches qu’elle avait gagnées et celles qu’elle avait perdues et Mr. Collins avait tant à dire de l’hospitalité de Mr. et de Mrs. Philips, de son indifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper, de la crainte qu’il avait d’être de trop dans la voiture, qu’il n’avait pas terminé lorsqu’on arriva à Longbourn.
q