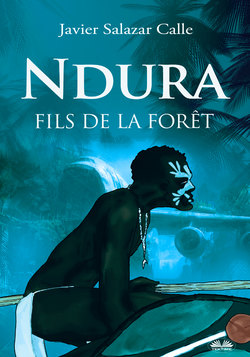Читать книгу Ndura. Fils De La Forêt - Javier Salazar Calle - Страница 6
1er JOUR
ОглавлениеLE DEBUT DE CETTE ETONNANTE HISTOIRE
Je regardai l’horloge. L’avion qui allait nous ramener en Espagne décollerait dans deux heures. Alex, Juan et moi-même nous trouvions déjà dans la zone des boutiques de l’aéroport de Windhoek, où nous écoulions les dernières monnaies locales et achetions, au passage, ce fameux cadeau que l’on laisse toujours pour la fin. Nous avions déjà mangé et il ne nous restait qu’à faire les boutiques. J’avais acheté à mon père un couteau au manche en bois où était gravé le nom du pays, Namibie, et toutes sortes de figurines animales, en bois également, finement taillées, pour les autres personnes. En particulier, j’avais pris pour ma petite amie Elena, une magnifique girafe taillée à la main dans un village typique de la savane africaine. Alex s’était trouvé une sarbacane et un grand nombre de flèches, pour, selon ses dires, jouer avec la cible des fléchettes et varier le jeu, lui donnant ainsi une orientation, dirons-nous, plus tribale. Nous avions passé une heure à déambuler d’un côté et de l’autre, sac à dos à l’épaule, profitant des derniers instants dans ce pays exotique. Jusqu’à l’appel pour l’embarquement. Comme nous avions déjà enregistré nos bagages, nous nous sommes directement dirigés vers la porte indiquée. Peu de temps après, ayant pris quelques photos de l’appareil, nous nous sommes assis sur nos sièges à l’intérieur de l’avion, un ancien modèle quadrimoteur à hélices. Notre safari de 15 jours sur tous terrains parmi la savane sauvage africaine prenait fin et, même si ces terres allaient nous manquer, nous avions bien envie d’une douche chaude et d’un véritable repas, à l’espagnole. Il était, malgré tout, dommage de s’en aller à ce moment-là, puisqu’on nous avait dit que, dans quelques jours, aurait lieu l’une des plus impressionnantes éclipses de soleil de ces dix dernières années et que la zone d’Afrique où nous nous trouvions était la meilleure pour la voir distinctement.
J’étais le plus motivé et le plus aventurier des trois et j’avais fini par les convaincre de venir ici avec moi car c’était une chose d’avoir l’esprit aventurier et une autre de s’en aller sans compagnie. Au début, ils avaient été réticents à l’idée d’abandonner leurs projets de vacances décontractées dans le nord de l’Italie, pour un safari photographique, soi-disant incommode, dans un lieu aux températures supérieures à 40º toute la journée et dépourvu d’ombre pour se protéger. Une fois l’expérience finie, ils ne regrettaient absolument pas, au contraire, ils recommenceraient sans y réfléchir à deux fois. L’appareil nous amènerait à plus de 1.000 kilomètres au nord, jusqu’à un autre aéroport international, où nous ferions la liaison avec les lignes aériennes européennes, modernes et confortables, pour rentrer chez nous.
Après le décollage, nous avons passé notre temps à visionner les photos sur l’appareil numérique d’Alex. Il y en avait une très drôle d’Alex et Juan courant, épouvantés, un gnou de mauvaise humeur les suivant, à la charge. Tandis qu’ils finissaient de les regarder, entre rires et souvenirs, je me plongeai dans mes pensées en regardant par le hublot, voyant passer les nuages tout autour. Je me sentais très bien. Je rentrais à la maison après une merveilleuse aventure dans un pays incroyable avec mes deux meilleurs amis que je connaissais depuis l’école. C’était comme si nous avions pris part à un reportage du National Geographic, ceux que j’aimais tant regarder à la télévision pendant que je mangeais. Un safari en 4x4, suivant la trace des grandes migrations de gnous, photographiant les troupeaux d’éléphants ou observant les célèbres lions à quelques mètres de distance, en pleine savane sauvage africaine. Nous avions vu des combats d’hippopotames, des crocodiles en attente, à la recherche d’une proie, des hyènes avides de charogne, des vautours volant en cercle au-dessus d’un cadavre, d’étranges reptiles, toutes sortes d’insectes; nous avions campé dans des tentes au milieu de nulle part, dîné à la lueur d’un feu de bois sous un ciel limpide, constellé d’étoiles… une merveilleuse expérience. Surtout la visite de l’Etosha National Park.
Au-dessous, contrastant avec ce que nous avions vu jusque-là, tout n’était qu’une immense tache verte. Nous traversions la zone de l’équateur. La forêt, verte frondaison sans fin, recouvrait tout. L’objectif de notre prochain voyage serait quelque chose de ressemblant à cela : une remontée en barque du fleuve Amazone, avec des arrêts prévus afin de profiter des innombrables formes de vie endémiques. Il nous avait été donné de voir l’immensité d’une savane déboisée et je voulais maintenant voir la magnificence d’une mer de végétation, débordante de vie. Pouvoir avancer à coups de machette à travers la forêt presque impraticable, apprendre à trouver des aliments, connaitre les tribus isolées de toute civilisation, voir des animaux et des plantes exotiques… mais bon, cela serait pour l’an prochain, si j’arrivais à convaincre à nouveau mes amis; et sinon, le nord de l’Italie n’est pas mal non plus.
Un grand bruit, comme une explosion, suivi d’un mouvement très brusque de l’avion m’arracha à mon monde de fantaisies. L’appareil commença à faire des soubresauts dans les airs et j’eus bientôt l’impression d’être monté sur une montagne russe. Je me retrouvai par terre, au milieu du couloir, projeté sur une dame. Je me levai tant bien que mal et me rassis, essayant de ne pas tomber à nouveau. Des cris de panique résonnaient partout. La confusion était totale.
– Au feu, au feu! L’aile a été touchée! – cria quelqu’un assis du côté du couloir opposé au mien.
– A droite! – signala un autre passager.
Au début, je ne savais pas à quoi tout cela faisait référence, mais lorsque je regardai par le hublot de son côté, je vis une grande fumée épaisse. Comme si l’appareil était plongé dans la nuit, une nuit tragique. L’avion décrivait des mouvements chaque fois plus brusques. Certaines personnes commencèrent à crier. L’on entendit dans les haut-parleurs la voix fébrile et à peine audible du pilote nous disant que la guérilla du Congo, que nous survolions à présent, nous avait lancé un missile et que nous allions devoir réaliser un atterrissage d’urgence. Une femme eût une attaque d’hystérie et deux hôtesses et un homme qui proposa son aide durent la faire asseoir et l’attacher. Nous nous sommes assis rapidement, tous les trois, avons resserré nos ceintures et avons adopté la position que nous avait indiquée l’hôtesse après être montés dans l’avion, la tête entre les genoux, le regard rivé sur le sol en métal, peu rassurant. Nous étions terrorisés. Tandis que je me trouvai dans cette posture incommode, je me rappelai qu’une fois, au journal télévisé, j’avais entendu parler de ces rebelles qui s’autofinançaient puisqu’ils contrôlaient l’une des mines du pays. Une mine de diamants ou de coltan, minerai de prix contenant un métal indispensable à la fabrication des puces des téléphones portables, des puces électroniques ou des composants de centrales nucléaires. C’était une sorte de guerre civile sanglante, dans laquelle les pays limitrophes avaient des intérêts économiques et militaires. Elle durait depuis plus de vingt ans et ne semblait pas près de cesser.
Les secousses étaient si fortes qu’elles me projetaient en avant, encore et encore, avec un tel élan que la ceinture de sécurité me comprimait l’estomac, me laissant le souffle coupé, et que ma tête s’en venait frapper le siège de devant. Je me rendis compte que le nez de l’avion pointait vers le sol, amorçant une descente vertigineuse. Le bruit était infernal, comme si des milliers de moteurs tournaient à plein régime en même temps. Juste avant de toucher le sol, le pilote fit une dernière annonce par les haut-parleurs : il allait tenter un atterrissage d’urgence dans une clairière qu’il avait localisée. Ma dernière pensée fut que le choc allait tous nous tuer. Après, tout fut confusion, de grands bruits, des chocs, l’obscurité…
Lorsque je repris connaissance, j’avais un très fort mal de tête. Je portai la main à mon front et vis que je saignais un peu. J’avais, de plus, des contusions et des griffures sur tout le corps; surtout une grosse éraflure, la peau rougie par le frottement de la ceinture. Je passai mes doigts dessus et sentis une forte brûlure qui me fit serrer violemment les dents. Je regardai mes amis, Juan paraissait commotionné, il émettait une sorte de grognement de plainte et remuait un peu, Alex… Alex ne bougeait pas du tout, son visage, auparavant toujours joyeux et animé, était complètement pâle, l’air figé. Du sang jaillissait en abondance de sa nuque. Je l’appelai désespérément, à plusieurs reprises. Je touchai son visage sans vie, je le pris entre mes mains et l’agitai doucement, appelant, implorant. Alex était mort. Mort. Ce mot résonna plusieurs fois dans ma tête, comme répondant à son propre écho. Mort.
Affligé, dépassé par la situation, j’essayais de réagir. Un bruit martelait ma tête : boum–boum–boum, probablement à cause du choc. Attendez, ce n’était pas dans ma tête, on entendait au loin le son de tambours jouant toujours le même rythme. On aurait dit que quelqu’un communiquait à distance.
– Merde! – pensai-je.
Je me levai en titubant, une idée me vint à l’esprit. Si les guérilleros nous ont abattu, ils viendront ici et nous feront prisonniers ou peut-être même qu’ils nous tueront. Il fallait partir immédiatement. Ma première réaction fut d’alerter Alex, mais lorsque je tournai la tête et le vis à nouveau, je repris conscience de sa mort. Je restai immobile quelques secondes jusqu’à ce que je parvienne à réagir. Je m’approchai de Juan, qui était toujours sur son siège et s’était agité une ou deux fois, comme quelqu’un qui dort et qui fait un cauchemar.
– Juan – balbutiai-je– il faut que nous partions d’ici.
– Et Alex? – bredouilla-t-il sans ouvrir les yeux.
– Alex, Alex est mort, Juan – lui répondis-je en essayant de ne pas m’effondrer –. Allez, Alex est mort et nous le serons aussi si nous ne nous en allons pas. Il est mort.
Je cherchai, en chancelant, mon sac à dos parmi le chaos jusqu’à ce que je le trouve. Je le pris et me dirigeai vers l’arrière de l’avion. Là, un des côtés était en feu et il faisait très chaud. La cabine entière était remplie de personnes pêle-mêle, adoptant les postures les plus insolites, certains étaient blessés, d’autres cherchaient à réagir, d’autres étaient morts. De tous côtés provenaient des cris, des gémissements, des murmures. J’atteignis la partie cuisine et je mis dans mon sac tout ce que je trouvai: des canettes de rafraîchissements, des sandwichs, des boîtes de choses non identifiées, une fourchette. Quand le sac fut plein je revins auprès de Juan et pris son sac, qui se trouvait sur une dame ; je mis dedans des couvertures de l’avion. Alors je me souvins de la trousse à pharmacie et je retournai à la cuisine. Elle s’y trouvait, par terre, ouverte avec tous les produits éparpillés. Je recueillis du mieux possible ceux qui étaient le plus près et sortis chercher Juan.
– Allez, Juan, on file d’ici.
– Je ne peux pas – murmura-t-il – tout me fait mal.
– Allez, Juan, tu dois te lever ou ils nous tueront tous. Je vais laisser les sacs dehors et je reviens te chercher.
– D’accord, d’accord, je vais essayer – me répondit-il, en s’agitant légèrement sur son siège.
Je pris les deux sacs à dos et sortis, titubant encore un peu étant donné la violence de la secousse. Je dus faire un très gros effort pour ne pas m’arrêter en chemin pour aider les autres personnes, mais je ne savais pas de combien de temps je disposais. J’avais seulement envie de vivre. Vivre un jour de plus pour voir, une nouvelle fois, le soleil se lever. Nous nous trouvions dans la clairière du bois, sur un côté. Apparemment, le pilote essaya d’atterrir ici comme il n’y avait pas d’arbres mais dévia légèrement; l’aile gauche avait été perdue lors du choc contre les grands arbres. Une grande colonne de fumée s’échappait de l’avion et s’élevait jusqu’au ciel, permettant à quiconque de la voir à plusieurs kilomètres à la ronde. Je m’enfonçai un peu dans l’épaisseur feuillue et laissai les sacs au pied d’un grand arbre. Je fis ensuite demi-tour, voulant revenir à l’avion, mais, à ce moment-là, un groupe d’hommes noirs armés fit irruption dans la clairière par le côté opposé au mien. Je me baissai rapidement, me cachant derrière un tronc. Je sentis une pointe de douleur à l’estomac. Les guérilleros, certains habillés en camouflage et d’autres en civil, encerclèrent l’avion, pointant leurs armes et criant sans cesse. Je ne comprenais rien à ce qu’ils disaient, mais la zone où nous nous trouvions devait être swahilie ou allez donc savoir quoi.
– Nitoka! – Criaient-ils sans arrêt – enyi!, nitoka!, maarusi!1
Quelques passagers déconcertés et confus commencèrent à sortir de l’avion peu après. Ils furent étendus sur le sol sans ménagements et fouillés consciencieusement. Un plus grand nombre de rebelles arriva. Un des passagers, un homme qui avait été assis devant nous, paniqua et se leva, essayant de s’enfuir en courant. Les guérilleros tirèrent de multiples rafales avec leurs mitraillettes, le tuant presque sur le coup. Pendant ce moment de confusion, Juan sortit de l’avion et commença à courir en direction contraire à ce qui retenait leur attention.
– Basi!2, basi! – crièrent quelques rebelles lorsqu’ils le virent.
– Nifyetua!3– cria celui qui semblait être le chef alors que Juan était sur le point d’atteindre le bord de la clairière.
Alors deux d’entre eux lui tirèrent dans le dos, sans attendre. Une des balles passa près de moi en sifflant. Je baissai la tête et fermai les yeux le plus fort possible, croyant bêtement que cela pourrait me protéger des projectiles. Il tomba à genoux, à cinq mètres à peine de l’endroit où j’étais en train d’observer et, avant de s’effondrer complètement, arriva à me voir blotti là et m’adressa son dernier sourire.
–Nitoka, maarusi! – continuaient-ils à crier en direction de l’avion.
Je n’eus pas à faire un trop gros effort pour éviter de crier, j’étais resté totalement muet et paralysé. Je ne sais combien de temps je restai comme ça, mais, lorsque je pus réagir, je sus avec certitude qu’il ne me restait qu’une seule issue: fuir pour sauver ma vie. Je pris les deux sacs et m’éloignai, pénétrant dans la végétation de la forêt avec la plus grande discrétion possible, ce qui était beaucoup demander vu que j’avançais en zigzag et que mon corps était meurtri. J’étais donc incapable de le contrôler. Je ne savais pas quelle direction prendre, mais il était certain que plus il y aurait de distance entre ces sauvages et moi, plus grandes seraient mes chances de survie.
Je marchai pendant presque deux heures, éperonné par la crainte, par la peur de mourir, jusqu’à ce que mes jambes cèdent. Je tombai, défaillant. Les sacs me paraissaient être remplis de pierres. Mon genou gauche me faisait très mal; après m’être blessé en jouant au football, il n’était pas complètement guéri et me posait problème encore aujourd’hui si je forçais trop. J’ouvris mon sac et en sortit une canette. Elle était encore un peu fraîche, je la bus avec empressement. Je transpirais abondamment, des gouttes de sueur coulaient, tels des torrents, de mon menton, comme s’il venait de pleuvoir ou comme si je venais de sortir d’une piscine. Je manquais d’air et j’ouvrais la bouche, essayant d’inspirer de grandes bouffées. Je m’engouai à cause d’une gorgée bue trop vite et j’éternuai fortement, je pensai m’étouffer. Lorsque je parvins à me calmer, toujours haletant, je me rendis compte que la lumière était plus faible : la nuit tombait. Alex mort dans l’accident, Juan criblé de balles; j’avais perdu mes deux meilleurs amis l’espace d’un instant pour la stupidité d’une guerre civile que je ne comprenais pas et qui m’était indifférente. Pourquoi ne s’entretuent-ils pas ? Pourquoi nous ? Pourquoi mes amis, Alex, Juan? Salauds! Si ça ne tenait qu’à moi, ils crèveraient tous. A cause d’eux, j’étais seul maintenant, dans ce putain d’endroit, humide, angoissant, asphyxiant, sans mes amis. Pourquoi moi? Pourquoi eux? La mort de Juan, fusillé par ces sauvages tournait en boucle dans ma tête, comme si c’était un film. La lumière de ses yeux s’éteignant dans le dernier regard qu’il m’adressa… J’essayai de ne pas y penser, de l’occulter dans quelque recoin de mon esprit, rien à faire. Cela fait quelques heures nous étions ensemble, riant, nous remémorant les anecdotes du voyage, et maintenant…
Je pleurai un long moment, je ne sais combien de temps, mais cela me fit beaucoup de bien. Lorsque je pus m’arrêter, je me sentais beaucoup mieux, du moins plus tranquille. Il était évident qu’il allait faire nuit : la forêt obscure entrait dans le monde des ténèbres. Il me fallait chercher un endroit où dormir. J’avais peur de dormir à même le sol, pensant surtout aux rebelles qui pourraient me trouver. Dormir dans un arbre ne me tranquillisait pas davantage, avec les serpents, ces singes hurleurs ou allez donc savoir quelle bête féroce, sauvage et affamée. Je devais prendre une décision. Les serpents ou les hommes armés et enragés? Les serpents me semblèrent être une meilleure option, ils ne m’avaient encore rien fait, pour le moment. Je cherchai un arbre auquel je pourrais grimper facilement, difficile d’accès pour les serpents et avec un espace où je pourrais m’installer pour dormir.
Je me rendis compte à ce moment-là de l’incroyable quantité de types d’arbres et de plantes qu’il y avait. Des plus petites plantes, presque minuscules, aux arbres de plus de 50 mètres dont le tronc dépassait en grosseur celui des autres arbres sans que l’on puisse en voir le bout. Un riche mélange de différentes espèces de flore parsemé ça et là; il y avait même de très hauts palmiers, aux feuilles colorées et effrangées, larges de plusieurs mètres, aux denses et compactes inflorescences4. Il y avait une couche supérieure d’arbres, d’environ 30 mètres. Certains la dépassaient même largement. Une seconde couche, ensuite, de dix ou vingt mètres de hauteur, avec des arbres à forme allongée, comme les cyprès de nos cimetières y une troisième couche, de cinq à huit mètres de haut, que la lumière peinait à atteindre. Il y avait aussi des arbustes, de jeunes et rares plants de divers types d’arbres et une mousse épaisse qui recouvrait quasiment tout à certains endroits, de même qu’une multitude de lianes, grimpant à tous les troncs, pendant de toutes les branches. Des fleurs et des fruits de toutes parts, surtout dans les plus hautes couches, inatteignables. L’on percevait aussi tous types d’animaux. On ne les voyait pas aisément, cependant l’on pouvait entendre d’innombrables piaillements d’oiseaux, des cris de singes, le bruit des branches s’agitant au-dessus de moi au passage de l’un d’eux et celui des insectes bourdonnant autour des fleurs. On entendait même, de partout, les pas d’animaux terrestres, comme un bruit lointain. Les papillons et le reste des insectes voletaient dans tous les sens. Si je n’avais pas été dans la situation dans laquelle je me trouvais, j’aurais pu profiter d’un si bel endroit, mais, à ce moment précis, tout était un obstacle à ma survie. J’avais peur de tout.
Après avoir cherché un court instant, je trouvai un arbre qui me parut adéquat et y montai, les sacs sur le dos. On aurait dit qu’ils pesaient énormément et mon genou implorait le repos. Lorsque je fus suffisamment en hauteur pour me sentir en sécurité mais pas assez pour me tuer ou me blesser grièvement si je chutais pendant la nuit, je me positionnai du mieux que possible entre deux branches épaisses, côte à côte et presque parallèles. Je me couvris un peu avec une des petites couvertures de l’avion que j’avais apportée et utilisai l’autre comme oreiller. Je pus entrevoir dans le ciel une incroyable quantité de grandes chauves-souris marron foncé qui battaient des ailes, voltigeant de cette façon si caractéristique qui leur est propre : des êtres à l’apparence furtive, se déplaçant par impulsions5. Je n’arrivais pas à les compter, il devait y en avoir des milliers, se posant surtout sur les palmiers pour se nourrir de leurs fruits ou chasser les insectes qui les mangeaient, pensai-je.
Je dus dormir deux heures, fractionnées en de petits intervalles de quinze à vingt minutes. Les bruits me harcelaient de toutes parts. Je n’entendais que des pas, des voix, des cris, des criaillements, des petits cris perçants, des bourdonnements, des bruissements : un constant murmure qui augmentait et s’atténuait sans cesse. Il me parût même entendre plusieurs fois le cri d’agonie d’un enfant et des barrissements d’éléphants. Je ne savais pas s’il s’agissait vraiment de cela ou si c’était quelque chose de ressemblant, tout simplement. De temps à autres l’on entendait un rugissement assez inquiétant, ce qui me laissait imaginer qu’une bête féroce viendrait me dévorer pendant mon sommeil. Parfois, l’angoisse m’empêchait de respirer, tenaillant mon cœur, presque au point d’en ressentir une douleur. Chaque son, chaque mouvement, chaque chose qui se passait autour de moi était un tourment, une sensation d’angoisse oppressante. Dès que j’arrivais à m’endormir, il se passait quelque chose, n’importe-quoi, qui m’obligeait à me réveiller, apeuré. Parfois je voyais briller des yeux dans la nuit lugubre et, pour essayer de me réconforter, je me disais que c’était un simple hibou ou son plus proche parent vivant ici, mais ces tentatives pour rester positif étaient de courte durée. Je finissais toujours par voir des félins aux troubles intentions ou un dangereux serpent, en train de chasser. D’autres fois, il me semblait entendre des coups de feu à proximité, des rafales intermittentes, mais, si je tendais l’oreille, je n’arrivais pas à entendre quoi que ce soit.
– Javier – j’entendis Alex m’appeler.
– Oui, où es-tu? – dis-je, me réveillant en sursaut.
– Javier – entendis-je de nouveau.
Je regardai dans toutes les directions, angoissé, dans l’expectative, désirant voir mon ami. Jusqu’à ce que je réalise qu’Alex était mort et que j’étais tout seul, sans aucune aide, en pleine jungle. Cela me faisait peur de ne pouvoir compter sur l’aide de personne, de n’avoir personne avec qui partager ma douleur, mon désespoir en cet instant. Je ne devais pas céder à la panique, je devais expulser de ma tête les mauvaises pensées pour pouvoir subsister mais j’en étais incapable. Une sensation suffocante de solitude m’obligeait à puiser dans mes peurs.
– Javier, Javier
Son appel dura toute la nuit, inquisitif, attrayant.
Je serais parti avec lui, si j’avais su où aller.
1
Langue swahilie: enyi!, nitoka, maarusi!: Vous! Sortez! Vite!
2
Langue swahilie: basi: halte!
3
Langue swahilie: nifyetua!: feu!
4
Flore: Palmier à huile, Elaeis guineensis
5
Faune: Roussette paillée africaine ou roussette des palmiers africaine, Eidolon helvum