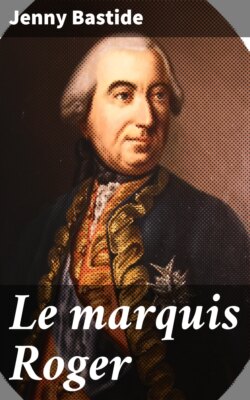Читать книгу Le marquis Roger - Jenny Bastide - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A M. ARMAND DE MARIGNI.
ОглавлениеFlorence, 14 février 1840.
Ne me fais pas de reproches, j’avoue mes torts, Armand. Je suis ici depuis trois mois; tu es mon seul ami, l’homme que j’estime le plus, et je ne t’ai point encore écrit. Tu sais bien, du reste, que ce n’est point mon cœur qu’il faut accuser, mais mes habitudes nonchalantes et rêveuses. Puis tu m’as tellement reproché de me laisser dominer par tout ce qui m’entoure, que tu ne seras pas étonné d’apprendre que je fais rarement ce que je veux.
Je sors pour une heure, je rencontre quelqu’un qui m’entraîne; je ne me plais point avec ce quelqu’un, mais j’y suis et j’y reste. Ou bien, si je rentre, je me place au coin du feu, mon écritoire auprès de moi; puis je pense, je ne pense à rien d’important peut-être; je me mets à rêver à quelque chose de tout à fait impossible, par exemple, à l’amour sans fin, au bonheur sans nuages; puis, tout à coup, je suis pris d’un profond ennui de tout, je cherche ce qui pourrait me plaire, m’amuser, et je ne trouve rien.
Cependant je crois qu’aujourd’hui je vais t’écrire une longue lettre. Il tombe une de ces pluies torrentielles qui donnent un avant-goût du déluge. C’est quelque chose de hideux que la pluie à Florence.
Je me trouve pour la seconde fois en Italie. Veux-tu savoir comment cela s’est fait? tu n’étais pas à Paris pour me retenir; le petit Derny voulait aller à Florence, où il a le bonheur de s’imaginer qu’il est amoureux. Il a donné l’ordre à Baptiste de faire charger mes malles et préparer ma voiture de voyage: je le laissai dire, croyant que je ne partirais pas. Puis je me suis senti en route sans en être trop fâché, car il m’importe peu d’être à Florence ou à Paris; le monde est partout le même. Je m’amuserais même assez ici, si je pouvais m’amuser quelque part. On ne pense qu’aux plaisirs dans cette ville de fleurs; presque tout le monde ne sait rien, ne veut rien savoir, ne fait rien et ne veut rien faire. Les habitants sont tellement insoucieux, qu’il y en a beaucoup, j’en suis sûr, qui ne connaissent pas la moitié des curiosités que renferme leur ville. Toute la vie d’un Florentin, et surtout d’une Florentine, se borne à se promener, à faire ou à recevoir des visites, à se rendre au théâtre ou au bal. Ils accordent tout au luxe extérieur; pourvu qu’ils éblouissent, ils sont heureux. Naturellement peu sensibles, il leur faut de continuelles intrigues; c’est une occupation de tous les jours. Mais ils ne donneraient pas une larme à la perte ni au malheur d’un ami. Quant à leur jalousie et à leurs coups de stylet, on ne trouve cela que dans les opéras, où il y a toujours provision de femmes adultères et de maris cruels.
L’hiver est fort sévère, et je m’ennuierais assez sans une espèce de coterie que nous avons formée ici, Derny et moi. Il m’a présenté chez une comtesse française dont tout le monde prétend que je suis amoureux. En vérité, il n’en est rien; c’est une maladie dont je me crois à jamais guéri. Mais je m’amuse passablement dans la société de madame de Vatry. Cette femme est encore assez belle. — Ce mot encore, je le sais, gâte bien des choses. Cependant il est vrai qu’avec ses trente-six ans, la comtesse pourrait fort bien s’en donner vingt-huit. Elle est peut-être un peu chargée d’embonpoint et de couleurs, elle rit peut-être un peu trop haut et sans retenue; mais elle a de fort belles dents, et sa gaieté m’amuse. Elle a de ces plaisanteries un peu hasardées qu’on ne lui pardonnerait point si elle ne possédait pas cent mille livres de rente; et des prétentions au talent, que je crois justifiées. Du reste, tu sais que je ne suis pas fat, mais je t’avoue que la comtesse m’aime plus que je ne le voudrais. Elle ne peut se passer de moi; cela me gêne parfois, moi qui aime l’indépendance par-dessus tout, et cependant je me laisse aimer...
On jouit chez madame de Vatry d’une grande liberté, et l’on y joue beaucoup. J’arrive chez elle souvent abattu, découragé, fort maussade enfin; au bout d’un moment, je me trouve ranimé. Derny prétend qu’elle a des plaisanteries à la Déjazet, qui ont beaucoup de prix pour des Français; et il est vrai qu’il n’y a qu’eux qui sachent rire et faire rire.
Je me trouve continuellement avec la comtesse, parce qu’on nous invite toujours ensemble. Elle est séparée de son mari, et m’a dit une fois, avec un grand soupir, qu’elle me priait de ne jamais toucher cette corde-là. Si le mari de la comtesse était jaloux, il a dû avoir furieusement à souffrir. Elle a une coquetterie fort évidente; et, comme elle cherche à la réprimer quand je suis là, il faut bien croire qu’elle m’aime réellement. Je me laisse donc aller, et ma vie se passe ainsi sans peine ni plaisir...
Ma lettre a été interrompue par un petit billet de la comtesse; la pluie avait cessé, et elle me prévenait qu’elle avait envie d’aller visiter San-Miniato. Quoique le tête-à-tête m’ennuyât assez, car la comtesse veut alors faire du sentiment, ce qui lui va fort mal, je ne pouvais me dispenser d’accepter, et je répondis que j’irais la prendre.
Comme je n’avais pas besoin de ma voiture, je me rendis à pied chez elle. Présumant qu’elle ne serait pas prête de longtemps, sa toilette est toujours fort longue, je m’arrêtai machinalement devant un marchand de tableaux à considérer deux charmantes aquarelles représentant, l’une une jeune fille en prière dans une église, l’autre la même jeune fille en habits de religieuse. Tu sais que je me connais un peu en peinture, et je trouvais le coloris d’une fraîcheur et d’un fini parfaits. Je demandai si ces deux tableaux étaient à vendre; on me répondit qu’ils appartenaient à madame la comtesse de Vatry; qu’on n’avait fait seulement que les encadrer, et qu’on allait les envoyer au palais de cette dame. J’ai été agréablement surpris en arrivant chez la comtesse de trouver les deux tableaux, qu’on suspendait déjà dans son boudoir.
La comtesse rougit en m’entendant lui demander si c’était son ouvrage; elle en convint cependant, et reçut mes éloges avec une simplicité et un embarras qui me firent plaisir. Je ne pensais pas, je l’avoue, qu’elle eût assez de modestie pour cacher un si charmant talent.
Nous sommes partis, et avons laissé sa voiture au pied de l’avenue de cyprès qui conduit à San-Miniato. C’est une église, tu le sais, d’une architecture admirable, et d’où l’on découvre tout Florence.
La comtesse n’est pas très-leste, et nous gravissions péniblement la montée, lorsque nous rencontrâmes une femme voilée qui fit un salut très-profond en passant devant la comtesse. A sa taille svelte, je ne pouvais douter que ce ne fût une jeune personne. Elle me parut mise fort simplement, elle était accompagnée d’une gouvernante fort convenable de tournure.
Le bras de la comtesse trembla sous le mien; et elle me regarda presque avec colère quand je lui dis assez naïvement:
— A ce pied si petit, si bien chaussé, on ne peut méconnaître une Française.
— Vous êtes galant pour vos compatriotes, me dit la comtesse avec dépit.
Dans ce moment, je pus remarquer ma maladresse: madame de Vatry a les pieds et les mains énormes.
Nous entrâmes dans l’église, où il se trouve des choses fort remarquables. La comtesse examina tout fort légèrement, et sortit presque aussitôt.
Je la suivais, quand j’aperçus à terre une feuille de papier. C’était l’esquisse très-fidèle d’un tableau placé sur le maître-autel. Je ne sais pourquoi je serrai cette feuille de papier sans en parler à la comtesse.
J’arrivai tout naturellement à lui parler du peu de temps qu’elle pouvait accorder à son charmant talent; elle me répondit qu’elle se levait de bonne heure, et changea la conversation. Elle, ordinairement si gaie, si facile à distraire, me parut préoccupée et rêveuse...
C’est Baptiste qui te portera cette lettre. En parlant de son départ, il m’a dit, croyant que je le savais, une chose assez extraordinaire, parce que la comtesse ne m’en a jamais parlé. C’est qu’elle a chez elle une nièce d’une extraordinaire beauté, et qui ne va jamais dans le monde. A ce propos, Baptiste ajouta:
— Je vais voir mademoiselle Mélanie, la femme de chambre, le matin, attendu que madame la comtesse se lève toujours fort tard.
Cependant elle m’a assuré que c’était le matin qu’elle travaillait... Au surplus, ce n’est pas la première fois que je me suis aperçu que la comtesse altère souvent la vérité. Je dois lui savoir gré, en tout cas, de la peine qu’elle se donne de dissimuler ses défauts devant moi; mais je sais qu’elle est violente, envieuse et colère. Pourquoi cache-t-elle sa nièce? Il m’est venu un soupçon qui n’a peut-être pas le sens commun. Après tout, de quoi vais-je m’inquiéter? Je ne regarde ma liaison avec la comtesse que comme une distraction qui m’ennuie le matin, parce que je suis forcé d’être son chevalier, et qui me distrait le soir, à cause du monde que je trouve chez elle.
Je puis d’un instant à l’autre quitter Florence; rien ne m’y retient, et tu me verras peut-être arriver quelques jours après cette lettre. Je ne sais ce que je désire; le monde m’ennuie, la solitude me pèse. Florence est une ville plutôt agitée que gaie; on y danse sans entrain; les heures sont marquées pour tout. La toilette des femmes les occupe tellement, qu’elles en font l’unique sujet de toutes leurs conversations. Les Italiennes sont frivoles et indifférentes, excepté pour ce qui touche leur vanité. Elles ont une dépravation sans grâce et sans excuse; leur coquetterie n’a rien qui parle à l’imagination. Ici point de ces difficultés, de ces mystères qui donnent un stimulant à l’amour; point de crainte, de dangers, rien de ce qu’un homme délicat peut désirer. Tout s’arrange sans difficulté, même avec la famille: une mère, un frère, un mari se montrent les meilleurs amis de l’amant de leur femme, de leur fille ou de leur sœur. C’est à une mère qu’une femme mariée vient demander compte des infidélités de son fils. L’Italien n’a de scrupules pour rien; le mérite sans argent et sans titre est à ses yeux comme s’il n’était pas. Quoi qu’ils en disent, ils n’aiment point les Français, dont ils redoutent la supériorité et surtout la moquerie.
Du reste, la société de Florence et très-accueillante, presque trop facile, et certes, on y rencontre des gens qui ne seraient reçus nulle part ailleurs. Ce que l’on trouve ici surtout, c’est une quantité d’Anglais qui vient nent en Italie par économie et peuvent y mener un train qu’ils ne pourraient supporter chez eux: si dans les bals vous remarquez de belles jeunes filles décolletées outre mesure, échevelées et couchées sur les bras d’un homme qu’elles ne connaissent pas, vous pourrez dire en toute sûreté que ce sont des Anglaises.
On joue beaucoup à Florence. Je ne puis mieux comparer cette ville qu’à une continuelle saison d’eau; enfin, je ne me déplais pas trop ici, et j’y reste. Tu reconnaîtras bien là, Armand, mon caractère incertain.
Allons, encore une interruption.
La comtesse me fait prévenir qu’elle a ce soir sa loge à la Pergola; elle se félicite beaucoup de ce que cette loge soit à côté de celle du roi Jérôme Bonaparte.
Imagine-toi, Armand, que nous vivons ici de pair à compagnon avec tous ces rois détrônés. Les Bonaparte sont en majorité ; mais il n’y produisent aucune sensation.
Du reste, les succès qu’on obtient à Florence sont de peu de durée; la comtesse de Vatry est dans ce moment fort à la mode, et je partage ses succès. Nous faisons assaut de luxe, de chevaux, de voitures; cela m’amuse passablement. Je perds beaucoup d’argent au jeu; mais qu’est-ce que cela me fait? je n’ai que pour moi à penser. Je n’ai point envie de me marier, quoiqu’il me semble que je serais heureux si je pouvais rencontrer une femme selon mon goût et mes idées. Mais je dois avouer que je n’ai plus d’illusions; à trente-quatre ans, il me semble que j’en ai soixante pour la lassitude du cœur. Je connais trop le monde pour l’aimer; je pourrais faire du bien, j’en ferais même: à quoi cela me servirait-il? à me prouver que l’ingratitude est un vice si commun, qu’il ne faut plus s’en étonner. Je suis las d’être généreux, comme je suis las de tout.
Je ne fermerai cette lettre qu’après un grand bal que va donner la comtesse de Vatry. Il me fournira peut-être quelque événement intéressant à te raconter: car je crains bien, mon cher Armand, que tu ne trouves ma lettre fort insignifiante....
Eh bien, mon ami, j’arrive du bal; il est six heures du matin, et je n’éprouve pas le moindre besoin de me reposer. Je me sens, au contraire, agité, nerveux, impatient; et pourtant je préfère cent fois cette agitation à l’apathie dans laquelle je suis souvent plongé.
Il faisait une chaleur étouffante quand j’entrai chez madame de Vatry; ses salons étaient remplis: et, bien que j’eusse promis à la comtesse d’arriver de bonne heure, j’étais resté à rêvasser au coin du feu. Elle vint au-devant de moi, et me fit de vifs reproches de m’être fait attendre. Elle paraissait radieuse et fort contente de sa parure, qui me sembla pourtant de fort mauvais goût. C’était un pasticio de fleurs, de diamants, de plumes; cet amas de colifichets ajoutait encore à sa rotondité, et lui ôtait le peu de grâce dont elle est naturellement si peu pourvue. Je t’avoue que j’étais assez vexé d’être reconnu comme le cavalier servant de cette robuste beauté. La comtesse me quitta enfin pour s’occuper de ducs, de princes qu’elle était fière de recevoir: un de ses ridicules est d’attacher beaucoup d’importance à s’entourer de gens titrés.
Au bout de quelques moments, elle se disposa à figurer dans un quadrille, et me donna son énorme bouquet à garder. J’étais aussi ennuyé qu’embarrassé de cette marque de confiance, et me trouvais parfaitement ridicule avec cette botte de fleurs à la main; enfin je la posai sur un piédestal supportant un groupe de marbre. J’aperçus alors, cachée à demi par ce groupe, une jeune personne qui paraissait fort embarrassée d’elle-même.
Je ne te ferai point son portrait, Armand; tu jurerais que j’en suis amoureux. On voyait qu’elle faisait tous ses efforts pour qu’on ne la remarquât pas; elle regardait les quadrilles avec beaucoup d’attention, mais il était facile de juger que c’était plutôt pour se donner une contenance que par plaisir: car l’expression d’une profonde mélancolie était répandue sur cette figure si jeune et si candide. Sa toilette, — la toilette d’une femme la peint d’abord, — sa toilette donc était de la plus élégante simplicité ; de frais camélias blancs et naturels faisaient ressortir l’éclat de ses noirs cheveux; des fleurs semblables relevaient sa robe de gaze. Tout son ensemble était tellement distingué, que j’aurais juré que cette jeune personne devait avoir un rang élevé dans le monde. Mais comment la laissait-on seule ainsi, sans appui? Faite pour attirer tous les regards, comment personne ne s’en occupait-il?
Je restais immobile de l’autre côté du piédestal; j’évitais de fixer mes yeux sur les siens; je m’apercevais qu’elle perdait contenance sous mes regards. Je m’adressai à plusieurs habitués de la maison pour savoir qui elle était; tous l’ignoraient et tous répétaient: Elle est bien belle! Enfin j’aperçus à la porte de la galerie un homme de confiance de la maison de la comtesse, et je lui demandai le nom de cette jeune personne.
— C’est la nièce de madame la comtesse, me répondit-il, mademoiselle Alice de Lostange.
Je me sentis encore plus révolté de l’abandon de cette jeune personne. Je m’approchai sans hésiter de madame de Vatry, qui venait de terminer son quadrille et sautillait encore pour se donner des airs de jeunesse.
— Présentez-moi à mademoiselle Alice de Lostange, lui demandai-je?
Tu ne saurais croire, Armand, l’expression de fureur qui se répandit sur ses traits; sa figure riante et animée par la coquetterie devint pâle et sombre; mais elle n’osa me refuser, et, me conduisant vers sa nièce, elle lui jeta mon nom avec colère et dédain.
Je demandai à mademoiselle de Lostange de figurer avec moi dans le premier quadrille, et je restai près d’elle jusqu’à ce que le signal en fût donné. J’étais outré contre la comtesse: comment pouvait-elle laisser ainsi chez elle, sans appui, sans la présenter, une jeune personne si bien faite pour briller? Non, lu ne peux te faire une idée, Armand, de la grâce charmante de mademoiselle de Lostange, de sa modestie, cette vertu si rare maintenant chez une jeune fille; de cette réserve sans embarras et sans gaucherie qui n’exclut pas l’esprit; de ce regard intelligent et doux; de cette beauté parfaite qui paraît s’ignorer encore.
Je lui demandai pourquoi je ne l’avais pas encore rencontrée chez sa tante; elle me répondit avec embarras, mais avec mesure.
Madame de Vatry figurait dans le quadrille à côté du nôtre, et nous lançait des regards courroucés dont mademoiselle de Lostange ne paraissait pas s’apercevoir. Cependant elle souffrait beaucoup; j’en étais sûr. Je la reconduisis sur une banquette moins écartée que celle où elle était assise précédemment; mais aucune dame ne lui parla: elle n’avait été présentée à personne.
Je restai près d’elle autant qu’il me fut possible; mais la comtesse ne tarda pas à venir me redemander son bouquet d’un ton fort irrité. J’avais oublié, sur le piédestal où je l’avais posé, ce faisceau de fleurs, et je ne pus le retrouver.
— Je conçois votre distraction, me dit-elle avec dépit, mademoiselle de Lostange est bien faite...
— J’avoue, Madame, que je ne m’étonne pas de trouver dans votre famille une aussi belle personne; seulement je suis surpris de ne pas l’avoir encore rencontrée chez vous.
— Mademoiselle de Lostange est la nièce de M. de Vatry, me répondit-elle; au fait, elle ne m’est rien, et je ne m’en suis chargée que jusqu’à ce qu’elle trouve une position convenable.
Je crus comprendre qu’il s’agissait d’un mariage, et je répondis:
— Il ne sera pas difficile de trouver un établissement à une aussi belle personne.
La comtesse me regarda avec ironie.
— Vous vous trompez, monsieur le marquis, dit-elle: mademoiselle de Lostange n’a pas de dot.
Ma figure témoigna le mécontentement que j’éprouvais de cette réponse. Quelle opinion avait-elle donc des hommes, si elle croyait qu’il n’existât chez eux aucune générosité ?
— Du reste, reprit rapidement la comtesse, elle peut se marier d’un instant à l’autre; il y a un cousin...
— Ah! il y a un cousin?
— Oui, et vous savez que le cousin d’une jeune fille est presque toujours un amant donné par la nature; il existe une grande passion entre Édouard de Vatry et Alice de Lostange.
M’expliqueras-tu, Armand, pourquoi je me sentis une espèce d’humeur de ce que cette jeune personne, dont les regards étaient si purs et si naïfs, connût déjà une passion aussi tumultueuse que celle de l’amour?
La comtesse me laissa presque désenchanté, et elle me parut même moins coupable de ne pas avoir lancé sa nièce dans le monde. Au fait, c’est un pénible fardeau qu’une jeune fille amoureuse.
Je cherchai des yeux mademoiselle de Lostange, elle avait disparu. Tu vas reconnaître encore la bizarrerie de mon caractère; j’en fus à la fois bien aise et fâché. Elle était sans doute allée rêver à ses amours absents; je ne devais plus m’étonner de ce qu’elle n’aimait pas le bal: son cœur était occupé, pouvait-elle jouir de quelque plaisir quand celui qu’elle aime n’était pas là ?
Je m’ennuyais mortellement au bal, j’entrai dans le salon où l’on jouait, et j’ai perdu une centaine de louis au lansquenet; je suis sorti aussi fatigué, aussi découragé qu’il soit possible de l’être. Pourquoi cela? Qu’est-ce que cela me fait, après tout, que mademoiselle de Lostange soit si amoureuse de son cousin? Je ne dois peut-être jamais revoir cette jeune personne, et en vérité je ne le désire pas. Il y a bien assez de jeunes filles romanesques et ridicules.
Je viens de sonner, ce n’est point Baptiste qui est venu, et quand je l’ai demandé, j’ai appris qu’il était sorti. Au bout d’un instant, il est rentré fort essoufflé, et s’est excusé sur ce qu’il croyait que je me lèverais tard. Il m’a appris qu’il était allé prendre les commissions de la femme de chambre de la comtesse. Je lui ai fait une question fort inutile sans doute; mais sait-on quelquefois pourquoi l’on parle?
Je lui ai demandé si mademoiselle de Lostange lui avait aussi remis quelque commission. Il m’a répondu qu’il avait deux lettres. Je n’ai pas osé lui demander pour qui, car, en effet, cela ne me regarde pas; mais j’ai donné à ce brave garçon un portefeuille à moi pour qu’il ne perdit pas ces papiers.
Baptiste, qui m’a vu naître, est assez libre avec moi, et m’a demandé comment il devait arranger toutes les lettres qu’on lui avait remises pour la France. J’ai placé moi-même un paquet de papiers d’envoi de mademoiselle de Lostange à une vicomtesse de Laumont. Quelle est donc cette vicomtesse, et quelle confidence si volumineuse Alice peut-elle avoir à lui faire? En vérité, je crois que toutes les jeunes filles d’aujourd’hui ont la prétention d’écrire leurs Mémoires.
Mademoiselle de Lostange n’a point échappé cette occasion de se rappeler à son cousin; il y a aussi une lettre à l’adresse de M. Édouard de Vatry, lieutenant au 9e dragons.
Que penses-tu, Armand, d’une jeune personne qui écrit à un lieutenant de dragons? Il est vrai qu’elle l’aime, qu’ils sont fiancés, qu’ils vont se marier: grand bien leur fasse! Moi, j’ai envie de partir pour Naples ou pour la Sicile. Qu’irai-je y faire?... user des jours pour arriver à la fin; vivre pour dire avoir vécu. Que puis-je attendre maintenant de l’existence? J’ai joui de tout, je sais ce que c’est que ces plaisirs auxquels on fait tant de sacrifices. La comtesse m’ennuie, sa gaieté triviale me pèse; mais par quoi puis-je remplacer les heures que je dépense avec elle? je n’en sais rien.
Adieu, je vais tâcher de dormir; ce sera autant de pris sur la longue journée qui m’attend. Je te serre la main, Armand.