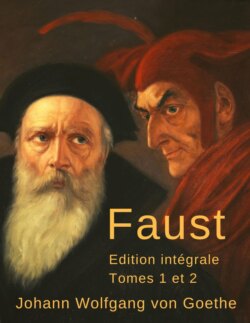Читать книгу Faust (Édition intégrale, tomes 1 et 2) - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
DE LA PREMIÈRE ÉDITION
Оглавление(1828)
Voici une troisième traduction de Faust ; et ce qu’il y a de certain, c’est qu’aucune des trois ne pourra faire dire : « Faust est traduit ! » Non que je veuille jeter quelque défaveur sur le travail de mes prédécesseurs, afin de mieux cacher la faiblesse du mien, mais parce que je regarde comme impossible une traduction satisfaisante de cet étonnant ouvrage. Peut-être quelqu’un de nos grands poëtes pourrait-il, par le charme d’une version poétique, en donner une idée ; mais, comme il est probable qu’aucun d’eux n’astreindrait son talent aux difficultés d’une entreprise qui ne rapporterait pas autant de gloire qu’elle coûterait de peine, il faudra bien que ceux qui n’ont pas le bonheur de pouvoir lire l’original se contentent de ce que notre zèle peut leur offrir. C’est néanmoins peut-être une imprudence que de présenter ma traduction après celles de MM. de Saint-Aulaire et A. Stapfer. Mais, comme ces dernières font partie de collections chères et volumineuses, j’ai cru rendre service au public en en faisant paraître une séparée.
Il était, d’ailleurs, difficile de saisir un moment plus favorable pour cette publication ; Faust va être représenté incessamment sur tous les théâtres de Paris, et il sera curieux sans doute pour ceux qui en verront la représentation de consulter en même temps le chef-d’œuvre allemand, d’autant plus que les théâtres n’emprunteront du sujet que ce qui convient à l’effet dramatique, et que la scène française ne pourrait se prêter à développer toute la philosophie de la première partie, et beaucoup de passages originaux de la seconde.
Je dois maintenant rendre compte de mon travail, dont on pourra contester le talent, mais non l’exactitude. Des deux traductions publiées avant la mienne, l’une brillait par un style harmonieux, une expression élégante et souvent heureuse ; mais peut-être son auteur, M. de Saint-Aulaire, avait-il trop négligé, pour ces avantages, la fidélité qu’un traducteur doit à l’original ; on peut même lui reprocher les suppressions nombreuses qu’il s’est permis d’y faire ; car il vaut mieux, je crois, s’exposer à laisser quelques passages singuliers ou incompréhensibles que de mutiler un chef-d’œuvre. M. Stapfer a fait le contraire : tout ce qui avait un sens a été traduit, et même ce qui n’en avait pas, ou ne nous paraissait pas en avoir. Cette méthode lui a mérité de grands éloges, et c’est aussi celle que j’ai tenté de suivre, parce qu’elle n’exige que de la patience, et entraîne moins de responsabilité. Au reste, cette prétention de tout traduire exposera, aux yeux de beaucoup de personnes, ma prose et mes vers à paraître martelés et souvent insignifiants ; je laisse à ceux qui connaissent l’original à me laver de ce reproche, autant que possible ; car il est reconnu que Faust renferme certains passages, certaines allusions, que les Allemands eux-mêmes ne peuvent comprendre ; en revanche, je dirai avec le traducteur que je viens de citer :
« Il me reste à protester contre ceux qui, après la lecture de cette traduction, s’imagineraient avoir acquis une idée complète de l’original. Porté sur tel ouvrage traduit que ce soit, le jugement serait erroné ; il le serait surtout à l’égard de celui-ci, à cause de la perfection continue du style. Qu’on se figure tout le charme de l’Amphitryon de Molière, joint à ce que les poésies de Parny offrent de plus gracieux, alors seulement on pourra se croire dispensé de le lire. »
Je n’essayerai pas de donner ici une analyse complète de Faust. Assez d’auteurs l’ont jugé ; et il vaut mieux, d’ailleurs, laisser quelque chose à l’imagination des lecteurs, qui auront à la fin du livre de quoi l’exercer. Je les renvoie encore au livre de l’Allemagne, de madame de Staël, dont je vais en attendant citer un passage :
« … Certes, il ne faut y chercher ni le goût, ni la mesure, ni l’art qui choisit et qui termine ; mais, si l’imagination pouvait se figurer un chaos intellectuel, tel que l’on a souvent décrit le chaos matériel, le Faust de Gœthe devrait avoir été composé à cette époque. On ne saurait aller au delà en fait de hardiesse de pensée, et le souvenir qui reste de cet écrit tient toujours un peu du vertige. Le diable est le héros de cette pièce ; l’auteur ne l’a point conçu comme un fantôme hideux, tel qu’on a coutume de le présenter aux enfants ; il en a fait, si l’on peut s’exprimer ainsi, le méchant par excellence, auprès duquel tous les méchants et celui de Gresset, en particulier, ne sont que des novices, à peine dignes d’être les serviteurs de Méphistophélès (c’est le nom du démon qui se fait l’ami de Faust). Gœthe a voulu montrer dans ce personnage, réel et fantastique tout à la fois, la plus amère plaisanterie que le dédain puisse inspirer, et néanmoins une audace de gaieté qui amuse. Il y a dans les discours de Méphistophélès une ironie infernale qui porte sur la Création tout entière et juge l’univers comme un mauvais livre dont le diable se fait le censeur.
« S’il n’y avait dans la pièce de Faust que de la plaisanterie piquante et philosophique, on pourrait trouver dans plusieurs écrits de Voltaire un genre d’esprit analogue ; mais on sent dans cette pièce une imagination d’une tout autre nature. Ce n’est pas seulement le monde moral tel qu’il est qu’on y voit anéanti, mais c’est l’enfer qui est mis à sa place. Il y a une puissance de sorcellerie, une pensée du mauvais principe, un enivrement du mal, un égarement de la pensée, qui fait frissonner, rire et pleurer tout à la fois. Il semble que, pour un moment, le gouvernement de la terre soit entre les mains du démon. Vous tremblez, parce qu’il est impitoyable ; vous riez, parce qu’il humilie tous les amours-propres satisfaits ; vous pleurez, parce que la nature humaine, ainsi vue des profondeurs de l’enfer, inspire une pitié douloureuse.
« Milton a fait Satan plus grand que l’homme ; Michel-Ange et le Dante lui ont donné les traits hideux de l’animal, combinés avec la figure humaine. Le Méphistophélès de Gœthe est un diable civilisé. Il manie avec art cette moquerie, légère en apparence, qui peut si bien s’accorder avec une grande profondeur de perversité ; il traite de niaiserie ou d’affectation tout ce qui est sensible ; sa figure est méchante, basse et fausse ; il a de la gaucherie sans timidité, du dédain sans fierté, quelque chose de doucereux auprès des femmes, parce que, dans cette seule circonstance, il a besoin de tromper pour séduire ; et ce qu’il entend par séduire, c’est servir les passions d’un autre, car il ne peut même faire semblant d’aimer : c’est la seule dissimulation qui lui soit impossible. »
Je crois qu’il était difficile de mieux peindre Méphistophélès ; cette appréciation est bien digne de l’ouvrage qui l’a inspirée ; mais où le sublime caractère de Faust serait-il mieux rendu que dans cet ouvrage même, dans ces hautes méditations, auxquelles la faiblesse de ma prose n’a pu enlever tout leur éclat ? Quelle âme généreuse n’a éprouvé quelque chose de cet état de l’esprit humain, qui aspire sans cesse à des révélations divines, qui tend, pour ainsi dire, toute la longueur de sa chaîne, jusqu’au moment où la froide réalité vient désenchanter l’audace de ses illusions ou de ses espérances et, comme la voix de l’Esprit, le rejeter dans son monde de poussière ?
Cette ardeur de la science et de l’immortalité, Faust la possède au plus haut degré ; elle l’élève souvent à la hauteur d’un dieu, ou de l’idée que nous nous en formons, et cependant tout en lui est naturel et supportable ; car, s’il a toute la grandeur et toute la force de l’humanité, il en a aussi toute la faiblesse ; en demandant à l’enfer des secours que le ciel lui refusait, sa première pensée fut sans doute le bonheur de ses semblables, et la science universelle ; il espérait à force de bienfaits sanctifier les trésors du démon, et, à force de science, obtenir de Dieu l’absolution de son audace ; mais l’amour d’une jeune fille suffit pour renverser toutes ses chimères : c’est la pomme d’Éden qui, au lieu de la science et de la vie, n’offre que la jouissance d’un moment et l’éternité des supplices.
Les deux caractères dramatiques qui se rapprochent le plus de Faust sont ceux de Manfred et de don Juan, mais encore quelle différence ! Manfred est le remords personnifié, mais il a quelque chose de fantastique qui empêche la raison de l’admettre ; tout en lui, sa force comme sa faiblesse, est au-dessus de l’humanité ; il inspire de l’étonnement, mais n’offre aucun intérêt, parce que personne n’a jamais participé à ses joies ni à ses souffrances. Cette observation est encore plus applicable à don Juan ; si Faust et Manfred ont offert, sous quelques rapports, le type de la perfection humaine, il n’est plus que celui de la démoralisation, et livré enfin à l’esprit du mal ; on sent qu’ils étaient dignes l’un de l’autre.
Et cependant, dans tous trois, le résultat est le même, et l’amour des femmes les perd tous trois !…
Quel parallèle entre ces grandes créations si différentes !… Je n’ose me laisser entraîner à le prolonger ! mais si celle de Faust est bien supérieure aux deux autres, combien Marguerite surpasse et les amours vulgaires de don Juan, et l’imaginaire Astarté de Manfred ! En lisant les scènes de la seconde partie, où sa grâce et son innocence brillent d’un éclat si doux, qui ne se sentira touché jusqu’aux larmes ? qui ne plaindra de toute son âme cette malheureuse sur laquelle s’est acharné l’esprit du mal ? qui n’admirera cette fermeté d’une âme pure, que l’enfer fait tous ses efforts pour égarer, mais qu’il ne peut séduire ; qui, sous le couteau fatal, s’arrache aux bras de celui qu’elle chérit plus que la vie, à l’amour. à la liberté, pour s’abandonner à la justice de Dieu, et à celle des hommes, plus sévère encore ?
Quelle combinaison ! quelle horrible torture pour Faust, à qui son pacte promettait quelques années de bonheur, mais dont il venait de commencer le supplice éternel ! Si l’amour semble lui promettre toutes ses délices, une pensée affreuse va les convertir en tourments. « En vain, dit-il, elle me réchauffera sur son sein, en serai-je moins le fugitif, l’exilé ?… le monstre sans but et sans repos, qui, comme un torrent, mugissant de rochers en rochers, aspire avec fureur à l’abîme ? Mais elle, innocente, simple, une petite cabane, un petit champ des Alpes, et elle aurait passé toute sa vie dans ce petit monde, au milieu d’occupations domestiques. Tandis que moi, haï de Dieu, je n’ai point fait assez de saisir ses appuis pour les mettre en ruine, il faut que j’engloutisse toute la joie de son âme !… Enfer, il te fallait cette victime !… etc. »
Marguerite n’est pas une héroïne de mélodrame ; ce n’est vraiment qu’une femme, une femme comme il en existe beaucoup, et elle n’en touche que davantage. Trouverait-on sur la scène quelque chose de comparable à ses entretiens naïfs avec Faust, et surtout au dialogue si déchirant de la prison, qui termine la pièce ?
On s’étonnera qu’elle finisse ainsi ; mais que pouvait-on y ajouter ?… Peut-être le moment où Faust se livre à l’enfer ; mais comment le rendre, et comment l’esprit humain pouvait-il supposer que l’enfer lui gardât encore une plus horrible torture ? D’un autre côté, le dénoûment ainsi interrompu permet au lecteur la pensée consolante que celui qui l’a intéressé si vivement par son génie et ses malheurs échappe aux griffes du démon, puisqu’un repentir suffirait pour lui reconquérir les cieux.
Tel n’est pas cependant le sort de Faust dans les pièces et les biographies allemandes ; le diable s’y empare réellement de lui au bout de vingt-quatre ans, et la description de ce moment terrible en est le passage le plus remarquable. Ceux qui veulent tout savoir peuvent consulter là-dessus l’Histoire prodigieuse et lamentable du docteur Faust, avec sa mort épouvantable, où il est montré combien est misérable la curiosité des illusions et impostures de l’esprit malin : ensemble, la Corruption de Satan, par lui-même, étant contraint de dire la vérité ; par Widman, et traduite par Cayet, en 1561 [1].
Les légendes de Faust sont très-répandues en Allemagne ; quelques auteurs, entre autres Conrad Durrius, pensent qu’elles furent primitivement fabriquées par les moines contre Jean Faust ou Fust, inventeur de l’imprimerie, irrités qu’étaient ces cénobites d’une découverte qui leur enlevait les utiles fonctions de copistes de manuscrits. Cette conjecture assez probable est combattue par d’autres auteurs ; Klinger l’a admise dans son roman philosophique intitulé les Aventures de Faust, et sa Descente aux enfers.
Suivant l’opinion la plus accréditée, Faust naquit à Mayence, au commencement du XVe siècle. Plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir donné naissance, et conservent des objets que son souvenir rend précieux : Francfort, le premier livre qu’il a imprimé ; Mayence, sa première presse ; etc. On montre à Wittemberg deux maisons qui lui ont appartenu, et qu’il légua, par testament, à son disciple Vagner.