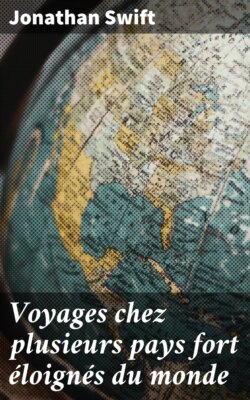Читать книгу Voyages chez plusieurs pays fort éloignés du monde - Jonathan Swift - Страница 4
CHAPITRE I
ОглавлениеMON père habitait le comté de Nottingham où il avait un petit bien. J’étais le troisième de ses cinq enfants. A l’âge de quatorze ans, il m’envoya au Collège Emanuel, à Cambridge, où pendant trois ans j’étudiai avec assiduité. Le prix de ma pension était bien modique, mais constituait pourtant une lourde charge pour les ressources très limitées de mon père. Je dus quitter le collège et entrer en apprentissage chez Mr. Jacques Bates, célèbre chirurgien de Londres, qui me garda quatre ans.
Mon bon père m’envoyait de temps à autre des petites sommes d’argent qui me servirent à étudier la navigation et les branches des sciences mathématiques indispensables aux voyageurs. Je prévoyais déjà ma destinée. J’obéis au même sentiment instinctif en quittant Mr. Bates, pour me rendre à Leyde terminer mes études de médecine, si utiles au cours des longs voyages. Je passai deux années dans la célèbre ville Hollandaise, et j’étais à peine de retour en Angleterre que sur la recommandation de mon cher maître Mr. Bates, j’embarquais en qualité de chirurgien à bord de l’Hirondelle, commandée par le capitaine Abraham Pannell.
Pendant trois ans et demi je naviguai sous ses ordres, parcourant le monde entre deux voyages au Levant, et à mon retour, un peu lassé sans doute, je résolus de me fixer à Londres. Mr. Bates m’encouragea fort et m’aida à m’établir en me présentant à plusieurs de ses clients. Je pris un appartement dans une petite maison d’Old Jewry, et j’épousai peu après Miss Mary Burton, (seconde fille de Mr. Edmund Burton, établi bonnetier dans Newgate Street,) qui m’apporta en dot quatre cents livres sterling.
J’avais un foyer et une situation pleine de promesses, mais la roue de la fortune ne tourne pas toujours selon nos désirs. Deux ans s’étaient à peine écoulés que mon cher maître, Mr. Bates, tombait malade et mourait bientôt. Je n’avais guère de relations encore et ma clientèle s’en alla diminuant peu à peu. Après avoir consulté ma femme et quelques amis, je me déterminai à prendre de nouveau la mer.
Je fus successivement chirurgien à bord de deux navires et je passai six longues années à voyager dans les Indes Orientales et Occidentales, ce qui me permit de rétablir un peu ma fortune. J’emportais toujours avec moi un grand nombre de livres et j’employais mes heures de loisir à étudier les meilleurs auteurs anciens et modernes. Quand nous descendions à terre, j’en profitais pour observer le caractère et les mœurs des peuplades indigènes et pour apprendre leur langue. J’y parvenais facilement, grâce à mon excellente mémoire.
J’étais revenu dans mon pays et j’avais passé trois années au sein de ma famille, quand je reçus des offres fort avantageuses du Capitaine Pritchard, dont le vaisseau l’Antilope allait appareiller pour les Mers du Sud. J’acceptai.
Nous mîmes à la voile le 4 Mai 1669, sous les plus rassurants auspices et les débuts de notre voyage furent heureux.
Mais une tempête violente s’éleva soudain comme nous virions vers les Indes Orientales et poussa le navire au N.O. de la Terre de Van Diemen. Le 5 Novembre, jour où commence l’été dans ces parages, et le temps étant très couvert, la vigie signala un récif à moins d’une demi-encâblure du vaisseau. Toute manœuvre étant rendue impossible par la violence du vent, notre malheureux bâtiment vint se briser sur l’écueil. Six hommes de l’équipage (dont j’étais) réussirent à mettre la chaloupe à la mer et à s’éloigner du récif à force de rames, mais bientôt la fatigue nous terrassa et nous dûmes nous confier à la merci des vagues. Une demi-heure s’écoula dans les plus cruelles angoisses. Tout d’un coup, le vent du Nord se prit à souffler violemment et notre chaloupe chavira. Je ne puis dire exactement quel fut le sort de mes malheureux compagnons, mais, hélas! j’ai lieu de penser qu’ils périrent tous!
Quant à moi, j’eus le bonheur de conserver mon sang-froid, et à peine à l’eau je me mis à nager à l’aventure en me laissant conduire par le vent et la marée. J’étais cependant à bout de forces quand je me trouvai enfin prendre pied. L’ouragan avait déjà perdu beaucoup de sa fureur, mais la pente était si douce que je dus marcher plus d’une demi-lieue dans la mer avant d’atteindre le rivage. Il pouvait être alors huit heures du soir environ. Après avoir fait quatre cents mètres sans trouver aucune trace d’êtres vivants, la fatigue s’empara de moi et je m’écroulai vaincu sur l’herbe très courte et très douce où je m’endormis aussitôt profondément. Combien de temps dura mon sommeil? Je ne saurais le dire au juste, mais je l’évaluai à neuf heures environ, car le jour se levait quand je voulus me mettre debout. A mon intense surprise je fus incapable de remuer un seul membre, et dans un instant, je me rendis compte de ma situation. Mes jambes et mes bras étaient fortement fixés au sol par des liens; il en était de même de mes cheveux très longs et touffus, et de minces ligatures entouraient mon corps depuis les aisselles jusqu’aux cuisses. Jugez de l’état d’impuissance où j’étais réduit! Autour de moi, je percevais bien comme une rumeur confuse, mais, dans la triste posture où je me trouvais, il m’était impossible de rien voir que le ciel! Presque aussitôt je sentis quelque chose de vivant qui remuait le long de ma jambe gauche et qui, s’avançant doucement sur ma poitrine, vint presque à toucher mon menton. Je baissai les yeux autant qu’il me fut possible et à mon intense stupéfaction je distinguai une petite créature humaine, humaine, oui vraiment, mais qui n’avait pas six pouces de haut et qui portait un arc, un carquois et des flèches! En même temps j’eus la désagréable sensation d’une quarantaine d’êtres semblables qui s’agitaient sur moi. J’étais dans le plus profond ébahissement. On l’eut été à moins! Et je ne pus me retenir de jeter de si grands cris que ces petits bonshommes s’enfuirent, tous, épouvantés. Toutefois la plupart revinrent bientôt et l’un d’eux eut la hardiesse de s’approcher tout près de mon visage. Après m’avoir examiné, il leva les mains et les yeux au ciel en témoignage d’admiration et il cria d’une voix aiguë mais distincte: «Hekinah degul!» Ses compagnons répétèrent ces mêmes mots plusieurs fois de suite. Je n’en étais pas plus avancé !
Silencieusement, je faisais mille efforts pour me libérer et je réussis enfin à rompre les liens et à arracher les piquets qui retenaient mon bras gauche au sol. En même temps, d’un violent effort qui me causa une extrême douleur, je parvins à desserrer un peu les liens qui attachaient mes cheveux du côté gauche, et je me trouvai alors en état de tourner légèrement la tête. Pour la seconde fois, les petits bonshommes furent saisis d’une folle panique et s’enfuirent, en poussant des cris de terreur. Puis le silence se fit. J’entendis quelqu’un crier d’un ton de commandement: «tolgo phonac!» et à l’instant, plus de cent flèches s’enfoncèrent dans ma main gauche et me piquèrent comme autant d’aiguilles acérées. Quand la pluie de flèches s’arrêta, je laissai échapper des gémissements, arrachés par la souffrance, et je fis de nouveaux efforts pour me délivrer. Nouvelles décharges, nouvelles blessures. Je vis bien qu’il fallait me résoudre à demeurer dans une quasi-immobilité jusqu’au soir où il me serait plus facile de rompre mes chaînes. Mais le hasard en disposa différemment.
Dès que la foule qui m’entourait eût remarqué mes dispositions pacifiques, il ne fut plus question de me décocher des flèches, et pendant plus d’une heure, j’entendis à deux toises environ de mon oreille droite comme un bruit d’ouvriers charpentiers au travail. Lentement, avec précaution, je tournai la tête de ce côté et j’aperçus un curieux petit échafaudage, haut d’un pied et demi, formant comme une minuscule tribune, où avaient pris place quatre de ces petits êtres. L’un d’eux m’adressa un long discours, dont, vous le devinez, ami lecteur, je ne saisis pas un traître mot! L’orateur me sembla d’âge moyen et d’une taille plus élevée que celle de ses compagnons. Le page qui portait la queue de sa robe, était à peine un peu plus grand que mon doigt. J’ai dit que le discours fut long. Si je n’en compris pas une syllabe, j’en saisis du moins le sens approximatif, et d’après le ton et les périodes, je devinai que l’orateur avait tour à tour recours aux promesses et aux menaces, à la sévérité et à la bonté. Je répondis en manifestant ma soumission par une mimique expressive, levant ma main gauche et mes yeux vers le soleil, comme pour prendre celui-ci à témoin de ma bonne foi. Je mourais littéralement de faim, n’ayant rien eu à me mettre sous la dent depuis le naufrage. Je cédai au besoin, et portant plusieurs fois mes doigts à ma bouche, je fis comprendre la faim dont j’étais dévoré au hurgo (c’est ainsi que ces petits êtres désignent leurs grands seigneurs) qui m’interpellait. Celui-ci descendit immédiatement de sa tribune, et sur ses ordres, plusieurs échelles furent appliquées contre moi. Une centaine de petits hommes les escaladèrent avec célérité et m’apportèrent des paniers remplis de viandes fort bien apprêtées, ma foi, mais plus petites que des ailes d’alouette! De deux ou trois plats je ne faisais qu’une bouchée. Les pauvres petites gens s’empressaient de leur mieux et témoignaient de mille manières l’émerveillement et l’admiration que leur causaient mon appétit et mes capacités stomacales! Manger était bien, mais il me fallait boire maintenant. Ils jugèrent, d’après mon appétit, toute l’étendue de ma soif; fort ingénieusement, ils hissèrent sur moi un de leurs plus grands tonneaux de vin, le roulèrent jusqu’à mes lèvres et le défoncèrent. Je le vidai d’une gorgée; il ne contenait pas une demi-pinte. Le vin avait le même goût que le vin de Bourgogne, mais il était plus agréable encore. Une seconde tonne me fut apportée et eût le même sort que la première. Quand j’eûs accompli toutes ces merveilles, ils poussèrent des exclamations de joie et se prirent à danser sur ma poitrine en répétant dans leur allégresse: «Hekinah degul! Hekinah degul!»
Ils s’adressèrent ensuite aux spectateurs et les avertirent d’avoir à s’écarter en leur criant: “ Borach mevolah! ” Puis ils me demandèrent, par signe, de jeter les deux tonneaux. Quand je les eûs envoyés en l’air ce fut une clameur universelle, où l’on n’entendait que leur fameux «Hekinah degul!»
Lorsqu’ils virent que j’étais rassassié, ils s’écartèrent et je vis s’avancer vers moi un groupe de personnes, dont l’une, d’un rang très élevé, m’était envoyée par Sa Majesté Impériale. Son Excellence monta sur mon mollet droit, vint jusqu’à mon visage, et me présenta des lettres de créance, revêtues du sceau impérial. Je dus subir un nouveau discours qui dura bien dix minutes et qui fut prononcé sur un ton très calme mais non moins résolu. De la main, l’orateur m’indiquait un point de l’horizon, que je connus plus tard pour la Capitale du Royaume de Lilliput, où je devais être transporté ; ainsi en avait décidé Sa Majesté dans son Conseil. Je répondis par quelques mots tout à fait inutiles, et au moyen de signes très expressifs, j’indiquai mon vif désir d’être libre. L’Excellence parut m’avoir compris, car il secoua la tête négativement et, continuant d’employer le langage des signes, me montra que je devais être transporté dans la position même où je me trouvais. J’eûs bien encore quelques vélléités de résistance, mais j’y renonçai aussitôt, le nombre de mes petits adversaires augmentant sans cesse, et je témoignai à l’Excellence que je me résignais à mon sort. Sur quoi le hurgo (grand seigneur) et sa suite se retirèrent avec beaucoup de civilités et de marques de satisfaction. Presque aussitôt mes liens furent relâchés et on étendit sur ma figure et mes mains une sorte de pommade parfumée qui fit disparaître en quelques minutes la cuisson douloureuse occasionnée par les maudites flèches. Toutes ces circonstances m’avaient prédisposé au sommeil. Les docteurs de Sa Majesté ayant sur son ordre mélangé à ma boisson un puissant narcotique, je dormis à peu près huit heures. Pendant mon sommeil on me hissa sur une singulière machine construite à cet effet, sur l’ordre de l’Ingénieur Impérial. Ces petites gens excellent dans les arts mécaniques et en l’espace de quelques heures ils avaient monté l’appareil qui m’était destiné.
Imaginez un cadre de bois de sept pieds de long sur quatre de large, posé sur vingt-deux roues et distant du sol de trois pouces. Dès que le narcotique eût agi, ce chariot fut placé parallèlement à moi. Le plus difficile n’était pas fait. Ce n’était pas une petite affaire, vous le pensez bien, de me placer sur cette machine! Voici comment ils s’y prirent: quatre-vingt piquets furent plantés enterre et de fortes cordes, de la grosseur d’un fil d’emballage, fixées au moyen de crochets à d’innombrables bandes de toile que des ouvriers avaient passées sous mon cou, mes mains, mes bras et tout mon corps. 900 petits hommes, choisis parmi les plus robustes, tirèrent alors ces cordes au moyen des poulies dont les piquets étaient surmontés, et ainsi en moins de trois heures je fus hissé, déposé sur le chariot et solidement attaché. Il ne fallut pas moins de 1500 chevaux, triés parmi les plus vigoureux coursiers des écuries Impériales, et hauts à peu près de quatre pouces et demi, pour me traîner jusqu’à la métropole, à huit cents mètres de là.
Notre voyage dura près de deux jours. Quand nous fûmes à deux cents mètres des portes de la ville, l’Empereur vint à notre rencontre avec toute la Cour. Mais les grands officiers se refusèrent obstinément à laisser Sa Majesté exposer ses jours en montant sur mon corps.
Notre convoi s’était arrêté près d’un ancien temple désaffecté depuis quelques années, à la suite d’un meurtre qui y avait été commis. Ce temple, le plus vaste de tout le royaume, me fut assigné pour demeure. La grande porte, au Nord, ayant à peu près quatre pieds de haut sur deux de large, je pouvais assez facilement pénétrer à l’intérieur en rampant. Deux petites fenêtres, situées à six pouces du sol, encadraient la porte. C’est à l’une d’elles que les forgerons de l’Empereur fixèrent 92 câbles semblables à des chaînes de montre, et les fixèrent à ma jambe gauche au moyen de trente-six cadenas. Mes chaînes ayant à peu près deux mètres de long j’avais la liberté de me promener de long en large dans l’espace d’un demi-cercle.
Vis-à-vis du temple, de l’autre côté de la route, s’élevait une tour d’au moins cinq pieds de haut. L’Empereur y monta avec sa suite, afin de m’examiner tout à son aise.
Quand les ouvriers furent convaincus qu’il m’était impossible de m’échapper ils coupèrent mes liens et je me levai, mais avec un sentiment d’amertume et de tristesse indicibles.
Quand le peuple me vit debout, allant et venant, il exprima son étonnement par des rumeurs dont je ne puis vous donner une idée.