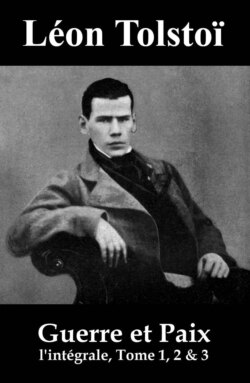Читать книгу Guerre et Paix (l'intégrale, Tome 1, 2 & 3) - León Tolstoi - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XVIII
ОглавлениеL’attaque du 6ème chasseurs avait assuré la retraite du flanc droit. Au centre, l’incendie allumé à Schöngraben par la batterie oubliée de Tonschine arrêtait le mouvement des Français, qui éteignaient le feu propagé par le vent, et nous donnaient ainsi le temps de nous retirer; la retraite du centre à travers le ravin se faisait avec bruit et précipitation, quoique sans désordre. Mais le flanc gauche, qui avait été attaqué en même temps et cerné par des forces supérieures sous le commandement de Lannes, composé des régiments d’infanterie d’Azow et de Podolie, était débandé. Bagration envoya Gerkow au général commandant le flanc gauche, avec ordre de se replier immédiatement.
Gerkow, les doigts à la hauteur de la visière, s’élança résolument au galop, mais il avait à peine quitté Bagration que son courage le trahit; saisi d’une terreur folle, il lui fut impossible d’aller à l’encontre du danger; sans avancer jusqu’à la fusillade, il se mit à chercher le général et les autres chefs là où ils ne pouvaient se trouver; il en résulta que l’ordre ne fut pas transmis.
Le commandant du flanc gauche était, par ancienneté de grade, le chef du régiment que nous avons vu à Braunau et dans lequel servait Dologhow, tandis que le commandant de l’extrême gauche était le chef du régiment de Pavlograd, dont faisait partie Rostow. Les deux chefs, violemment irrités l’un contre l’autre, ce qui causa un malentendu, perdaient du temps en récriminations injurieuses, pendant qu’au flanc droit on se battait depuis longtemps et que les Français commençaient à opérer leur retraite.
Les régiments de cavalerie et le régiment des chasseurs étaient peu en mesure de prendre part à l’engagement; du soldat au général, personne ne s’y attendait, et l’on s’occupait paisiblement du chauffage dans l’infanterie, et du fourrage dans la cavalerie.
«Votre chef est mon ancien en grade, disait, rouge de colère, l’Allemand qui commandait les hussards, à l’aide de camp du régiment de chasseurs… Qu’il fasse comme bon lui semble, je ne puis sacrifier mes hommes… Trompettes, sonnez la retraite!»
L’action cependant devenait chaude; la canonnade et la fusillade grondaient; à droite et au centre, les tirailleurs de Lannes franchissaient la digue du moulin et s’alignaient de notre côté à deux portées de fusil. Le général d’infanterie se hissa lourdement sur son cheval et, se redressant de toute sa hauteur, alla rejoindre le colonel de cavalerie. La politesse apparente de leur salut cachait leur animosité réciproque.
«Je ne puis pourtant pas, colonel, laisser la moitié de mon monde dans le bois. Je vous prie… et il appuyait sur ce mot… je vous prie d’occuper les positions et de vous tenir prêt pour l’attaque.
— Et moi, je vous prie de vous mêler de vos affaires; si vous étiez de la cavalerie…
— Je ne suis pas de la cavalerie, colonel, mais je suis un général russe, si vous ne le savez pas…
— Je le sais très bien, Excellence, reprit le premier, en éperonnant son cheval et en devenant pourpre… Ne vous plairait il pas de me suivre aux avant-postes? Vous verriez par vous-même que la position ne vaut rien; je n’ai pas envie de faire massacrer mon monde pour votre bon plaisir.
— Vous vous oubliez, colonel, ce n’est pas pour mon bon plaisir, et je ne saurais vous permettre de le dire…»
Le général accepta la proposition pour ce tournoi de courage: la poitrine en avant et fronçant le sourcil, il se dirigea avec lui vers la ligne des tirailleurs, comme si leur différend ne pouvait se vider que sous les balles. Arrivés là, ils s’arrêtèrent en silence et quelques balles volèrent par-dessus leurs têtes. Il n’y avait rien de nouveau à y voir, car, de l’endroit même qu’ils avaient quitté, l’impossibilité pour la cavalerie de manœuvrer au milieu des ravins et des broussailles était aussi évidente que le mouvement tournant des Français pour envelopper l’aile gauche. Les deux chefs se regardaient comme deux coqs prêts au combat, chacun attendant en vain un signe de faiblesse de son adversaire. Tous deux subirent cette épreuve avec honneur, et ils l’auraient prolongée indéfiniment par amour-propre, aucun ne voulant abandonner la partie le premier, si, au même instant, une fusillade, accompagnée de cris confus, n’avait éclaté à deux pas en arrière.
Les Français étaient tombés sur les soldats occupés à ramasser du bois: il ne pouvait donc plus être question pour les hussards de se replier avec l’infanterie, car ils étaient coupés de leur chemin de retraite sur la gauche par les avant-postes ennemis, et force leur fut d’attaquer, malgré les difficultés du terrain, pour s’ouvrir un passage.
L’escadron de Rostow, qui n’avait eu que le temps de se mettre en selle, se trouvait juste en face de l’ennemi, et, alors, comme sur le pont de l’Enns, il n’y avait rien entre l’ennemi et eux, rien que cette distance pleine de terreur et d’inconnu, cette distance entre les vivants et les morts que chacun sentait instinctivement, en se demandant avec émotion s’il la franchirait sain et sauf!…
Le colonel arriva sur le front, en répondant de mauvaise humeur aux questions des officiers; en homme résolu à faire à sa tête, il leur jeta un ordre. Rien n’avait été dit de bien précis, mais une vague rumeur faisait pressentir une attaque, et l’on entendit tout à la fois le commandement: «Alignez-vous!» et le froissement des sabres tirés du fourreau. Nul ne bougeait: l’indécision des chefs était si apparente, qu’elle ne tarda pas à se communiquer à leurs troupes, infanterie et cavalerie.
«Ah! Si cela pouvait venir plus vite, plus vite,» se disait Rostow, en sentant arriver le moment de l’attaque, cette grande et ineffable jouissance dont ses camarades l’avaient si souvent entretenu.
«En avant avec l’aide de Dieu, mes enfants! Cria la voix de Denissow… Au trot, marche!»
Les croupes des chevaux ondulèrent, Corbeau tira sur la bride et partit.
Rostow avait à sa droite les premiers rangs de ses hussards et au fond, devant lui, une ligne sombre dont il ne pouvait se rendre compte à distance, mais qui était l’ennemi. On entendait au loin des coups de fusil.
«Au trot accéléré!…»
Et Rostow, suivant l’impulsion de son cheval excité, se sentait gagné par la même ardeur. Un arbre solitaire qui lui avait semblé être au milieu de cette ligne mystérieuse était maintenant dépassé:
«Eh bien, la voilà dépassée, et il n’y a rien de terrible, au contraire tout devient plus gai, plus amusant. Oh! Comme je vais les sabrer!» murmura-t-il avec joie en serrant la poignée de son sabre.
Un formidable hourra retentit derrière lui…
«Qu’il me tombe seulement sous la main!»
Et, enlevant Corbeau, il le lança à pleine carrière; l’ennemi était en vue. Tout à coup un immense coup de fouet cingla l’escadron. Rostow leva la main, prêt à sabrer, mais au même moment il vit s’éloigner Nikitenka, le soldat qui galopait devant lui, et il se sentit, comme dans un rêve, emporté avec une rapidité vertigineuse, sans quitter sa place. Un hussard le dépassa au galop et le regarda d’un air sombre.
«Que m’arrive-t-il? Je n’avance pas; je suis donc tombé? Suis-je mort?»
Questions et réponses se croisaient dans sa tête. Il était seul au milieu des champs; plus de chevaux emportés, plus de hussards, il ne voyait autour de lui que la terre immobile et le chaume de la plaine. Quelque chose de chaud, du sang, coulait autour de lui:
«Non, je ne suis que blessé; c’est mon cheval qui est tué!»
Corbeau essaya de se relever, mais il retomba de tout son poids sur son cavalier; des flots de sang coulaient de sa tête et il se débattait dans de vains efforts. Rostow, cherchant à se remettre sur ses pieds, retomba à son tour, sa sabretache s’accrocha à la selle:
«Où sont les nôtres? Où sont les Français?…»
Il n’en savait rien… Il n’y avait personne.
Étant parvenu à se dégager de dessous son cheval, il se releva. Où donc se trouvait à présent cette ligne qui séparait si nettement les deux armées?
«Ne m’est-il pas arrivé quelque chose de grave? Cela se passe-t-il toujours ainsi, et que dois-je faire à présent?…»
Il sentit un poids étrange peser sur son bras gauche engourdi. Son poignet semblait ne plus lui appartenir, et pourtant aucune trace de sang ne se voyait sur sa main:
«Ah! Voilà enfin des hommes, ils vont m’aider,» pensa-t-il avec joie. Le premier de ceux qui accouraient vers lui, hâlé, bronzé, avec un nez crochu, vêtu d’une capote gros bleu, portait un shako de forme étrange; l’un d’eux prononça quelques mots dans une langue qui n’était pas du russe. D’autres, habillés de même façon, conduisaient un hussard de son régiment.
«C’est, sans doute un prisonnier… Mais va-t-on me prendre aussi? Se dit Rostow, qui n’en croyait pas ses yeux. Sont-ce des Français?»
Il examinait les survenants, et, malgré sa récente bravoure qui les voulait tous exterminer, ce voisinage le glaçait d’effroi.
«Où vont-ils?… Est-ce à moi qu’ils en veulent?… Me tueront-ils?… Pourquoi? Moi que tout le monde aime?…»
Et il se souvint de l’amour de sa mère, de sa famille, de l’affection que chacun avait pour lui, ce qui rendait cette supposition invraisemblable.
Il restait cloué à sa place, sans se rendre compte de sa situation; le Français au nez crochu, à la figure étrangère, échauffée par la course, et dont il pouvait déjà distinguer la physionomie, arrivait sur lui la baïonnette en avant. Rostow saisit son pistolet, mais, au lieu de le décharger sur son ennemi, il le lui jeta violemment à la tête, et s’enfuit à toutes jambes se cacher dans les buissons.
Les sentiments de lutte et d’excitation qu’il avait si vivement éprouvés sur le pont de l’Enns étaient bien loin de lui: il courait comme un lièvre traqué par les chiens; l’instinct de conserver son existence jeune et heureuse envahissait tout son être, et lui donnait des ailes! Sautant par-dessus les fossés, franchissant les sillons avec l’impétuosité de son enfance, il tournait souvent en arrière sa bonne et douce figure pâlie, tandis que le frisson de la peur aiguillonnait sa course.
«Il vaut mieux ne pas regarder,» pensa-t-il; mais, arrivé aux premières broussailles, il s’arrêta; les Français étaient distancés, et celui qui le poursuivait ralentissait le pas et semblait appeler ses compagnons:
«Impossible!… Ils ne peuvent pas vouloir me tuer?» se dit Rostow.
Cependant son bras devenait de plus en plus lourd; on aurait dit qu’il traînait un poids de deux pouds, il ne pouvait plus avancer. Le Français le visait, il ferma les yeux et se baissa: une, deux balles passèrent en sifflant à ses oreilles; rassemblant ses dernières forces et soulevant son poignet gauche avec sa main droite, il s’élança dans les buissons. Là était le salut, là étaient les tirailleurs russes!