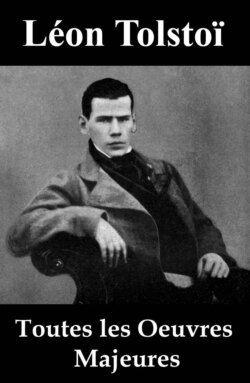Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Léon Tolstoï - León Tolstoi - Страница 112
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеPierre emportait avec lui de Pétersbourg des instructions complètes, écrites par ses nouveaux frères, pour le guider dans les différentes mesures qu’il méditait de prendre au sujet de ses paysans.
Arrivé à Kiew, il y réunit les intendants de toutes les terres qu’il possédait dans ce gouvernement, et leur fit part de ses intentions et de ses désirs. Il leur déclara qu’il allait incontinent prendre ses dispositions pour libérer ses paysans du servage. En attendant, il fallait leur venir en aide et ne pas les surcharger de travail; les femmes et les enfants devaient en être exemptés; les punitions devaient se borner à des réprimandes, et dans chaque bien il fallait organiser des hôpitaux, des asiles et des écoles. Quelques-uns des intendants (et il y en avait qui savaient à peine lire) l’écoutèrent avec terreur, en prêtant à ses paroles une portée qui leur était toute personnelle: il était mécontent de leur gestion et savait qu’ils le volaient. D’autres, après le premier moment d’effroi, s’amusèrent du bégaiement embarrassé de leur maître, et de ses idées, si étranges et si nouvelles pour eux. Le troisième groupe l’écouta par devoir et sans déplaisir. Le quatrième, composé des plus intelligents, l’intendant général en tête, y découvrirent tout de suite comment il fallait se comporter avec lui, pour en arriver à leurs fins. Aussi les intentions philanthropiques de Pierre rencontrèrent-elles chez eux une grande sympathie: «Mais, ajoutèrent-ils, il est de première nécessité de s’occuper des biens mêmes, vu le mauvais état de vos affaires.»
Malgré l’immense fortune du comte Besoukhow, son fils se trouvait en effet beaucoup plus riche avant d’en avoir hérité, avec les 10000 roubles de pension que lui faisait son père, qu’avec les 500000 roubles de rente qu’on lui supposait. Son budget était, en gros, à peu près le suivant: On avait à payer à la banque foncière 80000 roubles pour l’engagement des terres; 30000 pour l’entretien de la maison de campagne près de Moscou, la maison de Moscou et la rente à la princesse Catherine et à ses sœurs; 18000 en pensions et en fondations de charité; 150000 à la comtesse; 70000 en intérêts de dettes; 10000 environ dépensés pendant les deux dernières années pour la construction d’une église, et les 100000 qui lui restaient s’en allaient, il ne savait comment, si bien que, tous les ans, il était obligé d’emprunter, sans compter les incendies, la disette, la nécessité de rebâtir fabriques et maisons; aussi Pierre, dès son premier pas, se vit forcé de s’occuper lui-même de ses affaires, et il n’avait pour cela ni le goût, ni la capacité voulue.
Tous les jours il y consacrait quelques heures, sans qu’elles avançassent d’une ligne. Il sentait qu’elles continuaient à aller leur train habituel, sans que son travail eût la moindre influence sur leur marche accoutumée. De son côté, l’intendant en chef les lui présentait sous le plus triste aspect, lui démontrant la nécessité de payer ses dettes et d’entreprendre de nouveaux travaux avec la corvée, ce à quoi Pierre résistait, exigeant de son côté qu’on prît au plus tôt les mesures nécessaires pour hâter la libération de ses paysans; et comme il était impossible d’exécuter ces mesures avant d’avoir remboursé les dettes, elles étaient forcément renvoyées aux calendes grecques.
L’intendant ne se risquait pas à le lui dire franchement, et lui proposait, pour en arriver là, de vendre de beaux bois qu’il possédait dans le gouvernement de Kostroma, de belles et bonnes terres fertilisées par une rivière, et une propriété qu’il avait en Crimée. Mais toutes ces opérations se compliquaient d’une procédure si embrouillée, telle que levée d’hypothèques, entrée en possession, autorisation de vente, etc., que Pierre s’égarait dans ce dédale et se bornait à répéter: «Oui, oui, faites-le.»
Il manquait du sens pratique qui lui aurait facilité le travail, aussi ne l’aimait-il pas, et se bornait-il à paraître s’y intéresser devant son intendant, qui feignait d’y trouver un grand avantage pour le propriétaire, tout en se plaignant du temps que cela lui prenait.
Pierre rencontra à Kiew quelques connaissances, et les inconnus affluèrent également pour faire un accueil hospitalier à ce millionnaire, qui était le plus grand propriétaire de leur gouvernement. Les tentations qui s’ensuivirent furent si grandes, qu’il ne put y résister. Des jours, des semaines, des mois s’écoulèrent, avec le même accompagnement de déjeuners, de dîners, de bals, que durant son existence pétersbourgeoise, et, au lieu de cette nouvelle vie qu’il avait rêvée, il continua l’ancienne, seulement dans un autre milieu.
Il ne pouvait se dissimuler à lui-même que, des trois obligations imposées aux francs-maçons, il ne remplissait pas celle qui devait l’amener à être un exemple de pureté morale, et que des sept vertus à pratiquer, les bonnes mœurs et l’amour de la mort ne trouvaient en lui aucun écho. Il se consolait en se disant qu’il accomplissait l’autre mission, – la régénération de l’humanité, – et qu’il possédait d’autres vertus, – l’amour du prochain et la générosité.
Au printemps de l’année 1807, il se décida à retourner à Pétersbourg, et à faire, en y retournant, la visite de ses propriétés, afin de se rendre compte de visu des parties déjà réalisées de son programme, et de la situation où vivait le peuple que Dieu lui avait confié, et qu’il avait l’intention de combler de bienfaits.
L’intendant en chef, aux yeux de qui les entreprises du jeune comte étaient de l’extravagance pure, aussi désavantageuses pour lui que pour le propriétaire et pour les paysans mêmes, lui fit des concessions. Tout en lui représentant que l’émancipation était chose impossible, il fit toutefois commencer dans tous les biens des bâtisses énormes, pour asiles, écoles et hôpitaux. Partout il fit préparer des réceptions pompeuses et solennelles, assuré à part lui qu’elles déplairaient à Pierre; mais il pensait que ces processions, d’un caractère religieux et patriarcal, avec le pain et le sel, et les images en tête, étaient justement ce qui agirait le plus fortement sur l’imagination de son seigneur, et contribueraient à entretenir ses illusions.
Le printemps du Midi, le voyage dans une bonne calèche de Vienne, son tête-à-tête avec lui-même, lui causèrent de véritables jouissances. Ces biens, qu’il visitait pour la première fois, étaient plus beaux l’un que l’autre. Le paysan lui parut heureux, prospère, et touché de ses bienfaits. Les réceptions qu’on lui faisait partout l’embarrassaient sans doute un peu, mais, au fond du cœur, il en éprouvait une douce émotion. Dans un des villages, une députation lui offrit, avec le pain et le sel, l’image de saint Pierre et saint Paul, en lui demandant l’autorisation d’ajouter à l’église, aux frais de la commune, une chapelle en l’honneur de son patron saint Pierre. Dans un autre endroit, les femmes, avec leurs nourrissons sur les bras, le remercièrent de les avoir délivrées des travaux fatigants. Dans un troisième, le prêtre, la croix à la main, lui présenta les enfants auxquels, grâce à sa générosité, il donnait les premiers éléments de l’instruction. Partout il voyait s’élever et s’achever, sur le plan qu’il en avait donné, les hôpitaux, les écoles et les asiles, à la veille de s’ouvrir. Partout il révisait les comptes des intendants des biens, où les corvées étaient diminuées de moitié, et recevait, pour cette nouvelle preuve de bonté, les remerciements de ses paysans, vêtus de leurs caftans de drap gros bleu.
Seulement, Pierre ignorait que le village qui lui avait offert le pain et le sel, et qui désirait construire une chapelle, était un bourg très commerçant et que la chapelle était commencée depuis longtemps par les richards de l’endroit, ceux-là mêmes qui s’étaient présentés à lui, tandis que les neuf dixièmes des paysans étaient ruinés. Il ignorait aussi qu’à la suite de son ordre de ne pas envoyer les nourrices au travail de la corvée, ces mêmes nourrices étaient assujetties à un travail bien autrement pénible dans leurs propres champs. Il ignorait encore que le prêtre qui l’avait reçu la croix à la main pesait lourdement sur les paysans, prélevant de trop fortes dîmes en nature, et que les élèves qui l’entouraient lui étaient confiés à contre-cœur, et rachetés le plus souvent par les parents, au prix d’une forte rançon. Il ignorait que ces nouveaux bâtiments en pierre, élevés d’après ses plans, étaient construits par ses paysans, dont ils augmentaient par le fait la corvée, diminuée seulement sur le papier. Il ignorait enfin que là où l’intendant portait dans le livre les redevances comme moindres d’un tiers, ce tiers était compensé par une augmentation de corvées. Aussi Pierre, enchanté des résultats de son inspection, se sentait réchauffé d’une nouvelle ardeur philanthropique, et écrivait des lettres pleines d’exaltation au frère instructeur, ainsi qu’il appelait le Vénérable.
«Comme c’est facile d’être bon! Comme ça demande peu d’efforts, pensait Pierre, et combien peu nous y songeons!»
Il était heureux de la reconnaissance qu’on lui témoignait, mais cette reconnaissance même le rendit tout honteux à l’idée de tout le bien qu’il aurait encore pu faire.
L’intendant en chef, bête mais rusé, avait parfaitement compris le jeune comte, intelligent mais naïf, et le jouait de toutes les façons. Il profita de l’effet produit par les réceptions qu’il avait habilement commandées à l’avance, pour y trouver de nouveaux arguments contre l’émancipation des paysans, et lui assurer que ces derniers étaient parfaitement heureux.
Pierre lui donnait raison dans le fond de son cœur: il ne pouvait se représenter des gens plus contents, et compatissait au sort qui les attendait lorsqu’ils seraient libres; malgré tout, par un sentiment de justice, il ne voulait en démordre à aucun prix.
L’intendant promit de faire tous ses efforts pour exécuter la volonté du comte, bien convaincu à l’avance que son maître ne serait jamais en état de réviser ses actes, de s’assurer s’il avait fait son possible pour vendre assez de forêts et de biens, afin de dégager le reste, qu’il ne ferait pas de questions et ne saurait jamais que les bâtisses élevées dans une intention philanthropique restaient sans usage, et que les paysans continuaient à payer en argent et en travail la même redevance que partout ailleurs, c’est-à-dire tout ce qu’ils pouvaient humainement payer.