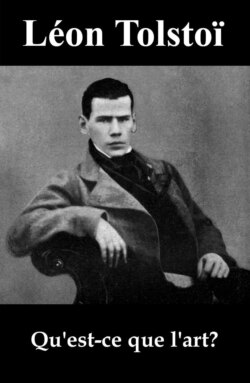Читать книгу Qu'est-ce que l'art? - León Tolstoi - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеOuvrez un journal quelconque: vous ne manquerez pas d’y trouver une ou deux colonnes consacrées au théâtre et la musique. Vous y trouverez aussi, au moins deux fois sur trois, le compte-rendu de quelque exposition artistique, la description d’un tableau, d’une statue, et aussi l’analyse de romans, de contes, de poèmes nouveaux.
Avec un empressement et une richesse de détails extraordinaires, ce journal vous dira comment telle ou telle actrice a joué tel ou tel rôle dans telle ou telle pièce; et vous apprendrez du même coup la valeur de cette pièce, drame, comédie ou opéra, ainsi que la valeur de sa représentation. Des concerts, non plus, on ne nous laissera rien ignorer: vous saurez quel morceau ont joué ou chanté tel et tel artiste, de quelle façon ils l’ont joué ou chanté. D’autre part, il n’y a plus aujourd’hui une grande ville où vous ne soyez assurés de trouver au moins une, et souvent deux ou trois expositions de tableaux, dont les mérites et les défauts fournissent aux critiques d’art la matière de minutieuses études. Quant aux romans et poèmes, pas un jour ne se passe sans qu’il en paraisse de nouveaux; et les journaux se considèrent comme tenus d’en offrir à leurs lecteurs une analyse détaillée.
Pour l’entretien de l’art en Russie (où c’est à peine si, pour l’éducation du peuple, on dépense la centième partie de ce qu’on devrait dépenser), le gouvernement accorde des millions de roubles, sous la forme de subventions aux académies, théâtres et conservatoires. En France, l’art coûte à l’État vingt millions de francs; il coûte au moins autant en Allemagne et en Angleterre.
Dans toutes les grandes villes, d’énormes édifices sont construits pour servir de musées, d’académies, de conservatoires, de salles de théâtre et de concert. Des centaines de milliers d’ouvriers, — charpentiers, maçons, peintres, menuisiers, tapissiers, tailleurs, coiffeurs, bijoutiers, imprimeurs, — s’épuisent, leur vie durant, en de durs travaux pour satisfaire le besoin d’art du public, au point qu’il n’y a pas une autre branche de l’activité humaine, sauf la guerre, qui consomme une aussi grande quantité de force nationale.
Encore n’est-ce pas seulement du travail qui se consomme, pour satisfaire ce besoin d’art: d’innombrables vies humaines se trouvent, tous les jours, sacrifiées pour lui. Des centaines de milliers de personnes emploient leur vie, dès l’enfance, à apprendre la manière d’agiter rapidement leurs jambes, ou de frapper rapidement les touches d’un piano ou les cordes d’un violon, ou de reproduire l’aspect et la couleur des objets, ou de renverser l’ordre naturel des phrases et d’accoupler à chaque mot un mot qui rime avec lui. Et toutes ces personnes, souvent honnêtes et bien douées, et capables par nature de toute sorte d’occupations utiles, s’absorbent dans cette occupation spéciale et abrutissante; ils deviennent ce qu’on appelle des spécialistes, des êtres à l’esprit étroit et pleins de vanité, fermés à toutes les manifestations sérieuses de la vie, n’ayant absolument d’aptitude que pour agiter, très vite, leurs jambes, leurs doigts, ou leur langue.
Et cette dégradation de la vie humaine n’est pas encore, elle-même, la pire conséquence de notre civilisation artistique. Je me rappelle avoir un jour assisté à la répétition d’un opéra, un de ces opéras nouveaux, grossiers et banals, que tous les théâtres d’Europe et d’Amérique s’empressent de monter, sauf à s’empresser ensuite de les laisser tomber à jamais dans l’oubli.
Quand j’arrivai au théâtre, le premier acte était commencé. Pour atteindre la place qu’on m’avait réservée, j’eus à passer par derrière la scène. À travers des couloirs sombres, on m’introduisit d’abord dans un vaste local où étaient disposées diverses machines servant aux changements de décor et à l’éclairage. Je vis là, dans les ténèbres et la poussière, des ouvriers travaillant sans arrêt. Un d’eux, pâle, hagard, vêtu d’une blouse sale, avec des mains sales et usées par la besogne, un malheureux évidemment épuisé de fatigue, hargneux et aigri, je l’entendis qui, en passant près de moi, grondait avec colère un de ses compagnons. On me fit ensuite monter, par un escalier, dans le petit espace qui entourait la scène Parmi une masse de cordes, d’anneaux, de planches, de rideaux et de décors, je vis s’agiter, autour de moi, des douzaines ou peut-être des centaines d’hommes peints et déguisés, dans des costumes bizarres, sans compter des femmes, naturellement aussi peu vêtues que possible. Tout cela était des chanteurs ou des choristes, des danseurs et danseuses de ballet, attendant leur tour. Mon guide me fit alors traverser la scène, et je parvins enfin au fauteuil que je devais occuper, en passant sur un pont de planches jeté au-dessus de l’orchestre, où je vis une grande troupe de musiciens assis auprès de leurs instruments, violonistes, flûtistes, harpistes, cimbaliers, et le reste.
Sur une estrade, au milieu d’eux, entre deux lampes à réflecteur, avec un pupitre devant lui, se tenait assis le chef d’orchestre, un bâton en main, dirigeant non seulement les musiciens, mais aussi les chanteurs sur la scène.
Je vis, sur cette scène, une procession d’Indiens qui venaient d’amener une fiancée. Il y avait là nombre d’hommes et de femmes en costumes exotiques, mais je vis aussi deux hommes en costume ordinaire, qui s’agitaient et couraient d’un bout à l’autre de la scène. L’un était le directeur de la partie dramatique, le régisseur, comme on dit. L’autre, qui était chaussé d’escarpins, et qui courait avec une agilité prodigieuse, était le maître de danse. J’ai su depuis qu’il touchait, par mois, plus d’argent que dix ouvriers n’en gagnent en un an.
Ces trois directeurs étaient en train de régler la mise en scène de la procession. Celle-ci, comme il est d’usage, se faisait par couples. Des hommes, portant sur l’épaule des hallebardes d’étain, se mettaient tout d’un coup en mouvement, faisaient plusieurs fois le tour de la scène, et de nouveau s’arrêtaient. Et ce fut une grosse affaire, de régler cette procession: la première fois, les Indiens avec leurs hallebardes partirent trop tard, la seconde fois trop tôt; la troisième fois ils partirent au moment voulu, mais perdirent leurs rangs au cours de leur marche; une autre fois encore ils ne surent pas s’arrêter à l’endroit qui convenait; et chaque fois la cérémonie entière était reprise, depuis le début. Ce début était formé par un récitatif, où il y avait un homme habillé en turc qui, ouvrant la bouche d’une façon singulière, chantait: «Je ramène la fi-i-i-i-ancée!» Il chantait, et agitait ses bras, qui naturellement étaient nus. Puis la procession commençait; mais voici que le cornet à piston, dans l’orchestre, manquait une note: sur quoi le chef d’orchestre, frémissant comme s’il eût assisté à une catastrophe, tapait sur son pupitre avec son bâton. Tout s’arrêtait de nouveau; et le chef, se tournant vers ses musiciens, prenait à partie le cornet à piston, lui reprochant sa fausse note, dans des termes que des cochers de fiacre ne voudraient pas employer pour se disputer entre eux. Et de nouveau tout recommençait: les Indiens avec leurs hallebardes se remettaient en mouvement, le chanteur ouvrait la bouche pour chanter: «Je ramène la fi-i-ancée!» Mais cette fois les couples marchaient trop près l’un de l’autre. Nouveaux coups de bâton sur le pupitre, nouvelle reprise de la scène. Les hommes marchaient avec leurs hallebardes, quelques-uns avaient des visages sérieux et tristes, d’autres souriaient et causaient entre eux. Puis les voici qui s’arrêtent en cercle, et se mettent à chanter. Mais voici que de nouveau le bâton frappe le pupitre; et voici que le régisseur, d’une voix désolée et furieuse, accable d’injures les malheureux Indiens. Les pauvres diables avaient, paraît-il, oublié qu’ils devaient de temps à autre lever les bras en signe d’animation. «Est-ce que vous êtes malades, tas d’animaux, est-ce que vous êtes en bois, pour rester ainsi immobiles?» Et maintes fois encore je vis recommencer la procession, j’entendis des coups de bâton, et le flot d’injures qui invariablement les suivait: «ânes, crétins, idiots, porcs,» plus de quarante fois j’entendis répéter ces mots à l’adresse des chanteurs et des musiciens. Ceux-ci, physiquement et moralement déprimés, acceptaient l’outrage sans jamais protester. Et le chef d’orchestre et le régisseur le savaient bien, que ces malheureux étaient désormais trop abrutis pour pouvoir faire autre chose que de souffler dans une trompette, ou de marcher en souliers jaunes avec des hallebardes d’étain; ils les savaient habitués à une vie commode et large, prêts à tout subir plutôt que de renoncer à leur luxe; de telle sorte qu’ils ne se gênaient point pour donner cours à leur grossièreté native, sans compter qu’ils avaient vu faire la même chose à Paris ou à Vienne, et avaient ainsi la conscience de suivre la tradition des plus grands théâtres.
Je ne crois pas, en vérité, qu’on puisse trouver au monde un spectacle plus répugnant. J’ai vu un ouvrier en injurier un autre parce qu’il pliait sous le poids d’un fardeau, ou, à la rentrée des foins, le chef du village gronder un paysan pour une maladresse; et j’ai vu les hommes ainsi injuriés se soumettre en silence; mais quelque répugnance que j’aie eue à assister à ces scènes, ma répugnance était atténuée par le sentiment qu’il s’agissait là de travaux importants et nécessaires, où le moindre manquement pouvait amener des suites fâcheuses.
Mais ici, dans ce théâtre, que faisait-on? Pourquoi travaillait-on, et pour qui? Je voyais bien que le chef d’orchestre était à bout de ses nerfs, comme l’ouvrier que j’avais rencontré derrière la scène: mais au profit de qui s’était-il énervé? L’opéra qu’il faisait répéter était, comme je l’ai dit, des plus ordinaires; j’ajouterai cependant qu’il était plus profondément absurde que tout ce qu’on peut rêver. Un roi indien désirait se marier; on lui amenait une fiancée; il se déguisait en ménestrel; la fiancée s’éprenait du ménestrel, en était désespérée, mais finissait par découvrir que le ménestrel était le roi son fiancé; et chacun manifestait une joie délirante. Jamais il n’y a eu, jamais il n’y aura des Indiens de cette espèce. Mais il était trop certain aussi que ce qu’ils faisaient et disaient non seulement n’avait rien à voir avec les mœurs indiennes, mais n’avait rien à voir avec aucunes mœurs humaines, sauf celles des opéras. Car enfin jamais, dans la vie, les hommes ne parlent en récitatifs, jamais ils ne se placent à des distances régulières et n’agitent leurs bras en cadence pour exprimer leurs émotions; jamais ils ne marchent par couples, en chaussons, avec des hallebardes d’étain; jamais personne, dans la vie, ne se fâche, ne se désole, ne rit ni ne pleure comme on faisait dans cette pièce. Et que personne au monde n’a jamais pu être ému par une pièce comme celle-là, cela encore était hors de doute.
Aussi la question se posait-elle naturellement: au profit de qui tout cela était-il fait? À qui cela pouvait-il plaire? S’il y avait eu, par miracle, de jolie musique dans cet opéra, n’aurait-on pas pu se borner à la faire entendre, sans tous ces costumes grotesques, ces processions, et ces mouvements de bras? Pour qui tout cela se fait-il tous les jours, dans toutes les villes, d’un bout à l’autre du monde civilisé? L’homme de goût ne peut manquer d’en être écœuré; l’ouvrier ne peut manquer de n’y rien comprendre. Si quelqu’un peut y prendre quelque plaisir, ce ne peut être qu’un jeune valet de pied, ou un ouvrier perverti qui a contracté les besoins des classes supérieures sans pouvoir s’élever jusqu’à leur goût naturel.
On nous dit, cependant, que tout cela est fait au profit de l’art, et que l’art est une chose d’une extrême importance. Mais est-il vrai que l’art soit assez important pour valoir qu’on lui fasse de tels sacrifices? Question d’autant plus urgente que cet art, au profit duquel on sacrifie le travail de millions d’hommes, des milliers de vies, et, surtout, l’amour des hommes entre eux, ce même art devient sans cesse, pour l’esprit, une idée plus vague et plus incertaine. Il se trouve en effet que les critiques, chez qui les amateurs d’art s’étaient accoutumés à avoir un soutien pour leurs opinions, se sont mis dans ces derniers temps à se contredire si fort les uns les autres, que, si l’on exclut du domaine de l’art tout ce qu’en ont exclu les critiques des diverses écoles, rien ne reste plus, ou à peu près, pour constituer ce fameux domaine. Les diverses sectes d’artistes, comme les diverses sectes de théologiens, s’excluent et se nient l’une l’autre. Étudiez-les, vous les verrez constamment occupées à désavouer les sectes rivales. En poésie, par exemple, les vieux romantiques désavouent les parnassiens et les décadents; les parnassiens désavouent les romantiques et les décadents; les décadents désavouent tous leurs prédécesseurs, et en outre les symbolistes; les symbolistes désavouent tous leurs prédécesseurs, et en outre les mages; et les mages désavouent tous leurs prédécesseurs. Parmi les romanciers, il y a les naturalistes, les psychologues, et les naturistes, tous prétendant être les seuls artistes qui méritent ce nom. Et il en est de même dans l’art dramatique, dans la peinture, dans la musique. Et ainsi cet art, qui exige des hommes de si terribles fatigues, qui dégrade des vies humaines, et qui force les hommes à pécher contre la charité, non seulement cet art n’est pas une chose clairement et nettement définie, mais ses fidèles, ses initiés eux-mêmes l’entendent de diverses façons si contradictoires, qu’on a peine désormais à dire ce que l’on entend parle mot d’art, et en particulier quel est l’art utile, bon, précieux, l’art qui mérite que de tels sacrifices lui soient offerts en hommage.