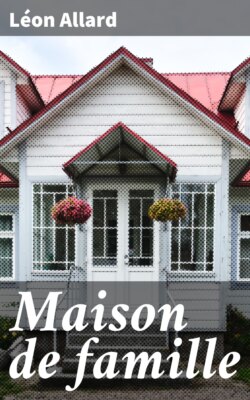Читать книгу Maison de famille - Léon Allard - Страница 4
II
POURQUOI SOPHIE A DIT «NON »
ОглавлениеAvant que l’idée lui fût venue de fonder une maison de famille dans la tranquille rue Buffon, madame Lescande avait d’abord tenu un misérable hôtel garni dont l’enseigne, peinte en grandes lettres bleues: «Hôtel du Nord», s’étalait, aux environs du Val-de-Grâce, tout en haut du faubourg Saint-Jacques. Dans cet hôtel, son premier établissement après son veuvage, elle hébergeait à la nuit des ouvriers maçons, des bonnes sans place, des gens de métiers douteux, musiciens ambulants, camelots, modèles d’atelier, toute une bohème de basse classe qu’il était prudent de toujours faire payer d’avance. La maison, très étroite de façade, tout en hauteur, comptait, à chaque étage d’un raide escalier, trois chambres grandes à peine comme des cabines de bains. A travers leurs papiers déchirés et leurs fissures de planches disjointes, les minces cloisons laissaient filtrer le soir des rayons de lumière d’un voisin chez l’autre, livrant à la merci des oreilles écouteuses et des yeux indiscrets les moindres paroles et les moindres actions. Fille ou femme que le chômage et la misère conduisaient dans cette louche hôtellerie, presque semblable à un mauvais lieu, ne pouvait, si elle avait conservé quelque instinct de pudeur féminine, se soustraire à cette promiscuité gênante des voisinages qu’en se faisant un rideau de ses nippes pendues devant les lézardes des murs.
Une vieille, une horrible vieille, rebut de tous les bureaux de placement, sans dents, sans âge et sans sexe, à barbe d’homme, à mèches grises de sorcière, au regard vicieux et méchant, mégère usée et avilie par une trop longue existence d’abjecte servitude, recevait de madame Lescande vingt francs par mois pour faire chaque matin un semblant de ménage dans les chambres des locataires. On ne lui connaissait d’autre nom qu’une abréviation de prénom: «Mélie». Cette appellation, qui pour être commune ne manque pas d’euphonique douceur, était tout ce qui restait à cette sordide et noire vieillesse d’une lointaine jeunesse qui peut-être, un demi-siècle auparavant, avait été toute blanche et rose. Cette unique servante était bien en rapport avec la maison délabrée et poussiéreuse, mal tenue, aux murs lépreux, aux plafonds écaillés, aux escaliers salis par les continuelles montées et descentes de grosses chaussures boueuses. Dès le matin, la vieille faisait entendre d’étage en étage sa voix de crécelle cassée, cherchant dispute à l’un ou à l’autre pour une cuvette en morceaux, pour une cruche d’eau répandue sur les paliers, ou des épluchures jetées sur les marches. Des voix d’hommes répondaient, grossières et blagueuses, ou des voix de femmes, glapissantes et suraiguës, qui de suite transformaient la querelle en bataille acharnée d’injures. La femme de ménage n’avait jamais le dessus, tous s’alliant contre elle, mais sous l’averse de rires et de gros mots qui tombait sur elle du haut de l’escalier, elle relevait encore la tête vers ses insulteuses; écumante de fureur, vaincue, mais non réduite, crachant lorsqu’elle ne pouvait plus parler, elle leur montrait le poing ou brandissait contre elles son balai avec des gestes d’impuissante menace.
Les antres les plus sombres ont parfois leur rayon de lumière, sur la plus laide masure fleurit souvent la plus belle giroflée. «L’Hôtel du Nord» avait sa fleur éclose et son rayon de soleil. Sophie, dans ce temps-là, était âgée tout au plus de quinze ans; mais grande, élancée, svelte et blonde, elle avait déjà toutes les grâces de la jeune fille; déjà la délicatesse de sa main, la petitesse de son pied, la distinction de ses traits, indiquaient en elle une finesse de race étrange chez la fille de madame Lescande, mais expliquée par la paternité de rencontre de ce jeune officier qui, dans un jour d’ennui de caserne, s’était oublié, malgré son grade, jusqu’à des amours de cantine. Cette supériorité native, l’insouciance de son très jeune âge, son innocence incurieuse, la gardaient isolée du milieu dans lequel elle vivait. Elle ne ressentait pas encore l’écœurement des vilenies étalées sous ses yeux et restait, immaculée de corps et d’esprit, au bord du cloaque, sans être atteinte par les éclaboussures.
Mélie était chargée de tous les soins de ménage à l’hôtel; Sophie n’avait donc nullement à s’en occuper. Sa mère lui avait fait apprendre l’état de modiste-fleuriste. Avec son goût inné d’élégance, il ne lui avait fallu qu’un court apprentissage pour être bien vite une des plus adroites dans ce difficile métier féminin. Elle possédait cette habileté des doigts, cette légèreté de chiffonnage qui est le grand secret de l’ouvrière en modes de Paris pour créer, sur une forme raide de chapeau, de si gracieuses choses avec des riens, avec des flous de dentelle, des bouts de rubans épinglés, à peine cousus, et faire paraître frais cueillis dans les champs leurs bouquets de fleurettes découpées en batiste. Sans aller à aucun atelier, Sophie travaillait chez elle pour un petit magasin de la rue Soufflot. Toutes les fois qu’elle y rapportait son ouvrage, les passantes s’arrêtaient, étonnées de voir, dans une vitrine du quartier Latin, un chef-d’œuvre de coquetterie parisienne exposé parmi toutes sortes d’excentricités de mauvais goût.
Fleuriste en même temps que modiste, elle préparait elle-même ses fleurs et se faisait dans sa chambre, au premier étage de l’hôtel, un printemps factice et de toute saison, printemps de fleurs artificielles, fraîches de couleurs, mais sans parfums, écloses à la douzaine, sous ses doigts actifs, au bout de tiges en fil de fer. Elle était gaie alors, et presque heureuse, aucun chagrin sérieux n’ayant encore troublé sa vie. Souvent elle chantait en travaillant devant sa fenêtre ouverte, et sa jolie voix, son fin profil de jeune fille, attiraient l’attention de toute une jeunesse d’école, élèves du Val-de-Grâce en uniforme militaire, étudiants se rendant aux hôpitaux, dont le passage, à de certaines heures, remplit de mouvement le faubourg Saint-Jacques; mais Sophie restait indifférente aux œillades amoureuses qui lui étaient lancées de la rue; elle ne les remarquait même pas.
Au rez-de-chaussée était le bureau, semblable à tous les bureaux d’hôtels garnis, avec ses clefs numérotées supendues au mur et les bougeoirs alignés sur une planche. Là trônait madame Lescande, sur un vieux fauteuil de cuir tellement usé et délabré, que le marchand de bric-à-brac, dont la boutique était voisine, n’en aurait pas donné vingt sous. La maîtresse de l’hôtel passait toutes ses journées dans une fainéante inaction, un laisser-aller avachi de grosse femme sans corset, boutonnée de travers et pour jusqu’au soir dans une robe élimée, blanchie aux plis par un trop long usage. Elle ne s’animait un peu que lorsqu’elle avait occasion de crier après la vieille Mélie, ce qui arrivait toutes les fois que la femme de ménage entrait dans le bureau, ou de gronder son fils Charles, cas plus rare, car ce mauvais garnement, chez qui germaient déjà tous les mauvais instincts, était continuellement échappé de la maison pour aller vagabonder, dans le quartier Mouffetard, avec des bandes de vauriens de son âge et de son espèce.
Madame Lescande avait deux défauts dominants, deux véritables passions: les cartes et le bavardage. Bésigue, piquet, chemin de fer, écarté, mort, vingt et un, elle pratiquait et connaissait tous les jeux. Quant à son bavardage, il s’exerçait à tort et à travers sur tout et sur rien, prenait texte d’une mouche, du temps, d’un «à-propos» quelconque pour se donner carrière en d’interminables histoires. Elle fût morte d’ennui dans le bureau de son hôtel, sans personne avec qui jouer ou bavarder. Cette société indispensable au bonheur de son existence de mollusque gras, elle l’avait trouvée dans un de ses locataires, non pas un locataire de passage, comme étaient la plupart, mais habitant à demeure l’Hôtel du Nord. Il s’appelait Castan. C’était lui que Charles devait retrouver un jour sur la place de l’Observatoire, vendant aux badauds une pâte non brevetée pour rendre le fil aux lames ébréchées des faux et des rasoirs. Au temps où il habitait l’hôtel de madame Lescande, il exerçait un autre métier, sinon plus lucratif, au moins plus sédentaire. Son établissement de photographie, situé juste en face de l’hôtel où il logeait, ne se composait que d’une cage vitrée, établie après coup, au septième ou huitième étage, au-dessus des toits, entre deux souches de cheminées, plus haut que les plus hautes mansardes. Cette cage, il la nommait pompeusement «ses ateliers».
Les échantillons de son art, exposés dans un cadre, devant la porte de la sombre et gluante allée qui servait d’entrée à la maison, n’attiraient chez ce photographe de faubourg qu’une rare clientèle: Parfois, quelque maçon limousin ou quelque pioupiou sortant de l’hôpital militaire, pâle encore d’une longue convalescence. Castan avait donc des loisirs. Presque chaque après-midi, il traversait la rue en voisin, la pipe à la bouche, vêtu de son costume d’atelier, pantoufles rouges, vareuse de laine bleue, béret fantastique sous lequel il relevait fièrement la tête toutes les fois qu’un gamin, en passant, l’apostrophait du nom «d’artiste». Il s’en allait ainsi tenir compagnie à son hôtesse, madame Lescande. Il supportait son bavardage oiseux et lui proposait quelque partie en cent liés, ayant trouvé le moyen de s’assurer, par cette habile complaisance, de nombreux grogs gratis, l’absinthe ou le bitter avant dîner et bien souvent le dîner même.
Madame Lescande en était arrivée, peu à peu, à ne plus pouvoir se passer de lui. Ne tenait-il pas ses registres d’hôtel de sa plus belle main d’écrivain public? Car avant d’être photographe, il avait exercé cet autre métier. Quels métiers d’ailleurs n’avait-il pas connus, ce Castan? Il ne les avouait certes pas tous, et, dans l’histoire bariolée de sa vie telle qu’il la racontait, on devinait des phases mystérieuses passées sous silence entre ses divers avatars. Tour à tour commis voyageur, partisan dans les guerres d’Amérique, surveillant dans une usine, écrivain public, acteur dans une troupe ambulante et enfin photographe, il n’avait gardé que le mauvais côté de ces divers états, le bagou menteur du placier de commerce, les jurons et l’ivrognerie du soldat de fortune, l’emphase commune de paroles et de geste de l’acteur de tréteaux, se constituant ainsi une personnalité caméléonne sous les aspects changeants de défauts et de vices variés. Le mystère dont il entourait certaine partie de son existence provenait peut-être de l’ombre restée sur lui de quelque maison centrale, car il lui échappait parfois, en parlant, de basses expressions de l’argot des bagnes. Les oreilles de madame Lescande, blasées qu’elles étaient par l’argot de caserne, ne s’en montraient pas choquées.
Elle tenait Castan pour le plus honnête homme du monde, un peu braque, disait-elle, mais si bon garçon, si complaisant! Il était presque de la famille. Il tirait les oreilles de Charles lorsque le galopin rentrait de quelqu’une de ses escapades. L’assiduité du photographe, le pied qu’il avait su prendre dans la maison, son intimité avec la veuve que ses quarante-cinq ans ne mettaient pas alors à l’abri de suppositions malveillantes, pouvaient faire soupçonner entre eux d’autres liens que ceux d’une amitié de voisinage, d’autres rapports que ceux d’hôtesse à locataire. La chose était possible, mais non prouvée. En tout cas, les apparences eussent été mieux gardées que l’on n’aurait pu s’y attendre de la part de deux êtres chez qui le sens moral n’était certes pas la qualité dominante et qui, tant l’un que l’autre, étaient gens à se moquer du qu’en dira-t-on de leur entourage.
Il était plus probable que Castan visait tout simplement au mariage, ainsi que le prétendaient quelques commères du quartier, amies de madame Lescande et la défendant contre les imputations contraires. Le photographe voyait d’assez près les affaires de l’hôtel pour avoir calculé les économies que la veuve, qu’il savait avare, avait dû faire depuis la mort de son mari. Le petit magot qu’il soupçonnait exister quelque part, serré dans un fond de commode ou placé chez un notaire, pouvait fort bien tenter sa convoitise peu scrupuleuse. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il faisait une sorte de cour, et cette cour n’était ni repoussée ni découragée, mais au contraire fort bien accueillie. Il plaisait visiblement, par ses défauts mêmes, par sa hâblerie, par ses manières de bel homme, sa pose à l’artiste, et peut-être madame Lescande désirait-elle, espérait elle se rajeunir en secondes noces avec ce grand brun à cheveux bouclés, à large carrure d’épaules, à moustaches en crocs et qui, reluqué par les filles, fier comme un coq de nombreux triomphes faciles, fort aux escrimes populacières, la boxe, la canne et la savate, prenait des airs vainqueurs avec les femmes, avec les hommes des airs de pourfendeur.
Quels que pussent être les illusions et les secrets espoirs de madame Lescande, il y avait des jours où elle ne savait trop si les attentions du beau Castan s’adressaient bien à elle et non à sa fille Sophie, toute jeune qu’elle fût. Lorsqu’il regardait la petite d’une certaine façon, lorsque, par manière de plaisanterie, il l’embrassait à moitié de force, car elle se défendait avec humeur de ces familiarités, la mère ressentait une sorte d’inquiétude jalouse, et la colère qu’elle n’osait laisser voir, qu’elle cachait sous un sourire contraint, lui faisait inventer aussitôt un prétexte, saisir la première raison venue, bonne ou mauvaise, pour gronder aigrement Sophie, la traiter de morveuse et de pimbêche, la claquer même en gamine et se débarrasser d’elle, se venger en même temps d’une inconsciente rivalité, en renvoyant à sa chambre la pauvre fille humiliée, indignée et pleurante de ces accès de sévérité dont elle ne pouvait soupçonner la véritable cause. Puis la réflexion venait à madame Lescande. Quelle idée avait-elle donc? Elle en haussait les épaules. Castan penser à Sophie? Quelle folie! Ne l’avait-il pas connue tout enfant? Il continuait à la traiter en petite fille, voilà tout, gardant avec elle des habitudes de jeux sans conséquence. Elle reprenait alors sa placidité de grosse femme inactive, et pour qu’elle oubliât ses craintes et ses soupçons, il suffisait que, pendant leur partie de cartes, le genou de Castan cherchât le sien sous la table.
Il avait souvent parlé de faire le portrait de Sophie. Il voulait, disait-il, avoir une nouvelle série de photographies pour l’exposition de sa vitrine. C’était chose convenue depuis longtemps, et si ce projet avait tardé à recevoir son exécution, le retard était toujours venu du photographe, qui semblait s’ingénier à trouver quelque empêchement chaque fois que madame Lescande annonçait l’intention de conduire sa fille à l’atelier: le temps était couvert, les appareils n’étaient pas en état, ou bien c’était Sophie qu’il trouvait trop pâle et le portrait ne serait pas réussi.
Quelle raison, après maintes remises du même genre sous différents prétextes, eut-il un jour d’insister pour faire immédiatement le portrait? Était-ce doncparce que madame Lescande, accablée par la chaleur d’une lourde après-midi de juin, se montrait peu disposée à quitter son fauteuil où, à demi débraillée, elle se laissait aller à un commencement de sieste? Il avait déjeuné chez elle. Pendant le repas, son regard s’était souvent arrêté sur Sophie, charmante dans une légère robe claire, le cou et les bras nus, le feu de l’été amenant à fleur de sa peau fine, comme une sève colorante, la rose et vivante carnation d’un sang jeune. Madame Lescande se sentait si lasse, qu’elle avait même refusé de faire une partie d’écarté. Elle n’aurait certes pas le courage de monter les six étages de l’atelier. Non, il n’y fallait pas songer. Elle était incapable d’un pareil effort. De toute l’après-midi, elle ne se bougerait pas. Castan semblait très mécontent de cette mauvaise volonté et il proposa d’emmener Sophie toute seule.
Mais alors, ce fut la jeune fille qui trouva des objections. On eût dit qu’un instinct l’avertissait d’un danger caché; qu’elle appréhendait de se trouver seule à la merci des galanteries de cet homme qui, depuis quelque temps, elle l’avait remarqué, guettait toutes les occasions de la surprendre dans les coins, derrière les portes, dans l’ombre de l’escalier, pour oser des libertés de langage, des familiarités caressantes de plus en plus accentuées et gênantes, mais dont la jeune fille, retenue par une honte, n’osait pas encore se plaindre à sa mère.
Le moindre empressement de sa part à accepter l’offre de Gastan n’eût pas manqué de mettre en éveil la jalousie de madame Lescande. Mais elle montrait de l’hésitation, il lui déplaisait visiblement d’aller seule à l’atelier; il n’en fallait pas davantage pour que, par méchant esprit de contradiction, sa mère la forçât à céder contre son gré.
Castan, lui, feignait d’y renoncer, à ce portrait.
–Si elle n’y tient pas, c’est bon, n’en parlons plus...
Mais madame Lescande imposa sa volonté.
–Que ça lui plaise ou non, elle ira; c’est moi qui le veux.
Sophie baissa la tête. Il lui fallait se résigner, obéir. Pouvait-elle dire ses craintes? Elles étaient tout instinctives, elle n’aurait su les formuler. Et puis de se voir dans cet abandon de toute protection maternelle, il lui venait à la fin comme un découragement navré, une lassitude de se défendre elle-même contre d’inconnues fatalités qu’elle sentait menaçantes.
La voilà donc qui monte les six étages du photographe. Devant elle, Castan se hâte, enjambant deux à deux les marches avec une féline agilité d’ancien clown. Plus lentement elle le suit, et, à mesure qu’elle monte, son cœur se serre: elle éprouve l’angoisse du malheureux las de vivre qui, dans une longue ascension tournante, gagne le faite d’un monument pour d’en haut se jeter au pavé.
A peine furent-ils entrés dans l’atelier, Castan mit le verrou à la porte.
Ce réduit vitré, isolé, comme une aire, à la cime des toits, semblait inaccessible à tout secours. Des rideaux de calicot bleu, tendus sur des. tringles, y faisaient un demi-jour mystérieux d’alcôve, mais n’empêchaient pas le soleil ardent, réverbéré par les tuiles et les ardoises, de changer en atmosphère d’étuve l’air lourd et surchauffé, rendu presque asphyxiant par des odeurs de collodion, par le parfum, concentré depuis la veille, d’un gros bouquet de fleurs fanées qui traînait sur un meuble. Oh! cet atelier, cet antre, cet enfer, quel souvenir elle devait toute sa vie en garder! Que de fois, des années après, rien qu’à respirer une fleur mourante, elle se sentit près de défaillir!
Pendant que, là-haut, sa fille, dans un moment de terreur, de trouble, d’ignorance surprise, de résistance violentée, d’anéantissement de tout son être, tombait, victime innocente, sous le coup d’un malheur contre lequel ne lui venaient que trop tard, dans une souffrance physique, la force et la volonté de se débattre; pendant cette heure de crime, d’irréparable chute, de tragique aventure, dont nul instinct de mère ne l’avait avertie, que faisait donc madame Lescande? Dans son bureau d’hôtel, à l’ombre des persiennes closes, accablée de chaleur et de son habituelle fatigue de ne rien faire, le visage luisant de sueur perlée, les cheveux collés au front, le corps à l’abandon entre les bras de son vaste fauteuil, béatement elle jouissait de la douceur d’une sieste ronflante, demi-sommes intermittents coupés de demi-réveils par les taquineries des mouches, un tic-tac d’horloge, un jappement de chien dans la rue.
–Madame!... madame!...
C’est Mélie qui ose troubler ainsi le repos de sa maîtresse. La vieille bonne est entrée brusquement, effarée, criante, les bras en l’air, plus dépeignée, plus sorcière que jamais.
–Madame, madame... Mamzelle Sophie!
Et elle raconte qu’elle vient de trouver la jeune fille dans sa chambre, se roulant par terre, s’arrachant les cheveux, se meurtrissant de coups la figure dans un accès d’inexplicable folie. Elle raconte encore qu’elle a voulu la calmer, la relever en la prenant dans ses bras, mais que Sophie lui a échappé pour se jeter de toute sa force contre les murs, en criant qu’elle veut mourir, qu’elle est perdue, perdue, perdue!
–Montez vite, sans ça, pour sûr, elle fera comme elle dit, elle se tuera.
Quand madame Lescande fut montée, effrayée par le récit de Mélie, quand elle vit sa fille les vêtements en désordre, échevelée, sanglotante, secouée de spasmes nerveux, toutes les idées de catastrophes possibles lui vinrent d’un coup, empoisonnement, fièvre chaude, épilepsie. Elle était loin de penser à l’affreuse vérité; l’enfant dans sa honte et son désespoir, ne trouvait pas de mots pour la lui dire.
Il fallut bien deviner, pourtant, il fallut bien comprendre.
L’indignation de la mère fut sincère, mais si compliqués sont les dessous égoïstes de la nature humaine qu’à cette indignation dut certainement se joindre un sentiment de colère tout personnel, une rage secrète ayant pour cause des espérances inavouées et déçues. Ah! le bandit! Il le payerait cher, son crime! Le tribunaux ne plaisantent pas, avec ces sortes d’affaires. Elle parlait d’aller chez le commissaire de police, elle voulait déposer une plainte, crier partout l’attentat commis, ameuter le quartier, soulever contre Castan un mouvement de réprobatien publique; elle était prête, pour sa vengeance, à tambouriner l’honneur perdu de sa fille, ainsi qu’on fait d’un coffre-fort enlevé par des voleurs.
Malgré l’affaissement désespéré de tout son être, Sophie sut comprendre qu’un aussi stupide éclat ne servirait qu’à l’étalement de sa honte. Livrer à la curiosité, à la pitié de tous son irrémédiable malheur? Subir l’humiliation d’interrogatoires, où il lui faudrait raconter à des juges, à des hommes! l’odieuse scène dont le souvenir seul la rendait folle? Était-ce donc possible? Non, elle ne voulait pas cela! Et dans l’épouvante qu’une telle pensée lui causait, elle trouva assez de protestations indignées et d’éloquentes supplications pour vaincre sur ce point l’entêtement de sa mère. Madame Lescande céda. Les choses ne pouvaient pourtant pas, trouvait-elle, se passer ainsi. Elle lui dirait au moins son fait, à ce Castan! Mais Castan était devenu invisible. Prudemment il s’était éclipsé. Sans doute qu’afin de dépister les recherches et de se soustraire aux conséquences possibles de sa criminelle action, il avait pris le parti de s’affubler une fois de plus d’un nom et d’un métier de rechange, de faire complètement peau neuve, car il abandonnait, en disparaissant, sa dépouille de photographe aux griffes d’un huissier qui depuis longtemps le harcelait de poursuites pour des termes en retard.
Peu de temps après cette navrante aventure, madame Lescande vendait son «Hôtel du Nord» et mettait toutes ses économies dans l’installation de la «Maison de famille» de la rue Buffon.
L’idée de cette transformation ne lui avait été inspirée que par des raisons d’intérêt, par l’ambition de diriger un établissement plus lucratif et plus relevé que son misérable garni de faubourg. Elle n’aurait pu trouver de meilleure combinaison si, en bonne mère, elle n’avait eu en vue que le bien de sa fille, le soulagement qu’un dépaysement de quartier, un changement de milieu et d’habitudes devaient apporter à ses remords et à son chagrin. Ce ne fut pas, pour Sophie la guérison complète de l’anémie morale, du mal incurable de tristesse dont elle était restée atteinte, qui la pâlissait et la maigrissait de jour en jour. Pas plus rue Buffon qu’au faubourg Saint-Jacques, le souvenir terrible ne pouvait complètement s’effacer; mais il eut moins d’acuité il fut moins le souvenir d’hier, et sa lente atténuation permit à la jeune fille de trouver, dans son découragement même, une plus tranquille résignation à son malheur.
Puis arrivèrent coup sur coup la guerre, la révolution, le siège de Paris, la Commune.
La durée du temps fut comme doublée pendant cette longue période de troubles, et, quand elle prit fin, l’inoubliable passé semblait moins proche qu’il n’était réellement, se trouvait reculé bien au delà d’une année dans un éloignement factice, une illusion de distance qui en rendait moins cruelle l’obsédante évocation. De Castan, on n’entendait plus parler. On le croyait disparu pour toujours, mort peut-être. D’après un bruit vague, rapporté par Charles de ses vagabondages au quartier Mouffetard, l’ancien photographe, devenu chef de bataillon de fédérés pendant la Commune, avait été fusillé lors de l’entrée des troupes dans Paris. Sophie avait cru ardemment à ce racontar d’échappés de barricades. Bien que cette mort fût loin d’être prouvée, malgré elle, par le désir de sa haine, elle avait été portée à s’en faire une certitude, et cette certitude irraisonnée fut pour elle apaisante, presque consolante; en même temps qu’une satisfaction de vengeance, elle y trouvait une sécurité d’avenir, la délivrance de l’anxieuse crainte, jusque-là gardée, de voir un jour Castan réapparaître dans sa vie.
Paris se relevant au milieu de ses décombres noirs encore de la fumée des batailles et des incendies, se hâtait de reprendre sa vie active de commerce et d’affaires. Ce fut à cette époque que les frères Herbelin vinrent habiter la maison de famille de madame Lescande. Ils louèrent un petit appartement meublé composé de trois pièces au deuxième étage. Employés dans la même maison, chez madame Fizanne, rue des Lions-Saint-Paul, ils demeuraient ensemble, ils ne se quittaient jamais. Bien qu’une différence d’âge de presque dix ans les séparât, depuis longtemps ils avaient ainsi réuni leurs deux existences dans une association fraternelle. Sans famille, sans parents proches, ils s’étaient habitués à être tout l’un pour l’autre. A la mort de leur père, un modeste fonctionnaire qui, après sa retraite et son veuvage, s’était retiré dans une ville du Centre, l’aîné des deux frères, Louis, n’avait pas vingt ans, Paul, le plus jeune, en avait dix à peine. Louis était venu à Paris gagner la vie pour deux et, dès ce moment, il était entré dans la fabrique de meubles de madame Fizanne que depuis il n’avait plus quittée. Quant à Paul, en souvenir des services administratifs de-son père, il avait obtenu une bourse dans un collège de province.
De ce temps d’enfance et de collège, Paul Herbelin avait toujours gardé le souvenir des vacances qu’il venait passer, chaque année, auprès de son grand frère. Lorsque après les dix mois de séparation, pendant lesquels ils ne s’étaient écrit que de rares et courtes lettres, le petit collégien, tout fier de voyager seul, débarquait à la gare d’Orléans, chargé de son bagage d’écolier, paquets d’effets et liasses de livres, il était sûr d’apercevoir, à travers les grillages de la salle d’attente, les larges épaules et la bonne figure souriante de son Louis. Au milieu du flot bousculant des voyageurs qui, par les portes trop étroites, se précipitaient aux voitures, ils s’enlaçaient dans une embrassade émue. Et l’aîné, regardant l’enfant qui, chaque fois, lui revenait plus grand et plus robuste, ne pouvait s’empêcher de rire de sa tunique étriquée et de ses manches trop courtes. Il le débarrassait d’une partie de ses multiples paquets et tous deux s’en allaient à pied. La joie de se revoir mettait dans leur premier bavardage une presse de questions et de réponses croisées; le bonheur d’aller côte à côte donnait à leurs pas une alacrité de marche légère.
Ils suivaient le trottoir du quai, le long des grilles du Jardin des Plantes. L’éparpillement de l’arrivage du train se faisait sur la chaussée, dans un défilé de fiacres chargés et d’omnibus du chemin de fer lancés au grand trot. Le bruit des roues, ce mouvement de fourmilière, l’horizon de la Seine fermé devant eux, dans un fond de décor, par la grandiose silhouette de Notre-Dame, rendaient au jeune Paul l’impression de ce Paris où tout son désir était de venir un jour vivre avec son frère.
Ces sensations de l’arrivée, à chaque voyage il les retrouvait, toujours les mêmes; il les reconnaissait, par elles commençait véritablement son bonheur des vacances; et pour cela il les aimait, il aimait jusqu’aux effluves de fauves qui lui venaient, à travers les grilles du jardin, des logettes où sont encagés, près de la bordure, les loups, les renards, les chacals et les sangliers. Puis c’étaient les grilles de la Halle aux vins continuant les grilles du Jardin des Plantes, des odeurs de fûts succédant aux fortes senteurs des bêtes sauvages, de longs haquets chargés de tonneaux se mêlant à la débandade plus clairsemée dés dernières voitures venant de la gare. Ils arrivaient, un peu plus loin, au restaurant de «La Tour d’Argent», où Louis payait à son frère un fin dîner de bienvenue dans un cabinet du premier étage. Accoudés à la balustrade de la fenêtre ouverte, pendant que le garçon, derrière eux, préparait la table, Paul cherchait à reconnaître, de l’autre côté de l’eau, parmi tous les toits de l’île Saint-Louis, celui de la maison où son frère habitait alors; et lorsqu’il croyait avoirtrouvé, dans le jour déclinant, le pan de briques rouges de cette toiture connue, il éprouvait une véritable émotion.
Pendant le dîner, ils se traitaient en vieux camarades, malgré leur grande disproportion d’âge, et, comme pour se mettre mieux à la portée l’un de l’autre, pour se rapprocher le plus possible, il semblait que l’aîné eût gardé, dans sa nature, quelque chose de l’insouciance de l’enfance, tandis que le cadet, au contraire, déjà sérieux, réfléchi, donnait des preuves d’une maturité de caractère bien souvent au-dessus de son âge. «Monsieur le philosophe» l’appelait son frère, en le plaisantant amicalement.
Louis Herbelin, habitant seul Paris à cette époque, n’avait pour logement qu’une grande chambre perchée tout en haut d’une vieille maison de la Cité. Pour héberger son Paul, pendant les deux mois de vacances, il lui fallait de son propre lit en faire deux, le dédoubler d’un matelas et improviser pour l’enfant une couchette à terre. Cela donnait à l’installation de la chambrette un petit air de campement. Le matelas de Paul tenait, au beau milieu, une place énorme. La table était reculée dans un coin. Pour laisser le passage libre, les chaises, les unes sur les autres, s’entassaient dans un autre coin. Le soir, lorsqu’ils étaient couchés, ils s’oubliaient, accoudés sur leurs traversins, en d’interminables causeries pendant lesquelles l’aîné, grand fumeur, bourrait pipe sur pipe. Paul parlait du collège, de ses éludes, de ses prix et montrait une ardeur empressée à vouloir terminer ses classes le plus vite possible pour venir vivre à Paris avec son frère, se faisant un rêve de vie à deux, que l’aîné d’ailleurs partageait et encourageait. Dans ces conversations, dans ces projets d’avenir, revenait souvent le nom de madame Fizanne. Louis ne le prononçait qu’avec le plus grand respect, une sorte de vénération, et en même temps avec la réserve hésitante d’un sentiment inavoué dont la nuance était trop délicate, trop discrète pour que l’intelligence de l’enfant pût en saisir la véritable signification.
De bonne heure Louis partait à son bureau, laissant le collégien livré à lui-même pour toute la matinée. Le studieux garçon tirait la table au jour de la fenêtre, étalait dessus ses cahiers et ses livres. Son frère voyait, avant de partir, ces préparatifs de travail et souvent il s’en fâchait.
–Laisse un peu ton latin, disait-il, et va te promener sur les quais. Ou bien prends mes haltères et fais une heure de gymnastique.
Et il ajoutait, en repliant le bras pour montrer son biceps:
–Vois-tu, petit, faut se faire du muscle.
Il était très amateur de tous les exercices de corps. Taillé en hercule, fier de sa force, de son agilité, il éprouvait un enfantin plaisir à en faire montre en toute occasion. Paul, plus apathique, plus tranquille, presque fille de nature, ne partageait pas cet engouement de gymnastique. Il ne regardait même pas les haltères déposés auprès de lui. Au lieu de s’essayer à soulever les lourdes boules à bras tendu, il préférait rester assis à sa table en face de la version ou du thème commencé, avec autant d’application que s’il eût travaillé sous les yeux d’un maître, ne s’interrompant parfois, ne profitant de sa liberté d’écolier non surveillé, que pour rouler de temps en temps une cigarette avec le tabac de son frère.
A midi, Paul rejoignait Louis dans un petit restaurant où celui-ci prenait tous les jours ses repas. Après le déjeuner, l’employé emmenait souvent son jeune frère passer avec lui le reste de la journée à la fabrique. Paul s’y plaisait beaucoup. Sa curiosité ne se lassait jamais de parcourir cette grande usine pleine du bruit, du mouvement, de l’activité fiévreuse du travail. Des ateliers où l’on marchait dans la sciure et les copeaux, où l’on respirait une bonne odeur de bois des Iles fraîchement découpé, il allait à la scierie à vapeur tout le jour grinçante et stridente, et partout il regardait, il observait, interrogeant ouvriers, contremaîtres, mécaniciens, désireux d’apprendre, de se rendre compte, de connaître par avance tous les rouages, toutes les phases de cette industrie au milieu de laquelle il espérait vivre un jour comme son frère. Dans l’atelier des dessinateurs, il passait des heures à copier des modèles de meubles; chez les sculpteurs, il tripotait la glaise, s’essayait à copier des motifs d’ornement, des enroulements décoratifs de feuilles, et, dans ce passe-temps, il trouvait tout à la fois le profit d’une étude et la distraction d’un amusement.
Bien souvent ses allées et venues à travers la maison le faisaient se trouver à l’improviste sur le passage de madame Fizanne. Très élégante, toujours vêtue d’une robe de soie noire, ne laissant à personne le soin de s’occuper de la vente, elle avait l’habitude de promener elle-même, avec une grâce de commerçante aimable, ses clients à travers les magasins remplis de meubles, et, tout en causant, sans même avoir l’air d’y penser, par sa manière habile de présenter la marchandise, bien en lumière, au mieux du goût de chacun, elle avait l’art d’enlever les affaires, de forcer les commandes, au point qu’il lui était arrivé d’inscrire sur ses livres, pour un renouvellement de mobilier complet, telle personne venue à la fabrique pour l’achat d’un simple fauteuil de bureau.
Lorsque le petit Paul la rencontrait ainsi, par les longues galeries du premier étage, il se rangeait respectueusement et s’effaçait, pour livrer passage, en rougissant comme une jeune fille. Le petit bonjour affectueux qu’elle lui adressait, en réponse à son salut, lui faisait l’effet d’un gracieux mot tombé des lèvres d’une souveraine. La profonde vénération, l’admiration de son frère pour madame Fizanne étaient passées en lui. Les cheveux précocement blanchis de cette femme toujours belle la rendaient, à ses yeux d’enfant, plus imposante encore par le contraste un peu étrange d’une vieillesse factice, toute dans la neige de la chevelure, et d’une jeunesse accusée, au contraire, par un front sans rides, par l’expression du sourire, la douceur inaltérée des traits, et, lorsqu’elle parlait, par le timbre chantant d’une harmonieuse voix de Tourangelle. Le profil, nettement et purement dessiné, rappelait les têtes de Minerve frappées sur des médailles antiques. Mais, comme une tare sur ce visage, la ligne blanche et sinueuse d’une cicatrice, trace d’un accident d’enfance, disait madame Fizanne, déparait tout le côté gauche de la figure. Cette ligne commençait au-dessous de la tempe, suivait la rondeur de la joue et, en se terminant à la naissance du cou, y formait un léger pli où elle semblait se creuser davantage.
Madame Fizanne avait un accueil affectueux pour ce petit collégien qui, chaque année, à l’époque des vacances, apparaissait à la fabrique, et cette amabilité ne venait pas seulement de ce que le petit Paul était le frère du plus ancien employé de la maison, mais plutôt d’une tendre compassion de femme inspirée par cette enfance orpheline. D’avance elle s’était engagée de grand cœur à lui donner plus tard une place dans le personnel de la fabrique. Il n’avait fallu, pour cela, qu’un mot dit un jour par Louis Herbelin. Dès que Paul eut terminé ses études, il vit donc se réaliser ses plus chers désirs. Il vint à Paris vivre auprès de son frère, il eut un emploi chez madame Fizanne, et, pendant cinq ans, de1865à1870, rien ne troubla la vie tranquille, heureuse et unie que s’étaient faite les deux Herbelin. Mais lorsque la guerre eut mis son arrêt aux affaires, lorsqu’ils se virent plus à charge qu’utiles dans la maison dont les ateliers fermés ne travaillaient plus, d’un commun accord ils en sortirent pour s’engager.
Quand ils vinrent annoncer à madame Fizanne cette résolution:
–Allez, mes amis, leur dit-elle. Faites votre devoir. Je n’ai pas le droit de vous retenir.
Au moment des adieux, elle fut, comme toujours, affectueuse, mais calme, et ne parut pas s’apercevoir de l’émotion, un peu trop accentuée, qu’éprouvait en la quittant ce grand bon garçon de Louis Herbelin.
Paul avait alors vingt-cinq ans. L’idée de la France envahie avait éveillé en lui un patriotisme raisonné d’homme déjà mûr. En cette occasion, il se montra pour ainsi dire l’aîné. Louis, en effet, ne s’engagea que par entraînement d’imitation, avec un enthousiasme plus en dehors, plus bruyant, plus juvénile, peut-être, mais à coup sûr moins réfléchi. Il vit surtout dans cet acte une libre carrière donnée, pour une fois dans sa vie, à ses goûts d’aventure. Marin, soldat, chercheur d’or, explorateur de pays inconnus, le revolver à la ceinture et la carabine à l’épaule, que de fois il avait rêvé une de ces romanesques existences en dehors des grandes routes battues! Que de fois il avait exprimé le regret que le hasard de la vie n’eût fait de lui qu’un employé de commerce assidu à son bureau! Aussi eût-il voulu, pour partir en guerre contre l’envahisseur, s’engager dans un corps franc. Il se voyait rampant dans les hautes herbes, embusqué derrière un tronc d’arbre, surprenant les vedettes prussiennes avec des ruses de sauvage, à l’exemple des héros de ses auteurs préférés, Fenimore Cooper, Gabriel Ferry, Gustave Aymard, dont il avait dévoré tous les ouvrages le soir, dans son lit, en fumant, comme un calumet, sa magnifique pipe en écume de mer, réveillant parfois son frère par le cri de guerre des Sioux ou des Comanches, jeté à pleine voix, dans la griserie de la lecture, au milieu du silence de leur chambre mansardée. Il lui fallut cependant renoncer à coiffer le petit chapeau de franc tireur, à plume de coq ou à branche de houx. Pour rien au monde il n’eût quitté son Paul, et il se résigna à endosser, comme lui, la capote bleue du simple lignard.
Après six longs mois de campagne, de dangers courus en commun, la guerre terminée ils reprirent leurs places à la fabrique de meubles, ils redevinrent les modestes employés d’autrefois, avec cette seule différence que le mince ruban de la médaille militaire ornait la boutonnière de Louis, et que cette phase de leur vie avait plus étroitement resserré leur affection, la doublant de cette autre affection fraternelle qui naît, entre compagnons d’armes, des longues étapes à marche forcée, des nuits de campement sous la même tente, des craintes éprouvées l’un pour l’autre sous la rafale des feux de peloton, des joies de se retrouver au bivouac, les soirs de bataille, l’un et l’autre vivants.
En quête d’un logement après leur retour à Paris, le hasard leur fit découvrir la «Maison de famille» de madame Lescande. Séduits par la tranquillité provinciale de la rue Buffon, par l’horizon d’arbres du Jardin des Plantes sous les fenêtres, par l’aspect vraiment familial de cette petite maison, tenue par une veuve en bonnet noir, ils vinrent s’y fixer et bientôt eurent repris leurs habitudes d’existence à deux, rangée et méthodique, partant ensemble le malin pour leur bureau, rentrant ensemble le soir, mêlant leurs vies dans une intimité de tous les instants, où il n’y avait plus ni aîné ni cadet. La campagne avait effacé toute différence d’âge; Louis abdiquait son rôle de tuteur, se laissait même volontiers guider et conseiller par son frère, ayant dans son jugement plus de confiance que dans le sien propre. Des côtés semblables de nature leur étaient des points de repère, pour se connaître l’un l’autre jusqu’en leurs dissemblances; et, même lorsqu’ils ne se parlaient pas, chacun d’eux savait lire couramment sur la physionomie, dans les regards de son frère, dans l’attitude de son silence ses plus petits mystères de pensées et de sentiment, ces restrictions de l’esprit et du cœur qu’on ne livre pas au meilleur ami, qu’on garde en soi-même, qui forment l’invisible fond des consciences et sont la source cachée des actions.
C’est ainsi, par cette divination chaque jour plus clairvoyante, que Paul avait approfondi, mieux que s’il en eût reçu la confidence parlée, le culte de tendresse admirative et dévouée, mais sans espérance et sans but, que depuis si longtemps Louis rendait à madame Fizanne.
C’est ainsi que Louis, de son côté, dès les premiers temps de leur séjour à la maison de famille, eut par avance la certitude que Paul aimerait un jour la fille de leur hôtesse. Il le comprit aux réticences, aux hésitations, aux apitoiements de son frère parlant de la tristesse et de la pâleur de la jeune fille; il eut pour indices des riens qui lui révélèrent tout, alors que Paul, s’interrogeant, restait encore indécis lui-même sur ce qu’il éprouvait, amour ou pitié.
Tous les jours il la voyait, tous les jours il l’approchait. D’abord, le hasard seul avait amené ces rencontres; mais bientôt Paul les rechercha, et madame Lescande, à l’affût d’un mari pour sa fille, sut favoriser, sans en avoir l’air, et multiplier les occasions de rapprochement. Elle entr’ouvrait la porte dès qu’elle entendait monter l’escalier.
–Monsieur Paul!... monsieur Paul!...
Il redescendait une moilié d’étage à cet appel; il entrait; il voyait la jeune fille, assidue à son travail, et toujours la mère trouvait un prétexte pour le retenir un bon quart d’heure à bavarder. Quand il eut pris ainsi l’habitude de voisiner, il arriva de plus en plus souvent que madame Lescande était absente à l’heure où il venait. Il trouvait alors Sophie toute seule: il prenait une chaise à côté d’elle. Leur conversation était bien banale, ne roulant que sur des lieux communs; et cependant la jeune fille, si farouche d’ordinaire, silencieuse avec tout autre, toujours assombrie par son inguérissable chagrin, s’apprivoisait peu à peu, semblait oublier quand il était là et en était venue à attendre, à espérer cette visite presque journalière, seule distraction de sa vie monotone. Comme une neige se fond, se fondait sa réserve froide des premiers temps. C’était si bon, si nouveau pour elle, cette affectueuse assiduité dont elle se sentait l’objet, cet hommage timide d’un honnête garçon venant simplement, naturellement, instinctivement à elle!
Cela la relevait à ses propres yeux, et pour une heure lui donnait l’illusion d’être une jeune fille comme les autres jeunes filles. L’attentat commis ne se lisait donc pas, dans les subites rougeurs de son front? L’ineffaçable tache était donc invisible, pour que Paul Herbelin l’eût jugée digne de son estime et de son respect? Oh! qu’elle lui en était reconnaissante! Comme elle l’en remerciait, tout bas, en levant vers lui son regard tout à la fois souriant et mouillé!
Elle l’avait bien compris, elle l’avait bien jugé: indulgent et bon. De cette indulgence ni de cette bonté elle ne pouvait rien attendre, puisqu’il ne savait rien et qu’aucun pardon ne pouvait tomber de lui sur elle, et pourtant elle éprouvait un grand allègement, rien qu’à sentir à ses côtés un être qu’elle devinait capable de l’absoudre.
Un seul mot d’amour prononcé eût suffi pour la mettre en garde contre l’entraînante sympathie qui l’attirait vers Paul, pour effaroucher, dès le début, une affection qui était déjà plus que de l’amitié. Mais ce mot d’amour, Paul ne le dit pas. Aussi put-elle s’abandonner tout entière au sentiment inconnu, mal défini, qui l’enveloppait d’une torpeur, dans laquelle s’ensommeillaient tous les mauvais souvenirs, et où elle trouvait, enfin, un étrange et doux bien-être d’âme reposée.
Elle ne se comprit elle-même, elle ne comprit qu’elle aimait que le jour où sa mère lui annonça la demande en mariage de Paul Herbelin.
L’amour déclaré fut dans son cœur comme un grand coup de lumière. Être sa femme!... c’était bien le bonheur!
Mais alors s’éleva devant elle tout l’odieux du passé. Castan! Et la honte de son indignité, la révolte de sa conscience, l’horreur du mensonge aussi bien que de l’aveu lui arrachèrent son cri douloureux de renoncement:
–Non, non! jamais!...
Jamais elle ne serait sa femme.