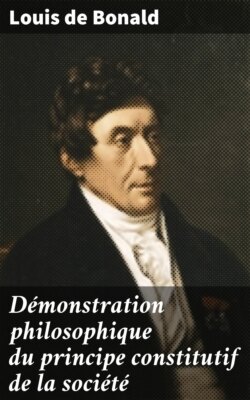Читать книгу Démonstration philosophique du principe constitutif de la société - Louis de Bonald - Страница 3
INTRODUCTION.
ОглавлениеAVANT d’exposer mes principes de philosophie appliquée à la société, j’ai dû considérer l’état actuel de la philosophie en France.
On peut ramener à trois écoles différentes les systèmes philosophiques qui partagent aujourd’hui les esprits.
C’est ce qu’a fait M. Ph. Damiron dans son Essai sur l’Histoire de la Philosophie en France au XIXe siècle, essai dont cette introduction n’est que l’analyse.
Il pourroit y avoir plus d’exactitude, et peut-être d’impartialité, dans les jugemens que M. Damiron porte sur quelques-uns des écrits qu’il examine: il est si difficile d’être entièrement juste envers ceux dont on ne partage pas les sentimens! mais, tel qu’il est, l’Essai suffit au dessein que nous nous sommes proposé. S’il n’expose pas avec assez de fidélité ou de connoissance les systèmes particuliers qu’il combat, il indique avec assez de précision les différentes écoles auxquelles ils appartiennent; or, ce sont les écoles de philosophie, et non les philosophes, que nous considérons dans cet écrit.
M. Damiron commence par l’école sensualiste, expression adoucie, équivalente de matérialiste.
Ce système seroit assez fidèlement traduit par cette définition de l’homme tirée de Saint-Lambert: «L’homme est une masse organisée
» et sensible, qui reçoit l’esprit de tout ce qui
» l’environne et de ses besoins.»
Dans ce système, les organes matériels sont tout l’homme, et même l’homme intelligent; la pensée est une digestion ou une sécrétion comme toute autre; elle est, dit Condillac, la sensation transformée.
«Ici, dit M. Damiron, les applications
» naissent d’elles-mêmes. Elles sont toutes en
» harmonie avec l’idée générale dont elles
» émanent. S’agit-il, en effet, de savoir ce que
» c’est que le bien, ce que c’est que le mal?
» la réponse est aisée. Le bien est tout ce qui
» tend à conserver l’homme, c’est-à-dire, l’organisme;
» le mal est tout ce qui tend à le
» détruire ou à le détériorer. Rien au-dessus
» du bonheur physique, rien de pis que les
» souffrances du corps: le bien suprême est la
» santé. Aussi le vice et la vertu ne peuvent
» être que l’habitude volontaire des actes
» conformes ou contraires à la loi de la conservation
» (toujours des corps ou de l’organisme).
» Tel est le fond du catéchisme de Volney:
» c’est la toute sa théorie. On regrette
» seulement d’y trouver des lacunes, l’une relative
» aux arts, l’autre à la religion. Sans doute, il
» ne juge pas ces deux formes de l’activité
» humaine assez positivement utiles à la
» conservation de l’individu pour en tenir compte
» ou en recommander l’usage. C’est un tort et
» une erreur; car, d’abord, il y a dans la
» culture des arts un charme honnête, etc, etc.
» Quant au sentiment religieux, Volney fait
» plus que le négliger, il le repousse et le
» proscrit; il ne veut ni de la foi ni de
» l’espérance, etc.»
Comment Volney auroit-il pu parler de religion, lorsqu’il ne reconnoît point d’ame distincte des organes, et qu’en auroit-il pu dire? Nous remarquerons seulement que, de la part de M. Damiron, l’expression de lacune est bien foible en parlant de l’absence de la religion dans un système de philosophie.
M. Damiron rejette ce système désolant, dont Locke, parmi les modernes, a jeté les fondemens, lorsqu’il élève la question de savoir si la matière peut recevoir la faculté de penser; que Condillac avec sa sensation transformée a continué et rendu populaire; et qui, à quelques différences près, est, selon M. Damiron, le système de MM. Cabanis (revenu depuis à des idées plus saines), Desttut de Tracy, Volney, Garat, Gall, Azaïs Broussais (ce dernier omis dans la première édition de l’Essai, et nommé dans la seconde), tous philosophes sensualistes ou matérialistes, et même M. La Romiguière, que M. Damiron classe parmi eux, parce que, dit-il, «le principe qu’il
» professa d’abord, qu’il modifia ensuite, savoir,
» que toute idée a sa source dans la sensation,
» offre assez de traces de ce système pour
» pouvoir sans inconvénient en prendre le nom
» et le drapeau.»
Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps sur cette doctrine abjecte, réfutée dans nos Recherches philosophiques etc., et M. Damiron l’a remarqué : elle animalise l’homme, en n’offrant à ses désirs et à son activité que des jouissances matérielles; elle laisse la vertu souffrante sans récompense, le crime heureux sans châtiment, la conscience sans remords, l’homme sans avenir et sans consolation; et, comme elle ne voit d’autre bonheur que la vigueur corporelle, et nie tout autre devoir que celui de la conserver, elle semble imaginée tout exprès pour les méchans, que Hobbes appelle des enfans robustes.
La seconde école, dans l’ordre suivi par M. Damiron, est l’école théologique, spiritualiste ou catholique (car il lui donne ces trois noms), et que nous appellerons l’école de philosophie religieuse, représentée par MM. de Maistre, de La Mennais, de Bonald et d’Eckstein.
Ceux-là croient l’homme une intelligence servie par des organes, intelligence distincte, par conséquent, de l’organisme, éclairée sur son origine, sa nature, ses devoirs et sa fin, non, comme le dit l’auteur de l’Essai, par une inspiration que les catholiques laissent aux protestans, mais par une révélation divine, positive, extérieure, transmise jusqu’à nous par un enseignement traditionnel ou historique; doctrine qui ne prend pas son point d’appui dans l’homme, dans sa sensation, comme l’école sensualiste, ou dans sa conscience, comme l’école éclectique; mais en dehors de l’homme, ou en Dieu.
La troisième école de philosophie est l’école éclectique, qui s’appelle aussi, on ne sait pourquoi, spiritualiste, rationnelle, car elle n’est proprement ni l’un ni l’autre; école éclectique, c’est-à-dire qui cherche pour choisir, renouvelée des Grecs, grands chercheurs de philosophie: Græci, dit saint Paul, sapientiam quærunty et dont MM. Bérard, virey, Kératry, Massias, Bonstesten, Ancillon, Droz, de Gérando, Maine de Biran, Royer-Collard, Cousin, Jouffroy, et M. Damiron lui-même, sont les disciples ou les apôtres.
Puisque le caractère de cette école est de choisir, et par conséquent de chercher, il sembleroit naturel d’attendre, pour la définir, de savoir si elle a fini de chercher, et ce qu’elle a enfin trouvé et choisi. Nous ne le savons pas, et, s’il faut en croire M. Damiron, elle ne le sait pas elle-même, et il est difficile qu’elle puisse jamais le savoir, tant il y a de différences et même de contradictions dans les recherches faites à la fois par tant de philosophes, et d’incertitude dans leurs choix. «La philosophie de » l’éclectisme, dit l’auteur de l’Essai, plus di» verse et plus confuse, a plus de peine à se » rallier à un nom et à un drapeau.» Ce ne sont cependant pas les noms qui lui manquent, puisqu’elle en a, dans l’Essai de M. Damiron, plus à elle seule que les deux autres écoles ensemble; ni les drapeaux, puisqu’elle en a autant que de philosophes. Mais c’est tout-à-fait la faute de l’éclectisme lui-même; c’est à une école qui sait, ou croit savoir, et non à une école qui cherche et cherchera toujours, qu’un homme supérieur peut attacher son nom et son drapeau. Ainsi, continue M. Damiron, «l’éclectisme n’est pas le même, dans tous les
» temps; il dépend des opinions au milieu
» desquelles il intervient; aujourd’hui il se trouve
» entre le sensualisme et la théologie; il
» consiste, par conséquent, dans un spiritualisme
» rationnel. Bien des différences séparent sans
» doute les écrivains assez nombreux que nous
» rangeons dans cette classe. Outre le génie,
» qui n’est pas le même, il y a encore des
» questions qui sont loin d’être identiques;
» mais ce qui leur est commun à tous est de
» ne prendre leur doctrine ni dans le système
» de la sensation, ni dans celui de la tradition
» (de la révélation), mais dans un système
» moyen, qui, plus large que le premier et
» plus positif que le second, s’attache bien
» moins à repousser qu’à modifier l’un et
» l’autre, moins à les nier tous les deux qu’à
» les compléter, les éclaircir, et à leur
» emprunter avec critique ce qu’ils peuvent avoir
» de vrai.»
Ainsi l’éclectisme n’est pas proprement une doctrine, mais il est en quelque sorte deux doctrines; il n’est pas un système suivi dans toutes ses parties, «il dépend des opinions
» au milieu desquelles il intervient; aujourd’hui
» il se trouve entre le sensualisme et le
» spiritualisme,» demain il peut se trouver peut-être entre l’illuminisme de Saint-Martin et celui de Swedemborg. «Bien des différences
» séparent les nombreux écrivains que nous
» rangeons dans cette classe; mais ce qui leur
» est commun à tous, est de ne prendre leurs
» doctrines dans aucun des deux autres systèmes,
» mais dans un système moyen plus
» large que l’un, plus positif que l’autre, et
» qui s’attache moins à les nier qu’à les compléter.»
Cette explication du système éclectique n’est pas très - philosophique, au moins dans l’expression. Que signifie en effet rendre plus large le système matérialiste, et plus positif le système théologique ou religieux, et les compléter tous deux? Le système matérialiste est aussi large qu’il peut l’être; il est surtout simple et complet; il n’admet qu’une substance, la matière, et il en fait tout et même l’intelligence; il en fait son Dieu et son homme. Rien certainement de plus simple et de plus complet. Lui ajouterez-vous, pour le rendre plus large, une ame distincte des organes? ce ne sera plus le matérialisme, mais le système opposé, qui admet les deux substances. Ne lui ajouterez-vous qu’un peu d’ame et retrancherez-vous quelque chose à son organisme? il n’en sera ni plus large ni plus complet, et, d’odieux qu’il est, il deviendra ridicule.
D’un autre côté, le système religieux du catholique est aussi positif qu’il est possible qu’il le soit, fondé sur une révélation écrite, transmise jusqu’à nous d’âge en âge par la tradition, base universelle de la législation de tous les peuples, conservée fidèlement par le plus ancien peuple qui subsiste encore sous nos yeux, reçue par les nations les plus éclairées et les plus fortes, comme le fondement de leurs croyances, et défendue par les plus beaux génies. Qu’ajouterez-vous à ce système pour le rendre plus positif et plus complet? Le ferez-vous pencher vers le sensualisme? Mais, dans ce système, l’homme est une intelligence servie par des organes, et, dans ces organes, serviteurs ou ministres de l’intelligence, est toute-la matière que le système spiritualiste peut admettre.
Et puis, dans quelle proportion, quelle dose, si je peux ainsi parler, prendrez-vous de l’un pour ajouter à l’autre? Ils sont, chacun dans leur genre, deux systèmes absolus, et il ne peut y en avoir d’autres; deux systèmes complets, positifs: l’un dans l’affirmation de la seule substance corporelle, l’autre dans l’affirmation des deux substances corporelle et spirituelle qui composent l’être humain; deux systèmes diamétralement contradictoires, et, pour en composer un tiers système, un système moyen qui ne soit ni l’un ni l’autre et qui soit tous les deux, vous chercherez en vain, vous vous condamnerez, comme les Danaïdes, à remplir un tonneau sans fonds, vous chercherez toujours, et vous ne choisirez jamais de manière à faire un corps de doctrine, un et lié dans toutes ses parties et universellement reçu: et prenez garde que, tant que vous cherchez, vous n’êtes que des sceptiques; dès qu’une fois vous aurez choisi, vous n’êtes plus éclectiques.
Et c’est ici que se montre la grande erreur de l’éclectisme. La pensée a été donnée à l’homme comme instrument, moyen, produit de son activité intellectuelle, de même que ses organes lui ont été donnés comme instrument et moyen de son activité corporelle. L’homme doit nourrir ses organes, pour les faire vivre et croître; il doit les exercer, pour les fortifier et les rendre propres au service qu’il en attend: mais il prend toujours au-dehors de lui-même, et ce qui accroît leur substance, et ce qui exerce leurs forces. L’homme doit également nourrir son esprit par l’étude, l’exercer et le fortifier par le travail; mais c’est aussi toujours hors de lui-même qu’il doit chercher les matériaux de ses études et les objets de ses travaux: et, pour cela, la religion, la morale, la jurisprudence, la politique, l’histoire, les sciences, les arts, la nature, l’univers tout entier, sont à sa disposition: Tradidit mundum disputationi eorum. Les éclectiques, au contraire, ne prennent qu’en eux-mêmes l’objet et le sujet de leurs pensées, et ne pensent, si je peux parler ainsi, que leur propre pensée. Leur science philosophique est la science du moi, mot qui revient si souvent dans leurs écrits; ils n’étudient que leur conscience, qui ne veut dire, en langage philosophique, que la science de soi, suî scientia. Ce sont donc des ouvriers sans ouvrage, qui ne travaillent que sur leurs outils; labeur ingrat, plaisir stérile, qui ne sauroit produire, et dessèche l’esprit sans le féconder; vaine contemplation de soi-même, qui ressemble à cette occupation des solitaires du Mont-Athos, qui, les journées entières, les yeux fixés sur leur nombril, prenoient pour la lumière incréée les éblouissemens de vue que leur causoit cette position. J’avois, en adoucissant l’expression, caractérisé d’une manière vraie et énergique cette dangereuse habitude de l’esprit. M. Damiron a trouvé ce rapprochement ridicule: ce n’étoit pas là son défaut.
Aussi l’éclectisme, qui prend dans la conscience son premier principe, comme le matérialisme le prend dans la sensation, se produit dans ses écrits par une expression vague, obscure, aride, abstraite, sans couleur et sans vie; et je doute que personne, hors leurs auteurs ou leurs traducteurs, ait pu lire jusqu’au bout, sans une extrême fatigue, les nombreux ouvrages sortis de l’école éclectique, ou écossaise. En voici des exemples pris au hasard: «Plus que jamais fidèle à la méthode psychologique,
» dit un célèbre professeur de cette
» école, au lieu de sortir de l’observation, je
» m’y enfonçai davantage; et c’est par l’observation
» que, dans l’intimité de la conscience,
» et à un degré où Kant n’avoit pas
» pénétré sous la relativité et la subjectivité
» des principes nécessaires, j’atteignis et je
» démêlai le fait instantané, mais réel, de
» l’aperception spontanée de la vérité, aperception
» qui, ne se réfléchissant pas immédiatement
» elle-même, passe inaperçue dans
» les profondeurs de la conscience, mais y est
» la base véritable de ce qui, plus tard, sous
» une forme logique, et entre les mains de la
» réflexion, devient une conception nécessaire.
» Toute subjectivité et toute réflexivité expire
» dans la spontanéité de l’aperception; mais
» la lumière primitive est si pure, qu’elle est
» insensible. C’est la lumière réfléchie qui
» nous frappe, mais souvent en offusquant de
» son éclat infidèle la pureté de la lumière
» primitive. La raison devient bien subjective
» par son rapport au moi volontaire et libre,
» siège et type de toute subjectivité ; mais, en
» elle-même, elle est impersonnelle, et n’appartient
» pas plus à tel moi qu’à tel autre moi
» dans l’humanité. Elle n’appartient pas même
» à l’humanité, et ses lois ne relèvent que
» d’elle-même.»
J’avoue avec une entière sincérité que, quoique assez accoutumé à des études sérieuses, je ne comprends pas un mot de ce long passage; et, si d’autres moi en pénètrent le sens, il est pour le mien d’une obscurité désespérante. Encore un exemple pris dans le même auteur: «Dans tout et partout, Dieu
» revient en quelque sorte à lui-même dans
» la conscience de l’homme, dont il constitue
» indirectement le mécanisme et la triplicité
» phénoménale, par le reflet de son propre
» mouvement ou de la triplicité substantielle,
» dont il est l’identité absolue.
» Tout fait individuel est un concert de
» deux parties, dont l’une est entièrement individuelle
» et déterminée par elle-même, et
» la seconde, individuelle et déterminée par
» son contact avec la première, n’est cependant
» considérée en elle-même, ni individuelle,
» ni déterminée.»
En veut-on un autre exemple, tiré du plus littéraire, au moins dans son style, des philosophes qui composent la galerie de M. Damiron. Au reste, celui-ci est plutôt de l’école sensualiste, selon l’auteur de l’Essai.
«Quant à la volonté, son point de départ
» est la faculté élémentaire, ou le désir, comme
» l’attention est le point de départ de la faculté
» élémentaire de l’entendement; le désir engendre,
» comme l’attention, deux autres facultés,
» ni plus ni moins, savoir: la préférence
» et la liberté. La préférence est au désir
» ce que la comparaison est à l’attention, et la
» liberté est à la préférence ce que la raison
» est à la comparaison. Comme les facultés
» élémentaires de l’entendement se compliquent
» des facultés secondaires qui interviennent
» dans leur exercice, de même les
» trois facultés élémentaires de la volonté,
» savoir: le désir, la préférence et la liberté,
» se compliquent successivement de diverses
» facultés secondaires auxquelles elles donnent
» naissance, telles que le repentir et la délibération.
» Le repentir naît à la suite de la
» préférence...»
«Le repentir, dit M. Damiron (raisonnant
» sur ce passage), n’entre pas dans les facultés
» intellectuelles de l’auteur que nous venons
» de citer, quoiqu’il soit une faculté, selon
» Condillac; mais, selon l’auteur cité, le
» repentir appartient à la sensibilité : la
» délibération suit la préférence et précède la liberté.
» On peut d’abord préférer sans avoir délibéré ;
» mais, si l’acte de préférence a été suivi du
» repentir, on ne préfère pas de nouveau sans
» délibérer. Or, la préférence après délibération,
» c’est la préférence libre, la liberté.
» Désir, préférence, liberté, voilà les trois
» facultés réelles; leur réunion est la volonté.
» Mais, comme la réunion de plusieurs facultés
» n’est point une faculté réelle, la volonté n’est
» point une faculté propre, mais une faculté
» nominale, un signe, ainsi que l’entendement,
» et rien de plus.»
Je le demande à tout homme sans prévention, qu’a-t-on appris, que sait-on, quand on a pâli sur cet étrange enseignement? qu’en reste-t-il dans l’esprit? quelles notions utiles et distinctes a-t-on acquises? pense-t-on que l’intelligence soit plus éclairée par la subjectivité et la réflexibilité, par la lumière primitive ou la lumière réfléchie; ou que l’esprit, même le plus ordinaire, ait besoin d’étudier toute cette généalogie de désir, de préférence, de liberté, de volonté, pour désirer, préférer, vouloir et agir? Cette dissection de la faculté intellectuelleen a perception, intuition, perception, réflexion, observation, etc. lui servira-t-elle de quelque chose pour apercevoir, concevoir, observer, réfléchir et juger? et cela ne ressemble-t-il pas un peu aux leçons de grammaire que le maître de langue donne dans les comédies de Molière à M. Jourdain? Autant vaudroit soutenir que l’homme a besoin, pour digérer ses alimens, de connoître le mécanisme de la digestion; ou, pour marcher, d’avoir étudié les lois du mouvement.
M. Damiron reproche sans cesse de la poésie au système religieux qu’il appelle théologique, comme si la poésie étoit condamnée à ne pas raisonner. Assurément on n’accusera pas l’enseignement éclectique d’être trop poétique.
Mais si, comme le dit M. Damiron, «chez
» les nations la foi fait tout;.... si l’histoire de
» la philosophie est celle des croyances; si la
» philosophie n’est que la foi des peuples
» réfléchie et expliquée;» si enfin la philosophie, qu’on peut appeler une religion humaine, veut se substituer à la religion divine, comment, même avec l’appui des journaux populaires dont se vante l’éclectisme, peut se rendre populaire la foi à une doctrine, ou plutôt à des opinions si diverses, si confuses, si peu unanimes, exprimées dans un langage si abstrait, si vague, si peu populaire? Si elles pouvoient être comprises, elles ne feroient qu’un peuple de chercheurs, qui n’auroit rien de fixe dans ses dogmes, rien d’arrêté dans des croyances qui ne parlent ni au cœur ni à l’esprit, ne présentent à l’un aucun sentiment, et n’entretiennent l’autre que de doutes et d’incertitudes! «Voyez, dit M. Damiron, les prodiges de la
» société chrétienne: elle n’a dans l’origine de
» puissance que sa foi; mais sa foi lui vaut
» l’Empire.» C’est que les chrétiens ne cherchent pas, ils savent; car croire, c’est savoir.
«Les nations, dit encore M. Damiron, ne sont
» que ce qu’elles croient.» Que seroit donc la nation qui croiroit à l’éclectisme?
Au reste, les éclectiques ont eu une preuve récente de la foiblesse, de l’obscurité, de l’incohérence de leur système: les journaux nous ont appris que l’Académie avoit proposé, pour sujet de prix annuel, l’explication de l’éclectisme. Personne n’a répondu à l’appel, et personne ne pou voit y répondre: c’est une énigme qui n’a pas de mot.
Avant de passer à l’école religieuse par laquelle nous terminerons cette dissertation, il convient de s’arrêter sur le rapprochement qu’a fait M. Damiron des fortunes diverses des écoles de philosophie en France, avec les diverses phases de la révolution. Ce rapprochement ne fera peut-être pas honneur à l’éclectisme aux yeux de certaines personnes; mais, comme la philosophie chez une nation avancée fait partie de sa littérature, il en résultera une nouvelle démonstration de cette vérité avancée ailleurs par l’auteur de cet écrit: Que la littérature est l’expression de la société.
En effet, M. Damiron montre le matérialisme tout-puissant aux premières époques de la révolution, sous le règne de l’anarchie et de la terreur. Alors la force physique régnoit seule, et la société, livrée à la partie matérielle et populaire de la nation, n’étoit occupée qu’à ravir ou à disputer des intérêts matériels.
«A la restauration, continue M. Damiron,
» tout se déclare. L’école éclectique et l’école
» théologique se constituent l’une et l’autre.
» Mais la première, foible encore, sans
» principes bien arrêtés, dispose les esprits plutôt
» qu’elle ne les gouverne; elle commence à
» percer, mais ne règne pas encore. La seconde,
» au contraire (l’école religieuse), pleine
» de force et d’éclat, et comme armée de toutes
» pièces, a d’abord une action assez vive et
» assez étendue par le clergé qui la propage,
» et le pouvoir qui la favorise. Elle a bientôt
» un public; mais ensuite elle défaille et
» commence à perdre crédit. Aujourd’hui elle est
» peu puissante. De son côté, l’éclectisme a
» grandi et s’est, développé ; il a gagné sur tous
» les points, et le grand nombre est à lui. Il a
» presque passé dans les journaux et dans les
» plus populaires, preuve qu’il arrive à
» l’empire.»
Est-ce l’histoire de la philosophie, ou n’est-ce pas plutôt celle de la société politique que nous venons de présenter? A la restauration, la monarchie commence, et avec elle l’ordre, la paix, la religion, tous les bienfaits de l’état véritablement social, mêlés cependant de l’élément populaire déposé dans la constitution écrite dans la Charte. Le système de philosophie catholique ou religieuse commence donc avec la monarchie, et tend avec elle à s’étendre et à s’affermir. Toutefois s’élève à côté d’elle, timide encore et sans force, la philosophie éclectique. L’esprit et la tendance monarchiques s’affoiblissent; la philosophie religieuse s’affoiblit avec la monarchie: l’une et l’autre défaillent à la fois; la démocratie gagne du terrain; l’éclectisme, son contemporain, son compagnon, ou plutôt son complice, grandit avec elle et se développe. Il gagne, comme elle, sur tous les points; le grand nombre est à lui; il passe dans les journaux les plus populaires, preuve qu’il arrive à l’empire; et preuve que nous arrivons à l’anarchie, suivant la remarque faite à la tribune par un de nos derniers ministres, M. de Martignac; et je m’étonne que, pour l’honneur de son éclectisme, M. Damiron n’ait pas répudié cette honteuse alliance avec les journaux populaires, ces organes furibonds de la démocratie.
Au reste, je doute que les philosophes anciens, même les éclectiques, et Cicéron le premier de tous, Cicéron qui disoit: Mihi nihil unquam populare placuit, eussent attaché tant de prix à la popularité de leur philosophie. Horace n’en vouloit pas même pour sa poésie, Odi profanum vulgus, et arceo.
«Ainsi, continue M. Damiron, au sensualisme
» répond, sous le directoire et sous l’empire,
» le peu de foi aux choses morales, la
» corruption des consciences, leur servilité, la
» conduite brutale du pouvoir, le matérialisme
» des arts et le dédain de la religion... Quand,
» à son tour, le catholicisme reparoît (avec la
» monarchie), et entre en scène avec l’éclat
» et l’appui des noms qui le soutiennent, tout
» s’en ressent; aussitôt la foi semble renaître,
» elle gagne le pouvoir, passe dans les arts et
» dans les mœurs, etc.»
Ainsi le système matérialiste s’allie naturellement à l’anarchie et à ses désordres; le système catholique ou religieux, à la monarchie et à l’ordre... L’éclectisme, qui ne repousse ni n’admet le matérialisme et le spiritualisme, qui ne nie ni l’un ni l’autre et veut les modifier tous les deux et les compléter, est donc forcé de tenir le milieu entre l’ordre et le désordre, entre le bien et le mal, comme la démocratie, à laquelle il s’allie, veut tenir le milieu entre la monarchie et l’anarchie: système entre-deux, comme dit Pascal, entre le vrai et le faux, système moyen ou mitoyen, système foible tant que l’État incline vers la monarchie plus que vers sa rivale, qui grandit, prend de la force, et se développe à mesure que la démocratie prend le dessus, et lorsque la société politique, incertaine de sa route, cherche aussi à choisir entre la monarchie et la démocratie. Ainsi l’éclectisme politique, qui fait le fond de toutes les constitutions modernes, et l’éclectisme philosophique, s’appuient mutuellement, introduits l’un et l’autre par de foibles politiques et de foibles philosophes, qui croient que la vérité est un milieu, comme la vertu, aussi incapables d’éclairer les peuples, qu’impuissans à les gouverner.
Si nous voulions aller plus loin, et comparer les divers systèmes philosophiques aux diverses religions, comme nous les avons comparés aux divers gouvernemens politiques, nous trouverions que le système de philosophie sensualiste ou matérialiste qui nie l’intelligence humaine, n’est que l’athéisme qui nie l’intelligence divine; que le système religieux ou catholique est le théisme, qui croit à l’existence de Dieu, et à la réalisation de l’idée abstraite de la Divinité, par sa présence réelle au milieu des hommes, au Verbe incarné, Dieu du genre humain, comme dit M. Cousin; et que l’éclectisme, qui ne rejette ni n’admet le matérialisme et le spiritualisme, mais prend de tous les deux, conduit au pur déisme qui modifie l’athéisme en admettant l’existence de la Divinité, et modifie le catholicisme en niant la réalité de sa présence au milieu des hommes, et son influence sur les destinées humaines.
Ainsi l’éclectisme philosophique admet un Dieu sans action dans la société, et l’éclectisme politique veut des rois sans influence et sans pouvoir.
Les systèmes de philosophie sont des croyances, ou, comme je l’ai déjà dit, des religions humaines, el les philosophes qui en sont les prêtres sont jaloux du pouvoir et de l’influence des prêtres qui enseignent des croyances divines; et les longues disputes de la philosophie et de la religion n’ont pas un autre principe.
Je passe à l’école de philosophie spiritualiste ou religieuse, sur laquelle je m’étendrai davantage; comme appartenant spécialement aux matières traitées dans cet ouvrage.
M. Damiron l’appelle aussi école catholique, et nous donne le droit d’appeler protestante l’école éclectique ou écossaise; et effectivement, fidèle au dogme calviniste, cette école ne voit qu’inspiration et sens privé, là où l’école catholique croit une véritable et réelle révélation.
Ainsi la philosophie catholique est une philosophie d’autorité générale, et l’éclectisme est une philosophie de raison individuelle: mais que peut vouloir l’éclectisme autre chose que faire de sa raison individuelle une autorité générale, qu’il trouve toute faite dans la philosophie catholique?
Dans l’école de philosophie religieuse ou catholique, il y a unité de vues et de systèmes entre ses défenseurs: seulement les uns ou les autres font des applications particulières et en quelque sorte spéciales des principes qui leur sont communs; M. de Maistre à la religion, M. de Bonald à la politique, M. de La Mennais à la philosophie, M. d’Eckstein à l’histoire.
On remarquera peut-être que M. Damiron s’étend, ce semble, avec complaisance et même, pour ce qui concerne M. de Bonald, avec exagération sur les talens le génie, l’érudition, l’éclat de style des écrivains de l’école religieuse. Il n’en dit pas tout-à-fait autant des écrivains des autres écoles, pas même, sans doute par modestie, de celle à laquelle il appartient. Quelques lecteurs pourroient prendre au pied de la lettre les éloges qu’il donne au style des écrivains catholiques, et en concevoir des préventions contre les systèmes opposés Quand on veut décrier le fond, il ne faut pas tant vanter la forme.
Il est vrai que, par compensation, l’école religieuse compte bien moins de noms que les deux autres, surtout que l’école éclectique; mais, si M. Damiron aime les noms propres, l’école religieuse pourroit revendiquer les noms des Pascal, des Leibnitz, des Euler, des Ch. Bonnet, et de tant d’autres qui ont été de l’école théologique et catholique, sans être théologiens ni même tous catholiques; et ces noms, elle pourroit les opposer, sans trop de désavantage, à tous ceux qu’a cités M. Damiron.
Cet écrivain voit beaucoup d’art et d’artifice dans le style de M. de Bonald, qui n’en a jamais mis dans son style, pas plus que dans sa conduite; et, s’il y a un mécanisme si savant et si curieux dans sa phrase, il a fait, comme M. Jourdain, de la prose sans le savoir. M. Damiron voit aussi de grands ressentimens dans les écrits de M. de Maistre, et dans ceux de M. de La Mennais de grands dégoûts et une grande mélancolie. Il n’y a rien de tout cela dans aucun de ces écrivains, mais un grand amour de la vérité ; et il seroit plus raisonnable et plus vrai d’attribuer à la supériorité de la cause qu’ils défendent, les différens mérites de leur style, la force de leurs pensées, et même le ton ferme et hardi de leurs écrits .
L’éclectique prend donc en lui-même et dans la conscience son premier principe, comme le matérialiste le prend dans la sensation.
Ainsi tous les deux le prennent dans l’homme; mais le philosophe catholique le prend hors de l’homme et en Dieu; et certes, quand on reconnoît l’existence de la Divinité, il faut la bannir de sa pensée, ou la placer à la tête de l’homme, de la société et de l’univers: Ab Jove principium disoient les païens.
C’est donc de la révélation ( s’il y a une révélation, dit M. Damiron), et non de l’inspiration que les catholiques, je le répète, laissent aux protestans, que partent, comme d’un premier principe, les partisans de cette doctrine; et, comme Archimède, ils demandent un point d’appui hors du monde pour le soulever. Cette révélation, orale pour la première famille, et plus tard écrite pour la première société publique, a été conservée par ce même peuple miraculeusement subsistant au milieu de nous, et transmise jusqu’à nous de génération en génération, par les monumens historiques ou traditionnels les plus authentiques, et par le monument de tous le plus authentique, l’établissement de la religion chrétienne, qui a été le dernier développement de la révélation primitive, et dont l’état extérieur et politique s’appelle la chrétienté, réunion et comme confédération des nations les plus puissantes et les plus éclairées qui furent jamais.
Cette révélation, que MM. de Maistre, de La Mennais et d’Eckstein, ont considérée et défendue comme une vérité de foi, religieuse et historique, j’ai voulu en donner la preuve philosophique ou scientifique, et j’ai soutenu la nécessité physique et morale, physiologique et psychologique, si l’on veut, de la transmission primitive du langage faite à l’homme par un être nécessairement supérieur et antérieur au genre humain.
Ce n’est pas, comme le dit M. Damiron, par l’autorité des livres saints, qui ne le disent pas, au moins directement, ni sur des recherches archéologiques que j’ai établi la nécessité de cette transmission primitive; je m’en suis servi tout au plus pour en confirmer la vérité. Mais quel besoin avois-je de l’archéologie ou même de la Bible, lorsque j’avois sous les yeux la preuve la plus visible, la plus palpable, la plus évidente, la plus populaire, la plus universelle, la plus usuelle, de la nécessité de cette transmission, dans l’état des sourds - muets, qui ne sont muets que parce qu’ils sont sourds, et dans le fait incontestable des enfans qui, nés chez les sauvages ou chez les peuples policés, parleront indifféremment les langues barbares des peuplades américaines, ou les langues polies des nations européennes, et n’en parleront conséquemment aucune, si aucune n’a pu frapper leur ouïe?
Cette preuve, je le sais, paroît à nos savans trop vulgaire et pas assez rationnelle ou scientifique; et une vérité sur laquelle on ne peut disputer, et qu’on ne peut contredire, ne doit pas prendre rang dans leur philosophie. En toute autre matière, ils ne veulent pas croire à ce qu’ils ne voient pas; dans celle-ci; ils refusent de croire à ce qu’ils voient, et, pour échapper à cette preuve irréfragable de la transmission primitive du langage, ou plutôt à ses nombreuses et naturelles conséquences, quelques-uns se sont jetés dans les hypothèses les plus monstrueuses: ils ont imaginé des myriades de siècles pendant lesquelles l’homme, par le moyen de circonstances favorables, auroit pu naître du limon de la terre échauffé par les rayons du soleil, d’abord imperceptible animalcule, puis insecte, poisson, bipède ou quadrupède, homme enfin; et, dans cette hypothèse, il étoit aussi facile de faire l’homme inventeur de son propre langage, que d’avoir fait le soleil créateur de l’homme. C’est ce qu’on appelle de la science.
M. Damiron ne partage pas ces extravagantes rêveries; mais, après avoir exposé avec bonne foi mon opinion sur la nécessité de la transmission primitive du langage, philosophe timide, mais consciencieux, n’osant pas l’admettre et craignant de la rejeter, il finit par demander: «Que faut-il en penser?» «Mais, pourrions-nous lui dire, philosophe,
» vous vous présentez pour nous servir de
» guide dans la recherche de la vérité, et au
» premier pas vous nous demandez la route!
» Vous écrivez pour nous éclairer, et c’est de
» nous que vous attendez la lumière! Mais c’est
» à vous-même que nous demandons ce qu’il
» faut penser de cette doctrine; et, puisque
» vous êtes éclectique, cherchez et choisisses
» entre les deux opinions qui font de Dieu
» ou de l’homme l’inventeur du langage, celle
» que nous devons embrasser.»
A la preuve physique de la nécessité de la transmission primitive du langage, tirée du spectacle de la transmission journalière que les hommes s’en font les uns aux autres, et de l’absence de toute parole, ou du mutisme absolu chez ceux qui n’ont pu recevoir cette transmission; à cette preuve physique, dis-je, se joint la preuve métaphysique tout aussi évidente de l’impossibilité de l’invention de la parole par les hommes, qui, sans parole ou sans expression, n’auroient pas pu avoir même la pensée de l’invention; et c’est ce qu’a très-bien aperçu J. J. Rousseau, lorsqu’il dit «que, tout considéré, la parole lui paroît
» avoir été fort nécessaire pour inventer la
» parole.»
Cette preuve n’est autre chose que l’évidente nécessité de la parole mentale ou intérieure pour s’exprimer à soi-même ou se rendre sensible sa propre pensée, et de la parole vocale ou extérieure pour l’exprimer et la rendre sensible pour les autres; et, comme je l’ai dit dans les Recherches philosophiques, sous une forme plus abrégée, la nécessité de penser sa parole avant de parler sa pensée.
C’est cette nécessité de la parole, pour exprimer sa pensée, qui a fait donner à des mots le nom usuel d’expressions; mais il faut observer que la parole n’est nécessaire que pour rendre la pensée aux choses morales, et non pour exprimer la pensée aux objets physiques qui se représentent à notre imagination, sous des images qui sont leurs expressions naturelles ou leurs représentations, des images qu’on peut figurer au dehors par le geste ou le dessin; le geste, qui est la parole de l’imagination, comme le dessin en est l’écriture.
M. Damiron ne sait trop que penser de cette nécessité de l’expression. Dans un endroit il dit «que l’homme ne peut avoir des idées » sans mots; rien de plus constant.» Dans un autre, cherchant à s’expliquer à lui-même comment l’homme a pu inventer son propre langage, il suppose évidemment, comme nous le verrons tout à l’heure, l’idée de l’invention et toutes celles qui en découlent antérieures à l’invention même.
Cependant, pour le mettre à portée de se décider en connoissance de cause sur cette question fondamentale, je lui indiquerai un écrit récent sur l’intelligence des sourds-muets, dans lequel l’auteur a rassemblé les témoignages les plus décisifs, recueillis dans les écrits des savans de presque toute l’Europe qui se sont occupés, par devoir ou par goût, de l’éducation des sourds-muets, et qui tous s’accordent à reconnoître que les sourds-muets n’ont point d’idées, parce qu’ils n’ont point d’expressions.
De ces deux propositions également incontestables, ou plutôt de ces deux faits, l’un, que les hommes ne peuvent parler que la langue qu’ils ont pu entendre; l’autre, qu’ils ne peuvent, sans expressions mentales ou vocales intérieurement ou extérieurement prononcées, se rendre sensibles leurs propres pensées, ni les rendre sensibles aux autres, c’est-à-dire, avoir la conscience de leurs propres pensées et en donner aux autres la connoissance; de ces deux faits, dis-je, résulte, ce me semble, le plus haut degré de certitude de la vérité que j’ai voulu établir, savoir, la révélation faite à l’homme par Dieu même, vérité si universellement reçue, qu’une révélation quelconque, sous une forme ou sous une autre, est le premier dogme des religions de tous les peuples, consentement de tous les peuples dans un même sentiment, que Cicéron appelle la voix de la nature et la preuve de la vérité ; vox naturœ et argumentum veritatis.
M. Damiron croit sans doute à une révélation, quoiqu’il ait demandé plus haut, s’il y a une révélation? «Dieu, dit-il, a produit, puis
» il a instruit, et le rôle de révélateur a du
» succéder à celui de créateur.» Jusque-là nous sommets d’accord, mais ici commence un autre système. «Non, continue M. Damiron, qu’en
» effet Dieu ait pris visage et corps, et se soit
» incarné sous quelque forme; tout ce qui se
» dit de semblable sur cette matière, est, à
» mon sens, figure et poésie. Il n’a point eu voix
» et langage; il n’a enseigné que sous voile, et
» n’a révélé que par symboles. C’est comme père
» des lumières, comme auteur de tout ce qui
» est et paroît que, se manifestant par toutes
» les puissances de la nature et tous les
» phénomènes de l’univers, il s’est fait sentir aux
» ames, il les a inspirées. Ainsi, ajoute-t-il,
» s’est passée la révélation, du moins ainsi l’entendons-nous.
» M. Cousin, le patriarche de l’éclectisme, l’entend autrement. «La rai» son, dit-il, est donc, à la lettre, une révélation,
» une révélation nécessaire et universelle,
» qui n’a manqué à aucun homme et a
» éclairé tout homme venant en ce monde;
» illuminat omnem hominem venientem in
» hunc mundum . La raison est le médiateur
» nécessaire entre Dieu et l’homme; le logos
» de Pythagore et de Platon, le Verbe fait
» chair, qui sert d’interprète à Dieu et de
» précepteur à l’homme, homme à la fois et Dieu
» tout ensemble. Ce n’est pas sans doute le
» Dieu absolu dans sa majestueuse indivisibilité,
» mais sa manifestation en esprit et en
» vérité ; ce n’est pas l’Être des êtres, mais
» c’est le Dieu du genre humain.»
» Selon M. Damiron, il ne faut pas croire que Dieu ait pu s’incarner, prendre voix et parole; selon M. Cousin, homme à la fois et Dieu tout ensemble, médiateur entre Dieu et l’homme, le Verbe s’est fait chair, et, en cette qualité, s’est manifesté en esprit et en vérité ; il est le Dieu du genre humain, le Dieu présent à la société, et il a pu par conséquent se faire entendre aux hommes. Je pourrois employer ici ces belles paroles du psalmiste: Qui plantavit aurem non audiet? qui finxit oculum non considerat? «Celui qui a fait l’oreille n’entendra
» pas? celui qui a fait l’œil ne verra
» pas?» Et l’on peut ajouter, celui qui a donné à l’homme voix et parole, ne parlera pas! M. Damiron ne voit que figure et poésie dans ce que nous croyons touchant la révélation faite à l’homme; mais n’est-ce pas aussi figure et poésie, plutôt que philosophie, que cet enseignement sous voile, cette révélation par symboles ce Père des lumières, auteur de tout ce qui est et paroît, qui se fait sentir aux ames et les inspire par toutes les puissances de la nature et tous les phénomènes de l’univers? Ces voiles, ces symboles, ces puissances, ces phénomènes qui se font sentir, expriment-ils des idées bien nettes, bien rationnelles, et ne rappellent-ils pas plutôt l’idée d’une sensation que celle d’un sentiment? Prenez garde que, dans tout cela, il n’y a encore point de parole, point d’expression, par conséquent point de pensées; tout est pour les yeux, rien pour l’intelligence; et, s’il ne faut que des yeux, l’homme le plus stupide peut aussi bien s’élever à l’idée du créateur et du révélateur, que l’homme le plus éclairé. Mais, de quelque manière que M. Damiron entende l’inspiration, à moins qu’il n’en fasse quelque chose de semblable à ce qu’on appelle dans l’école une prémotion physique, une sensation, l’inspiration suppose la pensée qui la reçoit, comme la pensée suppose des paroles qui l’expriment; et, quand on veut inspirer à quelqu’un quelque chose à dire ou à faire, ne faut-il pas lui parler de vive voix ou par geste, ou par écrit, et lui supposer, par conséquent, la pensée et la réflexion à ce qu’on veut lui inspirer? Une inspiration absolument muette ne trouveroit que des sourds.
C’est donc une loi générale de l’ordre moral et de la condition humaine, que l’homme ne puisse concevoir ou communiquer ses pensées que sous une expression mentale ou vocale, et Dieu lui-même n’est-il pas soumis aux lois générales qu’il a établies? C’est une loi générale de l’ordre moral, comme c’est une loi générale de l’ordre physique, que, dans le cercle, tous les points de la circonférence soient également éloignés du centre; et, comme Dieu lui-même ne pourroit faire un cercle sous une autre condition, et que toute figure où tous les points ne seroient pas à égale distance du centre, ne seroit pas un cercle, un être intelligent qui n’auroit pas besoin d’expression ou de parole pour connoître ses propres pensées et les transmettre au dehors, seroit tout ce que l’on voudroit, mais ne seroit pas l’homme tel que nous le connoissons.
Cette nécessité de la parole révélée est exprimée dans les livres saints, dont j’invoque ici l’autorité, non pour établir, mais pour confirmer la vérité de mes propositions. Écoutez saint Paul: Deus olim loquens patribus in prophetis novissimè diebus istis locutus est nobis in Filio... Et ailleurs: Fides ex auditu; quomodo audient sine prœdicante? «Dieu, qui
» a parlé autrefois à nos pères par les
» prophètes, dans ces derniers temps, et, de nos
» jours, nous a parlé par son Fils... La foi
» vient par l’ouïe; comment entendront-ils la
» vérité, si on ne la leur annonce?»
Je sais bien que, dans les écrits ascétiques, et en général dans les ouvrages religieux, on parle aussi d’inspiration; mais ce n’est pas au sens que l’entendent les protestans et que l’entend M. Damiron: c’est, dans l’intention de ces écrivains, une expression figurée, qui ne signifie qu’une attention plus intime aux vérités révélées.
Mais il faut bien le dire, ce n’est pas le principe de la révélation qui épouvante nos philosophes, ce sont les conséquences qui en découlent naturellement; c’est non-seulement l’exisence d’un être antérieur et supérieur à l’homme, mais sa manifestation aux hommes en esprit et en vérité, c’est-à-dire en ame et en corps; c’est la législation qu’il leur a donnée; c’est, en un mot, toute l’économie de la religion chrétienne, fondée sur l’incarnation et la prédication du Verbe fait chair, base inébranlable sur laquelle s’est élevé le majestueux édifice du christianisme, qui s’avance à travers les siècles, et toujours attaqué, et aujourd’hui plus que jamais, par toutes les erreurs de l’esprit, par toutes les passions du cœur, reste et restera inébranlable à leurs atteintes, et, dans ses trésors, recèle encore des sujets de consolation pour ses enfans, et de confusion pour ses ennemis.
Et qu’on prenne garde que, lorsque nous disons que Dieu a communiqué à l’homme le don de la parole, et que, comme dit M. Damiron, il l’a instruit après l’avoir produit; nous ne contestons pas qu’il ait pu le créer parlant, au lieu de le rendre parlant après l’avoir créé ; nous ne disons pas qu’il ait reçu au premier moment une langue complète; nous disons seulement que l’homme, au premier instant de son existence, a été instruit en pensées et en expressions de tout ce qu’il lui étoit nécessaire de savoir et d’exprimer: et que l’homme ait été créé avec le don de la parole, ou qu’il l’ait reçu après avoir été créé, cette double hypothèse ne change rien au fait de la révélation, prouvée par la nécessité d’une transmission primitive et par l’impossibilité de penser sans expressions.
En attendant de savoir ce qu’il faut en penser, M. Damiron, après avoir repoussé comme peu philosophiques les comparaisons, qu’à l’exemple du plus célèbre philosophe de l’antiquité, j’avois employées pour faire entrer plus facilement ma pensée dans l’esprit du lecteur, essaie de donner de l’invention du langage par l’homme lui-même, une explication qui, dit-il, sera peut-être plus philosophique. Le lecteur en jugera: la voici:
«Quelles que soient l’origine et la nature de
» J’esprit, on peut dire, indépendamment de
» tout système, et sans s’exposer à être
» contredit par aucun, que cet esprit qui vit, sent
» et se meût en nous, est quelque chose d’animé
» et d’actif; que c’est une force, une
» force intelligente de perception des pensées:
» voilà les mouvemens qui sont propres à cette
» force. Tant que ces mouvemens sont purs,
» simplement spirituels, dégagés de tout lien,
» de toute force matérielle, ils sont si déliés,
» si rapides, si peu marqués, qu’à peine
» laissent-ils de trace dans la conscience; ils y
» passent comme l’éclair. Ce sont là ces demipensées,
» ces vagues sensations, ces notions
» irréfléchies, qu’on retrouve en soi-même
» dans tous les instans où l’on ne donne nulle
» attention à ce qu’on voit, où l’on se borne à
» sentir; et de fait on n’en auroit pas d’autres,
» si les choses en restoient toujours là. Mais,
» comme il est inévitable que l’esprit vienne
» à réfléchir, à recueillir ces impressions, et
» qu’alors la perception est en lui plus ferme
» et plus prononcée, ces pensées, ces mouvemens
» intellectuels, deviennent plus forts,
» se produisent avec plus d’énergie, et sortent
» de la pure conscience pour pénétrer dans
» l’organisation. En y pénétrant, ils y déterminent
» certains mouvemens internes, que
» suivent aussitôt les gestes d’attitude, la physionomie
» et la parole. L’organe vocal, en
» particulier, est très-propre, par son extrême
» souplesse, à bien recevoir et à bien rendre
» ces impressions de l’ame. Il arrive donc que
» les pensées se mettent en rapport avec les
» mouvemens organiques, et principalement
» avec les sons, qu’elles s’y allient et s’y unissent
» intimement. C’est au point qu’on a peine
» quelquefois à les en distinguer, et qu’on croit
» les voir, les saisir, les sentir réellement dans
» les phénomènes, qui n’en sont cependant
» que les signes. Or, une telle alliance n’a pas
» lieu sans que ces actes de l’esprit ne participent
» plus ou moins à la nature de ceux
» du corps. Ils prennent quelque chose de leur
» caractère et de leur allure; ils deviennent
» plus positifs et plus marqués; ils se matérialisent
» en quelque sorte, et sont alors des
» pensées qui, arrêtées et fixées par l’expression,
»s’achèvent, se définissent et se changent
» en idées claires et distinctes. C’est ainsi
» qu’on pense au moyen des signes, et surtout
» au moyen des mots.»
Que faut-il penser de cette explication, puis-je à mon tour demander à M. Damiron, et qu’en pense-t-il lui-même? en est-il pleinement satisfait? ne trouve-t-il pas un peu précipitée la conclusion qu’il a tirée de ce long raisonnement, et que j’ai soulignée? Toutes ces locutions physiques qu’il emploie pour expliquer le fait moral de l’invention du langage, ces forces, ces mouvemens internes et intellectuels dont il parle comme il parleroit de mouvemens intestins et qui passent comme l’éclair, ces demi-pensées qui sortent de la conscience et passent dans l’organisation, cette parole, qui est, dit-il ailleurs, une sortie de l’esprit qui passe de la conscience dans les nerfs, s’y projette, pour ainsi dire, et s’y produit sensiblement au moyen du son et de la voix; ces pensées qu’on croit voir, saisir, sentir, dans des phénomènes qui ne sont pas des signes, ces actes de l’esprit qui se matérialisent, en quelque sorte, etc. tout cela lui paroît-il à lui-même, et dans la pensée et dans l’expression, bien philosophique? Ces demi-pensées ces vagues sensations, si déliées, si rapides, qu’à peine laissent-elles des traces dans la conscience; ces notions irréfléchies alors qu’on se borne seulement à sentir, lui rendent-elles une raison suffisante de l’art merveilleux du langage articulé et de tous ses phénomènes? M. Damiron confond-il les idées et les images, les pensées et les sensations? Est-ce qu’il y a des moitiés de pensées ou des moitiés d’expressions? Il n’y a pas encore de langage, et il veut que l’esprit réfléchisse, recueille des impressions vagues et fugitives, qui ne laissent pas de traces dans la conscience, et qu’alors la perception soit plus forte et plus prononcée; expression remarquable, qui échappe au philosophe, et qui devroit lui faire apercevoir qu’une perception n’est prononcée que lorsqu’on peut la prononcer ou la parler. Il faut pour cela que la conscience pénètre dans l’organisation: comment se fait ou peut se faire cette action de l’être moral qui pénètre l’être physique? La conscience est-elle autre chose que l’intelligence qui réfléchit à ce qu’elle a fait, à ce qu’elle fait ou veut faire, à ses devoirs, à ses fautes, etc.? Et y a-t-il conscience, suî scientia, sans pensée et par conséquent sans expression? Combien d’autres questions à adresser à M. Damiron avant de lui accorder cette conclusion si peu préparée: «C’est
» ainsi qu’on pense au moyen des signes et
» surtout au moyen des mots!»
Est-ce que M. Damiron compare le geste ou le dessin, signe de la pensée, aux choses matérielles, images ou figures que les Latins appeloient signa, avec les mots qui ne sont pas les signes, mais l’expression naturelle de la pensée, ou la pensée exprimée et rendue sensible?
Mais le raisonnement par lequel M. Damiron veut expliquer l’invention du langage par l’homme lui-même, peut-il détruire ou seulement balancer le fait évident, palpable, visible comme la lumière du soleil, du mutisme qui n’a pour cause que la surdité, ou l’absence d’une langue transmise, pour ceux qui ne sont pas sourds? Si l’organe des premiers inventeurs du langage, au temps de la plus extrême barbarie, puisqu’elle précédoit l’invention du langage, a pu, à cause de sa prodigieuse souplesse, se prêter, comme dit M. Damiron, aux mouvemens intellectuels, et produire spontanément le langage, comment nos muets, au milieu de toutes les relations de la société, qui donnent aux esprits bien plus de mouvement et d’activité, entourés d’êtres parlans et entendans, et en commerce continuel avec eux, malgré tous les bienfaits d’une éducation qui ne leur laisse pas les mots à inventer, puisqu’elle s’applique à leur enseigner les mots d’une langue toute formée, comment nos muets ne peuvent-ils pas même répéter cette parole, et ne font-ils entendre que des sons inarticulés qui les rapprochent bien plus de la brute que de l’homme? Et encore il faut remarquer, comme une nouvelle preuve, que depuis le premier homme qui la reçut de Dieu, l’art de parler a toujours été transmis et est venu aux hommes, comme la vie, par succession; que l’homme, même doué de tous ses sens, ne parleroit qu’avec une extrême difficulté, ou même ne parleroit pas du tout, si, jusqu’à quinze ou vingt ans, il étoit entièrement séquestré de la société de ses semblables, parce que son organe vocal n’auroit plus assez de souplesse pour se prêter aux combinaisons infinies du langage articulé.
La production de l’esprit par la parole, est comme celle des corps le résultat de l’action simultanée de deux agens; et de là vient sans doute que les mêmes expressions s’appliquent aux deux opérations, et qu’on dit, en parlant de la pensée, conception, production, fécondité de l’esprit, génération des idées, etc.
Non, philosophes, vous ne dissiperez pas le doute de J. J. Rousseau, «que la parole lui
» paroit avoir été fort nécessaire pour inventer
» la parole.» Jamais vous n’expliquerez autrement que par une transmission primitive la merveille de la parole et le fait de sa transmission journalière: et, lorsque vous ne niez pas l’existence d’un Être supérieur à l’homme, et que vous avez pour vous l’opinion de tous les peuples qui ont admis une révélation, et l’exemple des nations les plus éclairées et des plus beaux génies qui ont cru à celle que reconnoissent les chrétiens, pourquoi vous égarer dans des hypothèses chimériques ou absurdes, supposer toujours ce qui est en question, et vouloir que la pensée ait précédé la parole, lorsque, sans parole, je le répète, l’homme ne pourroit avoir eu même la pensée de l’invention?
Mais si la Divinité a créé l’homme parlant, ou lui a révélé l’art de parler après l’avoir créé, elle lui a donc donné aussi le merveilleux organe de la voix, et celui plus merveilleux peut-être de l’ouïe, sans lesquels il ne pourroit parler: elle a donc créé l’homme intelligence servie par des organes; elle a donc créé les organes sans lesquels il ne pourroit parler, et l’activité de son intelligence seroit sans action; elle a donc créé l’univers, habitation de l’homme, et sans lequel le genre humain ne sauroit subsister. Ces vérités, je le sais; ne se démontrent pas de la même manière que le carré de l’hypolénuse, où les propriétés du cercle se démontrent à nos yeux et à notre esprit; mais elles se démontrent à la partie la plus élevée de notre intelligence, à notre raison; elles se démontrent avec la même certitude que les vérités géométriques, par une suite d’inductions et de conséquences si naturelles et si évidentes, qu’elles sont comprises par les enfans et les hommes les plus simples; et si une science orgueilleuse demande qu’on lui explique comment l’Être incorporel a pu agir sur la matière pour lui donner l’existence et la forme, je m’engage à la satisfaire pleinement, si elle daigne m’expliquer comment la volonté, qui est aussi quelque chose d’incorporel, peut agir sur les organes, qui sont aussi de la matière, sur la langue pour la faire parler, sur les mains pour les faire agir, sur les yeux et les oreilles pour les faire regarder et écouter, sur le corps tout entier pour le transporter d’un lieu à un autre; et agir sur les organes non-seulement pour leur commander ce qui peut leur être utile ou agréable, mais pour leur commander la fatigue, la douleur, la souffrance, la mort, oui, la mort; puissance de la volonté de détruire même ses organes, puissance de l’homme sur lui-même, puissance incompréhensible et qui n’a pas de modèle, si on peut le dire, dans la puissance même de Dieu, qui ne peut rien contre lui-même, et dont toutes les lois ne tendent qu’à la conservation des êtres qu’il a créés.
M. Damiron croit que la révélation une fois admise, «tout ce qui n’y revient pas et n’y est
» pas conforme, est réputé par les chrétiens
» erreur et mensonge, sciences physiques, sciences
» métaphysiques, sciences morales, etc. Mais le philosophe peut-il ignorer que nous n’étudions pas dans les livres saints les sciences physiques, quoique sur plusieurs points l’observation ait confirmé les faits exposés dans les livres saints? Malebranche n’y a pas cherché sa métaphysique, ni Leibnitz sa Théodicée; ils ont pu se rencontrer avec les livres saints, comme le feront tous ceux qui s’occuperont à développer les vérités de l’ordre moral; mais, s’ils y ont trouvé la vérité, on peut dire que c’est sans l’y chercher. Et, lorsque de prétendus savans ont l’injustice d’accuser la révélation d’arrêter les recherches sur des objets de science ou de philosophie, je leur demanderai de quelles connoissances nécessaires, ou simplement utiles, la foi à la révélation a borné les progrès; je demanderai à l’éclectisme ce qu’il a trouvé depuis qu’il cherche, ce qu’il a préféré depuis qu’il choisit.
Je crois avoir démontré, dans les Recherches philosophiques sur les premiers objets de nos connoissances morales, la nécessité physique et morale de la transmission primitive du langage, prouvée pour nous, pour tous les hommes, tous les temps et tous les lieux, par la nécessité de sa transmission constante et journalière à tous les êtres humains, à mesure qu’ils arrivent à la vie sociale; prouvée par l’impossibilité de parler où sont les hommes à qui la parole n’a été ni pu être transmise; prouvée encore par la nécessité de l’expression ou de la parole, pour penser aussi bien que pour parler, pour penser aux choses qui ne peuvent pas se présenter sous des images ou figures, et pour en parler aux autres. Personne, que je sache, n’a essayé de combattre ces deux propositions, et je ne crains pas d’assurer que personne ne le tentera avec succès; et certes, il faut bien qu’elles soient incontestables, puisque, pour les combattre, on s’est jeté dans l’hypothèse ridicule, si elle n’étoit monstrueuse, de l’homme né, sous la forme de poisson ou d’insecte, de la terre échauffée par les rayons du soleil, etc.
Ces deux vérités une fois reconnues, il étoit naturel de chercher les pensées dans l’expression, puisque nous ne pouvons les connoître nous-mêmes ni les faire connoître aux autres par un autre moyen, et les pensées les plus générales sous les expressions les plus générales. C’est ce que j’ai fait, et nous entrons ici sur le terrain de la métaphysique ou de la philosophie transcendante, qui est la connoissance des vérités les plus générales, bien différente des sciences proprement dites, dont chacune s’attache à considérer et à développer quelque vérité particulière, historique, politique, chronologique, géométrique, astronomique, botanique, zoologique, etc.
Ces expressions les plus générales, puisqu’elles comprennent absolument tous les êtres et leurs rapports les plus généraux, une fois trouvées dans la langue la plus vraie et la plus exacte qui fût jamais, j’en ai fait l’application à la société, c’est-à-dire, à ce qu’il y a de plus général dans nos conceptions, puisqu’il comprend aussi tous les êtres intelligens et sociaux.
J’ai donc cherché les caractères généraux, naturels ou nécessaires, permanens, par conséquent, et indestructibles, de la société en général et des sociétés en particulier, et de toutes les sociétés; caractères plus ou moins explicites et développés suivant les divers états de société, et d’où naissent des rapports entre les êtres semblables qui composent chaque société, rapports domestiques ou publics, religieux ou politiques, généraux ou particuliers, universels ou locaux; et partout j’ai retrouvé ces caractères sans effort, sans subtilité, et leurs diverses manières d’être, qui distinguent les sociétés en sociétés parfaites ou imparfaites, constituées ou non constituées, selon que ces caractères et les rapports qui en découlent sont conformes ou contraires à la nature des êtres en société.
Enfin, et pour compléter la démonstration, j’ai retrouvé l’expression de ces caractères dans les habitudes les plus familières du langage, comme j’en avois trouvé le type dans les conceptions les plus élevées auxquelles la raison puisse atteindre.
Feu M. Loyson, professeur de l’École-Normale, cité par M. Damiron, a traité de calembourg cette vaste catégorie, qui, dans son expression comme dans sa réalité, comprend tous les êtres. Cette légèreté dans une matière aussi grave ne fait honneur, ni à la philosophie du professeur, ni à celle de l’École-Normale.
C’est là, je le crois du moins, de la philosophie, et de la philosophie appliquée à la société. Les écoles de philosophie moderne, matérialiste ou éclectique, ont fait la philosophie de l’homme individuel, du moi, qui joue un si grand rôle dans leurs écrits; j’ai voulu faire la philosophie de l’homme social, la philosophie du nous; si je peux ainsi parler, et ces deux pronoms, moi et nous, distinguent parfaitement les deux manières différentes de philosopher.
Qu’on y prenne garde, cependant; jamais ce moi, mille fois répété, ne peut être ni dire nous; et quel est le moi qui puisse dire nous, si ce n’est un moi général, un moi pouvoir, un homme, enfin, qui représente tous les autres; l’homme roi dans une société, L’HOMME DIEU dans l’univers?
C’est, je le répète, de la philosophie, et la seule vraie, la seule positive, la seule qui explique l’homme social, et qu’on ne peut considérer hors de la société.
Ni la philosophie des sens, ni celle du doute, qui cherche et cherchera toujours, ne peuvent convenir à l’âge avancé de la société. La première, étrangère à l’homme moral, et qui ne voit dans l’homme que la partie animale et matérielle, n’est au fond que le chapitre homme d’un traité de zoologie; l’autre est en arrière de dix-huit siècles sur le temps présent. Il n’y a plus, depuis l’établissement du christianisme, d’autre philosophie raisonnable que la philosophie religieuse, et c’est une grande vérité, même philosophique, que cette parole d’un Père de l’Église: Solutio omnium difficultatum Christus.
Cette philosophie, à la fois théorique et pratique, qui a confondu la sagesse du Portique et évangélisé les pauvres, c’est-à-dire, enseigné les hommes les plus simples, éclaire l’esprit du savant qui l’étudié, et échauffe le cœur de l’homme simple, à qui la vue d’une croix sur un grand chemin en dit plus que les Entretiens de Mallebranche, la Théodicée de Leibnitz, ou les Lettres d’Euler, n’en disent aux savans.
Aussi, dit M. Damiron, «le peuple et les » philosophes ne pensent pas de la même façon,
» et cependant leurs idées ne se repoussent
» pas; elles diffèrent sans se combattre, et se
» rapportent au fond malgré la forme. Ainsi,
» les philosophes ne font qu’un avec le peuple:
» leur pensée n’est que sa pensée, leurs doctrines
» ne sont que sa foi.» Il y auroit quelque chose à rabattre de cette conclusion, et les doctrines de nos philosophes ne sont heureusement pas la foi des peuples. C’est ce qui m’a souvent fait désirer qu’on pût mettre le livre de l’enfance, le Catéchisme, à la portée des savans, comme on a mis l’enseignement des sciences et des lettres à la portée des enfans.
En considérant sous un point de vue rationnel les vérités proposées à notre foi, n’ai-je pas rempli un des vœux de la philosophie?
«Ne viendra-t-il pas une autre époque, dit
» M. Damiron, où ce que la dernière manifestation
» (de la vérité) pourroit avoir encore
» d’obscur et de mystérieux, paroîtra plus
» intelligible et plus clair; où une croyance
» nouvelle, fille et héritière du christianisme,
» en reproduira les dogmes, mais sous des
» formes qui conviendront mieux que les
» précédentes à la manière dont tout le monde
» voit aujourd’hui les choses?»
Non, il n’y aura point, il ne peut y avoir de croyance nouvelle. Le christianisme a rempli sur ce point tous les vœux raisonnables de l’esprit: il a satisfait tous les besoins du cœur; mais il peut y avoir de nouveaux motifs de croire, et la force de la religion chrétienne, au milieu des attaques les plus furieuses et les plus habiles qu’elle ait essuyées, est pour nous, qui en sommes témoins, un de ces nouveaux motifs de croire à sa divinité. Non, il n’y aura point de nouvelle croyance; mais l’ancienne croyance peut recevoir de nouveaux développemens qui la rendront plus auguste et plus chère, non à ce monde qui voit les choses de la religion d’une certaine manière, c’est-à-dire, avec indifférence, ignorance, haine ou mépris; à ce monde qui ne paroît nombreux que parce qu’il fait du bruit; mais à ce monde chrétien qui, trouvant assez de lumières dans la religion, n’en est pas moins disposé à en accueillir de plus grandes, pourvu qu’elles soient approuvées par la grande autorité de l’Église, qui éprouve tous les esprits et n’en repousse aucun.