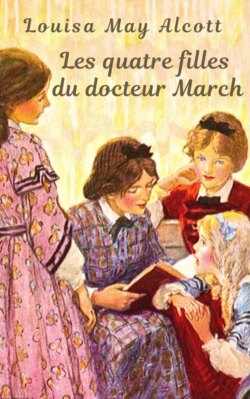Читать книгу Louisa May Alcott : Les quatre filles du docteur March - Луиза Мэй Олкотт, Луиза Мэй Олкотт, Mybook Classics - Страница 6
Chapitre 3 - Le petit Laurentz
Оглавление« Jo ! Jo ! où êtes-vous ? criait Meg au bas de l’escalier qui montait au grenier.
— Ici », répondit une voix, tout en haut.
Et Meg, grimpant l’escalier, trouva sa sœur occupée à croquer une pomme, tout en pleurant sur un livre qu’elle lisait. Elle était enveloppée dans sa pèlerine et étendue au soleil, près de la fenêtre, sur un vieux sofa veuf d’un de ses pieds. C’était là le refuge favori de Jo, là qu’elle aimait à se retirer avec ses livres favoris, pour jouir pleinement de sa lecture, et de quelques biscuits qu’elle partageait avec un ami fort singulier, qu’elle était parvenue à apprivoiser et qui vivait volontiers dans sa compagnie. Il n’avait aucunement peur d’elle, et tournait, tant qu’elle était là, autour du canapé avec une familiarité sans exemple dans un rat, car, oui vraiment, c’était bien un rat. À la vue du singulier ami de sa sœur, Meg s’arrêta tout interdite ; mais, à la vue de Meg, Raton, c’était le nom du petit animal, Raton s’enfuit dans son trou, et Meg reprit courage. Jo essuya ses larmes et mit son livre de côté.
« Quel plaisir, Jo ! lui dit Meg, voyez ! Une invitation en règle de Mme Gardiner pour demain soir. » Et lui montrant le précieux papier, elle le lui lut avec un plaisir que les jeunes filles qui ont de rares occasions de plaisir comprendront sans effort :
« Madame Gardiner prie miss Marsh et miss Joséphine d’assister à la soirée dansante qu’elle donnera la veille du jour de l’an. »
« Maman veut bien que nous y allions, Jo ! Mais quelle robe allons-nous mettre ?
— À quoi bon le demander ? Vous savez bien que nous mettrons nos robes de popeline, puisque nous n’en avons pas d’autre, répondit Jo, achevant à elle toute seule la provision de biscuit, à laquelle, par son brusque départ, Raton avait perdu tous ses droits.
— Si j’avais seulement une robe de soie ! Maman a dit que j’en aurais peut-être une quand j’aurai dix-huit ans, mais trois ans d’attente c’est une éternité !
— Nos robes ont tout à fait l’air d’être de soie, et elles sont bien assez jolies pour nous. La vôtre est aussi belle que si elle était neuve, mais la mienne est brûlée et déchirée. Qu’est-ce que je vais faire ? La brûlure se voit horriblement, et je ne peux pas l’enlever.
— Vous resterez aussi immobile que possible ; comme le devant est bien, tout ira, si vous ne vous montrez pas de dos. Moi, j’aurai un ruban neuf dans les cheveux, maman me prêtera sa petite broche qui a une perle fine ; mes nouveaux souliers de bal sont charmants, et mes gants peuvent aller, quoiqu’ils ne soient pas aussi frais que je le voudrais.
— Les miens ont des taches de limonade, et je ne peux pas en avoir de neufs. J’irai sans gants ! dit Jo, qui ne se tourmentait jamais beaucoup pour des questions de toilette.
— Il faut que vous ayez des gants, ou bien je n’irai pas ! s’écria Meg d’un ton décidé. Les gants sont plus importants que tout le reste ; vous ne pouvez pas danser sans gants, et si vous ne dansiez pas, je serais si fâchée !
— Mais, Meg, si je ne dois pas montrer mon dos, je ne puis pas bouger, et par conséquent je ne puis ni valser ni même danser ; mais ne vous en inquiétez pas, je n’y tiens pas du tout. Ce n’est déjà pas si amusant de tourner en mesure dans une chambre ; j’aime mieux courir et sauter.
— Vous ne pouvez pas demander des gants neufs à maman, c’est trop cher, et vous êtes si peu soigneuse !… Notre mère a été obligée de vous dire, quand vous avez sali les autres, qu’elle ne vous en donnerait pas de nouveaux de tout l’hiver ; mais ne pourriez-vous trouver un moyen de rendre les vôtres possibles ?
— Je peux fermer les mains de manière à ce que personne ne voie qu’ils sont tachés en dedans ; c’est tout ce que je peux faire ! Cependant il y a peut-être un moyen ; je vais vous dire comment nous pouvons nous arranger : mettons chacune un gant propre et un gant sale.
— Vos mains sont plus grandes que les miennes, Jo, cela est sûr ; vous déchireriez mon gant sans utilité, repartit Meg, qui avait un faible pour les jolis gants.
— Alors, c’est décidé, j’irai sans gants ; je m’inquiète fort peu de ce que l’on dira, répondit Jo en reprenant son livre.
— Vous l’aurez, mon gant, vous l’aurez ! s’écria Meg ; seulement, je vous en prie, ne le tachez pas et conduisez-vous convenablement. Ne mettez pas vos mains derrière votre dos comme un général, ne regardez pas fixement les gens.
— Ne m’ennuyez pas avec tant de recommandations ; je serai aussi raide qu’une barre de fer et je ne ferai pas de bêtises, si je peux ! Maintenant allez répondre à votre billet, et laissez-moi finir cette splendide histoire. »
Meg descendit « accepter avec beaucoup de remerciements », examiner sa robe et chanter comme un oiseau en arrangeant son unique col de dentelle, tandis que Jo finissait son histoire et ses pommes et jouait à cache-cache avec M. Raton qui avait reparu.
La veille du jour de l’an, la chambre qui était le parloir de la maison était déserte. Beth et Amy s’amusaient à tout ranger, et leurs sœurs étaient absorbées par l’importante affaire de s’apprêter pour la soirée. Quoique leurs toilettes fussent très simples, il y eut beaucoup d’allées et venues, de rires et de paroles, et à un certain moment une forte odeur de brûlé emplit la maison ; Meg ayant désiré avoir quelques frisures, Jo s’était chargée de passer ses papillotes au feu.
« Est-ce que cela doit fumer comme cela ? demanda Beth.
— C’est l’humidité qui sèche, répondit Jo.
— Quelle drôle d’odeur ! On dirait des plumes brûlées, ajouta Amy en roulant ses jolies boucles blondes autour de son doigt, d’un air de supériorité.
— Là ! maintenant je vais ôter les papiers et vous verrez un nuage de petites frisures », dit Jo, mettant les pinces de côté. Elle enleva le papier, mais aucun nuage n’apparut ; les cheveux venaient avec le papier, et la coiffeuse posa avec stupéfaction sur le bureau, à côté de sa victime, plusieurs petits paquets à moitié brûlés.
« Qu’avez-vous fait ? Je suis tout abîmée. Je ne peux plus aller au bal maintenant ! Oh ! mes cheveux, mes pauvres cheveux ! gémit Meg en regardant avec désespoir les petites boucles inégales qui tombaient sur son front.
— Toujours mon bonheur habituel. Aussi vous n’auriez pas dû me demander de le faire, je fais tout mal. Je suis on ne peut plus fâchée ; le fer était trop chaud, murmura la pauvre Jo, en pleurant de regret.
— Mettez votre ruban de manière à ce que le petit bout des frisures revienne sur votre front, dit Amy pour consoler Meg, vous serez tout à fait à la dernière mode.
— Je suis jolie maintenant pour avoir essayé d’être belle ! Je voudrais bien ne pas avoir pensé à mes cheveux ! cria Meg avec impatience.
— Cela aurait mieux valu ; ils étaient si doux et si jolis ! Mais ils repousseront bientôt », dit Beth en venant embrasser et consoler la pauvre brûlée.
Après plusieurs autres malheurs moins grands, Meg fut enfin habillée. Et, avec l’aide de toute la famille, Jo arriva aussi à être coiffée et habillée. Elles étaient très bien dans leur simplicité. Meg avait sa robe de popeline gris argent, une ceinture de soie bleue, un col et des manches de dentelle, et la fameuse perle fine. Jo avait mis sa robe de popeline noisette, une collerette raide comme en mettent quelquefois les petits garçons, et pour seul ornement des chrysanthèmes blancs dans ses cheveux. Elles mirent chacune un joli gant propre et tinrent l’autre à la main, et tout le monde déclara que c’était parfait. Les souliers à hauts talons de Meg étaient terriblement étroits ; ils lui faisaient très mal, quoiqu’elle ne voulût pas l’avouer, et les trente-trois épingles à cheveux de Jo lui semblaient enfoncées dans sa tête ; « mais tant pis, dit Jo, pour une fois soyons élégantes ou mourons. »
Mme Marsch, mal portante, ne pouvait les accompagner, mais elle les avait dans la journée recommandées aux soins d’une de ses amies, qu’elles devaient retrouver au bal.
« Amusez-vous bien, chéries, leur dit MmeMarsch, au moment enfin arrivé du départ, et revenez à onze heures, aussitôt que Hannah ira vous chercher. »
La porte se refermait à peine sur les deux sœurs, qu’on leur cria par la fenêtre :
« Enfants ! enfants ! avez-vous chacune un mouchoir de poche brodé ?
— Oui, oui ! de très jolis, et Meg a de l’eau de Cologne sur le sien ! cria Jo. Et elle ajouta en riant, pendant qu’elles allaient chez Mme Gardiner : Je crois que si nous avions à nous sauver d’un tremblement de terre, maman penserait encore à nos mouchoirs. Elle n’oublie rien.
— Elle a bien raison, dit Meg, c’est aux détails qu’on reconnaît une vraie lady, à la fraîcheur de ses gants et de ses bottines et à la beauté de son mouchoir de poche », répondit Meg, qui avait beaucoup de petits goûts aristocratiques.
Enfin elles arrivèrent et, après être restées un certain temps devant la glace du cabinet de toilette de Mme Gardiner, Jo demanda à sa sœur :
« Ma ceinture est-elle droite ? Et mes cheveux sont-ils à peu près à leur place ?
— Oui, oui, mais n’oubliez pas de bien dissimuler la brûlure de votre robe, lui répondit Meg.
— Je suis sûre d’oublier. Si vous me voyez faire quelque chose de mal, mouchez-vous bien fort, je comprendrai, répliqua Jo en remettant sa collerette droite et donnant un dernier regard à sa coiffure.
— Vous n’y pensez pas, Jo ; ce ne serait pas du tout distingué. Si vous faites quelque chose de mal, je froncerai les sourcils, et, si c’est bien, je ferai un signe de tête. Surtout tenez-vous droite, faites de petits pas et ne donnez pas de poignées de main si on vous présente à des inconnus, cela ne serait pas convenable.
— Comment faites-vous pour savoir tout ce qui est convenable ? Moi je n’ai jamais pu l’apprendre. Ne trouvez-vous pas que cette musique est gaie ? » dit Jo en descendant.
Les deux sœurs allaient rarement dans le monde ; aussi, quelque peu cérémonieuse que fût la réunion, c’était pour elles un grand événement qui leur inspirait une certaine timidité. Elles furent reçues très cordialement par Mme Gardiner, une belle vieille dame qui les conduisit vers Sallie, une de ses filles. Meg, qui la connaissait, fut bientôt à son aise ; mais Jo, qui se souciait peu des petites filles et de leur bavardage, resta seule, le dos soigneusement appuyé contre le mur, se sentant aussi dépaysée dans ce salon qu’un petit poulain dans une serre remplie de fleurs.
Dans un coin de la chambre, plusieurs jeunes garçons parlaient gaiement de traîneaux et de patins, et Jo, qui aimait passionnément à patiner, aurait bien voulu aller les rejoindre ; mais Meg, à qui elle télégraphia son désir, fronça les sourcils d’une manière si alarmante qu’elle n’osa pas bouger. Les jeunes gens s’en allèrent un à un ; personne ne lui parla, et elle fut laissée seule, n’ayant pour toute ressource que la possibilité de regarder autour d’elle, puisque, grâce à sa robe brûlée, elle ne pouvait changer de place. Cependant on commençait à danser ; Meg fut tout de suite invitée, et les petites bottines trop étroites glissaient si légèrement sur le parquet, que personne n’aurait pu deviner quelles souffrances endurait leur propriétaire. Jo, voyant un gros jeune homme à cheveux rouges s’approcher d’elle, craignit que ce ne fût pour l’inviter et se glissa dans l’embrasure assez profonde d’une fenêtre. Elle se cacha derrière les rideaux avec l’intention de tout regarder de là sans être vue. Le poste était bien choisi pour s’amuser en paix du bruit des autres. Malheureusement, une autre personne timide avait déjà choisi le même refuge, et elle se trouva face à face avec le « jeune Laurentz ».
« Mon Dieu ! Je ne savais pas qu’il y eût quelqu’un dans cette cachette », balbutia Jo, se préparant à s’en aller aussi vite qu’elle était venue.
Mais le jeune garçon se mit à rire et dit aimablement, quoiqu’il eût l’air un peu effrayé :
« Ne faites pas du tout attention à moi, mademoiselle, et restez si cela vous fait plaisir.
— Je ne vous gênerai pas ?
— Pas le moins du monde. J’étais venu derrière ce rideau parce que, ne connaissant presque personne ici, je m’y sentais un peu dépaysé dans le premier moment. Vous savez, dit-il en se levant, on éprouve toujours un peu d’embarras.
— C’est pour la même raison que je m’y réfugiais. Ne partez pas, je vous en prie, à moins que vous n’en ayez envie. »
Le jeune garçon offrit une chaise à Jo, puis se rassit. Cela fait, il regarda ses bottes jusqu’à ce que Jo, essayant d’être polie et aimable, lui dit :
« Je crois que j’ai déjà eu le plaisir de vous voir. Vous habitez tout près de chez nous, n’est-ce pas ?
— Oui, dans la maison à côté. »
Et, levant les yeux vers Jo, il se mit à rire, car l’air cérémonieux de la petite demoiselle contrastait d’une manière fort drôle avec la conversation qu’ils avaient eue ensemble, lorsqu’il avait rapporté le chat à son propriétaire.
Jo se mit aussi à rire et dit de son air habituel :
« Votre cadeau de Noël nous a fait bien plaisir.
— C’est grand-père qui vous l’a envoyé.
— Oui, mais c’est vous qui lui en avez donné l’idée, n’est-ce pas ?
— Comment se porte votre chat, miss Marsch ? demanda le petit Laurie, essayant de prendre un air sérieux, mais ne parvenant pas cependant à cacher la gaieté qui faisait briller ses grands yeux noirs.
— Très bien, je vous remercie, monsieur Laurentz. Mais je ne suis pas miss Marsch, je suis seulement Jo.
— Je ne suis pas M. Laurentz, je suis seulement Laurie.
— Laurie Laurentz ! Quel drôle de nom !
— Mon nom de baptême est Théodore, mais il ne me plaît pas. On a fini par m’appeler Laurie, et j’aime mieux cela.
— Moi aussi je déteste mon nom, il conviendrait à une personne très douce et très posée, et je ne suis ni l’une ni l’autre. Je voudrais que tout le monde dît Jo, au lieu de Joséphine. Comment avez-vous fait pour obtenir de vos camarades de vous appeler Laurie ?
— Je me suis fâché, je me suis battu avec le plus grand qui s’y refusait, et tout a très bien marché après.
— Je ne peux pas me battre avec tante Marsch ; ainsi je suppose que je dois me résigner, murmura Jo avec un soupir.
— N’aimez-vous pas la danse, miss Jo ? demanda Laurie, en ayant l’air de penser que le nom lui allait bien.
— Si, assez, lorsqu’il y a beaucoup de place et que tout le monde est gai ; mais, dans un petit salon comme celui-ci, où je suis sûre de tout renverser, de marcher sur les pieds des autres, ou de faire quelque chose de terrible, je mets la danse de côté et je laisse Meg faire la belle pour nous deux. Mais vous dansez, vous ?
— Quelquefois. Cependant, comme je suis resté quelque-temps en Europe et que je ne suis pas ici depuis longtemps, j’ai peur de ne pas connaître vos danses.
— En Europe ! oh ! racontez-m’en quelque chose. J’aime beaucoup les récits de voyages. »
Laurie n’avait pas l’air de savoir par où commencer ; mais, Jo lui faisant beaucoup de questions, il lui raconta comme quoi il avait été en pension à Vevey en Suisse, un endroit où les petits garçons portent des képis au lieu de chapeaux, ont des bateaux sur le lac de Genève, et, pendant les vacances, vont faire des excursions avec leurs maîtres sur les glaciers.
— Oh ! que je voudrais avoir été dans cette pension-là ! s’écria Jo. Êtes-vous allé à Paris ?
— Nous y avons passé l’hiver dernier.
— Parlez-vous français ?
— À Vevey, on ne nous permettait pas d’employer une autre langue.
— Ah ! dites-moi quelque chose en français. Je le lis, mais je ne peux pas le prononcer.
— Quel nom a cette jeune demoiselle qui danse avec ces jolies bottines ? dit complaisamment Laurie.
— Oh ! que c’est bien. Vous avez dit : « Quelle est cette jeune fille aux jolies bottines », n’est-ce pas ?
— Oui, mademoiselle.
— C’est ma sœur Marguerite, vous le savez bien. La trouvez-vous jolie ?
— Oui, elle me rappelle les jeunes filles de Genève ; elle est si fraîche et si calme, et elle danse si bien ! »
Jo rougit de plaisir en entendant les compliments qu’on faisait de sa sœur, et se promit de ne pas oublier de les lui redire. Elle était redevenue son joyeux elle-même en ne voyant personne faire attention à sa robe ou lever les sourcils à tout propos. Aussi son air gentleman mit bientôt Laurie à l’aise, et, à force de regarder, de bavarder et de critiquer, ils furent bientôt de vieilles connaissances. Jo aimait de plus en plus son « jeune voisin ». Elle le regarda très attentivement plusieurs fois afin de pouvoir le bien décrire à ses sœurs, car, n’ayant pas de frère et très peu de cousins, les petits garçons étaient pour elle des créatures presque inconnues.
« Des cheveux noirs bouclés, de grands yeux noirs, un teint brun, un nez aquilin, une jolie bouche, de jolies mains et de petits pieds, très poli pour un garçon, et en même temps très gai… Quel âge peut-il avoir ? »
Elle allait le lui demander, mais s’arrêta juste à temps, et, avec un tact qui lui était peu habituel, elle essaya d’arriver à le savoir d’une manière plus polie.
« Je suppose que vous irez bientôt à l’Université. Je vous vois piocher, – non, travailler beaucoup », dit Jo en rougissant d’avoir laissé échapper le mot « piocher ».
Laurie sourit et n’eut pas l’air choqué, puis répondit en haussant les épaules :
« Pas avant deux ou trois ans, en tout cas ; car je n’irai certainement pas avant d’avoir dix-sept ans.
— N’avez-vous donc que quinze ans ? demanda Jo, qui trouvait Laurie très grand et qui lui aurait bien donné dix-sept ans.
— J’aurai quinze ans le mois prochain.
— Que je voudrais donc pouvoir aller à l’Université ! Vous ne paraissez pas être de mon avis ?
— Je la déteste. Je ne peux pas souffrir la manière d’étudier de ce pays-ci.
— Qu’est-ce que vous aimeriez ?
— Vivre en Italie, et m’amuser comme je l’entends. »
Jo aurait bien désiré lui demander ce que c’était que s’amuser comme il l’entendait, mais les sourcils noirs de son compagnon s’étaient froncés subitement d’une manière si alarmante, qu’elle changea ce sujet et dit, en battant la mesure avec son pied :
« Quelle jolie valse ! Pourquoi n’allez-vous pas la danser ?
— J’irai si vous y venez aussi, répondit-il en lui faisant un drôle de petit salut français.
— Je ne peux pas ; j’ai dit à Meg que je ne danserais pas, parce que… »
Et elle s’arrêta, ne sachant pas si elle devait continuer.
« Parce que quoi ? demanda curieusement Laurie.
— Vous ne le direz pas ?
— Jamais.
— Eh bien, vous saurez que j’ai la mauvaise habitude de ne prendre garde à rien, pas même au feu, et de brûler souvent mes robes ; celle-ci a été brûlée par derrière, et, quoiqu’elle ait été bien raccommodée, cela se voit, et Meg m’a recommandé de ne pas bouger de la soirée pour qu’on ne s’en aperçoive pas. Ah ! vous pouvez rire si vous voulez, je sais que c’est drôle. »
Mais Laurie ne rit pas, il baissa seulement les yeux une minute, et l’expression de sa figure étonna Jo, lorsqu’il lui dit très gentiment :
« Ne faites pas attention à votre robe, je vais vous dire ce que nous pourrions faire : il y a près d’ici un grand vestibule dans lequel nous serons très bien pour danser sans que personne nous regarde. D’ailleurs nous tournerons très vite, on n’y verra rien du tout. Venez, je vous en prie. »
Jo accepta sans se faire prier davantage et suivit son jeune cavalier dans le vestibule. Elle eut soin pourtant de passer derrière tout le monde et très près du mur pour ne pas trahir, dès le début, le secret de sa robe brûlée ; mais, par exemple, elle regretta beaucoup de n’avoir pas de jolis gants lorsqu’elle vit son cavalier en mettre une paire jaune paille, d’une étonnante fraîcheur.
Laurie dansait bien, et Jo éprouva un grand plaisir à danser avec lui, dans un endroit où elle ne pouvait « faire aucun malheur » ; il lui apprit le pas allemand, et tous deux ne s’arrêtèrent de danser que lorsque la musique eut complètement cessé. Ils s’assirent alors pour se reposer sur la dernière marche de l’escalier, et Laurie était au milieu du récit d’un festival d’étudiants à Heidelberg, lorsque Meg fit signe à sa sœur de venir. Jo, se rendant bien à contrecœur à son appel, la trouva dans une chambre à côté, étendue sur un sofa, tenant son pied, et se lamentant.
« J’ai le pied tout enflé, les stupides talons ont tourné et m’ont donné une entorse épouvantable. J’ai très mal et ne peux plus me tenir debout ; je ne sais pas comment je pourrai jamais revenir chez nous.
— Je savais bien que vous vous feriez mal avec ces bottines trop étroites ! Je suis très fâchée, mais je ne vois qu’un moyen, c’est d’aller vous chercher une voiture, ou de rester ici toute la nuit, répondit Jo, en frottant doucement le pied endolori de sa sœur.
— Cela coûterait beaucoup trop d’argent de prendre une voiture, et d’ailleurs nous ne pourrions pas en trouver. Tout le monde est venu dans des voitures particulières, et quand même il y en aurait d’autres, les stations sont loin d’ici, et nous n’avons personne à envoyer.
— J’irai, moi, dit Jo. Ce n’est pas plus difficile aujourd’hui qu’un autre jour.
— Non, non, dit Meg, vous n’irez pas. Il est dix heures passées, et il fait noir comme dans un four. Je ne peux pas non plus rester ici ; plusieurs amies de Sallie couchent chez elle, et il n’y a plus de chambre à coucher disponible. Je vais me reposer en attendant Hannah ; quand elle viendra, je ferai comme elle voudra.
— Je vais demander à Laurie. Il ira, lui, dit Jo, enchantée de son idée.
— Miséricorde ! ne demandez et ne dites rien à personne ; donnez-moi seulement mes caoutchoucs et mettez de côté ces maudites bottines, je ne peux plus danser maintenant.
— On va souper ; j’aime mieux rester avec vous.
— Non, ma chère ; allez vite me chercher un peu de café glacé ; je sais qu’il y en a. Je ne peux décidément pas bouger. »
La chambre était solitaire.
Meg s’étendit sur le canapé en cachant soigneusement ses pieds sous sa robe, et Jo se mit à la recherche de la salle à manger en faisant des bévues tout le long de son chemin. Après être entrée dans un cabinet noir rempli de robes et avoir brusquement ouvert une chambre dans laquelle reposait la vieille madame Gardiner, elle finit par trouver la salle à manger et prit une tasse de café qu’elle renversa immédiatement sur elle, rendant ainsi le devant de sa robe aussi peu présentable que le dos.
« Dieu, que je suis maladroite ! s’écria-t-elle en frottant sa robe avec le gant de Meg et le salissant aussi.
— Puis-je vous aider ? » demanda une voix amie. Et Laurie vint à côté d’elle portant d’une main une tasse de café et de l’autre une glace.
« J’essayais de porter quelque chose à Meg qui est très fatiguée ; quelqu’un m’a poussée et me voilà dans un bel état ! répondit Jo en portant piteusement ses regards de sa robe tachée à son gant couleur de café.
— Je cherchais quelqu’un à qui donner ceci. Puis-je le porter à votre sœur ?
— Je le veux bien ; je vais vous montrer où elle est, mais je ne vous offre pas de rien porter, je ferais encore d’autres maladresses. »
Jo le conduisit vers sa sœur, et Laurie, comme s’il était habitué à servir les dames, mit une petite table devant elles, apporta deux autres tasses de café et deux autres glaces pour lui-même et pour Jo, et fut si complaisant que la difficile Meg elle-même dit à Jo que « c’était un gentil petit gentleman ». Ils s’amusèrent beaucoup et étaient tellement occupés à tirer des papillotes et à devenir des rébus, que, lorsque Hannah vint les chercher, Meg, oubliant son pied, se leva, mais elle ne put retenir un cri de douleur ; elle fut obligée de s’appuyer sur Jo pour ne pas tomber.
« Chut ! ne dites rien ! dit-elle à Laurie. Ce n’est rien. Je me suis un peu tordu le pied, voilà tout ! »
Et elle alla en boitant chercher son manteau.
Hannah gronda, Meg pleura, et Jo, voyant toutes ses idées repoussées, se décida à agir sans consulter personne. Elle se glissa hors de la chambre et, s’adressant au premier domestique qu’elle rencontra, lui demanda s’il pourrait lui trouver une voiture. Le domestique, qui était étranger, ne la comprit pas, et Jo, très embarrassée, en attendait un autre, quand Laurie, qui l’avait entendue, vint lui offrir de revenir dans la voiture de son grand-père.
« Il est si tôt ! Vous ne vouliez pas sans doute vous en aller déjà, lui répondit Jo, qui paraissait cependant soulagée d’un grand poids, mais hésitait encore à accepter.
— Je devais partir de très bonne heure, répliqua Laurie. Je vous en prie, permettez-moi de vous ramener chez vous ; c’est mon chemin, vous savez, et on vient de dire qu’il pleut. »
Tout étant ainsi arrangé, Jo accepta avec reconnaissance et remonta vite chercher sa sœur et sa bonne. Hannah, qui, comme les chats, détestait la pluie, ne fit aucune objection, et elles montèrent gaiement dans l’élégante calèche. Laurie sauta sur le siège sans vouloir rien entendre, afin de laisser à Meg la possibilité d’étendre son pied, et les jeunes filles purent, en toute liberté, parler de leur soirée :
« Je me suis fameusement amusée ! Et vous ? demanda Jo en s’étendant.
— Moi aussi, jusqu’à ce que je me sois fait mal. L’amie de Sallie, Annie Moffat, m’a fait toutes sortes d’amitiés et m’a invitée à aller passer quelques jours chez elle au printemps, en même temps que Sallie. La troupe d’opéra y sera et je m’amuserai parfaitement bien, si mère veut me laisser aller, répondit Meg, contente à la seule pensée du plaisir qu’elle se promettait.
— Je vous ai vue danser avec le jeune homme aux cheveux rouges qui m’avait fait fuir. Était-il aimable ?
— Oh ! excessivement ! J’ai dansé avec lui une délicieuse redowa. D’abord il n’a pas les cheveux rouges, il les a blonds.
— Il ressemblait à une sauterelle quand il a fait le nouveau pas. Laurie et moi ne pouvions pas nous empêcher de rire en le regardant. Nous avez-vous entendus ?
— Non, mais c’était très impoli. Qu’est-ce que vous faisiez cachés tout ce temps-là ? »
Jo raconta ses aventures, et lorsqu’elle eut fini, on était arrivé. Elle et Meg remercièrent beaucoup Laurie et, après bien des « bonsoir », se glissèrent sans bruit dans leur chambre, afin de ne réveiller personne ; mais, au moment où elles ouvraient leur porte, deux petits bonnets de nuit se soulevèrent, et deux voix endormies mais empressées crièrent :
« Racontez-nous la soirée ! Racontez-nous la soirée !
— C’est tout à fait comme si j’étais une grande dame, je suis rentrée chez moi en voiture, et j’ai une femme de chambre pour me déshabiller, dit Meg, pendant que Jo lui frictionnait le pied avec de l’arnica et lui arrangeait les cheveux.
— Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de belles dames qui se soient autant amusées que nous ! Nos cheveux brûlés, nos vieilles robes, nos gants dépareillés et nos bottines trop étroites qui nous donnent des entorses quand nous sommes assez bêtes pour les mettre, répondit Jo, n’ont rien ôté de ses agréments à la soirée. »
Et je pense qu’elle avait tout à fait raison.
q