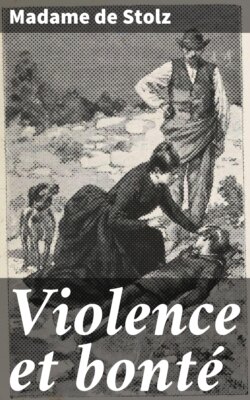Читать книгу Violence et bonté - Madame de Stolz - Страница 8
Ce n’était pas un conte breton.
ОглавлениеUn jour, Robert avait alors près de sept ans, Mme d’Embrun fut tout à coup appelée, pour une affaire grave, au chef-lieu de son département, et se vit dans la nécessité de laisser son enfant à Hauteroche. Mlle Trépiez, la terrible cousine, ne s’y trouvait point, et cette circonstance n’était pas regrettable, car, du plus loin que s’apercevaient la vieille cousine et le petit garçon, il s’établissait entre eux une sorte de courant de violence, qui menaçait de tout renverser sur son passage.
Fortement prévenus l’un contre l’autre, ils ne le cachaient point, et leur attitude ordinaire, dès qu’ils étaient en vis-à-vis, était celle du chien et du chat.
Mme d’Embrun ne voyait que trop ce manque d’entente et ce parti pris de se contrarier mutuellement. Aussi évitait-elle soigneusement de jamais faire à sa cousine une invitation en règle; mais cette précaution était inutile: on en fit la triste expérience. La cousine, à l’humeur acerbe, se trouvait bien à Hauteroche; elle faisait grand cas de l’air de la campagne, et particulièrement de celui que respirait Mme d’Embrun. Donc, elle s’invitait elle-même, et pour autant de semaines ou de mois que cela lui était agréable.
«Je me plais chez vous, disait-elle à Emmeline avec une naïveté digne d’un autre âge, et j’y reste très volontiers.»
C’était, pour le dire en un mot, une personne indiscrète.
La mère de Robert ne pouvait donc regretter l’absence de Mlle Trépiez, coïncidant avec la sienne. Elle avait un moyen bien simple de s’épargner toute inquiétude pendant son voyage de vingt-quatre heures: c’était de confier Robert au vieux garde et à sa femme.
Sa résolution étant arrêtée, elle en fit part à son petit garçon, qui trouva l’idée très amusante; et le chargea d’aller lui-même porter cette nouvelle à Philémon et à Baucis.
«Maman, pourquoi donc, quand vous voulez rire, appelez-vous Desnoyers Philémon et Corentine Baucis?
— Mon enfant, parce que La Fontaine a raconté, d’une façon charmante, dans de fort jolis vers. l’histoire imaginaire de deux vieux époux, portant ces noms, s’aimant beaucoup pendant leur longue existence, et obtenant de Jupiter, le maître des dieux selon la Fable, de mourir tous les deux ensemble, afin que l’un n’eût pas à pleurer la perte de l’autre.»
Robert, satisfait sur ce point, ne songea plus qu’au plaisir de passer tout un jour et toute une nuit dans la maison du vieux garde. Cette idée lui souriait; il était en belle humeur; et pendant trois jours sa mère, en lui donnant ses leçons, ne remarqua en lui aucun de ces gestes d’impatience qui souvent n’étaient que les précurseurs d’un accès de colère.
Non seulement le petit héritier du château d’Hauteroche avait en sa mère une excellente maîtresse, mais encore il était lui-même un excellent élève; doué de mémoire et surtout d’intelligence, aimant déjà la lecture, et par conséquent ouvrant la porte à ces connaissances qu’on acquiert sans s’en douter, en s’amusant à lire. Il savait plus que la plupart des enfants de son âge, et ses heureuses facultés se développaient, à la grande joie de sa mère. L’ombre au tableau, c’était toujours cette violence, qui, à la moindre contradiction, contractait les traits de l’enfant et le rendait brusque, irrité, farouche.
Quand vint l’heure de partir pour son court voyage, Mme d’Embrun prit son fils par la main et le conduisit elle-même au pavillon. Il sautait de plaisir, car tout ce qui est nouveau plaît à l’enfance, et le petit lit qu’on avait improvisé dans un coin de la grande chambre semblait à Robert un vrai sujet de récréation. Il embrassa sa mère de tout son cœur, mais sans tristesse, parce qu’elle allait revenir le lendemain.
«Ce ne sera pas long, disait la bonne Corentine, seulement douze heures!
— Maman disait vingt-quatre heures?
— Oui, mais là-dessus vous dormirez douze heures, et les heures de sommeil ne comptent pas.»
Cet argument fut d’un très bon effet sur l’esprit du petit dormeur, et, quand Mme d’Embrun fut partie, il rentra volontiers chez Corentine, et s’amusa de tout ce qui composait la vie de la bonne femme. Il la suivait des yeux dans tous les détails du ménage, et surtout dans les soins qu’elle donnait aux animaux, car elle avait une petite basse-cour à elle, et Robert fut, bien entendu, chargé, pour ce jour-là, de donner du grain aux poules et aux canards.
Puis il se livra, avec son ami Desnoyers, aux travaux du jardinage. On était à la fin de septembre; il y avait des soins particuliers à donner à la terre. Bien qu’on eût amplement le nécessaire provenant du potager du château, Desnoyers se faisait un plaisir de cultiver ce coin de terre, que lui avait offert Mme d’Embrun. C’était, avec le pavillon, comme une petite propriété lui appartenant, sa vie durant, et dont il pouvait jouir à sa guise. La vieille Corentine soutenait que les légumes de son jardin étaient plus savoureux que ceux du potager. Pourquoi? C’était tout simplement parce que son mari les avait semés et cultivés.
Comme on le pense, on ne négligea pas, dans cette belle journée d’automne, de s’occuper des rosiers. Les roses du Bengale étaient en grand honneur à Hauteroche. Mme d’Embrun, au temps de son bonheur, en avait fait entourer le château, et, depuis son veuvage, les roses demeuraient toujours, comme les descendantes de celles qu’Albert apportait si gracieusement à sa jeune femme. Ces fleurs fidèles semblaient lui dire: «Tu auras encore du bonheur par ton fils, et nous en serons les témoins».
Le vieux garde, dont le cœur reconnaissant cherchait à jeter un peu de consolation dans celui de la châtelaine, avait dit à Robert:
«Votre maman aime les rosiers du Bengale, et il y en a jusque sous ses fenêtres; mais j’en ai un magnifique, qu’elle ne connaît pas; je vais vous le donner, et vous le cultiverez tout seul, sous ma direction.
— Vrai? il sera à moi!
— A vous tout à fait. Nous le mettrons en pot, pour qu’il devienne encore plus beau: car le rosier du Bengale, mis en pot, change pour ainsi dire de nature. Toutes les roses qu’il produira seront, bien entendu, pour Madame; et puis, quand viendra l’hiver, vous mettrez le rosier dans le grand salon et il y fleurira.
— Tu crois? quel bonheur! Est-ce qu’un jour elle voudra bien mettre une rose à son corsage?
— Qui sait? Peut-être que si Nous ne vous mettiez plus jamais en colère, elle y consentirait pour vous récompenser. Mais un garçon qui donne de grands coups de poing sur la table, qui frappe la terre du pied, qui crie, qui dit des injures à sa bonne, qui fait le vilain, le méchant! comment voulez-vous que Madame accepte de lui une rose pour la mettre à son corsage? Ce n’est vraiment pas possible! Votre cher papa! il était bon, lui!»
Robert fut chargé de donner du grain aux poules.
Robert sentait la justesse de ce que disait le vieux garde, et il prenait bien sincèrement la résolution de se rendre digne d’offrir des roses à sa mère, des roses de son beau rosier, que lui-même allait cultiver.
Dès ce jour le petit garçon se mit en rapport avec l’arbuste favori, il coupa deux fleurs jaunies, il enleva, d’après l’avis de Desnoyers, ce qui pouvait nuire; il vida, au pied du rosier, deux fois son petit arrosoir, et dit de ces paroles amies qui prouvent qu’on veut vivre en bonne intelligence.
Le vieux garde emmena Robert faire une promenade au loin, afin d’occuper son temps et de le faire passer plus vite; puis on revint au pavillon, où Corentine avait préparé un souper du goût de Robert. Il mangea de bon appétit, but un doigt de vin pur, et babilla de son mieux, à la grande joie des braves gens, qui étaient à la fois honorés et charmés de la confiance que leur témoignait en cette circonstance la mère de leur jeune maître.
Après le souper on organisa une petite veillée autour de la lampe, et, pour amuser l’enfant, Corentine proposa une partie de loto.
«Non Corentine, pas de loto; j’y joue trop souvent, cela ne m’amuserait pas.
— Eh bien, voyons, qu’est-ce que nous allons donc faire?
— Ah! si vous vouliez! si vous vouliez!
— Parlez, je ne demande pas mieux que de vous contenter.
— Je voudrais.... Il y a presque trois jours que je ne me suis pas mis en colère!
— Presque trois jours? allons, ce n’est pas tout à fait la mesure, mais enfin....
— Ah! vous avez compris? Je voudrais un conte breton!
— Et moi, mon cher enfant, j’avais résolu de vous raconter une histoire bretonne; c’est bien plus beau qu’un conte, puisque c’est vrai.
— Comment? c’est arrivé ?
— C’est arrivé.
— Pour de bon?
— Pour de bon. Ah! c’est une histoire terrible à raconter, et terrible à entendre.
— Vraiment?
— Oui, je ne voulais vous la dire que quand vous auriez sept ans, car il faut avoir l’âge de raison pour apprendre de pareilles choses.
— Corentine, j’aurai sept ans dans huit jours.
— Je le sais bien, c’est pourquoi je vais me décider.»
La Bretonne prit son tricot, accompagnement obligé de tous ses. récits; le père Desnoyers, s’installa dans son grand fauteuil; le petit garçon, les yeux grands ouverts, se mit en face de la conteuse pour mieux la regarder et l’écouter.
Ce moment avait quelque chose de solennel. Le-temps, assez beau pendant le jour, s’était peu à peu refroidi; le vent du nord soufflait, faisant courir dans la campagne ces bruits de feuilles agitées et se touchant entre elles, ces voix aiguës ou plaintives qui attristent le voyageur solitaire. On se sentait bien autour de la lampe, parce que la tempête ne pouvait pas vous atteindre. C’était l’heure des légendes, l’heure des confidences sérieuses. Robert aurait peut-être senti une vague frayeur si le personnage le plus rassurant qui fût au monde n’eût fait partie du trio.
Corentine allait commencer, on le croyait du moins; mais elle baissa la tête, et resta muette un instant.
«Qu’est-ce que vous avez, Corentine?
— Rien; je réfléchis. Je me demande si je dois vous raconter cette épouvantable histoire. C’est peut-être bien grave pour votre âge!
— Plus que huit jours pour avoir sept ans! dit Robert en joignant les mains.
— Femme, tu peux parler, dit le vieux garde; il a l’âge de raison, va! Huit jours de plus, huit jours de moins, peu importe. Il comprendra très bien, et ça lui entrera si loin dans la mémoire que ça n’en sortira plus.
— Dieu le veuille!» répondit la vieille, en levant les yeux au ciel et jetant un soupir.
Robert voyait que les préliminaires devenaient de plus en plus effrayants; il ne savait que penser; mais l’intérêt que cette histoire inconnue lui inspirait redoublait, et jamais auditeur ne s’était montré plus recueilli.
«Encore une fois, mon cher enfant, dit la femme du vieux garde, ce n’est pas un conte breton, c’est une histoire. Ce que je vais vous raconter s’est passé, il y a dix ou douze ans, dans une grande ville de notre Bretagne, à Nantes, pas loin du village où je suis née.
— A Nantes?
— Oui, à Nantes; et jamais un Nantais ne perdra le souvenir de cet événement. Il y avait un homme.... C’était un brave homme, entendez bien; c’était ce qu’on appelle un honnête homme, un bon père de famille.
— Ah! tant mieux! Ses enfants devaient bien l’aimer!
— Oui, hélas! ils l’aimaient, les pauvres enfants!...
— Vous avez l’air de les plaindre?
— Les malheureux!... Ce brave, homme, ce bon père de famille avait toujours gagné sa vie sans nuire à personne; tout le monde l’estimait, ce pauvre couvreur.
— On avait bien raison, Corentine.
— On ne lui connaissait qu’un seul défaut.
— Un? c’est bien peu, Corentine!
— Oui; mais, voyez-vous, monsieur Robert, celui-là peut mener au crime.
— Vraiment? Quel était donc ce grand défaut?
— Je vais vous le dire. Quand il était petit, il n’avait pas fait tous les efforts possibles pour vaincre ce défaut qui, avec le temps, était devenu une grande passion.
— Mais, Corentine, vous ne me dites pas quel était ce défaut.»
La femme du vieux garde posa son tricot sur ses genoux; son visage devint encore plus grave; elle baissa la voix et dit, en regardant l’enfant dans les yeux:
«La colère».
Robert ne put soutenir le regard que la Bretonne attachait sur lui, il détourna les yeux et fut comme interdit.
Desnoyers remarqua l’expression étrange qui se peignait sur ses traits enfantins. On eût dit que l’intelligence de Robert, supérieure à son âge, lui faisait penser que s’il ne se corrigeait pas, il pourrait lui arriver plus tard un grand malheur.
En ce moment il n’osait plus demander qu’on poursuivît l’histoire de cet homme; ce fut Desnoyers qui dit:
«Allons, ma femme, continue.
— J’ai peine à continuer, répondit-elle; c’est tellement affreux! Enfin!... Donc, il ne s’était pas corrigé, dans son enfance, de ce grand, très grand défaut. Sa mère avait beau le punir et lui parler raison, il ne cessait de retomber dans ses-violences. Devenu un homme, il se maria, et il eut quatre petits enfants, quatre garçons. L’aîné avait peut-être sept ou huit ans. Il les aimait beaucoup, et il travaillait tant qu’il pouvait pour les nourrir, les habiller, les soigner aussi bien qu’il était nécessaire.
— Ce pauvre homme, il était bien bon!
— Sans doute, murmura Desnoyers, il avait bon cœur; mais ce n’est pas assez.
— Voilà donc que cet homme, comme je vous le disais, avait gardé son grand défaut. Il paraît que, dans sa. propre maison, il y avait beaucoup de choses qui le portaient à l’impatience; mais, ne s’étant pas corrigé étant petit, ces impatiences se changeaient en des accès de colère, et ces accès de colère atteignaient à la fureur.
«Dans ces occasions il ne savait plus ni ce qu’il disait, ni ce qu’il faisait; et tout le monde pensait qu’un jour ou l’autre on entendrait dire dans la ville qu’il y avait, ici ou là, une victime de sa colère.
— Mon Dieu! quel malheur! s’écria Robert. On devait avoir peur de lui?
— Il y avait bien de quoi! Un homme en colère est aussi, à craindre qu’une bête féroce, parce qu’il a une grande force et qu’il n’a plus sa raison.
— Oh! continuez l’histoire! Qu’est-ce qu’il va arriver?»
Robert était immobile, anxieux; il aurait voulu savoir, et il avait peur de savoir. Le vent mugissait plus que jamais à travers la campagne; la pluie fouettait les vitres, tout était morne et triste. Corentine continua:
«Un jour, cet homme avait eu avec sa femme une dispute assez vive, et, comme elle avait un mauvais caractère, elle s’entêtait à contredire son mari, à faire ce qu’il ne voulait pas, sans se soucier d’exciter de plus en plus sa malheureuse passion. Le père de famille tient tête; on en vient aux injures. Il se monte, il s’oublie, il ne sait plus où il est, ce qu’il est. Il sent dans tout son corps le frémissement de la fureur. Bientôt il ne trouve plus de paroles; il en arrive aux coups. La scène se passe à, un étage élevé, près d’une fenêtre ouverte.... Ah! je ne sais pas si je dois finir l’histoire!...
— Finissez-la! dit, sur le ton de la prière, l’enfant ému, troublé.
— Eh bien, puisqu’il faut tout dire, cet homme, qui avait bon cœur, cet homme, au plus haut degré de la colère, saisit un de ses enfants, et le jette par la fenêtre.
— Oh! mon Dieu! Mais pourquoi?
— Parce qu’il était en colère. Des cris épouvantables retentissent autour du criminel; ces cris augmentent sa fureur: il saisit un second enfant, et le lance dans l’espace,... puis un troisième , et tombe sur le plancher, comme sans vie, pendant que les trois victimes de sa colère expirent dans les souffrances, par la main de ce père qui les a tant aimés, tant embrassés, et en qui la passion a éteint tout à coup le sentiment paternel.»
Robert était muet, parce qu’il ne savait pas comment exprimer ce qu’il éprouvait; de grosses larmes coulaient sur ses joues pâlies. Desnoyers ne cherchait pas à adoucir l’impression que ressentait un enfant de sept ans; il l’aimait trop pour l’empêcher de pleurer dans un pareil moment. C’était une grande leçon qui venait de tomber des lèvres de la paysanne bretonne; il ne fallait pas l’amoindrir.
Après quelques instants de silence, Robert demanda timidement:
«Est-ce qu’elle est finie l’histoire?
— Non, mon cher enfant, pas encore; après un crime, ce n’est jamais fini; il faut une punition. Le père de famille eut la sienne; elle fut terrible!
— Qu’est-ce qu’on lui a fait?
— On l’a mis en prison; et puis on l’a fait venir devant les juges. Toute la ville était là. On connaissait ce malheureux; on s’était longtemps intéressé à lui; mais trois enfants!... Tout était contre lui: la pitié qu’excitaient les pauvres innocents, dont on croyait encore entendre les cris déchirants; les malédictions de la malheureuse mère, qui redemandait ses enfants; qui sentait sa raison s’égarer à force de douleur! Tout accusait l’assassin, et il n’avait rien à dire pour sa défense. Les lois sont justes! L’homme fut condamné.
— Condamné à quoi?
— Condamné à mort!»
Robert demeura silencieux, les yeux baissés, plein de compassion pour les victimes, et tout surpris qu’un homme bon, estimable, pût en arriver à être appelé assassin, à être condammé à mort.
«Je veux achever cette terrible histoire, reprit la Bretonne, et puis nous n’en parlerons plus; c’est par trop triste.
«Le pauvre couvreur, rendu à lui-même, eut horreur de sa propre personne. Il plaignit ses enfants, il plaignit leur mère; et, bien avant de se voir condamné par la justice, il s’était condamné lui-même, n’espérant plus qu’en Celui dont l’éternelle et infinie bonté pardonne à tout coupable repentant.
«Or il arriva que, le jour de l’exécution, tout le monde aurait voulu qu’on fît grâce au criminel; mais lui n’avait pas même tenté d’obtenir au moins une diminution de peine. Il se jugeait indigne de l’indulgence des hommes.
«Sa femme elle-même, touchée des admirables sentiments dont il faisait preuve, sa femme en vint à lui pardonner, à avouer qu’elle l’avait imprudemment excité à la colère; elle conjura les autorités de lui laisser la vie; tout fut inutile.
«Le pauvre couvreur fit une réparation publique de son crime; et, en marchant à la mort, il disait que la sentence était juste, qu’il avait mérité d’être retranché des vivants, que sa punition serait un exemple salutaire pour tous ceux qui, comme lui, avaient contracté l’habitude de se livrer à cette passion, qui devient, à un moment ou à un autre, une espèce de folie.
«Il mourut; et tout le monde pleura sur lui, car il avait fait pitié à tous par son humble et sincère repentir. Contrairement à l’usage en pareil cas, on rendit à son corps les honneurs funèbres dus aux corps des chrétiens; on le porta à l’église, au milieu d’une foule recueillie, qui se rappelait ce qu’il avait été toute sa vie et combien on l’avait justement estimé.
«Et voilà, mon cher enfant, ce qu’on peut devenir quand on ne combat point tous les jours ce terrible défaut, dont votre catéchisme vous dit: «La colère est un péché capital». Elle est finie mon histoire.»
Elle était finie; mais Robert écoutait encore. Il entendait comme une voix intérieure qui lui parlait tout bas et lui disait: «Prends garde, toi aussi, de faire des victimes!»
Le vent soufflait encore, la nuit était noire. Desnoyers montra à Robert de belles images qu’il avait dans un vieux livre, et il le fit causer de choses et d’autres, pour lui préparer un sommeil calme et réparateur. Bientôt les yeux du cher petit se fermèrent. La femme du vieux garde le déshabilla et il prit possession de son petit lit, après avoir dit bonsoir à ses bons vieux amis. Au moment où Corentine l’embrassa, en se penchant sur son lit, ses yeux à demi fermés se rouvrirent et ses lèvres murmuraient:
«Ah! quel malheur! Ces pauvres enfants!»