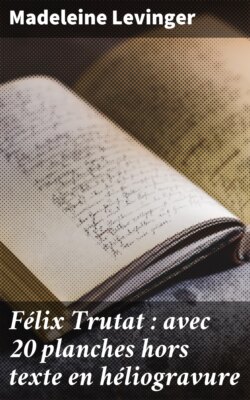Читать книгу Félix Trutat : avec 20 planches hors texte en héliogravure - Madeleine Levinger - Страница 3
PRÉFACE
ОглавлениеL’HISTOIRE, et notamment l’histoire de l’art, a souvent changé d’aspect depuis un siècle.
Aux environs de 1850, des hommes tels que Philippe de Chennevières et le comte de Laborde firent une consommation incroyable d’érudition. Les sociétés historiques et archéologiques exhumèrent une masse de vieux papiers dont la publication n’est pas encore épuisée et qui, maintenant encore, sont notre principale source d’information.
Toutefois l’air de leur temps était romantique et chaleureux. Dans la prestigieuse poussière des archives qu’ils remuaient, leur pensée modelait des fantômes; ils les aimaient bientôt d’un véritable amour. Et quand les textes cessaient de leur en fournir l’histoire, ils ne résistaient pas à la tentation de nous en suggérer le roman.
Tout de même, ils nous ont restitué la physionomie individuelle de maints artistes et nous leur devons une infinité de résurrections précieuses bien que peut-être un peu trop pailletées.
La fin du siècle ne manqua point de verser dans l’autre excès: Exposer le document tout nu, tout cru, le disséquer en silence devint de rigueur. Triant le sable de ses analyses, l’historien aurait cru se déshonorer par une conclusion dont la surface eût dépassé le bord de son éprouvette.
Sans doute, le temps dans lequel nous vivons a bénéficié des immenses classements effectués par les deux âges précédents. Mais il ose viser d’autres objectifs et semble assez disposé à mener de front deux enquêtes.
La première porte encore et toujours sur l’artiste étudié ; j’insiste sur ce mol. Il signifie que rien ne permet d’éluder cette longue période consacrée aux archives, aux bibliothèques, à l’entraînement à la chronologie, qui s’impose pendant des années à quiconque veut ne point hasarder trop de sottises. Puis, quand il se sent un peu sûr de son fait, l’historien peut et doit s’adonner davantage à une autre tâche, non moins délicate et qui consiste non plus à «étudier», mais à «comprendre».
En effet, on commence à concéder que l’intérêt essentiel d’une œuvre n’est pas uniquement dans les incidents qui présidèrent à sa naissance et à son exécution; il est aussi, il est surtout dans sa teneur en poésie, en cette poésie rebelle par définition, à se laisser analyser. L’œuvre contient de la poésie comme une pile peut contenir de l’électricité. Ce n’est parfois qu’en scrutant longuement l’œuvre, que nous trouvons le point de contact et que nous pouvons établir entre elle et nous quelque chose comme un circuit. Mais à proprement parler cet impondérable qu’on appelle ici la poésie, n’a pas de nom. S’il en avait un, s’il pouvait se désigner par un mot, par un bruit, par un objet tangible, l’œuvre n’aurait plus sa raison d’être. Elle offrirait tout au plus à l’historien un élément d’information sur certaines habitudes mentales du passé. Pour me faire bien comprendre, je prierai qu’on se représente, par exemple, une toile de Delacroix et, aussitôt après, une scène historique quelconque d’Horace Vernet.
Cette attention déférente à l’égard de l’œuvre poétique nous éloigne peu à peu d’une thèse si longtemps triomphante en vertu de laquelle l’artiste ou, pour le mieux nommer, l’inspiré, n’était que le fruit du «milieu» qui l’avait vu naître.
Or, à bien considérer les grands artistes, on demeure confondu par la modicité de leur dette à l’égard de leur «milieu». Tout, en ces matières, et même les épidémies de génies que l’humanité vit parfois, demeure un mystère.
Apollon souffle quand il veut, par les bouches qu’il veut. il faut se résigner à ne jamais connaître les raisons qui déterminent ses choix dans l’espace et dans le temps.
Aussi, le temps ou, si l’on veut, le «milieu» dans lequel on voit poindre un grand artiste ne l’éclaire aucunement. Que dis-je, c’est lui qui éclaire son temps.
Et c’est la seconde enquête contemporaine:
Ce n’est point à redire cette platitude, trop entendue, qu’un grand artiste éclaire son temps en ce sens qu’il l’illustre.
Au contraire, je voudrais exprimer que les réactions suscitées par l’apparition d’un grand artiste nous permettent d’apercevoir ce que fut alors le goût public.
Etablir l’histoire du goût public, voilà, n’est-ce pas, la tâche dévolue aux chercheurs de notre génération. Tâche qui, greffée sur le souci plus ancien et toujours fondamental d’étudier puis de comprendre les œuvres, élargit le débat, fait entrer véritablement l’histoire de l’art dans l’histoire;. cette ambition nous vaudra peut-être la chance de pénétrer d’un pas plus avant dans l’âme humaine collective du passé, et par conséquent, du présent.
Au surplus, cette lumière que projettent les grands artistes autour d’eux, éclaire non seulement la foule, mais s’accroche çà et là, sur des points menus et très brillants.
Certains hommes de second plan, qu’on n’eût peut-être pas eu l’idée de scruter auparavant, retiennent ainsi l’attention. Ils sont un peu ce qu’est le prophète par rapport au messie, ils préfigurent certaines grandes arrivées.
Tel est le cas de Félix Trutat, mort à Dijon en 1848, à peine âgé de vingt-quatre ans, auquel Mlle Mad. Levinger a consacré la minutieuse monographie qu’on va lire.
La vie de Félix Trutat, que ses contemporains ont ignoré presque totalement, offre çà et là, de curieuses analogies avec celle de Pagnest et de Géricault.
Comme eux il s’auréole d’un charme mélancolique et puissant par le fait qu’il disparut bien trop jeune. Comme eux, il présente un tragique contraste entre la fragilité de son destin et l’étonnante vigueur de sa peinture. Elle est d’une exécution matérielle riche et profonde; elle est pure de toute fièvre littéraire, mais chaude comme une chair vivante.
Félix Trutat préfigure Courbet; mais il semble qu’en cette année 1824 où mourait le grand Géricault, l’âme de celui-ci se fut incarnée, à peine affaiblie, dans ce petit enfant qui naissait à Dijon et dont le séjour ici-bas devait être plus bref encore.
Mlle Mad. Levinger qui fut, pendant longtemps, mon élève à l’école du Louvre, a pieusement décrit cette vie et les travaux dont, si courte, elle fut cependant si remplie.
Je crois que pas un amateur d’art — et je souhaiterais qu’on n’oubliât point ici l’étymologie de ce mot «amateur»—ne peut demeurer insensible à cette lecture.
ROBERT REY.