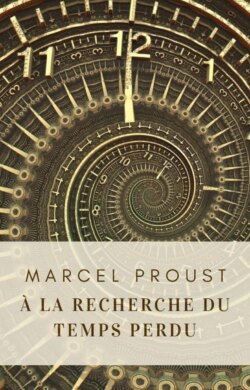Читать книгу À la recherche du temps perdu - Marcel Proust, Marcel Proust - Страница 7
Troisième partie – Noms de pays : le nom
ОглавлениеParmi les chambres dont j’évoquais le plus souvent l’image dans mes nuits d’insomnie, aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray, saupoudrées d’une atmosphère grenue, pollinisée, comestible et dévote, que celle du Grand-Hôtel de la Plage, à Balbec, dont les murs passés au ripolin contenaient, comme les parois polies d’une piscine où l’eau bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l’aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés fait courir le long des murs, dans celle que je me trouvai habiter, des bibliothèques basses, à vitrines en glace, dans lesquelles, selon la place qu’elles occupaient, et par un effet qu’il n’avait pas prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de claires marines, qu’interrompaient seuls les pleins de l’acajou. Si bien que toute la pièce avait l’air d’un de ces dortoirs modèles qu’on présente dans les expositions « modern style » du mobilier, où ils sont ornés d’œuvres d’art qu’on a supposées capables de réjouir les yeux de celui qui couchera là, et auxquelles on a donné des sujets en rapport avec le genre de site où l’habitation doit se trouver.
Mais rien ne ressemblait moins non plus à ce Balbec réel que celui dont j’avais souvent rêvé, les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise en me menant aux Champs-Élysées me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête, et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux. Je n’avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer, moins comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature ; ou plutôt il n’y avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n’étaient pas artificiellement combinés pour mon plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables – les beautés des paysages ou du grand art. Je n’étais curieux, je n’étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que moi-même, ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d’un grand génie, ou de la force ou de la grâce de la nature telle qu’elle se manifeste livrée à elle-même, sans l’intervention des hommes. De même que le beau son de sa voix, isolément reproduit par le phonographe, ne nous consolerait pas d’avoir perdu notre mère, de même une tempête mécaniquement imitée m’aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses de l’Exposition. Je voulais aussi, pour que la tempête fût absolument vraie, que le rivage lui-même fût un rivage naturel, non une digue récemment créée par une municipalité. D’ailleurs la nature, par tous les sentiments qu’elle éveillait en moi, me semblait ce qu’il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. Moins elle portait leur empreinte et plus elle offrait d’espace à l’expansion de mon cœur. Or j’avais retenu le nom de Balbec que nous avait cité Legrandin, comme d’une plage toute proche de « ces côtes funèbres, fameuses par tant de naufrages qu’enveloppent six mois de l’année le linceul des brumes et l’écume des vagues ».
« On y sent encore sous ses pas, disait-il, bien plus qu’au Finistère lui-même (et quand bien même des hôtels s’y superposeraient maintenant sans pouvoir y modifier la plus antique ossature de la terre), on y sent la véritable fin de la terre française, européenne, de la Terre antique. Et c’est le dernier campement de pêcheurs, pareils à tous les pêcheurs qui ont vécu depuis le commencement du monde, en face du royaume éternel des brouillards de la mer et des ombres. » Un jour qu’à Combray j’avais parlé de cette plage de Balbec devant M. Swann afin d’apprendre de lui si c’était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes, il m’avait répondu : « Je crois bien que je connais Balbec ! L’église de Balbec, du XIIe et XIIIe siècle, encore à moitié romane, est peut-être le plus curieux échantillon du gothique normand, et si singulière ! on dirait de l’art persan. » Et ces lieux qui jusque-là ne m’avaient semblé que de la nature immémoriale, restée contemporaine des grands phénomènes géologiques – et tout aussi en dehors de l’histoire humaine que l’Océan ou la grande Ourse, avec ces sauvages pêcheurs pour qui, pas plus que pour les baleines, il n’y eut de moyen âge – ç’avait été un grand charme pour moi de les voir tout d’un coup entrés dans la série des siècles, ayant connu l’époque romane, et de savoir que le trèfle gothique était venu nervurer aussi ces rochers sauvages à l’heure voulue, comme ces plantes frêles mais vivaces qui, quand c’est le printemps, étoilent çà et là la neige des pôles. Et si le gothique apportait à ces lieux et à ces hommes une détermination qui leur manquait, eux aussi lui en conféraient une en retour. J’essayais de me représenter comment ces pêcheurs avaient vécu, le timide et insoupçonné essai de rapports sociaux qu’ils avaient tenté là, pendant le moyen âge, ramassés sur un point des côtes d’Enfer, aux pieds des falaises de la mort ; et le gothique me semblait plus vivant maintenant que, séparé des villes où je l’avais toujours imaginé jusque-là, je pouvais voir comment, dans un cas particulier, sur des rochers sauvages, il avait germé et fleuri en un fin clocher. On me mena voir des reproductions des plus célèbres statues de Balbec – les apôtres moutonnants et camus, la Vierge du porche, et de joie ma respiration s’arrêtait dans ma poitrine quand je pensais que je pourrais les voir se modeler en relief sur le brouillard éternel et salé. Alors, par les soirs orageux et doux de février – le vent, soufflant dans mon cœur, qu’il ne faisait pas trembler moins fort que la cheminée de ma chambre – le projet d’un voyage à Balbec mêlait en moi le désir de l’architecture gothique avec celui d’une tempête sur la mer.
J’aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d’une heure vingt-deux dont je ne pouvais jamais sans que mon cœur palpitât lire, dans les réclames des compagnies de chemin de fer, dans les annonces de voyages circulaires, l’heure de départ : elle me semblait inciser à un point précis de l’après-midi une savoureuse entaille, une marque mystérieuse à partir de laquelle les heures déviées conduisaient bien encore au soir, au matin du lendemain, mais qu’on verrait, au lieu de Paris, dans l’une de ces villes par où le train passe et entre lesquelles il nous permettait de choisir ; car il s’arrêtait à Bayeux, à Coutances, à Vitré, à Questambert, à Pontorson, à Balbec, à Lannion, à Lamballe, à Benodet, à Pont-Aven, à Quimperlé, et s’avançait magnifiquement surchargé de noms qu’il m’offrait et entre lesquels je ne savais lequel j’aurais préféré, par impossibilité d’en sacrifier aucun. Mais sans même l’attendre, j’aurais pu en m’habillant à la hâte partir le soir même, si mes parents me l’avaient permis, et arriver à Balbec quand le petit jour se lèverait sur la mer furieuse, contre les écumes envolées de laquelle j’irais me réfugier dans l’église de style persan. Mais à l’approche des vacances de Pâques, quand mes parents m’eurent promis de me les faire passer une fois dans le nord de l’Italie, voilà qu’à ces rêves de tempête dont j’avais été rempli tout entier, ne souhaitant voir que des vagues accourant de partout, toujours plus haut, sur la côte la plus sauvage, près d’églises escarpées et rugueuses comme des falaises et dans les tours desquelles crieraient les oiseaux de mer, voilà que tout à coup les effaçant, leur ôtant tout charme, les excluant parce qu’il leur était opposé et n’aurait pu que les affaiblir, se substituait en moi le rêve contraire du printemps le plus diapré, non pas le printemps de Combray qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre, mais celui qui couvrait déjà de lys et d’anémones les champs de Fiesole et éblouissait Florence de fonds d’or pareils à ceux de l’Angelico. Dès lors, seuls les rayons, les parfums, les couleurs me semblaient avoir du prix ; car l’alternance des images avait amené en moi un changement de front du désir, et, aussi brusque que ceux qu’il y a parfois en musique, un complet changement de ton dans ma sensibilité. Puis il arriva qu’une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation sans qu’il y eût besoin d’attendre le retour d’une saison. Car souvent dans l’une on trouve égaré un jour d’une autre, qui nous y fait vivre, en évoque aussitôt, en fait désirer les plaisirs particuliers et interrompt les rêves que nous étions en train de faire, en plaçant, plus tôt ou plus tard qu’à son tour, ce feuillet détaché d’un autre chapitre, dans le calendrier interpolé du Bonheur. Mais bientôt, comme ces phénomènes naturels dont notre confort ou notre santé ne peuvent tirer qu’un bénéfice accidentel et assez mince jusqu’au jour où la science s’empare d’eux, et, les produisant à volonté, remet en nos mains la possibilité de leur apparition, soustraite à la tutelle et dispensée de l’agrément du hasard, de même la production de ces rêves d’Atlantique et d’Italie cessa d’être soumise uniquement aux changements des saisons et du temps. Je n’eus besoin pour les faire renaître que de prononcer ces noms : Balbec, Venise, Florence, dans l’intérieur desquels avait fini par s’accumuler le désir que m’avaient inspiré les lieux qu’ils désignaient. Même au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand ; même par un jour de tempête le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs.
Mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l’image que j’avais de ces villes, ce ne fut qu’en la transformant, qu’en soumettant sa réapparition en moi à leurs lois propres ; ils eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité, et, en accroissant les joies arbitraires de mon imagination, d’aggraver la déception future de mes voyages. Ils exaltèrent l’idée que je me faisais de certains lieux de la terre, en les faisant plus particuliers, par conséquent plus réels. Je ne me représentais pas alors les villes, les paysages, les monuments, comme des tableaux plus ou moins agréables, découpés çà et là dans une même matière, mais chacun d’eux comme un inconnu, essentiellement différent des autres, dont mon âme avait soif et qu’elle aurait profit à connaître. Combien ils prirent quelque chose de plus individuel encore, d’être désignés par des noms, des noms qui n’étaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes. Les mots nous présentent des choses une petite image claire et usuelle comme celles que l’on suspend aux murs des écoles pour donner aux enfants l’exemple de ce qu’est un établi, un oiseau, une fourmilière, choses conçues comme pareilles à toutes celles de même sorte. Mais les noms présentent des personnes – et des villes qu’ils nous habituent à croire individuelles, uniques comme des personnes – une image confuse qui tire d’eux, de leur sonorité éclatante ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément comme une de ces affiches, entièrement bleues ou entièrement rouges, dans lesquelles, à cause des limites du procédé employé ou par un caprice du décorateur, sont bleus ou rouges, non seulement le ciel et la mer, mais les barques, l’église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que j’avais lu la Chartreuse, m’apparaissant compact, lisse, mauve et doux ; si on me parlait d’une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j’habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n’avait de rapport avec les demeures d’aucune ville d’Italie, puisque je l’imaginais seulement à l’aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet des violettes. Et quand je pensais à Florence, c’était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu’elle s’appelait la cité des lys et sa cathédrale, Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant à Balbec, c’était un de ces noms où comme sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d’où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d’un état ancien de lieux, d’une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l’aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l’église et auquel je prêtais l’aspect disputeur, solennel et médiéval d’un personnage de fabliau.
Si ma santé s’affermissait et que mes parents me permissent, sinon d’aller séjourner à Balbec, du moins de prendre une fois, pour faire connaissance avec l’architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne, ce train d’une heure vingt-deux dans lequel j’étais monté tant de fois en imagination, j’aurais voulu m’arrêter de préférence dans les villes les plus belles ; mais j’avais beau les comparer, comment choisir plus qu’entre des êtres individuels, qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe ; Vitré dont l’accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien ; le doux Lamballe qui, dans son blanc, va du jaune coquille d’œuf au gris perle ; Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre ; Lannion avec le bruit, dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche ; Questambert, Pontorson, risibles et naïfs, plumes blanches et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux fluviatiles et poétiques ; Benodet, nom à peine amarré que semble vouloir entraîner la rivière au milieu de ses algues ; Pont-Aven, envolée blanche et rose de l’aile d’une coiffe légère qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal ; Quimperlé, lui, mieux attaché et, depuis le moyen âge, entre les ruisseaux dont il gazouille et s’emperle en une grisaille pareille à celle que dessinent, à travers les toiles d’araignées d’une verrière, les rayons de soleil changés en pointes émoussées d’argent bruni.
Ces images étaient fausses pour une autre raison encore ; c’est qu’elles étaient forcément très simplifiées ; sans doute ce à quoi aspirait mon imagination et que mes sens ne percevaient qu’incomplètement et sans plaisir dans le présent, je l’avais enfermé dans le refuge des noms ; sans doute, parce que j’y avais accumulé du rêve, ils aimantaient maintenant mes désirs ; mais les noms ne sont pas très vastes ; c’est tout au plus si je pouvais y faire entrer deux ou trois des « curiosités » principales de la ville et elles s’y juxtaposaient sans intermédiaires ; dans le nom de Balbec, comme dans le verre grossissant de ces porte-plume qu’on achète aux bains de mer, j’apercevais des vagues soulevées autour d’une église de style persan. Peut-être même la simplification de ces images fut-elle une des causes de l’empire qu’elles prirent sur moi. Quand mon père eut décidé, une année, que nous irions passer les vacances de Pâques à Florence et à Venise, n’ayant pas la place de faire entrer dans le nom de Florence les éléments qui composent d’habitude les villes, je fus contraint à faire sortir une cité surnaturelle de la fécondation, par certains parfums printaniers, de ce que je croyais être, en son essence, le génie de Giotto. Tout au plus – et parce qu’on ne peut pas faire tenir dans un nom beaucoup plus de durée que d’espace – comme certains tableaux de Giotto eux-mêmes qui montrent à deux moments différents de l’action un même personnage, ici couché dans son lit, là s’apprêtant à monter à cheval, le nom de Florence était-il divisé en deux compartiments. Dans l’un, sous un dais architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif ; dans l’autre (car ne pensant pas aux noms comme à un idéal inaccessible, mais comme à une ambiance réelle dans laquelle j’irais me plonger, la vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j’y enfermais donnait aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples, cet attrait qu’ils ont dans les œuvres des primitifs), je traversais rapidement – pour trouver plus vite le déjeuner qui m’attendait avec des fruits et du vin de Chianti – le Ponte-Vecchio encombré de jonquilles, de narcisses et d’anémones. Voilà (bien que je fusse à Paris) ce que je voyais et non ce qui était autour de moi. Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable, que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors j’avais fait moi-même plus attention à ce qu’il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n’était nullement une ville, mais quelque chose d’aussi différent de tout ce que je connaissais, d’aussi délicieux, que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d’après-midi d’hiver, cette merveille inconnue : une matinée de printemps. Ces images irréelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, différencièrent cette époque de ma vie de celles qui l’avaient précédée (et qui auraient pu se confondre avec elle aux yeux d’un observateur qui ne voit les choses que du dehors, c’est-à-dire qui ne voit rien), comme dans un opéra un motif mélodique introduit une nouveauté qu’on ne pourrait pas soupçonner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors du théâtre à compter seulement les quarts d’heure qui s’écoulent. Et encore, même à ce point de vue de simple quantité, dans notre vie les jours ne sont pas égaux. Pour parcourir les jours, les natures un peu nerveuses, comme était la mienne, disposent, comme les voitures automobiles, de « vitesses » différentes. Il y a des jours montueux et malaisés qu’on met un temps infini à gravir et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. Pendant ce mois – où je ressassai comme une mélodie, sans pouvoir m’en rassasier, ces images de Florence, de Venise et de Pise, desquelles le désir qu’elles excitaient en moi gardait quelque chose d’aussi profondément individuel que si ç’avait été un amour, un amour pour une personne – je ne cessai pas de croire qu’elles correspondaient à une réalité indépendante de moi, et elles me firent connaître une aussi belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d’entrer dans le paradis. Aussi sans que je me souciasse de la contradiction qu’il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux – et d’autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu’ils connaissaient – c’est ce qui me rappelait la réalité de ces images, qui enflammait le plus mon désir, parce que c’était comme une promesse qu’il serait contenté. Et, bien que mon exaltation eût pour motif un désir de jouissances artistiques, les guides l’entretenaient encore plus que les livres d’esthétique et, plus que les guides, l’indicateur des chemins de fer. Ce qui m’émouvait, c’était de penser que cette Florence que je voyais proche mais inaccessible dans mon imagination, si le trajet qui la séparait de moi, en moi-même, n’était pas viable, je pourrais l’atteindre par un biais, par un détour, en prenant la « voie de terre ». Certes, quand je me répétais, donnant ainsi tant de valeur à ce que j’allais voir, que Venise était « l’école de Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musée de l’architecture domestique au moyen âge », je me sentais heureux. Je l’étais pourtant davantage quand, sorti pour une course, marchant vite à cause du temps qui, après quelques jours de printemps précoce était redevenu un temps d’hiver (comme celui que nous trouvions d’habitude à Combray, la Semaine Sainte) – voyant sur les boulevards les marronniers qui, plongés dans un air glacial et liquide comme de l’eau, n’en commençaient pas moins, invités exacts, déjà en tenue, et qui ne se sont pas laissé décourager, à arrondir et à ciseler, en leurs blocs congelés, l’irrésistible verdure dont la puissance abortive du froid contrariait mais ne parvenait pas à réfréner la progressive poussée – je pensais que déjà le Ponte-Vecchio était jonché à foison de jacinthes et d’anémones et que le soleil du printemps teignait déjà les flots du Grand Canal d’un si sombre azur et de si nobles émeraudes qu’en venant se briser aux pieds des peintures du Titien, ils pouvaient rivaliser de riche coloris avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon père, tout en consultant le baromètre et en déplorant le froid, commença à chercher quels seraient les meilleurs trains, et quand je compris qu’en pénétrant après le déjeuner dans le laboratoire charbonneux, dans la chambre magique qui se chargeait d’opérer la transmutation tout autour d’elle, on pouvait s’éveiller le lendemain dans la cité de marbre et d’or « rehaussée de jaspe et pavée d’émeraudes ». Ainsi elle et la Cité des lys n’étaient pas seulement des tableaux fictifs qu’on mettait à volonté devant son imagination, mais existaient à une certaine distance de Paris qu’il fallait absolument franchir si l’on voulait les voir, à une certaine place déterminée de la terre, et à aucune autre, en un mot étaient bien réelles. Elles le devinrent encore plus pour moi, quand mon père en disant : « En somme, vous pourriez rester à Venise du 20 avril au 29 et arriver à Florence dès le matin de Pâques », les fit sortir toutes deux non plus seulement de l’Espace abstrait, mais de ce Temps imaginaire où nous situons non pas un seul voyage à la fois, mais d’autres, simultanés et sans trop d’émotion puisqu’ils ne sont que possibles – ce Temps qui se refabrique si bien qu’on peut encore le passer dans une ville après qu’on l’a passé dans une autre – et leur consacra de ces jours particuliers qui sont le certificat d’authenticité des objets auxquels on les emploie, car ces jours uniques, ils se consument par l’usage, ils ne reviennent pas, on ne peut plus les vivre ici quand on les a vécus là ; je sentis que c’était vers la semaine qui commençait le lundi où la blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que j’avais couvert d’encre, que se dirigeaient pour s’y absorber au sortir du temps idéal où elles n’existaient pas encore, les deux cités Reines dont j’allais avoir, par la plus émouvante des géométries, à inscrire les dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je n’étais encore qu’en chemin vers le dernier degré de l’allégresse ; je l’atteignis enfin (ayant seulement alors la révélation que sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce n’était pas, comme j’avais, malgré tant d’avertissements, continué à l’imaginer, les hommes « majestueux et terribles comme la mer, portant leur armure aux reflets de bronze sous les plis de leur manteau sanglant » qui se promèneraient dans Venise la semaine prochaine, la veille de Pâques, mais que ce pourrait être moi, le personnage minuscule que, dans une grande photographie de Saint-Marc qu’on m’avait prêtée, l’illustrateur avait représenté, en chapeau melon, devant les proches), quand j’entendis mon père me dire : « Il doit faire encore froid sur le Grand Canal, tu ferais bien de mettre à tout hasard dans ta malle ton pardessus d’hiver et ton gros veston. » À ces mots je m’élevai à une sorte d’extase ; ce que j’avais cru jusque-là impossible, je me sentis vraiment pénétrer entre ces « rochers d’améthyste pareils à un récif de la mer des Indes » ; par une gymnastique suprême et au-dessus de mes forces, me dévêtant comme d’une carapace sans objet de l’air de ma chambre, qui m’entourait, je le remplaçai par des parties égales d’air vénitien, cette atmosphère marine, indicible et particulière comme celle des rêves que mon imagination avait enfermée dans le nom de Venise, je sentis s’opérer en moi une miraculeuse désincarnation ; elle se doubla aussitôt de la vague envie de vomir qu’on éprouve quand on vient de prendre un gros mal de gorge, et on dut me mettre au lit avec une fièvre si tenace, que le docteur déclara qu’il fallait renoncer non seulement à me laisser partir maintenant à Florence et à Venise mais, même quand je serais entièrement rétabli, m’éviter, d’ici au moins un an, tout projet de voyage et toute cause d’agitation.
Et hélas, il défendit aussi d’une façon absolue qu’on me laissât aller au théâtre entendre la Berma ; l’artiste sublime, à laquelle Bergotte trouvait du génie, m’aurait, en me faisant connaître quelque chose qui était peut-être aussi important et aussi beau, consolé de n’avoir pas été à Florence et à Venise, de n’aller pas à Balbec. On devait se contenter de m’envoyer chaque jour aux Champs-Élysées, sous la surveillance d’une personne qui m’empêcherait de me fatiguer et qui fut Françoise, entrée à notre service après la mort de ma tante Léonie. Aller aux Champs-Élysées me fut insupportable. Si seulement Bergotte les eût décrits dans un de ses livres, sans doute j’aurais désiré de les connaître, comme toutes les choses dont on avait commencé par mettre le « double » dans mon imagination. Elle les réchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalité, et je voulais les retrouver dans la réalité ; mais dans ce jardin public rien ne se rattachait à mes rêves.
Un jour, comme je m’ennuyais à notre place familière, à côté des chevaux de bois, Françoise m’avait emmené en excursion – au delà de la frontière que gardent à intervalles égaux les petits bastions des marchandes de sucre d’orge – dans ces régions voisines mais étrangères où les visages sont inconnus, où passe la voiture aux chèvres ; puis elle était revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossée à un massif de lauriers ; en l’attendant je foulais la grande pelouse chétive et rase, jaunie par le soleil, au bout de laquelle le bassin est dominé par une statue quand, de l’allée, s’adressant à une fillette à cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son manteau et de serrer sa raquette, lui cria, d’une voix brève : « Adieu, Gilberte, je rentre, n’oublie pas que nous venons ce soir chez toi après dîner. » Ce nom de Gilberte passa près de moi, évoquant d’autant plus l’existence de celle qu’il désignait qu’il ne la nommait pas seulement comme un absent dont on parle, mais l’interpellait ; il passa ainsi près de moi, en action pour ainsi dire, avec une puissance qu’accroissait la courbe de son jet et l’approche de son but ; – transportant à son bord, je le sentais, la connaissance, les notions qu’avait de celle à qui il était adressé, non pas moi, mais l’amie qui l’appelait, tout ce que, tandis qu’elle le prononçait, elle revoyait ou, du moins, possédait en sa mémoire, de leur intimité quotidienne, des visites qu’elles se faisaient l’une chez l’autre, de tout cet inconnu, encore plus inaccessible et plus douloureux pour moi d’être au contraire si familier et si maniable pour cette fille heureuse qui m’en frôlait, sans que j’y puisse pénétrer, et le jetait en plein air dans un cri ; – laissant déjà flotter dans l’air l’émanation délicieuse qu’il avait fait se dégager, en les touchant avec précision, de quelques points invisibles de la vie de Mlle Swann, du soir qui allait venir, tel qu’il serait, après dîner, chez elle ; – formant, passager céleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage d’une couleur précieuse, pareil à celui qui, bombé au-dessus d’un beau jardin du Poussin, reflète minutieusement comme un nuage d’opéra, plein de chevaux et de chars, quelque apparition de la vie des dieux ; – jetant enfin, sur cette herbe pelée, à l’endroit où elle était un morceau à la fois de pelouse flétrie et un moment de l’après-midi de la blonde joueuse de volant (qui ne s’arrêta de le lancer et de le rattraper que quand une institutrice à plumet bleu l’eût appelée), une petite bande merveilleuse et couleur d’héliotrope, impalpable comme un reflet et superposée comme un tapis, sur lequel je ne pus me lasser de promener mes pas attardés, nostalgiques et profanateurs, tandis que Françoise me criait : « Allons, aboutonnez voir votre paletot et filons », et que je remarquais pour la première fois avec irritation qu’elle avait un langage vulgaire, et hélas, pas de plumet bleu à son chapeau.
Retournerait-elle seulement aux Champs-Élysées ? Le lendemain elle n’y était pas ; mais je l’y vis les jours suivants ; je tournais tout le temps autour de l’endroit où elle jouait avec ses amies, si bien qu’une fois où elles ne se trouvèrent pas en nombre pour leur partie de barres elle me fit demander si je voulais compléter leur camp, et je jouai désormais avec elle chaque fois qu’elle était là. Mais ce n’était pas tous les jours ; il y en avait où elle était empêchée de venir par ses cours, le catéchisme, un goûter, toute cette vie séparée de la mienne que par deux fois, condensée dans le nom de Gilberte, j’avais senti passer si douloureusement près de moi, dans le raidillon de Combray et sur la pelouse des Champs-Élysées. Ces jours-là, elle annonçait d’avance qu’on ne la verrait pas ; si c’était à cause de ses études, elle disait : « C’est rasant, je ne pourrai pas venir demain ; vous allez tous vous amuser sans moi », d’un air chagrin qui me consolait un peu ; mais en revanche quand elle était invitée à une matinée, et que, ne le sachant pas je lui demandais si elle viendrait jouer, elle me répondait : « J’espère bien que non ! J’espère bien que maman me laissera aller chez mon amie. » Du moins ces jours-là, je savais que je ne la verrais pas, tandis que d’autres fois, c’était à l’improviste que sa mère l’emmenait faire des courses avec elle, et le lendemain elle disait : « Ah ! oui, je suis sortie avec maman », comme une chose naturelle, et qui n’eût pas été pour quelqu’un le plus grand malheur possible. Il y avait aussi les jours de mauvais temps où son institutrice, qui pour elle-même craignait la pluie, ne voulait pas l’emmener aux Champs-Élysées.
Aussi si le ciel était douteux, dès le matin je ne cessais de l’interroger et je tenais compte de tous les présages. Si je voyais la dame d’en face qui, près de la fenêtre, mettait son chapeau, je me disais : « Cette dame va sortir ; donc il fait un temps où l’on peut sortir : pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme cette dame ? » Mais le temps s’assombrissait, ma mère disait qu’il pouvait se lever encore, qu’il suffirait pour cela d’un rayon de soleil, mais que plus probablement il pleuvrait ; et s’il pleuvait, à quoi bon aller aux Champs-Élysées ? Aussi depuis le déjeuner mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et nuageux. Il restait sombre. Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d’un coup, sur sa pierre maussade je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une couleur moins terne, la pulsation d’un rayon hésitant qui voudrait libérer sa lumière. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et mille reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s’y poser. Un souffle de vent les dispersait, la pierre s’était de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisés, ils revenaient, elle recommençait imperceptiblement à blanchir et par un de ces crescendos continus comme ceux qui, en musique, à la fin d’une Ouverture, mènent une seule note jusqu’au fortissimo suprême en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l’ombre découpée de l’appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir comme une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblait trahir une conscience appliquée, une satisfaction d’artiste, et avec un tel relief, un tel velours dans le repos de ses masses sombres et heureuses qu’en vérité ces reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu’ils étaient des gages de calme et de bonheur.
Lierre instantané, flore pariétaire et fugitive ! la plus incolore, la plus triste, au gré de beaucoup, de celles qui peuvent ramper sur le mur ou décorer la croisée ; pour moi, de toutes la plus chère depuis le jour où elle était apparue sur notre balcon, comme l’ombre même de la présence de Gilberte qui était peut-être déjà aux Champs-Élysées, et dès que j’y arriverais me dirait : « Commençons tout de suite à jouer aux barres, vous êtes dans mon camp » ; fragile, emportée par un souffle, mais aussi en rapport non pas avec la saison, mais avec l’heure ; promesse du bonheur immédiat que la journée refuse ou accomplira, et par là du bonheur immédiat par excellence, le bonheur de l’amour ; plus douce, plus chaude sur la pierre que n’est la mousse même ; vivace, à qui il suffit d’un rayon pour naître et faire éclore de la joie, même au cœur de l’hiver.
Et jusque dans ces jours où toute autre végétation a disparu, où le beau cuir vert qui enveloppe le tronc des vieux arbres est caché sous la neige, quand celle-ci cessait de tomber, mais que le temps restait trop couvert pour espérer que Gilberte sortît, alors tout d’un coup, faisant dire à ma mère : « Tiens voilà justement qu’il fait beau, vous pourriez peut-être essayer tout de même d’aller aux Champs-Élysées », sur le manteau de neige qui couvrait le balcon, le soleil apparu entrelaçait des fils d’or et brodait des reflets noirs. Ce jour-là nous ne trouvions personne, ou une seule fillette prête à partir qui m’assurait que Gilberte ne viendrait pas. Les chaises désertées par l’assemblée imposante mais frileuse des institutrices étaient vides. Seule, près de la pelouse, était assise une dame d’un certain âge qui venait par tous les temps, toujours hanarchée d’une toilette identique, magnifique et sombre, et pour faire la connaissance de laquelle j’aurais à cette époque sacrifié, si l’échange m’avait été permis, tous les plus grands avantages futurs de ma vie. Car Gilberte allait tous les jours la saluer ; elle demandait à Gilberte des nouvelles de « son amour de mère » ; et il me semblait que si je l’avais connue, j’avais été pour Gilberte quelqu’un de tout autre, quelqu’un qui connaissait les relations de ses parents. Pendant que ses petits-enfants jouaient plus loin, elle lisait toujours les Débats qu’elle appelait « mes vieux Débats » et, par genre aristocratique, disait en parlant du sergent de ville ou de la loueuse de chaises : « Mon vieil ami le sergent de ville », « la loueuse de chaises et moi qui sommes de vieux amis ».
Françoise avait trop froid pour rester immobile, nous allâmes jusqu’au pont de la Concorde voir la Seine prise, dont chacun et même les enfants s’approchaient sans peur comme d’une immense baleine échouée, sans défense, et qu’on allait dépecer. Nous revenions aux Champs-Élysées ; je languissais de douleur entre les chevaux de bois immobiles et la pelouse blanche prise dans le réseau noir des allées dont on avait enlevé la neige, et sur laquelle la statue avait à la main un jet de glace ajouté qui semblait l’explication de son geste. La vieille dame elle-même, ayant plié ses Débats, demanda l’heure à une bonne d’enfants qui passait et qu’elle remercia en lui disant : « Comme vous êtes aimable ! » puis, priant le cantonnier de dire à ses petits enfants de revenir, qu’elle avait froid, ajouta : « Vous serez mille fois bon. Vous savez que je suis confuse ! » Tout à coup l’air se déchira : entre le guignol et le cirque, à l’horizon embelli, sur le ciel entr’ouvert, je venais d’apercevoir, comme un signe fabuleux, le plumet bleu de Mademoiselle. Et déjà Gilberte courait à toute vitesse dans ma direction, étincelante et rouge sous un bonnet carré de fourrure, animée par le froid, le retard et le désir du jeu ; un peu avant d’arriver à moi, elle se laissa glisser sur la glace et, soit pour mieux garder son équilibre, soit parce qu’elle trouvait cela plus gracieux, ou par affectation du maintien d’une patineuse, c’est les bras grands ouverts qu’elle avançait en souriant, comme si elle avait voulu m’y recevoir. « Brava ! Brava ! ça c’est très bien, je dirais comme vous que c’est chic, que c’est crâne, si je n’étais pas d’un autre temps, du temps de l’ancien régime, s’écria la vieille dame prenant la parole au nom des Champs-Élysées silencieux pour remercier Gilberte d’être venue sans se laisser intimider par le temps. Vous êtes comme moi, fidèle quand même à nos vieux Champs-Élysées ; nous sommes deux intrépides. Si je vous disais que je les aime, même ainsi. Cette neige, vous allez rire de moi, ça me fait penser à de l’hermine ! » Et la vieille dame se mit à rire.
Le premier de ces jours – auxquels la neige, image des puissances qui pouvaient me priver de voir Gilberte, donnait la tristesse d’un jour de séparation et jusqu’à l’aspect d’un jour de départ, parce qu’il changeait la figure et empêchait presque l’usage du lieu habituel de nos seules entrevues, maintenant changé, tout enveloppé de housses – ce jour fit pourtant faire un progrès à mon amour, car il fut comme un premier chagrin qu’elle eût partagé avec moi. Il n’y avait que nous deux de notre bande, et être ainsi le seul qui fût avec elle, c’était non seulement comme un commencement d’intimité, mais aussi de sa part – comme si elle ne fût venue rien que pour moi par un temps pareil – cela me semblait aussi touchant que si, un de ces jours où elle était invitée à une matinée, elle y avait renoncé pour venir me retrouver aux Champs-Élysées ; je prenais plus de confiance en la vitalité et en l’avenir de notre amitié qui restait vivace au milieu de l’engourdissement, de la solitude et de la ruine des choses environnantes ; et tandis qu’elle me mettait des boules de neige dans le cou, je souriais avec attendrissement à ce qui me semblait à la fois une prédilection qu’elle me marquait, en me tolérant comme compagnon de voyage dans ce pays hivernal et nouveau, et une sorte de fidélité qu’elle me gardait au milieu du malheur. Bientôt l’une après l’autre, comme des moineaux hésitants, ses amies arrivèrent toutes noires sur la neige. Nous commençâmes à jouer et comme ce jour si tristement commencé devait finir dans la joie, comme je m’approchais, avant de jouer aux barres, de l’amie à la voix brève que j’avais entendue le premier jour crier le nom de Gilberte, elle me dit : « Non, non, on sait bien que vous aimez mieux être dans le camp de Gilberte, d’ailleurs, vous voyez elle vous fait signe. » Elle m’appelait en effet pour que je vinsse sur la pelouse de neige, dans son camp, dont le soleil en lui donnant les reflets roses, l’usure métallique des brocarts anciens, faisait un camp du drap d’or.
Ce jour que j’avais tant redouté fut au contraire un des seuls où je ne fus pas trop malheureux.
Car, moi qui ne pensais plus qu’à ne jamais rester un jour sans voir Gilberte (au point qu’une fois ma grand’mère n’étant pas rentrée pour l’heure du dîner, je ne pus m’empêcher de me dire tout de suite que si elle avait été écrasée par une voiture, je ne pourrais pas aller de quelque temps aux Champs-Élysées ; on n’aime plus personne dès qu’on aime), pourtant ces moments où j’étais auprès d’elle et que depuis la veille j’avais si impatiemment attendus, pour lesquels j’avais tremblé, auxquels j’aurais sacrifié tout le reste, n’étaient nullement des moments heureux ; et je le savais bien, car c’était les seuls moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention méticuleuse, acharnée, et elle ne découvrait pas en eux un atome de plaisir.
Tout le temps que j’étais loin de Gilberte, j’avais besoin de la voir, parce que cherchant sans cesse à me représenter son image, je finissais par ne plus y réussir, et par ne plus savoir exactement à quoi correspondait mon amour. Puis, elle ne m’avait encore jamais dit qu’elle m’aimait. Bien au contraire, elle avait souvent prétendu qu’elle avait des amis qu’elle me préférait, que j’étais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers quoique trop distrait, pas assez au jeu ; enfin elle m’avait donné souvent des marques apparentes de froideur qui auraient pu ébranler ma croyance que j’étais pour elle un être différent des autres, si cette croyance avait pris sa source dans un amour que Gilberte aurait eu pour moi, et non pas, comme cela était, dans l’amour que j’avais pour elle, ce qui la rendait autrement résistante, puisque cela la faisait dépendre de la manière même dont j’étais obligé, par une nécessité intérieure, de penser à Gilberte. Mais les sentiments que je ressentais pour elle, moi-même je ne les lui avais pas encore déclarés. Certes, à toutes les pages de mes cahiers, j’écrivais indéfiniment son nom et son adresse, mais à la vue de ces vagues lignes que je traçais sans qu’elle pensât pour cela à moi, qui lui faisaient prendre autour de moi tant de place apparente sans qu’elle fût mêlée davantage à ma vie, je me sentais découragé parce qu’elles ne me parlaient pas de Gilberte qui ne les verrait même pas, mais de mon propre désir qu’elles semblaient me montrer comme quelque chose de purement personnel, d’irréel, de fastidieux et d’impuissant. Le plus pressé était que nous nous vissions, Gilberte et moi, et que nous puissions nous faire l’aveu réciproque de notre amour, qui jusque-là n’aurait pour ainsi dire pas commencé. Sans doute les diverses raisons qui me rendaient si impatient de la voir auraient été moins impérieuses pour un homme mûr. Plus tard, il arrive que devenus habiles dans la culture de nos plaisirs, nous nous contentions de celui que nous avons à penser à une femme comme je pensais à Gilberte, sans être inquiets de savoir si cette image correspond à la réalité, et aussi de celui de l’aimer sans avoir besoin d’être certain qu’elle nous aime ; ou encore que nous renoncions au plaisir de lui avouer notre inclination pour elle, afin d’entretenir plus vivace l’inclination qu’elle a pour nous, imitant ces jardiniers japonais qui, pour obtenir une plus belle fleur, en sacrifient plusieurs autres. Mais à l’époque où j’aimais Gilberte, je croyais encore que l’Amour existait réellement en dehors de nous ; que, en permettant tout au plus que nous écartions les obstacles, il offrait ses bonheurs dans un ordre auquel on n’était pas libre de rien changer ; il me semblait que si j’avais, de mon chef, substitué à la douceur de l’aveu la simulation de l’indifférence, je ne me serais pas seulement privé d’une des joies dont j’avais le plus rêvé, mais que je me serais fabriqué à ma guise un amour factice et sans valeur, sans communication avec le vrai, dont j’aurais renoncé à suivre les chemins mystérieux et préexistants.
Mais quand j’arrivais aux Champs-Élysées – et que d’abord j’allais pouvoir confronter mon amour, pour lui faire subir les rectifications nécessaires, à sa cause vivante, indépendante de moi – dès que j’étais en présence de cette Gilberte Swann sur la vue de laquelle j’avais compté pour rafraîchir les images que ma mémoire fatiguée ne retrouvait plus, de cette Gilberte Swann avec qui j’avais joué hier, et que venait de me faire saluer et reconnaître un instinct aveugle comme celui qui dans la marche nous met un pied devant l’autre avant que nous ayons eu le temps de penser, aussitôt tout se passait comme si elle et la fillette qui était l’objet de mes rêves avaient été deux êtres différents. Par exemple si depuis la veille je portais dans ma mémoire deux yeux de feu dans des joues pleines et brillantes, la figure de Gilberte m’offrait maintenant avec insistance quelque chose que précisément je ne m’étais pas rappelé, un certain effilement aigu du nez qui, s’associant instantanément à d’autres traits, prenait l’importance de ces caractères qui en histoire naturelle définissent une espèce, et la transmuait en une fillette du genre de celles à museau pointu. Tandis que je m’apprêtais à profiter de cet instant désiré pour me livrer, sur l’image de Gilberte que j’avais préparée avant de venir et que je ne retrouvais plus dans ma tête, à la mise au point qui me permettrait dans les longues heures où j’étais seul d’être sûr que c’était bien elle que je me rappelais, que c’était bien mon amour pour elle que j’accroissais peu à peu comme un ouvrage qu’on compose, elle me passait une balle ; et comme le philosophe idéaliste dont le corps tient compte du monde extérieur à la réalité duquel son intelligence ne croit pas, le même moi qui m’avait fait la saluer avant que je l’eusse identifiée, s’empressait de me faire saisir la balle qu’elle me tendait (comme si elle était une camarade avec qui j’étais venu jouer, et non une âme sœur que j’étais venu rejoindre), me faisait lui tenir par bienséance jusqu’à l’heure où elle s’en allait, mille propos, aimables et insignifiants et m’empêchait ainsi, ou de garder le silence pendant lequel j’aurais pu enfin remettre la main sur l’image urgente et égarée, ou de lui dire les paroles qui pouvaient faire faire à notre amour les progrès décisifs sur lesquels j’étais chaque fois obligé de ne plus compter que pour l’après-midi suivante. Il en faisait pourtant quelques-uns. Un jour que nous étions allés avec Gilberte jusqu’à la baraque de notre marchande qui était particulièrement aimable pour nous – car c’était chez elle que M. Swann faisait acheter son pain d’épices, et par hygiène, il en consommait beaucoup, souffrant d’un eczéma ethnique et de la constipation des Prophètes – Gilberte me montrait en riant deux petits garçons qui étaient comme le petit coloriste et le petit naturaliste des livres d’enfants. Car l’un ne voulait pas d’un sucre d’orge rouge parce qu’il préférait le violet et l’autre, les larmes aux yeux, refusait une prune que voulait lui acheter sa bonne, parce que, finit-il par dire d’une voix passionnée : « J’aime mieux l’autre prune, parce qu’elle a un ver ! » J’achetai deux billes d’un sou. Je regardais avec admiration, lumineuses et captives dans une sébile isolée, les billes d’agate qui me semblaient précieuses parce qu’elles étaient souriantes et blondes comme des jeunes filles et parce qu’elles coûtaient cinquante centimes pièce. Gilberte, à qui on donnait beaucoup plus d’argent qu’à moi, me demanda laquelle je trouvais la plus belle. Elles avaient la transparence et le fondu de la vie. Je n’aurais voulu lui en faire sacrifier aucune. J’aurais aimé qu’elle pût les acheter, les délivrer toutes. Pourtant je lui en désignai une qui avait la couleur de ses yeux. Gilberte la prit, chercha son rayon doré, la caressa, paya sa rançon, mais aussitôt me remit sa captive en me disant : « Tenez, elle est à vous, je vous la donne, gardez-la comme souvenir. »
Une autre fois, toujours préoccupé du désir d’entendre la Berma dans une pièce classique, je lui avais demandé si elle ne possédait pas une brochure où Bergotte parlait de Racine, et qui ne se trouvait plus dans le commerce. Elle m’avait prié de lui en rappeler le titre exact, et le soir je lui avais adressé un petit télégramme en écrivant sur l’enveloppe ce nom de Gilberte Swann que j’avais tant de fois tracé sur mes cahiers. Le lendemain elle m’apporta, dans un paquet noué de faveurs mauves et scellé de cire blanche, la brochure qu’elle avait fait chercher. « Vous voyez que c’est bien ce que vous m’avez demandé, me dit-elle, tirant de son manchon le télégramme que je lui avais envoyé. » Mais dans l’adresse de ce pneumatique – qui, hier encore n’était rien, n’était qu’un petit bleu que j’avais écrit, et qui depuis qu’un télégraphiste l’avait remis au concierge de Gilberte et qu’un domestique l’avait porté jusqu’à sa chambre, était devenu cette chose sans prix, un des petits bleus qu’elle avait reçus ce jour-là – j’eus peine à reconnaître les lignes vaines et solitaires de mon écriture sous les cercles imprimés qu’y avait apposés la poste, sous les inscriptions qu’y avait ajoutées au crayon un des facteurs, signes de réalisation effective, cachets du monde extérieur, violettes ceintures symboliques de la vie, qui pour la première fois venaient épouser, maintenir, relever, réjouir mon rêve.
Et il y eut un jour aussi où elle me dit : « Vous savez, vous pouvez m’appeler Gilberte, en tous cas moi, je vous appellerai par votre nom de baptême. C’est trop gênant. » Pourtant elle continua encore un moment à se contenter de me dire « vous » et comme je le lui faisais remarquer, elle sourit, et composant, construisant une phrase comme celles qui dans les grammaires étrangères n’ont d’autre but que de nous faire employer un mot nouveau, elle la termina par mon petit nom. Et me souvenant plus tard de ce que j’avais senti alors, j’y ai démêlé l’impression d’avoir été tenu un instant dans sa bouche, moi-même, nu, sans plus aucune des modalités sociales qui appartenaient aussi, soit à ses autres camarades, soit, quand elle disait mon nom de famille, à mes parents, et dont ses lèvres – en l’effort qu’elle faisait, un peu comme son père, pour articuler les mots qu’elle voulait mettre en valeur – eurent l’air de me dépouiller, de me dévêtir, comme de sa peau un fruit dont on ne peut avaler que la pulpe, tandis que son regard, se mettant au même degré nouveau d’intimité que prenait sa parole, m’atteignait aussi plus directement, non sans témoigner la conscience, le plaisir et jusque la gratitude qu’il en avait, en se faisant accompagner d’un sourire.
Mais au moment même, je ne pouvais apprécier la valeur de ces plaisirs nouveaux. Ils n’étaient pas donnés par la fillette que j’aimais, au moi qui l’aimait, mais par l’autre, par celle avec qui je jouais, à cet autre moi qui ne possédait ni le souvenir de la vraie Gilberte, ni le cœur indisponible qui seul aurait pu savoir le prix d’un bonheur, parce que seul il l’avait désiré. Même après être rentré à la maison je ne les goûtais pas, car chaque jour, la nécessité qui me faisait espérer que le lendemain j’aurais la contemplation exacte, calme, heureuse de Gilberte, qu’elle m’avouerait enfin son amour, en m’expliquant pour quelles raisons elle avait dû me le cacher jusqu’ici, cette même nécessité me forçait à tenir le passé pour rien, à ne jamais regarder que devant moi, à considérer les petits avantages qu’elle m’avait donnés non pas en eux-mêmes et comme s’ils se suffisaient, mais comme des échelons nouveaux où poser le pied, qui allaient me permettre de faire un pas de plus en avant et d’atteindre enfin le bonheur que je n’avais pas encore rencontré.
Si elle me donnait parfois de ces marques d’amitié, elle me faisait aussi de la peine en ayant l’air de ne pas avoir de plaisir à me voir, et cela arrivait souvent les jours mêmes sur lesquels j’avais le plus compté pour réaliser mes espérances. J’étais sûr que Gilberte viendrait aux Champs-Élysées et j’éprouvais une allégresse qui me paraissait seulement la vague anticipation d’un grand bonheur quand – entrant dès le matin au salon pour embrasser maman déjà toute prête, la tour de ses cheveux noirs entièrement construite, et ses belles mains blanches et potelées sentant encore le savon – j’avais appris, en voyant une colonne de poussière se tenir debout toute seule au-dessus du piano, et en entendant un orgue de Barbarie jouer sous la fenêtre : « En revenant de la revue », que l’hiver recevait jusqu’au soir la visite inopinée et radieuse d’une journée de printemps. Pendant que nous déjeunions, en ouvrant sa croisée, la dame d’en face avait fait décamper en un clin d’œil, d’à côté de ma chaise – rayant d’un seul bond toute la largeur de notre salle à manger – un rayon qui y avait commencé sa sieste et était déjà revenu la continuer l’instant d’après. Au collège, à la classe d’une heure, le soleil me faisait languir d’impatience et d’ennui en laissant traîner une lueur dorée jusque sur mon pupitre, comme une invitation à la fête où je ne pourrais arriver avant trois heures, jusqu’au moment où Françoise venait me chercher à la sortie, et où nous nous acheminions vers les Champs-Élysées par les rues décorées de lumière, encombrées par la foule, et où les balcons, descellés par le soleil et vaporeux, flottaient devant les maisons comme des nuages d’or. Hélas ! aux Champs-Élysées je ne trouvais pas Gilberte, elle n’était pas encore arrivée. Immobile sur la pelouse nourrie par le soleil invisible qui çà et là faisait flamboyer la pointe d’un brin d’herbe, et sur laquelle les pigeons qui s’y étaient posés avaient l’air de sculptures antiques que la pioche du jardinier a ramenées à la surface d’un sol auguste, je restais les yeux fixés sur l’horizon, je m’attendais à tout moment à voir apparaître l’image de Gilberte suivant son institutrice, derrière la statue qui semblait tendre l’enfant qu’elle portait et qui ruisselait de rayons à la bénédiction du soleil. La vieille lectrice des Débats était assise sur son fauteuil, toujours à la même place, elle interpellait un gardien à qui elle faisait un geste amical de la main en lui criant : « Quel joli temps ! » Et la préposée s’étant approchée d’elle pour percevoir le prix du fauteuil, elle faisait mille minauderies en mettant dans l’ouverture de son gant le ticket de dix centimes comme si ç’avait été un bouquet, pour qui elle cherchait, par amabilité pour le donateur, la place la plus flatteuse possible. Quand elle l’avait trouvée, elle faisait exécuter une évolution circulaire à son cou, redressait son boa, et plantait sur la chaisière, en lui montrant le bout de papier jaune qui dépassait sur son poignet, le beau sourire dont une femme, en indiquant son corsage à un jeune homme, lui dit : « Vous reconnaissez vos roses ! »
J’emmenais Françoise au-devant de Gilberte jusqu’à l’Arc-de-Triomphe, nous ne la rencontrions pas, et je revenais vers la pelouse persuadé qu’elle ne viendrait plus, quand, devant les chevaux de bois, la fillette à la voix brève se jetait sur moi : « Vite, vite, il y a déjà un quart d’heure que Gilberte est arrivée. Elle va repartir bientôt. On vous attend pour faire une partie de barres. » Pendant que je montais l’avenue des Champs-Élysées, Gilberte était venue par la rue Boissy-d’Anglas, Mademoiselle ayant profité du beau temps pour faire des courses pour elle ; et M. Swann allait venir chercher sa fille. Aussi c’était ma faute ; je n’aurais pas dû m’éloigner de la pelouse ; car on ne savait jamais sûrement par quel côté Gilberte viendrait, si ce serait plus ou moins tard, et cette attente finissait par me rendre plus émouvants, non seulement les Champs-Élysées entiers et toute la durée de l’après-midi, comme une immense étendue d’espace et de temps sur chacun des points et à chacun des moments de laquelle il était possible qu’apparût l’image de Gilberte, mais encore cette image elle-même, parce que derrière cette image je sentais se cacher la raison pour laquelle elle m’était décochée en plein cœur, à quatre heures au lieu de deux heures et demie, surmontée d’un chapeau de visite à la place d’un béret de jeu, devant les « Ambassadeurs » et non entre les deux guignols, je devinais quelqu’une de ses occupations où je ne pouvais suivre Gilberte et qui la forçaient à sortir ou à rester à la maison, j’étais en contact avec le mystère de sa vie inconnue. C’était ce mystère aussi qui me troublait quand, courant sur l’ordre de la fillette à la voix brève pour commencer tout de suite notre partie de barres, j’apercevais Gilberte, si vive et brusque avec nous, faisant une révérence à la dame aux Débats (qui lui disait : « Quel beau soleil, on dirait du feu »), lui parlant avec un sourire timide, d’un air compassé qui m’évoquait la jeune fille différente que Gilberte devait être chez ses parents, avec les amis de ses parents, en visite, dans toute son autre existence qui m’échappait. Mais de cette existence, personne ne me donnait l’impression comme M. Swann qui venait un peu après pour retrouver sa fille. C’est que lui et Mme Swann – parce que leur fille habitait chez eux, parce que ses études, ses jeux, ses amitiés dépendaient d’eux – contenaient pour moi, comme Gilberte, peut-être même plus que Gilberte, comme il convenait à des lieux tout-puissants sur elle en qui il aurait eu sa source, un inconnu inaccessible, un charme douloureux. Tout ce qui les concernait était de ma part l’objet d’une préoccupation si constante que les jours où, comme ceux-là, M. Swann (que j’avais vu si souvent autrefois sans qu’il excitât ma curiosité, quand il était lié avec mes parents) venait chercher Gilberte aux Champs-Élysées, une fois calmés les battements de cœur qu’avait excités en moi l’apparition de son chapeau gris et de son manteau à pèlerine, son aspect m’impressionnait encore comme celui d’un personnage historique sur lequel nous venons de lire une série d’ouvrages et dont les moindres particularités nous passionnent. Ses relations avec le comte de Paris qui, quand j’en entendais parler à Combray, me semblaient indifférentes, prenaient maintenant pour moi quelque chose de merveilleux, comme si personne d’autre n’eût jamais connu les Orléans ; elles le faisaient se détacher vivement sur le fond vulgaire des promeneurs de différentes classes qui encombraient cette allée des Champs-Élysées, et au milieu desquels j’admirais qu’il consentît à figurer sans réclamer d’eux d’égards spéciaux, qu’aucun d’ailleurs ne songeait à lui rendre, tant était profond l’incognito dont il était enveloppé.
Il répondait poliment aux saluts des camarades de Gilberte, même au mien quoiqu’il fût brouillé avec ma famille, mais sans avoir l’air de me connaître. (Cela me rappela qu’il m’avait pourtant vu bien souvent à la campagne ; souvenir que j’avais gardé mais dans l’ombre, parce que depuis que j’avais revu Gilberte, pour moi Swann était surtout son père, et non plus le Swann de Combray ; comme les idées sur lesquelles j’embranchais maintenant son nom étaient différentes des idées dans le réseau desquelles il était autrefois compris et que je n’utilisais plus jamais quand j’avais à penser à lui, il était devenu un personnage nouveau ; je le rattachai pourtant par une ligne artificielle, secondaire et transversale à notre invité d’autrefois ; et comme rien n’avait plus pour moi de prix que dans la mesure où mon amour pouvait en profiter, ce fut avec un mouvement de honte et le regret de ne pouvoir les effacer que je retrouvai les années où, aux yeux de ce même Swann qui était en ce moment devant moi aux Champs-Élysées et à qui heureusement Gilberte n’avait peut-être pas dit mon nom, je m’étais si souvent le soir rendu ridicule en envoyant demander à maman de monter dans ma chambre me dire bonsoir, pendant qu’elle prenait le café avec lui, mon père et mes grands-parents à la table du jardin.) Il disait à Gilberte qu’il lui permettait de faire une partie, qu’il pouvait attendre un quart d’heure, et s’asseyant comme tout le monde sur une chaise de fer payait son ticket de cette main que Philippe VII avait si souvent retenue dans la sienne, tandis que nous commencions à jouer sur la pelouse, faisant envoler les pigeons, dont les beaux corps irisés qui ont la forme d’un cœur et sont comme les lilas du règne des oiseaux, venaient se réfugier comme en des lieux d’asile, tel sur le grand vase de pierre, à qui son bec en y disparaissant faisait faire le geste et assignait la destination d’offrir en abondance les fruits ou les graines qu’il avait l’air d’y picorer, tel autre sur le front de la statue, qu’il semblait surmonter d’un de ces objets en émail desquels la polychromie varie dans certaines œuvres antiques la monotonie de la pierre, et d’un attribut qui, quand la déesse le porte, lui vaut une épithète particulière et en fait, comme pour une mortelle un prénom différent, une divinité nouvelle.
Un de ces jours de soleil qui n’avait pas réalisé mes espérances, je n’eus pas le courage de cacher ma déception à Gilberte.
— J’avais justement beaucoup de choses à vous demander, lui dis-je. Je croyais que ce jour compterait beaucoup dans notre amitié. Et aussitôt arrivée, vous allez partir ! Tâchez de venir demain de bonne heure, que je puisse enfin vous parler.
Sa figure resplendit et ce fut en sautant de joie qu’elle me répondit :
— Demain, comptez-y, mon bel ami, mais je ne viendrai pas ! j’ai un grand goûter ; après-demain non plus, je vais chez une amie pour voir de ses fenêtres l’arrivée du roi Théodose, ce sera superbe, et le lendemain encore à Michel Strogoff et puis après, cela va être bientôt Noël et les vacances du jour de l’An. Peut-être on va m’emmener dans le midi. Ce que ce serait chic ! quoique cela me fera manquer un arbre de Noël ; en tous cas si je reste à Paris, je ne viendrai pas ici car j’irai faire des visites avec maman. Adieu, voilà papa qui m’appelle.
Je revins avec Françoise par les rues qui étaient encore pavoisées de soleil, comme au soir d’une fête qui est finie. Je ne pouvais pas traîner mes jambes.
— Ça n’est pas étonnant, dit Françoise, ce n’est pas un temps de saison, il fait trop chaud. Hélas ! mon Dieu, de partout il doit y avoir bien des pauvres malades, c’est à croire que là-haut aussi tout se détraque.
Je me redisais en étouffant mes sanglots les mots où Gilberte avait laissé éclater sa joie de ne pas venir de longtemps aux Champs-Élysées. Mais déjà le charme dont, par son simple fonctionnement, se remplissait mon esprit dès qu’il songeait à elle, la position particulière, unique – fût elle affligeante – où me plaçait inévitablement, par rapport à Gilberte, la contrainte interne d’un pli mental, avaient commencé à ajouter, même à cette marque d’indifférence, quelque chose de romanesque, et au milieu de mes larmes se formait un sourire qui n’était que l’ébauche timide d’un baiser. Et quand vint l’heure du courrier, je me dis ce soir-là comme tous les autres : « Je vais recevoir une lettre de Gilberte, elle va me dire enfin qu’elle n’a jamais cessé de m’aimer, et m’expliquera la raison mystérieuse pour laquelle elle a été forcée de me le cacher jusqu’ici, de faire semblant de pouvoir être heureuse sans me voir, la raison pour laquelle elle a pris l’apparence de la Gilberte simple camarade. »
Tous les soirs je me plaisais à imaginer cette lettre, je croyais la lire, je m’en récitais chaque phrase. Tout d’un coup je m’arrêtais effrayé. Je comprenais que si je devais recevoir une lettre de Gilberte, ce ne pourrait pas en tous cas être celle-là, puisque c’était moi qui venais de la composer. Et dès lors, je m’efforçais de détourner ma pensée des mots que j’aurais aimé qu’elle m’écrivît, par peur, en les énonçant, d’exclure justement ceux-là – les plus chers, les plus désirés – du champ des réalisations possibles. Même si par une invraisemblable coïncidence, c’eût été justement la lettre que j’avais inventée que de son côté m’eût adressée Gilberte, y reconnaissant mon œuvre, je n’eusse pas eu l’impression de recevoir quelque chose qui ne vînt pas de moi, quelque chose de réel, de nouveau, un bonheur extérieur à mon esprit, indépendant de ma volonté, vraiment donné par l’amour.
En attendant je relisais une page que ne m’avait pas écrite Gilberte, mais qui du moins me venait d’elle, cette page de Bergotte sur la beauté des vieux mythes dont s’est inspiré Racine, et que, à côté de la bille d’agathe, je gardais toujours auprès de moi. J’étais attendri par la bonté de mon amie qui me l’avait fait rechercher ; et comme chacun a besoin de trouver des raisons à sa passion, jusqu’à être heureux de reconnaître dans l’être qu’il aime des qualités que la littérature ou la conversation lui ont appris être de celles qui sont dignes d’exciter l’amour, jusqu’à les assimiler par imitation et en faire des raisons nouvelles de son amour, ces qualités fussent-elles les plus oppressées à celles que cet amour eût recherchées tant qu’il était spontané – comme Swann autrefois le caractère esthétique de la beauté d’Odette – moi, qui avais d’abord aimé Gilberte, dès Combray, à cause de tout l’inconnu de sa vie, dans lequel j’aurais voulu me précipiter, m’incarner, en délaissant la mienne qui ne m’était plus rien, je pensais maintenant comme à un inestimable avantage, que de cette mienne vie trop connue, dédaignée, Gilberte pourrait devenir un jour l’humble servante, la commode et confortable collaboratrice, qui le soir, m’aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. Quant à Bergotte, ce vieillard infiniment sage et presque divin à cause de qui j’avais d’abord aimé Gilberte, avant même de l’avoir vue, maintenant c’était surtout à cause de Gilberte que je l’aimais. Avec autant de plaisir que les pages qu’il avait écrites sur Racine, je regardais le papier fermé de grands cachets de cire blancs et noué d’un flot de rubans mauves dans lequel elle me les avait apportées. Je baisai la bille d’agate qui était la meilleure part du cœur de mon amie, la part qui n’était pas frivole, mais fidèle, et qui bien que parée du charme mystérieux de la vie de Gilberte demeurait près de moi, habitait ma chambre, couchait dans mon lit. Mais la beauté de cette pierre, et la beauté aussi de ces pages de Bergotte, que j’étais heureux d’associer à l’idée de mon amour pour Gilberte comme si dans les moments où celui-ci ne m’apparaissait plus que comme un néant, elles lui donnaient une sorte de consistance, je m’apercevais qu’elles étaient antérieures à cet amour, qu’elles ne lui ressemblaient pas, que leurs éléments avaient été fixés par le talent ou par les lois minéralogiques avant que Gilberte ne me connût, que rien dans le livre ni dans la pierre n’eût été autre si Gilberte ne m’avait pas aimé, et que rien par conséquent ne m’autorisait à lire en eux un message de bonheur. Et tandis que mon amour, attendant sans cesse du lendemain l’aveu de celui de Gilberte, annulait, défaisait chaque soir le travail mal fait de la journée, dans l’ombre de moi-même une ouvrière inconnue ne laissait pas au rebut les fils arrachés, et les disposait, sans souci de me plaire et de travailler à mon bonheur, dans un ordre différent qu’elle donnait à tous ses ouvrages. Ne portant aucun intérêt particulier à mon amour, ne commençant pas par décider que j’étais aimé, elle recueillait les actions de Gilberte qui m’avaient semblé inexplicables et ses fautes que j’avais excusées. Alors les unes et les autres prenaient un sens. Il semblait dire, cet ordre nouveau, qu’en voyant Gilberte, au lieu qu’elle vînt aux Champs-Élysées, aller à une matinée, faire des courses avec son institutrice et se préparer à une absence pour les vacances du jour de l’an, j’avais tort de penser, de me dire : « c’est qu’elle est frivole ou docile. » Car elle eût cessé d’être l’un ou l’autre si elle m’avait aimé, et si elle avait été forcée d’obéir, c’eût été avec le même désespoir que j’avais les jours où je ne la voyais pas. Il disait encore, cet ordre nouveau, que je devais pourtant savoir ce que c’était qu’aimer puisque j’aimais Gilberte ; il me faisait remarquer le souci perpétuel que j’avais de me faire valoir à ses yeux, à cause duquel j’essayais de persuader à ma mère d’acheter à Françoise un caoutchouc et un chapeau avec un plumet bleu, ou plutôt de ne plus m’envoyer aux Champs-Élysées avec cette bonne dont je rougissais (à quoi ma mère répondait que j’étais injuste pour Françoise, que c’était une brave femme qui nous était dévouée), et aussi ce besoin unique de voir Gilberte qui faisait que des mois d’avance je ne pensais qu’à tâcher d’apprendre à quelle époque elle quitterait Paris et où elle irait, trouvant le pays le plus agréable un lieu d’exil si elle ne devait pas y être, et ne désirant que rester toujours à Paris tant que je pourrais la voir aux Champs-Élysées ; et il n’avait pas de peine à me montrer que ce souci-là, ni ce besoin, je ne les trouverais sous les actions de Gilberte. Elle au contraire appréciait son institutrice, sans s’inquiéter de ce que j’en pensais. Elle trouvait naturel de ne pas venir aux Champs-Élysées, si c’était pour aller faire des emplettes avec Mademoiselle, agréable si c’était pour sortir avec sa mère. Et à supposer même qu’elle m’eût permis d’aller passer les vacances au même endroit qu’elle, du moins pour choisir cet endroit elle s’occupait du désir de ses parents, de mille amusements dont on lui avait parlé et nullement que ce fût celui où ma famille avait l’intention de m’envoyer. Quand elle m’assurait parfois qu’elle m’aimait moins qu’un de ses amis, moins qu’elle ne m’aimait la veille, parce que je lui avais fait perdre sa partie par une négligence, je lui demandais pardon, je lui demandais ce qu’il fallait faire pour qu’elle recommençât à m’aimer autant, pour qu’elle m’aimât plus que les autres ; je voulais qu’elle me dît que c’était déjà fait, je l’en suppliais comme si elle avait pu modifier son affection pour moi à son gré, au mien, pour me faire plaisir, rien que par les mots qu’elle dirait, selon ma bonne ou ma mauvaise conduite. Ne savais-je donc pas que ce que j’éprouvais, moi, pour elle, ne dépendait ni de ses actions, ni de ma volonté ?
Il disait enfin, l’ordre nouveau dessiné par l’ouvrière invisible, que si nous pouvons désirer que les actions d’une personne qui nous a peinés jusqu’ici n’aient pas été sincères, il y a dans leur suite une clarté contre quoi notre désir ne peut rien et à laquelle, plutôt qu’à lui, nous devons demander quelles seront ses actions de demain.
Ces paroles nouvelles, mon amour les entendait ; elles le persuadaient que le lendemain ne serait pas différent de ce qu’avaient été tous les autres jours ; que le sentiment de Gilberte pour moi, trop ancien déjà pour pouvoir changer, c’était l’indifférence ; que dans mon amitié avec Gilberte, c’est moi seul qui aimais. « C’est vrai, répondait mon amour, il n’y a plus rien à faire de cette amitié-là, elle ne changera pas. » Alors dès le lendemain (ou attendant une fête s’il y en avait une prochaine, un anniversaire, le nouvel an peut-être, un de ces jours qui ne sont pas pareils aux autres, où le temps recommence sur de nouveaux frais en rejetant l’héritage du passé, en n’acceptant pas le legs de ses tristesses) je demandais à Gilberte de renoncer à notre amitié ancienne et de jeter les bases d’une nouvelle amitié.
J’avais toujours à portée de ma main un plan de Paris qui, parce qu’on pouvait y distinguer la rue où habitaient M. et Mme Swann, me semblait contenir un trésor. Et par plaisir, par une sorte de fidélité chevaleresque aussi, à propos de n’importe quoi, je disais le nom de cette rue, si bien que mon père me demandait, n’étant pas comme ma mère et ma grand’mère au courant de mon amour :
— Mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue, elle n’a rien d’extraordinaire, elle est très agréable à habiter parce qu’elle est à deux pas du Bois, mais il y en a dix autres dans le même cas.
Je m’arrangeais à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swann ; certes je me le répétais mentalement sans cesse : mais j’avais besoin aussi d’entendre sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait pas. Ce nom de Swann d’ailleurs que je connaissais depuis si longtemps, était maintenant pour moi, ainsi qu’il arrive à certains aphasiques à l’égard des mots les plus usuels, un nom nouveau. Il était toujours présent à ma pensée et pourtant elle ne pouvait pas s’habituer à lui. Je le décomposais, je l’épelais, son orthographe était pour moi une surprise. Et en même temps que d’être familier, il avait cessé de me paraître innocent. Les joies que je prenais à l’entendre, je les croyais si coupables, qu’il me semblait qu’on devinait ma pensée et qu’on changeait la conversation si je cherchais à l’y amener. Je me rabattais sur les sujets qui touchaient encore à Gilberte, je rabâchais sans fin les mêmes paroles, et j’avais beau savoir que ce n’était que des paroles – des paroles prononcées loin d’elle, qu’elle n’entendait pas, des paroles sans vertu qui répétaient ce qui était, mais ne le pouvaient modifier – pourtant il me semblait qu’à force de manier, de brasser ainsi tout ce qui avoisinait Gilberte, j’en ferais peut-être sortir quelque chose d’heureux. Je redisais à mes parents que Gilberte aimait bien son institutrice, comme si cette proposition énoncée pour la centième fois allait avoir enfin pour effet de faire brusquement entrer Gilberte venant à tout jamais vivre avec nous. Je reprenais l’éloge de la vieille dame qui lisait les Débats (j’avais insinué à mes parents que c’était une ambassadrice ou peut-être une altesse) et je continuais à célébrer sa beauté, sa magnificence, sa noblesse, jusqu’au jour où je dis que d’après le nom qu’avait prononcé Gilberte, elle devait s’appeler Mme Blatin.
— Oh ! mais je vois ce que c’est, s’écria ma mère, tandis que je me sentais rougir de honte. À la garde ! À la garde ! comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c’est elle que tu trouves belle ! Mais elle est horrible et elle l’a toujours été. C’est la veuve d’un huissier. Tu ne te rappelles pas, quand tu étais enfant, les manèges que je faisais pour l’éviter à la leçon de gymnastique où, sans me connaître, elle voulait venir me parler sous prétexte de me dire que tu étais « trop beau pour un garçon ». Elle a toujours eu la rage de connaître du monde et il faut bien qu’elle soit une espèce de folle comme j’ai toujours pensé, si elle connaît vraiment Mme Swann. Car si elle était d’un milieu fort commun, au moins il n’y a jamais rien eu que je sache à dire sur elle. Mais il fallait toujours qu’elle se fasse des relations. Elle est horrible, affreusement vulgaire, et avec cela faiseuse d’embarras. »
Quant à Swann, pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon temps à table, à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait : « cet enfant est idiot, il deviendra affreux. » J’aurais surtout voulu être aussi chauve que Swann. Il me semblait un être si extraordinaire que je trouvais merveilleux que des personnes que je fréquentais le connussent aussi et que dans les hasards d’une journée quelconque on pût être amené à le rencontrer. Et une fois, ma mère, en train de nous raconter, comme chaque soir à dîner, les courses qu’elle avait faites dans l’après-midi, rien qu’en disant : « À ce propos, devinez qui j’ai rencontré aux Trois Quartiers, au rayon des parapluies : Swann », fit éclore au milieu de son récit, fort aride pour moi, une fleur mystérieuse. Quelle mélancolique volupté, d’apprendre que cet après-midi-là, profilant dans la foule sa forme surnaturelle, Swann avait été acheter un parapluie. Au milieu des événements grands et minimes, également indifférents, celui-là éveillait en moi ces vibrations particulières dont était perpétuellement ému mon amour pour Gilberte. Mon père disait que je ne m’intéressais à rien parce que je n’écoutais pas quand on parlait des conséquences politiques que pouvait avoir la visite du roi Théodose, en ce moment l’hôte de la France et, prétendait-on, son allié. Mais combien en revanche, j’avais envie de savoir si Swann avait son manteau à pèlerine !
— Est-ce que vous vous êtes dit bonjour ? demandai-je.
— Mais naturellement, répondit ma mère qui avait toujours l’air de craindre que si elle eût avoué que nous étions en froid avec Swann, on eût cherché à les réconcilier plus qu’elle ne souhaitait, à cause de Mme Swann qu’elle ne voulait pas connaître. C’est lui qui est venu me saluer, je ne le voyais pas.
— Mais alors, vous n’êtes pas brouillés ?
— Brouillés ? mais pourquoi veux-tu que nous soyons brouillés, répondit-elle vivement comme si j’avais attenté à la fiction de ses bons rapports avec Swann et essayé de travailler à un « rapprochement ».
— Il pourrait t’en vouloir de ne plus l’inviter.
— On n’est pas obligé d’inviter tout le monde ; est-ce qu’il m’invite ? Je ne connais pas sa femme.
— Mais il venait bien à Combray.
— Eh bien oui ! il venait à Combray, et puis à Paris il a autre chose à faire et moi aussi. Mais je t’assure que nous n’avions pas du tout l’air de deux personnes brouillées. Nous sommes restés un moment ensemble parce qu’on ne lui apportait pas son paquet. Il m’a demandé de tes nouvelles, il m’a dit que tu jouais avec sa fille, ajouta ma mère, m’émerveillant du prodige que j’existasse dans l’esprit de Swann, bien plus, que ce fût d’une façon assez complète, pour que, quand je tremblais d’amour devant lui aux Champs-Élysées, il sût mon nom, qui était ma mère, et pût amalgamer autour de ma qualité de camarade de sa fille quelques renseignements sur mes grands-parents, leur famille, l’endroit que nous habitions, certaines particularités de notre vie d’autrefois, peut-être même inconnues de moi. Mais ma mère ne paraissait pas avoir trouvé un charme particulier à ce rayon des Trois Quartiers où elle avait représenté pour Swann, au moment où il l’avait vue, une personne définie avec qui il avait des souvenirs communs qui avaient motivé chez lui le mouvement de s’approcher d’elle, le geste de la saluer.
Ni elle d’ailleurs ni mon père ne semblaient non plus trouver à parler des grands-parents de Swann, du titre d’agent de change honoraire, un plaisir qui passât tous les autres. Mon imagination avait isolé et consacré dans le Paris social une certaine famille, comme elle avait fait dans le Paris de pierre pour une certaine maison dont elle avait sculpté la porte cochère et rendu précieuses les fenêtres. Mais ces ornements, j’étais seul à les voir. De même que mon père et ma mère trouvaient la maison qu’habitait Swann pareille aux autres maisons construites en même temps dans le quartier du Bois, de même la famille de Swann leur semblait du même genre que beaucoup d’autres familles d’agents de change. Ils la jugeaient plus ou moins favorablement selon le degré où elle avait participé à des mérites communs au reste de l’univers et ne lui trouvaient rien d’unique. Ce qu’au contraire ils y appréciaient, ils le rencontraient à un degré égal, ou plus élevé, ailleurs. Aussi après avoir trouvé la maison bien située, ils parlaient d’une autre qui l’était mieux, mais qui n’avait rien à voir avec Gilberte, ou de financiers d’un cran supérieur à son grand-père ; et s’ils avaient eu l’air un moment d’être du même avis que moi, c’était par un malentendu qui ne tardait pas à se dissiper. C’est que, pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilberte, une qualité inconnue analogue dans le monde des émotions à ce que peut être dans celui des couleurs l’infra-rouge, mes parents étaient dépourvus de ce sens supplémentaire et momentané dont m’avait doté l’amour.
Les jours où Gilberte m’avait annoncé qu’elle ne devait pas venir aux Champs-Élysées, je tâchais de faire des promenades qui me rapprochassent un peu d’elle. Parfois j’emmenais Françoise en pèlerinage devant la maison qu’habitaient les Swann. Je lui faisais répéter sans fin ce que, par l’institutrice, elle avait appris relativement à Mme Swann. « Il paraît qu’elle a bien confiance à des médailles. Jamais elle ne partira en voyage si elle a entendu la chouette, ou bien comme un tic-tac d’horloge dans le mur, ou si elle a vu un chat à minuit, ou si le bois d’un meuble, il a craqué. Ah ! c’est une personne très croyante ! » J’étais si amoureux de Gilberte que si sur le chemin j’apercevais leur vieux maître d’hôtel promenant un chien, l’émotion m’obligeait à m’arrêter, j’attachais sur ses favoris blancs des regards pleins de passion. Françoise me disait :
— Qu’est-ce que vous avez ?
Puis, nous poursuivions notre route jusque devant leur porte cochère où un concierge différent de tout concierge, et pénétré jusque dans les galons de sa livrée du même charme douloureux que j’avais ressenti dans le nom de Gilberte, avait l’air de savoir que j’étais de ceux à qui une indignité originelle interdirait toujours de pénétrer dans la vie mystérieuse qu’il était chargé de garder et sur laquelle les fenêtres de l’entresol paraissaient conscientes d’être refermées, ressemblant beaucoup moins entre la noble retombée de leurs rideaux de mousseline à n’importe quelles autres fenêtres, qu’aux regards de Gilberte. D’autres fois nous allions sur les boulevards et je me postais à l’entrée de la rue Duphot ; on m’avait dit qu’on pouvait souvent y voir passer Swann se rendant chez son dentiste ; et mon imagination différenciait tellement le père de Gilberte du reste de l’humanité, sa présence au milieu du monde réel y introduisait tant de merveilleux, que, avant même d’arriver à la Madeleine, j’étais ému à la pensée d’approcher d’une rue où pouvait se produire inopinément l’apparition surnaturelle.
Mais le plus souvent – quand je ne devais pas voir Gilberte – comme j’avais appris que Mme Swann se promenait presque chaque jour dans l’allée « des Acacias », autour du grand Lac, et dans l’allée de la « Reine Marguerite », je dirigeais Françoise du côté du bois de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l’on voit rassemblés des flores diverses et des paysages opposés ; où, après une colline on trouve une grotte, un pré, des rochers, une rivière, une fosse, une colline, un marais, mais où l’on sait qu’ils ne sont là que pour fournir aux ébats de l’hippopotame, des zèbres, des crocodiles, des lapins russes, des ours et du héron, un milieu approprié ou un cadre pittoresque ; lui, le Bois, complexe aussi, réunissant des petits mondes divers et clos – faisant succéder quelque ferme plantée d’arbres rouges, de chênes d’Amérique, comme une exploitation agricole dans la Virginie, à une sapinière au bord du lac, ou à une futaie d’où surgit tout à coup dans sa souple fourrure, avec les beaux yeux d’une bête, quelque promeneuse rapide – il était le Jardin des femmes ; et – comme l’allée de Myrtes de l’Énéide – plantée pour elles d’arbres d’une seule essence, l’allée des Acacias était fréquentée par les Beautés célèbres. Comme, de loin, la culmination du rocher d’où elle se jette dans l’eau, transporte de joie les enfants qui savent qu’ils vont voir l’otarie, bien avant d’arriver à l’allée des Acacias, leur parfum qui, irradiant alentour, faisait sentir de loin l’approche et la singularité d’une puissante et molle individualité végétale ; puis, quand je me rapprochais, le faîte aperçu de leur frondaison légère et mièvre, d’une élégance facile, d’une coupe coquette et d’un mince tissu, sur laquelle des centaines de fleurs s’étaient abattues comme des colonies ailées et vibratiles de parasites précieux ; enfin jusqu’à leur nom féminin, désœuvré et doux, me faisaient battre le cœur mais d’un désir mondain, comme ces valses qui ne nous évoquent plus que le nom des belles invitées que l’huissier annonce à l’entrée d’un bal. On m’avait dit que je verrais dans l’allée certaines élégantes que, bien qu’elles n’eussent pas toutes été épousées, l’on citait habituellement à côté de Mme Swann, mais le plus souvent sous leur nom de guerre ; leur nouveau nom, quand il y en avait un, n’était qu’une sorte d’incognito que ceux qui voulaient parler d’elles avaient soin de lever pour se faire comprendre. Pensant que le Beau – dans l’ordre des élégances féminines – était régi par des lois occultes à la connaissance desquelles elles avaient été initiées, et qu’elles avaient le pouvoir de le réaliser, j’acceptais d’avance comme une révélation l’apparition de leur toilette, de leur attelage, de mille détails au sein desquels je mettais ma croyance comme une âme intérieure qui donnait la cohésion d’un chef-d’œuvre à cet ensemble éphémère et mouvant. Mais c’est Mme Swann que je voulais voir, et j’attendais qu’elle passât, ému comme si ç’avait été Gilberte, dont les parents, imprégnés, comme tout ce qui l’entourait, de son charme, excitaient en moi autant d’amour qu’elle, même un trouble plus douloureux (parce que leur point de contact avec elle était cette partie intestine de sa vie qui m’était interdite), et enfin (car je sus bientôt, comme on le verra, qu’ils n’aimaient pas que je jouasse avec elle), ce sentiment de vénération que nous vouons toujours à ceux qui exercent sans frein la puissance de nous faire du mal.
J’assignais la première place à la simplicité, dans l’ordre des mérites esthétiques et des grandeurs mondaines, quand j’apercevais Mme Swann à pied, dans une polonaise de drap, sur la tête un petit toquet agrémenté d’une aile de lophophore, un bouquet de violettes au corsage, pressée, traversant l’allée des Acacias comme si ç’avait été seulement le chemin le plus court pour rentrer chez elle et répondant d’un clin d’œil aux messieurs en voiture qui, reconnaissant de loin sa silhouette, la saluaient et se disaient que personne n’avait autant de chic. Mais au lieu de la simplicité, c’est le faste que je mettais au plus haut rang, si, après que j’avais forcé Françoise, qui n’en pouvait plus et disait que les jambes « lui rentraient », à faire les cent pas pendant une heure, je voyais enfin, débouchant de l’allée qui vient de la Porte Dauphine – image pour moi d’un prestige royal, d’une arrivée souveraine telle qu’aucune reine véritable n’a pu m’en donner l’impression dans la suite, parce que j’avais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expérimentale – emportée par le vol de deux chevaux ardents, minces et contournés comme on en voit dans les dessins de Constantin Guys, portant établi sur son siège un énorme cocher fourré comme un cosaque, à côté d’un petit groom rappelant le « tigre » de « feu Baudenord », je voyais – ou plutôt je sentais imprimer sa forme dans mon cœur par une nette et épuisante blessure – une incomparable victoria, à dessein un peu haute et laissant passer à travers son luxe « dernier cri » des allusions aux formes anciennes, au fond de laquelle reposait avec abandon Mme Swann, ses cheveux maintenant blonds avec une seule mèche grise ceints d’un mince bandeau de fleurs, le plus souvent des violettes, d’où descendaient de longs voiles, à la main une ombrelle mauve, aux lèvres un sourire ambigu où je ne voyais que la bienveillance d’une Majesté et où il y avait surtout la provocation de la cocotte, et qu’elle inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient. Ce sourire en réalité disait aux uns : « Je me rappelle très bien, c’était exquis ! » ; à d’autres : « Comme j’aurais aimé ! ç’a été la mauvaise chance ! » ; à d’autres : « Mais si vous voulez ! Je vais suivre encore un moment la file et dès que je pourrai, je couperai. » Quand passaient des inconnus, elle laissait cependant autour de ses lèvres un sourire oisif, comme tourné vers l’attente ou le souvenir d’un ami et qui faisait dire : « Comme elle est belle ! » Et pour certains hommes seulement elle avait un sourire aigre, contraint, timide et froid et qui signifiait : « Oui, rosse, je sais que vous avez une langue de vipère, que vous ne pouvez pas vous tenir de parler ! Est-ce que je m’occupe de vous, moi ! » Coquelin passait en discourant au milieu d’amis qui l’écoutaient et faisait avec la main, à des personnes en voiture, un large bonjour de théâtre. Mais je ne pensais qu’à Mme Swann et je faisais semblant de ne pas l’avoir vue, car je savais qu’arrivée à la hauteur du Tir aux pigeons elle dirait à son cocher de couper la file et de l’arrêter pour qu’elle pût descendre l’allée à pied. Et les jours où je me sentais le courage de passer à côté d’elle, j’entraînais Françoise dans cette direction. À un moment en effet, c’est dans l’allée des piétons, marchant vers nous que j’apercevais Mme Swann laissant s’étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve, vêtue, comme le peuple imagine les reines, d’étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l’exercice, sans penser qu’elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle. Parfois pourtant, quand elle s’était retournée pour appeler son lévrier, elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d’elle.
Ceux même qui ne la connaissaient pas étaient avertis par quelque chose de singulier et d’excessif – ou peut-être par une radiation télépathique comme celles qui déchaînaient des applaudissements dans la foule ignorante aux moments où la Berma était sublime – que ce devait être quelque personne connue. Ils se demandaient : « Qui est-ce ? », interrogeaient quelquefois un passant, ou se promettaient de se rappeler la toilette comme un point de repère pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitôt. D’autres promeneurs, s’arrêtant à demi, disaient :
— Vous savez qui c’est ? Mme Swann ! Cela ne vous dit rien ? Odette de Crécy ?
— Odette de Crécy ? Mais je me disais aussi, ces yeux tristes... Mais savez-vous qu’elle ne doit plus être de la première jeunesse ! Je me rappelle que j’ai couché avec elle le jour de la démission de Mac-Mahon.
— Je crois que vous ferez bien de ne pas le lui rappeler. Elle est maintenant Mme Swann, la femme d’un monsieur du Jockey, ami du prince de Galles. Elle est du reste encore superbe.
— Oui, mais si vous l’aviez connue à ce moment-là, ce qu’elle était jolie ! Elle habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries. Je me rappelle que nous étions embêtés par le bruit des crieurs de journaux, elle a fini par me faire lever.
Sans entendre les réflexions, je percevais autour d’elle le murmure indistinct de la célébrité. Mon cœur battait d’impatience quand je pensais qu’il allait se passer un instant encore avant que tous ces gens, au milieu desquels je remarquais avec désolation que n’était pas un banquier mulâtre par lequel je me sentais méprisé, vissent le jeune homme inconnu auquel ils ne prêtaient aucune attention, saluer (sans la connaître, à vrai dire, mais je m’y croyais autorisé parce que mes parents connaissaient son mari et que j’étais le camarade de sa fille), cette femme dont la réputation de beauté, d’inconduite et d’élégance était universelle. Mais déjà j’étais tout près de Mme Swann, alors je lui tirais un si grand coup de chapeau, si étendu, si prolongé, qu’elle ne pouvait s’empêcher de sourire. Des gens riaient. Quant à elle, elle ne m’avait jamais vu avec Gilberte, elle ne savait pas mon nom, mais j’étais pour elle – comme un des gardes du Bois, ou le batelier ou les canards du lac à qui elle jetait du pain – un des personnages secondaires, familiers, anonymes, aussi dénués de caractères individuels qu’un « emploi de théâtre », de ses promenades au Bois. Certains jours où je ne l’avais pas vue allée des Acacias, il m’arrivait de la rencontrer dans l’allée de la Reine-Marguerite où vont les femmes qui cherchent à être seules, ou à avoir l’air de chercher à l’être ; elle ne le restait pas longtemps, bientôt rejointe par quelque ami, souvent coiffé d’un « tube » gris, que je ne connaissais pas et qui causait longuement avec elle, tandis que leurs deux voitures suivaient.
Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice et, dans le sens zoologique ou mythologique du mot, un Jardin, je l’ai retrouvée cette année comme je le traversais pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre où, à Paris, dans les maisons, la proximité et la privation du spectacle de l’automne qui s’achève si vite sans qu’on y assiste, donnent une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes qui peut aller jusqu’à empêcher de dormir. Dans ma chambre fermée, elles s’interposaient depuis un mois, évoquées par mon désir de les voir, entre ma pensée et n’importe quel objet auquel je m’appliquais, et tourbillonnaient comme ces taches jaunes qui parfois, quoi que nous regardions, dansent devant nos yeux. Et ce matin-là, n’entendant plus la pluie tomber comme les jours précédents, voyant le beau temps sourire aux coins des rideaux fermés comme aux coins d’une bouche close qui laisse échapper le secret de son bonheur, j’avais senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversées par la lumière, dans leur suprême beauté ; et ne pouvant pas davantage me tenir d’aller voir des arbres qu’autrefois, quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée, de partir pour le bord de la mer, j’étais sorti pour aller à Trianon, en passant par le bois de Boulogne. C’était l’heure et c’était la saison où le Bois semble peut-être le plus multiple, non seulement parce qu’il est plus subdivisé, mais encore parce qu’il l’est autrement. Même dans les parties découvertes où l’on embrasse un grand espace, çà et là, en face des sombres masses lointaines des arbres qui n’avaient pas de feuilles ou qui avaient encore leurs feuilles de l’été, un double rang de marronniers orangés semblait, comme dans un tableau à peine commencé, avoir seul encore été peint par le décorateur qui n’aurait pas mis de couleur sur le reste, et tendait son allée en pleine lumière pour la promenade épisodique de personnages qui ne seraient ajoutés que plus tard.
Plus loin, là où toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres, un seul, petit, trapu, étêté et têtu, secouait au vent une vilaine chevelure rouge. Ailleurs encore c’était le premier éveil de ce mois de mai des feuilles, et celles d’un empelopsis merveilleux et souriant, comme une épine rose de l’hiver, depuis le matin même étaient tout en fleur. Et le Bois avait l’aspect provisoire et factice d’une pépinière ou d’un parc, où, soit dans un intérêt botanique, soit pour la préparation d’une fête, on vient d’installer, au milieu des arbres de sorte commune qui n’ont pas encore été déplantés, deux ou trois espèces précieuses aux feuillages fantastiques et qui semblent autour d’eux réserver du vide, donner de l’air, faire de la clarté. Ainsi c’était la saison où le bois de Boulogne trahit le plus d’essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite. Et c’était aussi l’heure. Dans les endroits où les arbres gardaient encore leurs feuilles, ils semblaient subir une altération de leur matière à partir du point où ils étaient touchés par la lumière du soleil, presque horizontale le matin, comme elle le redeviendrait quelques heures plus tard au moment où dans le crépuscule commençant, elle s’allume comme une lampe, projette à distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud, et fait flamber les suprêmes feuilles d’un arbre qui reste le candélabre incombustible et terne de son faîte incendié. Ici, elle épaississait comme des briques, et, comme une jaune maçonnerie persane à dessins bleus, cimentait grossièrement contre le ciel les feuilles des marronniers, là au contraire les détachait de lui, vers qui elles crispaient leurs doigts d’or. À mi-hauteur d’un arbre habillé de vigne vierge, elle greffait et faisait épanouir, impossible à discerner nettement dans l’éblouissement, un immense bouquet comme de fleurs rouges, peut-être une variété d’œillet. Les différentes parties du Bois, mieux confondues l’été dans l’épaisseur et la monotonie des verdures, se trouvaient dégagées. Des espaces plus éclaircis laissaient voir l’entrée de presque toutes, ou bien un feuillage somptueux la désignait comme une oriflamme. On distinguait, comme sur une carte en couleur, Armenonville, le Pré Catelan, Madrid, le Champ de courses, les bords du Lac. Par moments apparaissait quelque construction inutile, une fausse grotte, un moulin à qui les arbres en s’écartant faisaient place ou qu’une pelouse portait en avant sur sa moelleuse plate-forme. On sentait que le Bois n’était pas qu’un bois, qu’il répondait à une destination étrangère à la vie de ses arbres, l’exaltation que j’éprouvais n’était pas causée que par l’admiration de l’automne, mais par un désir. Grande source d’une joie que l’âme ressent d’abord sans en reconnaître la cause, sans comprendre que rien au dehors ne la motive. Ainsi regardais-je les arbres avec une tendresse insatisfaite qui les dépassait et se portait à mon insu vers ce chef-d’œuvre des belles promeneuses qu’ils enferment chaque jour pendant quelques heures. J’allais vers l’allée des Acacias. Je traversais des futaies où la lumière du matin, qui leur imposait des divisions nouvelles, émondait les arbres, mariait ensemble les tiges diverses et composait des bouquets. Elle attirait adroitement à elle deux arbres ; s’aidant du ciseau puissant du rayon et de l’ombre, elle retranchait à chacun une moitié de son tronc et de ses branches, et, tressant ensemble les deux moitiés qui restaient, en faisait soit un seul pilier d’ombre, que délimitait l’ensoleillement d’alentour, soit un seul fantôme de clarté dont un réseau d’ombre noire cernait le factice et tremblant contour. Quand un rayon de soleil dorait les plus hautes branches, elles semblaient, trempées d’une humidité étincelante, émerger seules de l’atmosphère liquide et couleur d’émeraude, où la futaie tout entière était plongée comme sous la mer. Car les arbres continuaient à vivre de leur vie propre et, quand ils n’avaient plus de feuilles, elle brillait mieux sur le fourreau de velours vert qui enveloppait leurs troncs ou dans l’émail blanc des sphères de gui qui étaient semées au faîte des peupliers, rondes comme le soleil et la lune dans la Création de Michel-Ange. Mais forcés depuis tant d’années par une sorte de greffe à vivre en commun avec la femme, ils m’évoquaient la dryade, la belle mondaine rapide et colorée qu’au passage ils couvrent de leurs branches et obligent à ressentir comme eux la puissance de la saison ; ils me rappelaient le temps heureux de ma croyante jeunesse, quand je venais avidement aux lieux où des chefs-d’œuvre d’élégance féminine se réaliseraient pour quelques instants entre les feuillages inconscients et complices. Mais la beauté que faisaient désirer les sapins et les acacias du bois de Boulogne, plus troublants en cela que les marronniers et les lilas de Trianon que j’allais voir, n’était pas fixée en dehors de moi dans les souvenirs d’une époque historique, dans des œuvres d’art, dans un petit temple à l’amour au pied duquel s’amoncellent les feuilles palmées d’or. Je rejoignis les bords du Lac, j’allai jusqu’au Tir aux pigeons. L’idée de perfection que je portais en moi, je l’avais prêtée alors à la hauteur d’une victoria, à la maigreur de ces chevaux furieux et légers comme des guêpes, les yeux injectés de sang comme les cruels chevaux de Diomède, et que maintenant, pris d’un désir de revoir ce que j’avais aimé, aussi ardent que celui qui me poussait bien des années auparavant dans ces mêmes chemins, je voulais avoir de nouveau sous les yeux, au moment où l’énorme cocher de Mme Swann, surveillé par un petit groom gros comme le poing et aussi enfantin que saint Georges, essayait de maîtriser leurs ailes d’acier qui se débattaient effarouchées et palpitantes. Hélas ! il n’y avait plus que des automobiles conduites par des mécaniciens moustachus qu’accompagnaient de grands valets de pied. Je voulais tenir sous les yeux de mon corps, pour savoir s’ils étaient aussi charmants que les voyaient les yeux de ma mémoire, de petits chapeaux de femmes si bas qu’ils semblaient une simple couronne. Tous maintenant étaient immenses, couverts de fruits et de fleurs et d’oiseaux variés. Au lieu des belles robes dans lesquelles Mme Swann avait l’air d’une reine, des tuniques gréco-saxonnes relevaient avec les plis des Tanagra, et quelquefois dans le style du Directoire, des chiffrons liberty semés de fleurs comme un papier peint. Sur la tête des messieurs qui auraient pu se promener avec Mme Swann dans l’allée de la Reine-Marguerite, je ne trouvais pas le chapeau gris d’autrefois, ni même un autre. Ils sortaient nu-tête. Et toutes ces parties nouvelles du spectacle, je n’avais plus de croyance à y introduire pour leur donner la consistance, l’unité, l’existence ; elles passaient éparses devant moi, au hasard, sans vérité, ne contenant en elles aucune beauté que mes yeux eussent pu essayer comme autrefois de composer. C’étaient des femmes quelconques, en l’élégance desquelles je n’avais aucune foi et dont les toilettes me semblaient sans importance. Mais quand disparaît une croyance, il lui survit – et de plus en plus vivace, pour masquer le manque de la puissance que nous avons perdue de donner de la réalité à des choses nouvelles – un attachement fétichiste aux anciennes qu’elle avait animées, comme si c’était en elles et non en nous que le divin résidait et si notre incrédulité actuelle avait une cause contingente, la mort des Dieux.
Quelle horreur ! me disais-je : peut-on trouver ces automobiles élégantes comme étaient les anciens attelages ? je suis sans doute déjà trop vieux – mais je ne suis pas fait pour un monde où les femmes s’entravent dans des robes qui ne sont pas même en étoffe. À quoi bon venir sous ces arbres, si rien n’est plus de ce qui s’assemblait sous ces délicats feuillages rougissants, si la vulgarité et la folie ont remplacé ce qu’ils encadraient d’exquis. Quelle horreur ! Ma consolation, c’est de penser aux femmes que j’ai connues, aujourd’hui qu’il n’y a plus d’élégance. Mais comment des gens qui contemplent ces horribles créatures sous leurs chapeaux couverts d’une volière ou d’un potager, pourraient-ils même sentir ce qu’il y avait de charmant à voir Mme Swann coiffée d’une simple capote mauve ou d’un petit chapeau que dépassait une seule fleur d’iris toute droite. Aurais-je même pu leur faire comprendre l’émotion que j’éprouvais par les matins d’hiver à rencontrer Mme Swann à pied, en paletot de loutre, coiffée d’un simple béret que dépassaient deux couteaux de plumes de perdrix, mais autour de laquelle la tiédeur factice de son appartement était évoquée, rien que par le bouquet de violettes qui s’écrasait à son corsage et dont le fleurissement vivant et bleu en face du ciel gris, de l’air glacé, des arbres aux branches nues, avait le même charme de ne prendre la saison et le temps que comme un cadre, et de vivre dans une atmosphère humaine, dans l’atmosphère de cette femme, qu’avaient dans les vases et les jardinières de son salon, près du feu allumé, devant le canapé de soie, les fleurs qui regardaient par la fenêtre close la neige tomber ? D’ailleurs il ne m’eût pas suffi que les toilettes fussent les mêmes qu’en ces années-là. À cause de la solidarité qu’ont entre elles les différentes parties d’un souvenir et que notre mémoire maintient équilibrées dans un assemblage où il ne nous est pas permis de rien distraire, ni refuser, j’aurais voulu pouvoir aller finir la journée chez une de ces femmes, devant une tasse de thé, dans un appartement aux murs peints de couleurs sombres, comme était encore celui de Mme Swann (l’année d’après celle où se termine la première partie de ce récit) et où luiraient les feux orangés, la rouge combustion, la flamme rose et blanche des chrysanthèmes dans le crépuscule de novembre, pendant des instants pareils à ceux où (comme on le verra plus tard) je n’avais pas su découvrir les plaisirs que je désirais. Mais maintenant, même ne me conduisant à rien, ces instants me semblaient avoir eu eux-mêmes assez de charme. Je voudrais les retrouver tels que je me les rappelais. Hélas ! il n’y avait plus que des appartements Louis XVI tout blancs, émaillés d’hortensias bleus. D’ailleurs, on ne revenait plus à Paris que très tard. Mme Swann m’eût répondu d’un château qu’elle ne rentrerait qu’en février, bien après le temps des chrysanthèmes, si je lui avais demandé de reconstituer pour moi les éléments de ce souvenir que je sentais attaché à une année lointaine, à un millésime vers lequel il ne m’était pas permis de remonter, les éléments de ce désir devenu lui-même inaccessible comme le plaisir qu’il avait jadis vainement poursuivi. Et il m’eût fallu aussi que ce fussent les mêmes femmes, celles dont la toilette m’intéressait parce que, au temps où je croyais encore, mon imagination les avait individualisées et les avait pourvues d’une légende. Hélas ! dans l’avenue des Acacias – l’allée de Myrtes – j’en revis quelques-unes, vieilles, et qui n’étaient plus que les ombres terribles de ce qu’elles avaient été, errant, cherchant désespérément on ne sait quoi dans les bosquets virgiliens. Elles avaient fui depuis longtemps que j’étais encore à interroger vainement les chemins désertés. Le soleil s’était caché. La nature recommençait à régner sur le Bois d’où s’était envolée l’idée qu’il était le Jardin élyséen de la Femme ; au-dessus du moulin factice le vrai ciel était gris ; le vent ridait le Grand Lac de petites vaguelettes, comme un lac ; de gros oiseaux parcouraient rapidement le Bois, comme un bois, et poussant des cris aigus se posaient l’un après l’autre sur les grands chênes qui, sous leur couronne druidique et avec une majesté dodonéenne, semblaient proclamer le vide inhumain de la forêt désaffectée, et m’aidaient à mieux comprendre la contradiction que c’est de chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours le charme qui leur vient de la mémoire même et de n’être pas perçus par les sens. La réalité que j’avais connue n’existait plus. Il suffisait que Mme Swann n’arrivât pas toute pareille au même moment, pour que l’Avenue fût autre. Les lieux que nous avons connus n’appartiennent pas qu’au monde de l’espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n’étaient qu’une mince tranche au milieu d’impressions contiguës qui formaient notre vie d’alors ; le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant ; et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas ! comme les années.