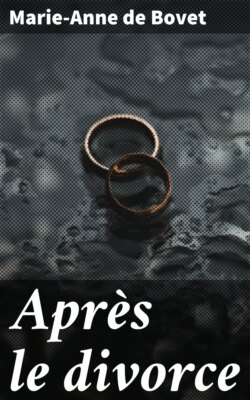Читать книгу Après le divorce - Marie-Anne de Bovet - Страница 5
II
ОглавлениеHeureux, le docteur Bertereau l'était, et il se glorifiait d'y avoir pris de la peine. A considérer le bonheur par les côtés purement positifs, véritablement en effet le sien était son œuvre. Rude et inlassable travailleur, sobre, patient, tenace, donnant tout de soi, cœur, intelligence, énergie au labeur qu'il aimait, sa situation de grand opérateur s'était fondée sur un solide savoir servi par une habileté de main peu commune. Parvenu à la tête du corps médical, il avait été envoyé au Sénat par les républicains de gouvernement de son département picard. N'ayant guère le goût, moins encore le temps d'être politicien, il se bornait à faire autorité au Luxembourg sur les questions d'hygiène publique, y marquant l'attention nécessaire à celles d'intérêt régional, et quant au reste, ministériel imperturbablement. Aimé de ses élèves pour la conscience de son enseignement, aussi pour sa grande bonté un peu bourrue, estimé de ses confrères, en dépit de l'envie, pour sa probité professionnelle, la loyauté de son caractère, la sûreté de son commerce, respecté de tous pour la dignité de sa vie, jouissant d'une réputation européenne qui souvent lui valait de lointains déplacements: illustres appendicites, litotrithies augustes, cancers royaux, tumeurs impériales, se chiffrant par le gros chèque accompagné d'une plaque ou d'un cordon—le docteur Bertereau possédait tout ce que peut souhaiter l'ambition légitime.
Personnellement, il était d'une simplicité d'habitudes confinant à la rusticité. Matineux et couche-tôt, robuste mangeur sans aucun raffinement gastronomique, ne buvant que de l'eau rougie, ne fumant point, ne connaissant d'autre plaisir que le travail, n'ayant pas le plus petit vice, même de collectionneur ou amateur de quoi que ce fût—de tout ce luxe qu'il créait autour de lui, il goûtait uniquement la joie de le donner aux siens. A condition que l'argent fût honnêtement acquis et que le rechercher ne détournât point de l'accomplissement des devoirs primordiaux, c'était, lui semblait-il, le but essentiel de l'activité humaine, comme le dépenser largement, afin d'en faire profiter autrui, constituait à ses yeux l'excuse, voire la raison d'être de la fortune.
Pas davantage ne lui faisaient défaut les satisfactions intimes. De complexion assez autoritaire, il gouvernait sa famille sans rencontrer de résistance, n'en abusant point cependant pour jouer les despotes. Mme Bertereau, de cœur excellent, de personnalité nulle, née pour être un reflet, était en admiration devant son grand homme, non toutefois sans exercer sur lui cette influence, d'autant plus occulte qu'elle est inconsciente, de l'épouse soumise, agissant en quelque sorte par la force du poids mort. Insignifiantes et sans beauté, ses filles avaient dû à leur dot très ronde des établissements avantageux dans la bourgeoisie industrielle et gouvernementale. L'aîné des fils, bien doué, laborieux, déjà interne des hôpitaux, promettait une belle carrière. Du second, «cacique» à l'École normale, section des lettres, l'esprit singulier, de tour ironique, acerbe, réfractaire aux dogmes sociaux qui constituent la religion civique de ce milieu, n'était pas sans déconcerter quelque peu son père, l'inquiétant même parfois. Mais du moins l'avenir s'ouvrait-il devant lui brillant et sûr. Tout ce monde était bien portant; l'union domestique régnait, ainsi que l'ordre dans les affaires. Hors ce qui, en Marcel, se révélait d'originalité périlleuse, gourme intellectuelle sans doute, qui s'éliminerait comme toutes effervescences de jeunesse, on ignorait chez les Bertereau ces complexités morales que le robuste ouvrier de science tenait pour manifestations morbides. On était des gens bien situés dans la vie, carrément assis et d'aplomb, solidement attachés aux choses de ce monde et les prenant telles quelles sans en chercher plus long ni plus haut, n'ayant qu'à se louer au demeurant de la façon dont elles sont arrangées.
Pour cette calme prospérité, ils auraient eu sujet de louer le ciel. Mais ils n'y songeaient point. Chez le père, ce n'était pas cet athéisme doctrinaire et agressif dont il se gardait comme d'une infraction à la loi de tolérance,—une tolérance faite plus d'indifférence que de charité,—mais le matérialisme serein du physiologiste qui, n'ayant jamais rencontré sous son bistouri l'organe nommé âme, n'a désir ni loisir de le chercher ailleurs. A quoi bon, puisqu'il est inutile au fonctionnement physique et mental de la machine humaine? Pour le reste, sa droiture native l'ayant toujours incliné vers les bonnes actions et détourné des tentations mauvaises, ce lui était assez de se savoir honnête homme, sans qu'il fût curieux de la source intangible où se puisent la distinction du bien et du mal, la conception de l'honneur, le sentiment de la bonté, et l'esprit de sacrifice, et l'instinct de justice et la lumière d'amour. Il y voyait simplement les fruits d'un exact équilibre de nature, ainsi que d'une éducation conduite selon de saines méthodes scientifiques. Tout l'édifice moral lui semblait fondé avec une solidité suffisante sur le principe de l'échange: ce qu'on doit à autrui, c'est afin qu'autrui vous le doive, toutes vertus ainsi abaissées au rang vulgaire de simples rouages sociaux. Et par ainsi tenait-il la culture de l'idéal pour pernicieuse autant qu'oiseuse, comme propre à fausser les données de la vie, à engendrer des chimères, à produire une déperdition des forces vives de l'homme au regard des besognes concrètes.
Issue d'un milieu de sec et froid positivisme,—elle était la fille du chimiste Vergniol, de l'Institut,—depuis longtemps Mme Bertereau avait tout oublié des premiers enseignements chrétiens qu'on lui avait donnés, dans un esprit de vague déférence pour des traditions surannées tombées à l'état d'usage, que répudie la supérieure raison masculine, mais encore convenables peut-être à la faiblesse du cerveau féminin. Absorbée en ses devoirs temporels et ses affections paisibles, elle ne ressentait nulle velléité d'intérêt pour les abstractions en général, ni pour rien qui fût extérieur au rayon intellectuel de son mari.
De même que ses parents lui avaient fait faire sa première communion, elle l'avait fait faire à ses enfants, et pour le même motif vulgaire. Mais depuis lors, fermés à des idées absentes de leur berceau, auxquelles leur entourage était étranger, voire hostile, ceux-ci avaient grandi dans une insouciance absolue des choses du divin. Hélène et Jeanne étaient de trop chétives âmes pour que jamais les eût effleurées aucune aspiration supérieure à leur cercle étroit de petits devoirs familiaux et mondains, d'occupations menues, de pensées frivoles. Chez Georges, la culture scientifique dépourvue de contre-poids spirituel avait desséché une nature, moins rude que celle de son père, moins forte aussi. D'essence plus subtile, Marcel subissait profondément l'intoxication de cette intellectualité aiguë qui, sans le frein moral, mène grand train à l'anarchisme. Seul de la famille, se trouvait-il ainsi affranchi de cette mentalité épaisse et vulgaire de la bourgeoisie arrivée. S'il ricanait aux idées séculaires, il ne respectait pas davantage le dogme jacobin. Par cette tangente il s'évadait de l'orbite paternel, de quoi le docteur commençait à éprouver un assez vif déplaisir.
Tel était le terrain, combien peu favorable au développement logique de sa nature si différente, où, à cet âge transitoire qui de l'enfant commence à dégager la jeune fille, le destin avait transplanté l'orpheline, dont le docteur et Mme Bertereau avaient fait comme leur dernière née.
De son père, Élisabeth ne conservait que la mémoire, estompée dans les brumes du recul, d'un bel homme très bon, avec de l'or sur un uniforme éclatant, d'un jour surtout où, après l'avoir embrassée plus fort que de coutume, il était parti à cheval—un jour où sa mère avait beaucoup pleuré. Ensuite, une lacune dans ce petit cerveau de quatre ans. Puis les larmes de nouveau étaient entrées dans la maison, des larmes plus éperdues, plus désespérées. On l'avait habillée de noir, on lui avait dit que son père était au ciel, que jamais il ne reviendrait. De ce jour-là, elle ne vit plus sa mère sourire. La balle prussienne qui avait foudroyé glorieusement le brillant chef de bataillon des grenadiers de la garde avait atteint sa veuve aux sources vives d'un frêle organisme. Réduite, outre le revenu de sa dot réglementaire, à sa modique pension, augmentée d'un bureau de tabac de maigre rapport, Mme Charles Bertereau avait quitté Versailles pour se fixer à Morlaix, son pays d'origine. Lentement la maladie de cœur avait exercé ses implacables ravages, et dix ans plus tard une crise d'asystolie l'emportait, sans qu'eussent réussi à conjurer le mal la science et le dévouement de son beau-frère accouru auprès d'elle. Du moins eut-elle la consolation suprême de savoir que sa fille, tout ce qu'elle regretterait d'ici-bas, trouverait affection et sollicitude chez l'oncle et tuteur, qui en fit à la mourante solennelle promesse—le bonheur même, peut-être, qu'elle eût été sans doute impuissante à lui donner.
Il semblait en effet que, part faite au déchirement de son petit cœur très tendre, la fillette gagnât à ce bouleversement d'existence. Tant qu'elle eût aimé sa mère et en eût été aimée, entre cette valétudinaire neurasthénique, vieillie avant l'âge, noyée dans un deuil éternel, et l'enfant saine, vivace, chez qui une précoce gravité, née de la tristesse ambiante, n'étouffait point cependant l'ardente sève de jeunesse—entre elles cette intimité morale n'avait pu exister qui fait vraiment la force des liens du sang. Au sortir d'une enfance retirée et morose, la joie de vivre bientôt eut raison de son chagrin. Il s'atténua, puis passa, laissant place à un souvenir attendri. Et dans une chaude atmosphère familiale la jolie fleur s'épanouit doucement, fraîche, pure, délicate. Son oncle était parfait pour elle. Mme Bertereau avait une de ces vocations de mère poule qui se réjouit de chaque poussin ajouté à la couvée. Si dans les rapports d'Élisabeth avec ses cousines il y avait quelque chose à reprendre, c'eût été plutôt de la partialité en sa faveur. Cette gracieuse et fine créature, au charme un peu austère et très prenant, séduction qui, de s'ignorer, n'en était que plus profonde, avait apporté dans sa nouvelle famille un élément qui y faisait défaut.
La bonne Mme Bertereau avait si bien pris pied dans son emploi de matrone, qu'on ne pouvait se l'imaginer—son mari lui-même—avoir été jeune et avoir été femme. Hélène était une grande fille massive et vulgaire, du type haquenée, haute en couleur, le verbe bruyant autant que le cerveau vide, futile sans grâce, coquette sans féminité, n'ayant de goût que pour le chiffon et à cause de ce qu'il coûte. Peut-être eût-elle ressenti quelque dépit de ne point posséder les attraits de cette cousine qu'on lui donnait pour sœur. Mais ce mauvais sentiment était emporté par la vanité de se savoir riche, le plus appréciable à ses yeux des biens de ce monde. Bientôt mariée d'ailleurs, épousant moins son mari que les Établissements Percheron frères, dans les enfants qui lui naquirent elle aimait surtout de petites poupées à attifer, et, passionnée de luxe uniquement, elle s'asseyait dans son argent avec cette ostentation grossière qui le fait prendre en dégoût par les âmes délicates.
Effacée au contraire et timide, bonne petite nature moutonnière dénuée de tout relief, pas positivement laide, mais de physique ingrat et de façons gauches, Jeanne non plus n'avait rien pour attirer ni pour attacher. Élisabeth se trouvait ainsi la grâce et la lumière de la maison.
Assurément elle y était heureuse. On remarquait en elle toutefois des rêveries, que son oncle mettait sur le compte de l'aspiration plus ou moins consciente au mariage. En cela le trompait ce diagnostic quasi infaillible quant aux choses brutales de la pathologie. Élisabeth était la jeune fille très jeune fille que ne soupçonnent guère les hommes et qu'ils comprennent mal. Elle aimait les plaisirs de son âge, mais avec assez de retenue pour que cela n'entravât point le développement des côtés sérieux d'un caractère incliné vers la paix et l'intimité domestiques. Qu'elle jouît de cette paix et de cette intimité au foyer des siens ou à celui d'un époux, cela lui était de peu. Se sachant mal pourvue, encore que pour soi-même elle crût à l'amour la vertu de suppléer au défaut d'argent, elle n'ignorait point que son établissement s'en trouvait rendu malaisé. Cela sans doute était selon la sagesse courante, que ne discutaient pas son esprit soumis, son âme douce. Seul un penchant maternel assez prononcé lui eût fait éprouver du regret de rester fille. Mais à vingt ans elle n'en était pas là. Et sans souci du présent, sans impatience de l'avenir, paisible, elle attendait que s'accomplît son destin.
Un malaise pourtant troublait Élisabeth. Trouble léger, dont elle-même ne possédait pas le secret. Elle avait été élevée dans la pratique exacte de la religion. A l'opposé de ce qui arrive souvent, au lieu que le cœur meurtri de sa mère se fût jeté dans la dévotion, plutôt s'en était-il éloigné d'abord. La douloureuse veuve en voulait un peu à Dieu de son malheur. Bretonne cependant, foncièrement chrétienne de par la profonde empreinte héréditaire, elle n'était pas allée jusqu'à la révolte contre une foi qui la consolait si imparfaitement. Sa santé chancelante ne lui permettant guère de continuer elle-même l'éducation de sa fille, elle l'avait mise au courant, tout près d'elle. Élisabeth y avait connu l'effervescence mystique qui naît à l'époque de la première communion et s'entretient volontiers dans l'ombre des cloîtres. Mais son brusque et si radical changement d'atmosphère était venu tarir l'afflux de cette adolescente piété. Non qu'elle cessât d'être régulière. Le docteur eût préféré sa pupille détachée de croyances qu'il jugeait puériles et caduques. Pour une femme toutefois, cela tirait à moins de conséquence. Et, au surplus, auprès de la mère mourante, pleinement réconciliée avec Celui qui l'avait éprouvée si cruellement, il s'était engagé à respecter les principes catholiques de l'enfant. Il avait scrupuleusement tenu parole. On faisait accompagner Élisabeth à la messe par une femme de chambre. Elle accomplissait le devoir pascal. Son oncle ayant pris, pour lui interdire le maigre, des prétextes de santé, docile à la prescription médicale comme au commandement de l'Église, elle en demandait dûment la dispense. Ainsi se tenait-elle en règle stricte avec les obligations.
Cela était insuffisant pour ses besoins d'âme. De pratique, elle aurait eu assez, mais c'est la vie intérieure qui lui faisait défaut. L'action d'un milieu indifférent est plus dissolvante que celle d'un milieu hostile. Heurtées, les idées religieuses d'Élisabeth se fussent exaltées par réaction naturelle. Ce qui même contribuait le plus efficacement à maintenir sa foi, c'étaient les paroles de sarcasme et de dénigrement qui sortaient de la bouche de certains amis de la maison. Mais ces propos ne lui étaient point personnellement adressés et nul jamais n'avait fait de tentative sur sa conscience. Aussi, dans la liberté dédaigneuse qui lui était laissée, ne trouvait-elle pas à puiser cette généreuse ferveur qu'inspire la persécution. Et, au point de vue même le plus largement ésotérique, tous autour d'elle étaient tellement étrangers à ces choses, que le sentiment qu'elle en avait s'étiolait faute d'aliments. Nature un peu molle, l'énergie lui manquait pour lutter contre son isolement moral. Puis cela était bien abstrait, bien complexe pour sa jeunesse. En sorte que, dans l'ambiance de matérialisme où elle vivait, les rites finissaient par prendre pour elle ce caractère machinal qui en amoindrit le sens divin. Fidèle à la lettre, Élisabeth sentait en elle se refroidir l'esprit.
De ce desséchement de son être spirituel, elle souffrait. Sujette à des réchauffements subits, comme celui qui s'était manifesté pour la cérémonie nuptiale de sa cousine Jeanne, ce lui était l'occasion de ces petites crises intimes auxquelles on attribuait faussement une cause si concrète. Car elle ne s'en ouvrait à personne, sachant que personne ne la comprendrait.
Sa tante toutefois ne se méprenait point en voyant dans ses élans de ferveur l'ascendant de son ancienne compagne de couvent. Jamais elles ne s'étaient perdues de vue. Plusieurs étés de suite, Élisabeth avait passé un mois ou deux chez une sœur de sa mère qui habitait un petit manoir sur la rivière de Morlaix. Monique Le Huédé était la fille d'un officier supérieur de la marine retiré dans le voisinage très proche. Déjà, lorsque les deux jeunes filles avaient été séparées par les circonstances, chez l'aînée s'était déclaré ce penchant pour la vie religieuse assez commun aux alentours de la seizième année. Le temps semblait l'avoir confirmé, quoique, soumise à ses directeurs spirituels, Monique n'en parlât guère, la prudence ecclésiastique lui ayant imposé l'essai de la vie du siècle avant qu'elle envisageât sérieusement l'éventualité d'une prise de voile. En attendant, elle s'adonnait aux pratiques de la piété la plus exaltée. Moralement dépaysée comme l'était, avenue de Messine, la nièce du grand chirurgien athée, sur cette terre de Bretagne si intensément catholique, où Élisabeth se retrempait dans le sang de sa race maternelle, il lui semblait retrouver son équilibre rompu. Ce n'était pas encore tout à fait cela néanmoins. La dévotion de Monique était trop rigide, trop exaltée aussi pour satisfaire complètement à ses propres tendances la portant vers une foi simple, calme, douce. Aussi ne suivait-elle pas son amie jusqu'au bout du chemin où celle-ci, dévorée d'un zèle d'apôtre qu'exagérait l'absolutisme de l'extrême jeunesse, s'employait ardemment à l'entraîner sur ses pas. N'empêche que les impressions subies laissaient leur empreinte et, rentrée à Paris, jusqu'à ce que l'eussent effacée des contacts si différents, Élisabeth ressentait le malaise créé par cette dualité morale.
Sans qu'aucune confidence épistolaire eût fait prévoir l'événement, comme Monique venait d'atteindre sa vingtième année elle se maria. Ayant eu dans leur famille la douloureuse aventure d'une fausse vocation au lendemain amer, ses parents l'avaient voulu détourner du cloître. Soit qu'à ce moment une détente se fût produite en elle, soit que la personne du prétendant qu'on lui fit connaître eût triomphé de son éloignement réel ou factice pour les fins normales des filles, elle consentit à épouser l'aimable et galant homme qu'était Alain Guivarch. Lui, las de la vie de garçon assez joyeusement menée, s'était volontiers épris de cette jolie personne un peu austère et frigide, mais qu'un mari aurait d'autant plus de mérite et d'agrément sans doute à conquérir à l'amour. Quittant le commissariat de marine, il venait d'entrer dans les bureaux de la Compagnie Transatlantique à Saint-Nazaire. Puis un emploi supérieur l'appela à l'administration centrale. Ainsi furent plus étroitement rapprochées les amies d'enfance. Leur intimité s'était encore accrue du fait qu'Élisabeth ayant perdu sa tante de Bretagne, ce deuil l'avait, six mois durant, tenue éloignée du train mondain, et la famille Bertereau ne le portant pas, un peu isolée dans la maison. A ce moment, Monique se trouvait séparée de son mari, en voyage de service aux ports des Antilles. Elle vivait très retirée. Il allait de soi que la jeune fille fréquentât beaucoup chez elle, et d'autant plus que celle-ci n'allait qu'à contre-cœur avenue de Messine, où tout lui était sujet de scandale. Car le mariage n'avait guère adouci cette âpre dévotion qui faisait d'elle—comme le remarquait le docteur Bertereau—une religieuse égarée dans le monde, avec plus d'intransigeance que n'en ont d'ordinaire les saintes filles nourries d'esprit de charité. Ses occupations conjugales et maternelles—un fils lui était né—l'empêchaient de donner autant de soi qu'auparavant aux pratiques pieuses, mais sans qu'eût fléchi la rigidité de sa religion. M. Guivarch aurait souhaité chez sa femme une foi plus amène. De trouver son foyer si morose, il commençait à le délaisser. Monique s'en affligeait. En humanisant son austérité, il n'eût tenu qu'à elle de retenir ce mari un peu léger, encore épris pourtant. Mais, scrupuleuse observatrice de tous les devoirs de l'épouse chrétienne, il en est un qu'elle ne savait pas remplir: celui de se faire aimer. Son humeur allait s'assombrissant de ce chagrin dont elle était l'artisan, et cela rejaillissait en sévérités envers le prochain. Élisabeth était si tendrement attachée aux parents très bons à qui elle devait d'oublier la tristesse d'être orpheline, qu'il lui eût déplu d'entendre sur eux des paroles de blâme. Aussi se taisait-elle avec son amie du malaise spirituel qui parfois l'oppressait. Et puis n'était-elle point assez heureuse par ailleurs pour éviter de s'y attarder, troublant ainsi la joie de vivre la vie douce et tiède de ses vingt ans en fleur?