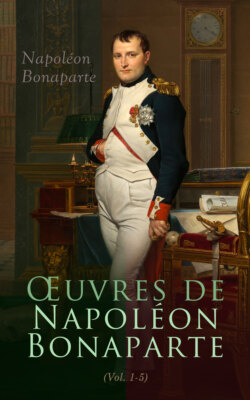Читать книгу Œuvres de Napoléon Bonaparte (Tome I-V) - Napoleon Bonaparte - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GÉNÉALOGIE DE NAPOLÉON BONAPARTE.
ОглавлениеTable des matières
En 1752, le grand-duc de Toscane ayant voulu réformer les abus qui se glissaient dans l'usurpation des titres de noblesse, établit une commission chargée de la vérification de ces titres et de leur enregistrement.
La famille des Buonaparte, ou Bonaparte5 déchue de son ancienne splendeur, exilée de Florence à la suite des troubles qui agitèrent l'Italie dans le douzième siècle, présenta une requête au chapitre de l'ordre de Saint-Étienne, pour obtenir son classement parmi les grands de Florence.
C'est cette requête, accompagnée de pièces authentiques à l'appui, qui nous a fourni les renseignemens dont nous offrons aujourd'hui un extrait succinct.
Le premier des membres de cette famille, dont le souvenir se soit conservé, Nicolas Bonaparte, attaché au parti des gibellins, fut compris dans la proscription qui les frappa, et banni de Florence en 1268, après avoir vu confisquer tous ses biens. Il se réfugia avec ses enfans à San-Miniato.
En 1441, un descendant du même Bonaparte, Leonardo Antonio Mocci, également gibellin, fut arrêté a Florence, accusé de haute trahison et décapité. Un registre déposé dans les archives de San-Miniato, et contenant l'état des biens confisqués aux rebelles, renferme le détail de ceux appartenant à Leonardo, et dont le tiers fut déclaré appartenir à son fils.
Depuis cette époque, plusieurs Bonaparte ont rempli avec distinction des fonctions élevées dans l'état militaire, la magistrature, et l'église, à Pisé, à Lucques, à Florence. L'enquête faite en août 1752, et présentée par le capitaine Nicolas Bonaparte, tant en son nom qu'en celui de ses enfans et de ses autres parens, nous a paru devoir occuper une place dans ce recueil; elle renferme une analyse historique des documens sur lesquels cette famille établissait ses prétentions. Nous en donnerons une traduction littérale.
Enquête pour le capitaine Bonaparte, fils et consorts.
«Illustrissimes seigneurs,
«Plusieurs raisons concluantes tendent à établir que la famille des exposans était placée dans un rang élevé et distingué de la ville de Florence; elle est regardée comme descendant de Buonaparte gibellin, porté, ainsi que ses fils, (al libro del chiodo), avec l'emploi de capitaine. La même famille était regardée comme jouissant du rang de grand de Florence, et fut reconnue judiciairement pour appartenir aux ordres nobles.
«Pour prouver qu'elle tire son origine du susdit Buonaparte, exilé avec ses fils en 1268, comme gibellin, du territoire de notre ville, nous employerons les raisons détaillées ci-après:
«1°. Notre premier raisonnement est que, Buonaparte gibellin, exilé en 1268 du territoire florentin, s'est réfugié avec quelques-uns de ses fils à San-Miniato, où dominait le parti gibellin, et que de lui sont descendus messire Jacopo, fils de messire Georgio di Jacopo de Buonaparti, résidant à San-Miniato, quartier de Poggighiti; qu'ils furent faits nobles, ainsi qu'il appert de l'admission des preuves par les seigneurs illustrissimes, et considérés comme descendans dudit messire Jacopo, fils de Giorgio, et aussi comme provenant dudit Buonaparte gibellin.
«En admettant cette première vérité, qu'ils descendent de messire Jacopo, fils de Giorgio, il en résulte deux conséquences: l'une, que ladite famille descendante de Buonaparte était noble à San-Miniato; l'autre, que cette ville était devenue sa véritable patrie. Si donc l'on reconnaît ces deux titres dans la famille des exposans, on ne peut se refuser à croire qu'elle était noble dès ce temps-là. Judiciairement considérée comme la vraie famille Buonaparte, elle en tirera l'invincible argument que les exposans proviennent de la même souche que messire Jacopo, lequel en provient lui-même par les fils de Buonaparte gibellin.
«L'argument ci-dessus se consolide de plus en plus en applicant au cas présent les doctrines légales: le séjour de la famille dans un même lieu, le même grade de noblesse et au même temps, forment un faisceau de preuves qui servent à établir la descendance d'une même souche; vérité qui devient plus évidente encore lorsque l'on voit Buonaparte, reconnu comme chef, donner son nom aux descendans.
«Ajoutons que l'article de qui, dans d'autres familles, précède le nom, suivant l'opinion des antiquaires les plus érudits, ne peut indiquer qu'une famille ordinaire devenue noble. Ainsi, devant les noms de médecins, de bourgeois et de riches, on joint l'article de à leurs noms, à moins qu'ils ne soient de haute lignée.
«On n'a jamais mis l'article de devant le nom de Achin Salviati, peintre excellent, et d'une si grande réputation; on n'en doit pas mettre devant le nom de notre famille, pas plus sans doute que devant le nom de nos anciens souverains les Médicis.
«Pour appuyer encore ce qui vient d'être dit, nous offrons les preuves suivantes, qui semblent sans réplique: non seulement Pierre di Gio di Jacopo di Moccio, l'un des informans, lors de la première description des décimes de l'année 1427, est cité comme citoyen de Florence, mais son père et son aïeul sont nommés comme alliés aux trois gentilshommes florentins Grandoni, Federighi et Ricci; de plus, ils résidèrent constamment dans le quartier du Saint-Esprit, où ils avaient leur habitation, et ils avaient établi leur sépulture dans l'église principale; nous citerons la mention de leur résidence au gonfalonier scala (gonfalone scala) où avaient passé Buonaparte gibellin et ses fils; ce qui prouve manifestement que Pierre, dont il vient d'être parlé, a continué d'occuper cette même habitation, comme descendant légitime du même nom, et le rapport du magistrat atteste qu'il était de Florence, habitait le même gonfalonier, et la même maison que le fondateur, M. Niccolo. Mais plus tard, au lieu d'y retourner, les Buonaparte occupèrent San-Miniato; ce qu'il est facile de reconnaître par la réticence que fit Pierre de son surnom dans le premier état de division qui eut lieu de sa part, ainsi que de ses descendans après lui. Cette omission, à laquelle on mit du mystère, donne à penser, ou plutôt à faire connaître, que ce même rejeton descendait de Buonaparte gibellin, dont la mémoire alors devait être odieuse à Florence, et ce moyen était plus facile à employer que de changer d'habitation, dans le dessein de laisser ignorer ces circonstances dans la ville. Il n'en était pas de même à San-Miniato, où dominait le parti gibellin. L'on voit même les auteurs, descendans et collatéraux du même Pierre, ne pas avoir recours au même moyen, et, dans toutes les occasions, tirer leur noblesse de Buonaparte. On voit aussi le sieur Nicolo lui-même taire tour à tour son surnom à San-Miniato, comme les autres l'avaient fait dans la ville de Florence, et, sans doute suivant les circonstances, le répéter ensuite deux fois dans la même inscription. On ne peut, dans le fait, imputer la réticence de ce nom qu'au désir de se tenir à l'abri de la haine que le peuple avait conçue pour lui, et il n'était certainement odieux au peuple que comme l'étaient les noms des autres grands et des gibellins: c'est le jugement qu'en portent tous les hommes éclairés. Il est peu de familles illustres qui n'aient été exposées aux mêmes inconvéniens à l'époque dont nous rappelons le triste souvenir.
«En quatrième lieu, lorsque, d'après l'inspection seule de l'arbre généalogique, nous voyons un membre de la famille parvenir aux premières dignités de l'église de Florence, dignités qui n'ont jamais été conférées qu'avec beaucoup de circonspection, nous pouvons en tirer l'induction de la haute considération qu'inspirait messire Jacopo, à cause de messire Pierre, chanoine et doyen florentin, avant le prince successeur de Francisco Bucellaï (c'est-à-dire en 1500.)
«On voit en outre les auteurs des informans alliés aux maisons Ricci, Federighi, Grandoni, Albizzi, Visdmnini, Alberti, Masi, Tornabuoni, parens des Tornaquiuci de Pauzano, parens de Ricasoli, Buonacorsi, Gaetani, Pamialichi, Attavanti, Squarcialupi et Borronaci, dont est né un des informans.
«De là on peut, avec beaucoup de raison, conclure que l'origine de la famille est noble, venant directement du même Buonaparte.
«Enfin, de ce que notre famille a été exclue des honneurs populaires dont elle était en possession, on doit en tirer la conséquence qu'elle était dévouée au parti gibellin.
«On la voit ensuite transférée à San-Miniato, et y posséder un château, et, fidèle au parti qu'elle avait embrassé, offrir une nouvelle victime dans la personne de Leonardo Antonio del nostro moccio, décapité pour cette raison en 1441.
«Toutes ces circonstances réunies établissent d'une manière péremptoire le dévouement de cette famille aux gibellins. Nous prouverons plus tard qu'elle jouissait d'une grande fortune, et que, si les honneurs et les dignités qui semblent devoir être l'apanage de ce rang, lui ont été refusés, il ne faut en accuser que les dissensions civiles qui la réduisirent enfin à cacher son nom.
«On ne peut tirer d'aucune archive des preuves plus fortes pour constater l'origine des informans quant à leur auteur Buonaparte. Bien qu'elles soient très concluantes, nous espérons que vos grandeurs voudront bien, dans leurs principes d'équité, prendre en considération la force de ces mêmes preuves, par l'impossibilité où se trouvent les informans de les compléter d'une manière plus satisfaisante.
«Indépendamment de la réunion des conjectures, qui vient d'être établie par ce qui précède, nous croyons être encore à même de prouver que Touquin d'Oddo et ses descendans remontent sans nul doute à Buonaparte gibellin, ainsi que nous l'avons déjà avancé plusieurs fois. Nos conjectures sont d'autant plus fondées, que nous trouvons dans un ancien registre de la famille des exposans, du commencement de l'année 1518, avant l'érection de la principauté, à la page 20, une note dont copie authentique se trouvera à la suite de la présente instruction. La vérité qui jaillit de cette note émane d'une personne respectable; elle a eu lieu également dans un temps non suspect; il faut donc en conclure que ce document mérite la plus grande confiance, quoiqu'il ne soit an surplus qu'un complément des preuves de noblesse que nous sommes en état de donner. Il faut en conclure également que cette même noblesse est établie et confirmée par probabilités ou vraisemblances qui peuvent être rangées au nombre des choses légales et authentiques. Ces probabilités, outre les raisons précédemment alléguées, dérivent incontestablement de trouver réunis, à la même époque et dans le même grade, d'une part, le colonel messire Jacopo di Giorgio, jusqu'à Buonaparte gibellin, et de l'autre, notre colonel Giovanni di Jaccopo jusqu'au même Buonaparte: En suivant même la proportion des temps, il ne paraîtrait pas impossible que lesdits Jacopo et Gio soyent tous les deux descendans du même Buonaparte, et cette probabilité, disons plus, cette vérité, se fortifie par l'apparition seule des personnes, qui, ayant lieu dans le même temps, leur fait assigner avec beaucoup de vraisemblance une origine commune. «Mais quand même cette noble origine ne serait pas établie, comme elle l'est, n'y a-t-il pas lieu de reconnaître, en passant a l'examen de la seconde proposition, que la famille Buonaparte se trouve liée aux familles les plus considérées de Florence, en ligne directe. Son séjour ancien et habituel dans cette dernière ville, ses armoiries, en un mot, c'est-à-dire le râteau rouge avec la fleur de lys d'or, armoiries données aux familles nobles par le roi Charles Ier, ainsi que la croix du peuple florentin, dont elle est depuis long-temps en possession, sont des preuves de sa noblesse qui attestent même qu'elle remonte au temps des gibellins. «A la vérité, les marques de noblesse données par le peuple ne s'accordèrent qu'aux familles d'un rang élevé, et le plus souvent, comme chacun le sait, à celles des mêmes familles qui s'empressèrent d'abjurer le parti des gibellins pour acquérir de la popularité. Quelques-uns des nôtres ont fait cette abjuration au moment même où ils recevaient les armoiries,. d'autres, depuis la décapitation du susdit Leonardi. «Privée des honneurs populaires, cette famille s'est considérée comme déchue de sa grandeur, et fut en butte à toutes sortes de mauvais traitemens, jusqu'à l'érection de la principauté. Alors seulement, voulant ne pas laisser perdre une illustration justement acquise, elle a relevé pour elle-même des faits qui avaient été tenus secrets, non pas tant, peut-être, pour en dissiper l'odieux que pour prouver qu'elle ne renonçait pas à ses droits, comme l'ont fait nombre d'autres familles, en refusant les armoiries et les alliances qui les auraient rendues agréables au peuple, en suivant l'impulsion du pays.
«Venons à l'autre point de notre exposé. Il est fondé sur ce que nous venons de dire, qu'en 1571, le chevalier Fausto Beltramini de Siena, voulant prendre la croix de St.-Étienne, non par grâce, mais d'après justice, établit le quartier de noblesse de Buonaparte par Catherina sa mère, fille de Gio, fils de notre Benedetto Buonaparte. Il prouva de même la noblesse d'Attavanti par la mère de Catherina, et en remontant jusqu'au premier grade de noblesse de Buonaparte à Florence, dans le temps même de la république, preuves qui émanent des documens des magistrats de San-Miniato depuis 1570 jusqu'à 1571, où ils s'expriment ainsi qu'il suit, au sujet des auteurs des exposans: «c'est bien volontairement qu'ils s'en sont abstenus, à cause de leur droit de cité à Florence,» et comme l'atteste plus clairement encore le témoignage de messire Antonio de Gucci de San-Miniato.
«Premier témoin. Il se rappelle avoir vu ledit Gio-Buonaparte, père de ladite Catherina, icelle mère dudit Fausto, en qualité de gentilhomme et homme d'armes de M.Valerio Orsini, aux appointemens de la république de Florence. Sur ces documens généraux, a été accordé le quartier de noblesse à Buonaparte par le conseil de Pise, avec une mention honorable sur le rapport qui en a été fait au sérénissime grand-maître.
«Les motifs de ce rapport ont été, que la famille de Buonaparte a joui du droit de cité à Florence et à Lucques; que plusieurs membres de cette famille avaient rempli l'emploi de vedut du collège, que d'autres ont eu des emplois au dehors; mais comme dans le temps San-Miniato n'avait pas de siège épiscopal, et que par conséquent ces familles ne pouvaient, en vertu des statuts de l'ordre, être admises aux preuves judiciaires, à l'effet de prendre l'habit, d'après le chapitre 3 du même statut, «le candidat doit être de la nation et né dans la ville,» malgré l'application de ce principe aux autres quartiers de noblesse, la justice ne put les étendre jusqu'au quartier de Buonaparte, c'est-à-dire à l'ancienne et noble origine de Buonaparte gibellin et à ses auteurs, quoiqu'ils fussent dès lors considérés comme grands.
«On voit en second lieu que la jouissance des emplois des collèges mentionnée au susdit rapport, avec l'approbation du saint ordre militaire, qui l'admettait même comme preuve judiciaire, concession semblable à celle faite a la famille Jeppi, ne peut s'expliquer autrement que par les preuves fournies par la famille Buonaparte et par Beltramini, de la possession des prérogatives du grade noble de Florence. Or, suivant les lois réglementaires de ce corps de noblesse, elle doit être placée au rang des patriciens.
«Mais pour éclaircir davantage ce qui vient d'être exposé, nous donnerons l'assurance que les preuves des titres des Buonaparte, faites par Beltramini dans la personne de Catherina di Gio di Benedetto Buonaparte, l'auteur commun, furent faites comme de famille florentine, sanctionnées par le saint ordre militaire. Ceci fit reconnaître judiciairement le quartier de Buonaparte à Ridolfi, soixante-dix ans après les preuves de Beltramini. Si tel a été l'effet des preuves de Beltramini, à plus forte raison les Buonaparte ont le droit de demander à être, comme les Ridolphi, reconnus nobles et de famille florentine.
«En résumant aux yeux de leurs seigneuries illustrissimes ce qui vient d'être examiné et discuté, la famille Buonaparte a le droit d'être classée parmi les grands ou gibellins, d'après le §10 de l'instruction de la loi sur la noblesse, ou d'être reconnue judiciairement pour famille florentine aux ordres nobles, suivant le §5 de la même loi. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, leurs seigneuries illustrissimes ne peuvent manquer de reconnaître le droit de cette même famille au patriciat florentin, ce qu'elle attend de leur bienveillance et de leur justice, se faisant du reste un honneur de les avoir pour juges.»
À la suite de cette pièce, s'en trouvait une autre contenant le dessin et la description des armoiries de Bonaparte.
«Les armes de la famille de Bonaparte sont un champ rouge avec deux raies blanches en bandes, et deux étoiles également blanches, l'une dessous, l'autre au-dessus des bandes. Au chef de l'écu, dans un champ d'azur, est un rateau rouge et deux fleurs de lys d'or. Au milieu du rateau, un champ blanc avec croix rouge.
«On voit de ces armes en beaucoup d'endroits à Florence, dans le cloître du St.-Esprit, au lieu de leur sépulture, et dans divers endroits de la ville de San-Miniato. Elles se trouvent aussi parmi les procédures faites au sujet de la profession de religion de St.-Etienne, par le chancelier Fausto Beltraroini, chevalier judiciaire de cet ordre militaire et sacré en l'année 1671, lesquelles procédures prouvent le quartier maternel de la famille Buonaparte.
«Les armes de la branche des Franchini de San-Miniato sont un champ d'or, et un pin au milieu. Au chef de l'ecu, est un rateau rouge dans un champ d'azur, avec trois fleurs de lys d'or.»
L'Arbre généalogique de la famille Buonaparte, dressé d'après les pièces produites, venait ensuite et était suivi:
1°. De renseignemens concernant la personne de Buonaparte gibellin et de ses fils exilés.
2°. D'autres documens concernant Leonardo d'Antonio, décapité comme gibellin.
3°. D'un Mémoire de Jules, fils de Jean Buonaparte, extrait d'un ancien livre de la famille des exposans.
4°. D'un document qui établit que Moccio Buonaparte est fils d'Oddo.
5°. D'un arbre des décimes de la famille.
6°. D'une attestation des gabelles et autres documens concernant les mariages et lignées de l'une et l'autre branche des Buonaparte. 7°. D'une attestation de l'office des traites, comme dépendance du collège et d'autres bureaux également pour les deux susdites branches.
8°. De preuves que leurs parens, depuis 1738, se sont surnommés Buonaparte, avec la jouissance du priorat.
9°. D'extraits de baptême des auteurs de la requête.
10°. D'un document sur le patrimoine ancien et actuel de la famille;
Sur les personnes constituées en dignités dans ladite famille;
Sur les nobles et anciens tombeaux de cette même famille dans San-Miniato et a Florence.
11°. D'un acte de notoriété de San-Miniato pour la famille de Buonaparte en 1571.
12°. D'une enquête sur leur famille, pour prouver judiciairement leur quartier, à l'ordre de Saint-Etienne, comme famille florentine.
13°. Des motifs des chevaliers rapporteurs pour accorder ledit quartier.
14°. Des motifs d'autres chevaliers rapporteurs auprès des grands-maîtres dudit ordre, pour octroyer judiciairement ledit quartier à d'autres Buonaparte.
15°. De preuves de l'établissement dans San-Miniato de l'ancienneté de la famille de messire Jacopo, fils de messire Giorgio Buonaparte.
Ces pièces, d'un intérêt secondaire, établissent cependant d'une manière authentique l'ancienneté de l'origine de cet homme extraordinaire, dont la naissance fut sans doute le moindre mérite. Il appartient tout entier au domaine de l'histoire: l'équitable postérité établira d'une manière invariable le rang qu'il mérite, et que ne peuvent aujourd'hui lui assigner ni l'enthousiasme ni la haine.
5 Dans les pièces généalogiques que l'on nous a communiquées, et qui comprenaient quarante pages in-folio, ce nom était écrit tantôt Bonaparte, tantôt Buonaparte, quoique tout le texte fût en italien.