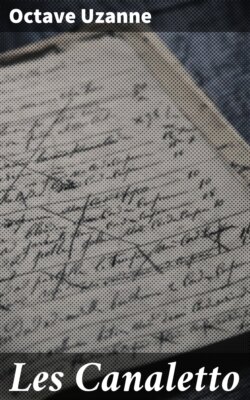Читать книгу Les Canaletto - Octave Uzanne - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE I
ОглавлениеTable des matières
LES CANALETTO, PORTRAITISTES DE VENISE
De toutes les cités du monde, Venise apparaît être celle qui ait exercé la plus impérieuse séduction aussi bien sur ses fils amoureux de leur mère, que sur ses visiteurs étrangers. Ses portraitistes se multiplièrent au cours de son histoire. Il n’y en eut point de plus zélés, de plus attentifs, de mieux doués que Le Canaletto et son neveu Bellotto, qui reproduisirent en de multiples tableaux ses visages, aspects et perspectives. La difficulté d’une étude complète sur ces deux petits maîtres vénitiens est apparente dans cet écrit plutôt essentiellement biographique, aucun développement critique n’y pouvant trouver place.
LES heureux et spirituels Vénitiens du siècle de Giambattista Tiepolo et de Goldoni déclaraient éprouver pour leur divine cité une telle dilection qu’ils y passaient leur vie à se «consoler les yeux».
On comprend aisément cette ivresse contemplative, cet enchantement continu de la vision, ce soulas bienfaisant du regard devant ce décor urbain le plus merveilleux qui ait été créé par les hommes et le moins susceptible de rassasier l’admiration, tellement le charme subtil des éclairages et la variété des atmosphères en modifie continuellement les aspects.
Aucun des voyageurs qui accoururent au chevet de la sérénessime République de 1700 jusqu’à l’heure de son agonie inconsciente et enjouée, ne s’avisa de protester contre cette déclaration d’intime jouissance du Civis Vénétus au contact visuel de sa chère ville natale et devant les surprenants et chatoyants spectacles qu’elle présente à chaque heure du jour.
Le Président de Brosse, qui s’y accagnarda voluptueusement, en bon épicurien qu’il était, avouait la délectation qu’il éprouvait à parcourir places, quais, canaux, ruelles et ponts, afin de se régaler «la vue» devant la splendeur et la variété des visions, échappées, perspectives imprévues qui s’offraient à lui, à chacune de ses promenades à pied ou en gondole. Gœthe, qui avait profondément subi les attraits de cette ville de Castors, comme il nommait la perle de l’Adriatique, en emporta dans ses yeux les sortilèges, qui, disait-il, s’y étaient fixés pour toujours et n’en parla désormais qu’en poète hypersensible aux phénomènes de fascination de la rétine par la beauté des choses.
Combien d’autres s’extasièrent devant les radieuses physionomies du palais des Doges, des Procuraties, de Saint-Marc, des palais de marbre du Grand Canal, de Saint-Georges Majeur, de la Giudecca et de cet extraordinaire mélange de terre et de mer, d’églises de tous styles, de coupoles byzantines, de mosaïques orientales, de façades roses baignant dans l’onde de la lagune, de vaisseaux et de gondoles se multipliant devant le quai des Esclavons, sans parler des jardins mystérieux et enchanteurs dépassant les murs de clôture, du peuple en liesse, des carillons et des barcarolles apportant leurs joyeuses vibrations dans la gaîté de l’atmosphère.
ANTONIO DA CANAL
Vue du Colisée à Rome
(Galerie Borghèse).
«Faites, implorait Gasparo Gozzi, qu’autour du Vénitien ambulant rie l’air qui l’enveloppe et que disparaisse à ses regards béatifiés tous les aspects de laideur, de douleur et de misère!»
La prière semble avoir été exaucée pour ceux qui goûtèrent l’heur de vivre dans cette patrie des fêtes carnavalesques et des épousailles de la mer à bord du solennel Bucentaure. Depuis Addison, qui vit Venise en 1700, jusqu’à Montesquieu, J.-J. Rousseau, l’abbé de Bernis, Mme du Boccage, Young, Moratin, Lady Montaigu et Mme Vigée-Lebrun, qui y séjournèrent tour à tour, il n’y eut qu’un concert de louanges, une exaltation d’hommages admiratifs, un constant panégyrique de l’exceptionnel et incomparable foyer d’art et de beauté que représenta la glorieuse Douairière de l’Adriatique, l’urbs-amphibie vivant de la mer et de l’opulence artistique prodigieuse de sa vie d’assolement sur pilotis.
Des peintres affluèrent de tous les points de l’Italie et de l’Europe dans ce bienheureux et libre séjour des plaisirs, des grâces et des ivresses de l’œil assoiffé d’impressions féeriques et de polychromies harmonieuses. Quelques-uns lui dédièrent, à leur passage, le los reconnaissant de leur talent, en symbolisant sur la toile l’image de cette Circé, de cette maravigliosa Regina del Mare. Mais les Vénitiens surtout, et aussi les artistes de Vérone, de Bellune, de Trévise s’entendirent mieux que les forestieri, à fixer avec un éclat et une sensible grandeur d’émotion les véritables traits de l’incomparable Idole.
Il fallait être issu du giron même de cette délicieuse Isola Madre pour la sentir pleinement, pour en percevoir toute la tendresse berceuse et en deviner la rare morbidesse, l’éloquent langage maniéré des architectures et toutes les délicates nuances des frissons de lumière sur la multiplicité de ses visages marmoréens.
Que de physionomies changeantes sur ce «Canal grande» ! Combien de sourires épanouis au seuil de la Basilique et sur la tour de l’horloge donnant accès à la Merceria! Quelle exhubérance de vie, de couleurs fines et nacrées sur la façade inachevée de SS. Giovanni e Paolo, devant la Scuola di S. Marco et sur ce monument équestre, le plus grandiose du monde, que Verrocchio érigea à la mémoire du mâle condottiere Bartholomeo Coleoni, de Bergame.
Toutes ces radieuses visions, reproduites, doublées souvent par le miroir des canaux, déformées parfois par le friselis, l’émoi chatouilleux des ondes plissées et zigzaguantes au passage des gondoles à fleur d’eau, donnèrent à Venise des expressions inoubliables, dont les maîtres de la palette se sont efforcé de restituer toutes les apparences spectrales, les aspects changeants, les magiques transparences et les paysages fantastiques, d’une indicible, exclusive et resplendissante splendeur.
Combien d’artistes peintres et graveurs vénitiens, paysagistes urbains dans l’âme, en dehors même de J. B. Tiepolo et de Francesco Guardi, cherchèrent à exprimer toutes les facettes esthétiques de la ville des Doges, où ils avaient fait vœu de vivre en rajeunissant la tradition de Bellini et du Véronèse. Qui se souvient encore aujourd’hui de Domenico et de Giuseppe Valeriani, de Marco Ricci, de Jacopo Marieschi, de Giambattista Piranèsi, cependant si exhubérant de vie et si prodigue de son talent de graveur original; de Zaïz, de J. B. Cimaroli, de Luca Carlevaris ou de Antonio Marini, qui, tous, méritèrent l’estime des connaisseurs et la ferveur d’une élite d’amateurs passionnés.
Depuis Vittore Carpaccio qui, dans les fonds de ses compositions, nous conserva l’image de la Venise du XVe siècle et surtout depuis le dernier des Vivarini, l’histoire des portraitistes de la Cité souveraine des lagunes serait certes intéressante à écrire, car du point de vue spécial des effigies de cet ancien centre du commerce du monde, cette histoire ne fut jamais réalisée au complet ni à la perfection.
Le nom qui domine tout ce passé aux yeux du public constituant la postérité, celui qui s’impose à la mémoire de tous les lettrés et curieux d’art, est un petit surnom aimable, diminutif sémillant et presque symbolique de la ville des canaux, un nom preste, cascadant dans l’oreille et qui semble avoir fait ricochet comme un palet miroitant à fleur de lagune, c’est un joli sobriquet à l’italienne, celui de Canaletto, le petit canal ou le bambino issu de Bernardo da Canal.
Le Canaletto! Aussitôt prononcé, ce mot évoque tous les visages pittoresques de Venezia la Bella, son Canalazzo, qui est sa grande artère, ses pali ou pieux semblables à des mirlitons géants fichés au-devant des nobles vieux palais princiers et presque tous peints aux couleurs de leurs possesseurs.
Le Canaletto! c’est la Dogana di Mare qui surgit à l’orée de la Giudecca, tout à la punta della Salute; c’est le noble défilé des édifices religieux et civils où apparaissent les styles d’architectures les plus étranges et les plus bâtards dans leur confusion d’accouplement avec les prodigalités du fastueux goût oriental. Les gothiques s’y multiplient au fil des canaux. Celui de Ravenne y épouse la somptuosité du gothico-byzantin, sinon du Roman fleuri et décadent.
On revoit le composite inextricable des frontons, des entablements, des arcs à paraphe où se déploya l’imagination confuse et le grandiose mauvais goût d’un Balthasar Lenghena et de quelques-uns de ses émules et disciples. Dans ces lapidaires extravagances, partout apparaissent, selon le mot de Taraboschi, les métaphores, les concettis et même le gongarisme. L’outrance des Levantins règne avec éclat sur toutes ces physionomies palatiales.
Regardons, éblouis, ces traits fixés par le maître Canaletto d’après ces magnifiques figures de marbre, travaillées comme des coffrets d’orfèvrerie que sont le Cà Doro, les palais Foscari, Balbi, Pisani, Grimani, Dandolo, Rezzonico, et cette Scuola di S. Rocco, sans évoquer ce bijou vénérable, cette châsse monumentale, où tout l’art de l’antique Byzance s’est merveilleusement concrétionné, cristallisé en mosaïques d’or, dans une splendeur mystique et dévotieuse; San Marco, la basilique des Basiliques où l’admiration confine à la piété et s’agenouille vaincue par l’écrasante puissance d’une beauté qu’il est insuffisant de proclamer, mais qu’il faut adorer.
Le Canaletto! c’est encore la Venise des paroisses écartées de S. Maria del Orto et de S. Caterina, proche les Fondamenta Nuove, c’est S. Giorgio Maggiore, c’est Mestre, Le Lido, les îles fameuses de la lagune et les jolies visions du canal de la Brenta. Canaletto a tout aimé des décors de son berceau. Il a tout peint des aspects de sa ville, les quartiers populeux, excentriques, les régions calmes presque désertiques et aussi les grandes assemblées de fêtes, les cérémonies où l’eau des canaux est invisible tant s’y accumulent les gondoles, les felouques, les péotes, les bissones, les embarcations pavoisées et fleuries, même les galères chargées de rames aux rythmes réguliers d’un harmonieux synchronisme.
ANTONIO DA CANAL
Le Palais Ducal à Venise
(Galerie des Offices à Florence).
Il nous a conservé, cet admirable portraitiste, les façons d’être et de paraître de sa cité, jusqu’aux expressions lumineuses et cinématiques des réceptions d’ambassadeurs qui attiraient aux abords du palais ducal, sur la Riva et la Piazetta, des foules curieuses et houleuses, tandis que se pressaient au port des esquifs luxueusement décorés, réservés aux personnages accueillants et accueillis. Quelques-unes de ses toiles ou de ses cuivres, si légèrement et ingénieusement mordus à l’eau-forte, nous ont restitué la vue des Journées des Régates sur le grand canal et aussi et surtout cette pompeuse procession du Bu centaure, qui avait lieu le jeudi de l’Ascension et attirait sur le quai des Esclavons toute la population enivrée et avide d’assister à la triomphale promenade du grand vaisseau de la Sérenissime République, à bord duquel le Doge, coiffé de son carno ducal, entouré d’une escorte toute revêtue de satin ou de velours écarlate, s’en allait dans l’éclat des trompettes, des buccins et des orchestrations de marches nuptiales, lancer, d’un geste symbolique, son anneau de fiançailles à la mer.
De ce coquet surnom de Canaletto se dégagent, à vrai dire, les essentielles et les plus diverses et désirables survivances de la Venise du XVIIIe siècle. Le nombre des tableaux qu’il nous légua pour enrichir nos connaissances de la ville de marbre qui lui avait donné le jour, cette accumulation de vues documentaires est si considérable qu’on n’est pas encore parvenu à en achever la nomenclature. Toutes les galeries publiques en possèdent des exemplaires, mais aussi les collections privées en conservent qui sont difficiles à repérer et à mettre à l’actif de ce maître dont l’inventaire de l’œuvre peint et gravé ne sera sans doute jamais réalisé au complet, pas plus d’ailleurs que sa monographie générale illustrée analytique, critique et biographique qui nécessiterait plusieurs volumes in-folio.
Longtemps, il ne fut question que d’un Canaletto. Il n’y en eut qu’un seul en réalité, Antonio da Canal, qui signa ou écrivit son nom de plusieurs façons: Canal, da Canal, Canale, Canaleto ou Canaletto et Canaletti. Personne, il y a deux siècles, n’y trouvait à redire. L’orthographe des noms propres ou des surnoms était inexistante et n’offrait aucune régularité. Peu importe donc le choix que l’historien peut faire d’une orthographe d’élection en prétendant la légitimer. Nous avons adopté ici la plus noble, celle qui s’adorne de la particule. Le maître des Calli et Canali semble en effet avoir pris en considération sa descendance de la vieille famille patricienne des Da Canal et il nous a plu de satisfaire la seule petite vanité qu’ait peut-être montré eu sa vie cet homme ultra-modeste qui s’immortalisa sous le diminutif de Canaletto.
Presque tous les grands artistes italiens vivent dans notre mémoire sous des noms d’emprunt, comme les apôtres et tous les primitifs et simples artisans qui sont à l’origine des mouvements d’art, de religion et des légendes historiques. On dit le Canaletto (fiston de Canal, ou petit Canal) comme on a dit toujours le Ghirlandajo (issu d’un guirlandier), le Sarto (Andréa), (originaire d’un maître tailleur); le Tintoretto (qui eut pour père un teinturier), le Véronèse (né à Vérone). Tous les peintres de l’Italie du XIVe au XVIIIe siècle subirent cette sorte de métonomasie si amusante à observer et qui déforma leur désignation patronymique comme pour mieux vulgariser leur gloire dans le milieu où leur action s’exerça.
BERNARDO DA CANAL
Perspective de S. Georges Majeur
(D’après une gravure de Canaletto).
Il n’y eut qu’un seul Canaletto, disons-nous: Antonio da Canal. De 1710 à 1750 environ, il conserva l’exclusivité de ce nom, étant donné que ses premières œuvres furent achevées avant 1720, lors de ses débuts en peinture, à l’époque de son voyage à Rome. Son neveu Bernardo Bellotto, étant né en 1723, lors de son retour de la ville éternelle, fut tout d’abord peintre de décors de théâtre et il dut probablement exercer cette profession jusqu’à 1712 approximativement.
Il devint élève de son avunculaire patron jusqu’en 1745 environ, date à laquelle ce jeune Vénitien, d’esprit aventureux, se mit à parcourir l’Europe avec tant d’activité qu’on ne saurait repérer tous ses déplacements ni la durée de sa présence successivement à Rome, à Londres, à Munich, à Dresde, à Pirna, à Vienne, à Saint-Pétersbourg et à Varsovie.
Durant un long temps, il ne fut que Bellotto (et même Comte Bellotto), disciple et neveu du fameux Canaletto. Il signait ses toiles Bellotto, Beloto ou Belotti, toujours sans souci d’orthographe suivie. Sa parenté fameuse à l’étranger, où l’oncle Antonio se refusait à faire de longs séjours, incita les hôtes royaux qui employaient le neveu à lui conférer le surnom du maître, mais ce ne fut vraiment qu’après la mort de celui-ci que Bellotto hérita, soit de son plein gré, soit par un legs régulier d’Antonio da Canal, ce surnom glorieux dont les Vénitiens de l’époque ne connurent peut-être pas la transmission, Bellotto detto il Canaletto fut une signature plus tardive qu’on ne l’imagine et connue surtout à l’étranger.
En tout cas, sur la fin du XVIIIe siècle et dans la première partie du xixe, la conception de deux Canaletto n’était pas encore admise. Bellotto restait à part. Aujourd’hui, il faut bien équitablement accoupler sous ce même surnom le maître et le disciple. Il est sage, sous ce vocable célèbre Le Canaletto, de réunir par une accolade les deux personnalités apparentées par consanguinité, par genre spécialisé et valeur artistique.
Sans Antonio da Canal, toutefois, il n’y aurait pas eu de Canaletto. Seul il fut le créateur incontesté de cette peinture architecturée et perspectivée qui n’existait qu’à l’état informe chez ses prédécesseurs, trop nombreux pour que nous les puissions nommer ici. Tiepolo avait ouvert la voie, mais avec une fougue et une fantaisie impétueuse et opulente qui était loin de s’allier toujours à l’exacte, précise et rigoureuse ordonnance des architectures vénitiennes.
Francesco Guardi fut, lui, le meilleur élève, le plus puissant disciple d’Antonio; il surpassa son maître, car il fut l’animateur des vues de villes et des paysages urbains. Ce fut un véritable maître qui grandit d’autant plus qu’on l’étudié davantage et qu’on découvre peu à peu l’étendue de son talent qui dépasse toutes les limites qu’on avait cru tout d’abord pouvoir lui assigner.
ANTONIO DA CANAL
Vue du départ du Bucentaure pour les fiançailles de la mer
(Galerie de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg).
Antonio da Canal, qui fit usage presque toujours de la chambre optique et qui fut le premier à en démontrer l’emploi rationnel et pratique, selon les découvertes que ses études lui avait fait faire, nous apparaît en quelque sorte comme le précurseur de Joseph Nicéphore Niepce et de Daguerre. Il ne chercha pas à fixer à l’aide d’agents chimiques les images de la chambre obscure, mais il mit toute sa prudente puissance de bon peintre à restituer les visions de l’écran sensible de la chambre noire à l’aide de ses pinceaux dociles à sa technique et à son talent d’exprimer toutes les valeurs chromophotogéniques qu’il avait surtout l’art de «chambrer» ingénieusement.
Il nous semble impossible, dans cette rapide étude de deux hommes si voisins par le génie d’un rendu remarquablement précis des visions urbaines, mais si distants par la vie, le caractère et le tempérament individuel, de ne pas nous satisfaire des deux portraits ébauchés de ces artistes et de ce qu’il nous est possible de concevoir de leur existence, fort peu communiante à vrai dire, du moins dans la ville qui fut le thème préféré de leurs travaux.
Le champ d’évolution qui nous était ici réservé nous oblige à l’abandon de toute velléité d’analyse critique de l’œuvre peint et gravé de Da Canal et de Bellotto. Il nous est même interdit, dans la crainte de perdre l’équilibre nécessaire à notre maintien sur le terrain assigné, d’envisager la multitude des toiles de ces deux maîtres qui se trouvent disséminées dans tous les musées du monde. Ce serait là un autre ouvrage à faire. Les Canaletto ne sont pas aisés à condenser dans une publication de développement restreint. Les tableaux qu’ils ont produit dépassent surtout sensiblement la moyenne des productions d’artistes des siècles précédents. On ne saurait s’attarder à les passer en revue, car il faudrait nombre d’albums pour en réunir et publier une reproduction d’ensemble.
Nous avons accordé à ces deux petits maîtres, qui furent les plus accrédités portraitistes des visages de Venise, l’intérêt que méritait leurs physionomies originales. Toutefois, en tant que prototypes de l’architecturisme et du perspectivisme venus soudainement dans l’histoire de la peinture, il resterait encore à leur prêter une attention toute particulière.
Leurs toiles non datées, la valeur toujours égale de leur talent, la régularité de leur facture, l’impossibilité de découvrir dans leur œuvre des manières différentes se référant à diverses époques de leur vie, ne permettent guère d’investigations critiques bien profondes sur leur entité d’artistes. Cela seul pourrait nous consoler d’avoir écrit à leur sujet ce livre forcément sommaire et incomplet.