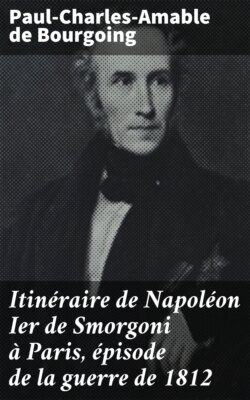Читать книгу Itinéraire de Napoléon Ier de Smorgoni à Paris, épisode de la guerre de 1812 - Paul-Charles-Amable de Bourgoing - Страница 3
CHAPITRE I
ОглавлениеLE DÉPART. — LES TROIS VOITURES. — LE TRAÎNEAU PRÉCURSEUR — L’ESCORTE.
Smorgoni est une petite ville lithuanienne du palatinat de Wilna, devenue célèbre aujourd’hui, parce que c’est de là que l’empereur Napoléon quitta l’armée pour se rendre à Paris, où sa présence était devenue nécessaire. La pensée politique dut l’emporter dans cette grave circonstance sur les considérations qui auraient pu le retenir à la tête de ses troupes. Ce qui importait le plus dans l’intérêt même du salut de notre armée, c’était de se montrer vivant et redoutable encore, malgré ce revers.
Il fallait se présenter à l’Allemagne déjà chancelante dans ses dispositions, et en partie dégoûtée de son alliance avec l’Empereur; il fallait, sans tarder et de nouveau, lui faire subir l’ascendant de sa présence. Il fallait faire connaître à la France inquiète et sourdement agitée, il fallait apprendre aux amis douteux, aussi bien qu’aux ennemis secrets, que Napoléon n’avait point succombé dans le terrible désastre qui venait de frapper ses légions.
La dispersion des régiments était complète dans les premiers jours de décembre 1812, une partie de nos corps d’élite campait encore le soir par fractions de bataillons ou de pelotons graduellement diminués; mais pendant la journée, la majorité de cette multitude de soldats, français et alliés, marchait sans ordre ni discipline. Depuis quelques jours, cependant, nous étions entrés dans les régions lithuaniennes, où le dénûment était un peu moins affreux que dans les contrées que nous avions traversées en partant de Moscou.
Le 5 décembre, nous venions d’arriver, après une marche pénible, sur la place de Smorgoni où se trouvait la maison devenue quartier-général de l’Empereur. Nos généraux avaient conservé leurs chevaux, mais la plupart de leurs aides de camp en étaient réduits à faire la route à pied. Ces états-majors cheminaient péniblement; on partait ensemble le matin, mais on était bientôt échelonné sur la route selon l’inégalité des forces de chacun; toutefois, on se réunissait autant que possible le soir; l’affection mutuelle semblait redoubler par ces misères croissantes supportées en commun.
J’avais alors vingt ans et le grade de sous-lieutenant adjudant-major dans la jeune garde; j’étais attaché, comme officier d’ordonnance et comme interprète, au général de division comte Delaborde, qui commandait une division des tirailleurs et voltigeurs, à laquelle était joint le contingent de Hesse-Darmstadt.
Ce jour-là, le général entra chez l’Empereur avec le duc de Trévise, chef de notre corps d’armée; tous deux en ressortirent peu de temps après. Ils avaient sans doute déjà reçu l’avis d’un départ, ou du moins ils l’avaient pressenti; mais aucune trace d’inquiétude ne se montrait sur leur visage. Ces deux hommes, dont je vénère et chéris la mémoire, étaient de ceux qu’aucun revers, qu’aucune souffrance ne découragent, qu’aucune prévision n’intimide.
Le duc de Trévise, illustré déjà par la victoire d’Ocaña, en Espagne, et par la conquête de d’électorat de Hanovre, avait, dans cette campagne de Moscou, donné de nouvelles preuves de son courage impassible. A Lutzen, son corps d’armée contribua puissamment à la victoire; toute sa vie offrit un constant modèle d’honneur et de fidélité.
Le général Delaborde, en raison des infirmités contractées à la guerre, paraissait beaucoup plus âgé qu’il ne l’était en effet. Vers la fin de la campagne de Russie, il ne pouvait monter à cheval que soutenu par ses aides de camp, mais il était doué d’un cœur intrépide et d’une ardeur entraînante. Une fois à la tête de ses colonnes d’attaque, je le vois encore en souvenir, le contraste d’un dos voûté, d’un visage vénérable et de tout le feu de la jeunesse, électrisait sa division, dont il était adoré. Il avait débuté dans la carrière des armes parmi nos héroïques volontaires de 1792. Son abord était un peu brusque, et son langage avait parfois une tournure soldatesque qu’il lui donnait à dessein, car il était instruit et même lettré : je l’ai vu converser en très-bon latin avec des moines polonais, les trinitaires d’Antokol, de Wilna.
En sortant de la maison qu’occupait l’Empereur, et autour de laquelle on remarquait une grande activité, le duc de Trévise et le général Delaborde s’entretinrent quelque temps avant de se séparer; le maréchal annonça un ordre important qui serait donné dans la soirée aux principaux chefs de l’armée. J’entendis aussi le général prononcer ces paroles: «Il va se passer un fait bien inattendu, mais, selon moi, nécessaire; résignons-nous et ne nous décourageons pas.»
Nous vîmes passer en ce moment un certain nombre de petits chevaux polonais conduits par des paysans; il est probable qu’ils étaient achetés pour les voitures de l’Empereur. Ces chevaux, trouvés dans le pays, étaient en bien meilleur état qu’aucun de ceux qui avaient subi avec nous les fatigues et les privations de la retraite.
Voici de quelle façon je fus témoin du départ de l’Empereur. On avait décidé qu’il aurait lieu la nuit, et les personnes indispensables avaient seules été prévenues. Traverser ce pays, où les batteurs d’estrade de l’armée ennemie s’étaient déjà répandus, semblait, aux plus hardis, une entreprise pleine de périls que la prudence conseillait de tenir secrète.
Je vis partir les voitures qui emportaient l’Empereur, marchant naguère encore à la tête de soldats innombrables. C’était un fait très-grave pour chacun de nous; mais, comme il arrive souvent, les témoins du dernier acte de ce drame funeste n’en furent pas aussi frappés que ceux qui lisaient, à distance, le détail de nos maux. Pour mon compte, j’avais alors toute l’insouciance, l’abnégation personnelle et le dévoûment absolu de mes jeunes contemporains; quelques vétérans seuls murmuraient en ce moment; quant à nous, ce départ ne nous causa ni surprise, ni inquiétude, et il ne me laissa d’autre souvenir que celui du spectacle curieux d’un grand événement historique.
Nous venions d’entrer dans l’izba ou petite maison de bois que nous devions occuper cette nuit-là, pour nous remettre en marche dès les premiers rayons du jour. Arrivé dans ce modeste réduit, le général me parla d’une façon qui ne se ressentait nullement de la triste gravité des circonstances.
«Eh bien! me dit-il, on m’annonce que l’Empereur va envoyer aux généraux de division un ordre important et pressé. Je ne sais comment je pourrai le lire; la provision de bougies de ma voiture est épuisée, et je ne vois à notre portée aucun feu de bivouac dont la clarté puisse y suppléer. Chargez-vous, en conséquence, d’entretenir la seule lumière dont nous disposions ici.» Il me montrait, en me parlant ainsi, le matériel primitif dont la population lithuanienne se sert pour éclairer l’intérieur de ses chaumières, c’est-à-dire de longues et minces planchettes résineuses de sapin, d’une longueur de trois ou quatre pieds, nommées en langue polonaise lucziwa. On plante ordinairement ces lattes gigantesques debout ou inclinées dans un bloc de bois servant de chandelier.
«Je vous recommande, ajouta le général, de ne pas laisser éteindre votre feu. Veillez pendant que je vais dormir. Vous le voyez, mon ami, c’est une occupation de vestale que je vous donne là ; rappelez-vous que c’est pour lire un ordre de l’Empereur que vous allez entretenir le feu sacré. Il veut, dit-on, parler ce soir à plusieurs de ses généraux; le bruit court qu’il songe à partir pour la France; peut-être va-t-il me faire appeler auprès de lui. Il faut que je puisse lire son ordre sur-le-champ; je ne voudrais pas être en retard d’un seul instant dans une circonstance pareille.»
J’obéis avec empressement au brave général Delaborde.
J’entretins la lumière avec soin. Chacune des grandes planchettes de sapin brûlait pendant cinq minutes environ; dès qu’elle approchait de sa fin, je la remplaçais par une autre.
J’avais accompli plusieurs fois cette opération et le général était déjà profondément endormi, lorsque mes regards se portèrent vers la fenêtre qui donnait sur la rue; notre izba, située à droite de la route parcourue par l’armée, était l’une des dernières de la ville. Mon attention fut attirée par la vue de deux chasseurs à cheval de la vieille garde, de cette troupe célèbre formée à l’époque de l’expédition d’Égypte, et nommée dans le principe régiment des guides. Ils étaient reconnaissables, dans cette nuit brumeuse, à leur manteau vert foncé se détachant sur un fond de neige, et à leurs immenses colbacks d’ourson noir, que leurs successeurs actuels ont eu raison de conserver comme un glorieux souvenir. Ces deux cavaliers, cette avant-garde, ces éclaireurs d’une marche aventureuse, pressaient bravement l’allure de leurs chevaux épuisés. Ils se hâtaient autant que le permettaient la neige et le verglas dont la route était couverte. L’un d’eux fit un faux pas tout près de la fenêtre d’où je le regardais avec tant de sympathie; je le vis tomber et presque s’abattre sous mes yeux. Je compris immédiatement ce que signifiaient ces deux cavaliers se pressant ainsi, à cette heure, et dans une pareille nuit. Ils devancent l’Empereur! m’écriai-je. Peu d’instants après, je voyais défiler un traîneau, puis trois voitures de formes diverses, parmi lesquelles distinguai le coupé de l’Empereur que nous connaissions si bien; les deux dernières voitures étaient, selon l’usage de ces contrées, irrégulièrement attelées de plusieurs chevaux grands et petits.
Un peloton fermait la marche. Dès que j’eus aperçu les premiers cavaliers de cette escorte, j’éveillai à la hâte le général, couché dans la pièce voisine; mais les voitures avaient passé si rapidement, qu’il ne put arriver à temps pour les voir. Il jugea comme moi, d’après la description que je lui fis, que c’était l’Empereur qui mettait à exécution le projet annoncé.
Le général Delaborde me dit alors avec son bon sens ordinaire: «Il a raison, il n’a plus rien à faire ici, c’est en France que son devoir l’appelle sans tarder; il a, comme empereur, à Paris dix fois plus de valeur qu’au milieu de nous, près d’une armée désorganisée.»
Nous avions, en effet, déjà reçu la nouvelle de la conspiration de Malet, qui, dans la nuit du 2 au 3 octobre, avait, pendant quelques heures, présenté à Paris des chances de réussite: nous comprenions, en outre, la profonde sensation que, dès ce moment, devait produire, en France et dans toute l’Europe, le récit du désastre dont nous étions les témoins.