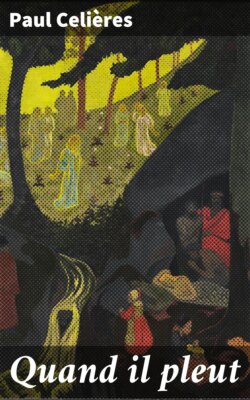Читать книгу Quand il pleut - Paul Célières - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA VENGEANCE D’UN MAUVAIS GARS
ОглавлениеTable des matières
«Il n’y a pas de fumée sans feu.» Si ce proverbe n’était que faux, comme tant d’autres à côté de lui dans ce gros livre que l’on a si improprement appelé la Sagesse des nations, il n’y aurait pas lieu de s’y arrêter. Mais il n’est pas seulement faux, il est faux et nuisible. «Il n’y a pas de fumée sans feu», c’est la porte grande ouverte à toutes les calomnies; c’est le passeport de tous les calomniateurs. Qu’il plaise au premier venu de répandre sur tel ou tel les bruits les plus absurdes, il se trouvera touj ours quelqu’un pour dire en hochant la tête: «Hé, hé! c’est absurde, oui; mais il n’y a pas de fumée sans feu.» Et voilà tel ou tel mis au ban de l’opinion, déshonoré!
Eh bien, n’en déplaise à la Sagesse des nations, il y a, et plus souvent qu’on ne le croit, de la fumée sans feu.
Pourquoi donc, par exemple, il y a une douzaine d’années, tous les habitants de Vaudoy disaient-ils, en parlant de Jacques Fauvel: «C’est un mauvais gars»? Il n’avait jamais fait de mal à qui que ce fût, rien pris à personne; il n’avait, de sa vie, eu maille à partir avec la justice, et on le soupçonnait capable de tout, excepté du bien, qu’il n’aurait peut-être pas manqué de faire si l’occasion s’en fût présentée.
Vaudoy est un petit village de Seine-et-Marne, qui ressemble à tous les villages, mais avec une couleur un peu plus agreste, et en quelque sorte vieillotte. La grande place est nue et raboteuse; il n’y est pas question de pavés; quelques toits de chaume apparaissent encore çà et là; et à l’étal du boucher, les morceaux de viande pendent, comme au temps jadis, à des crocs de fer scellés dans le mur. Quant aux habitants, ce sont des Briards, et tout le monde sait que les Briards ne valent ni moins ni plus que les Tourangeaux, les Picards ou les Normands. Ce sont des paysans avec tous les défauts et toutes les qualités des paysans. Braves gens pour la plupart, incapables de faire sciemment du mal au voisin, ce qui ne les empêchait pas de dire à tout venant: «Jacques Fauvel est un mauvais gars.» Si on leur avait demandé pourquoi, ils auraient été bien empêchés de répondre.
Ce Jacques Fauvel était un grand gaillard d’une quarantaine d’années, amaigri et desséché par le hâle. Ses cheveux longs et sa barbe grisonnante, qu’il laissait pousser par économie, donnaient à son visage quelque chose de rude, quoiqu’il n’y eût rien de dur dans ses traits. Son regard un peu fuyant semblait timide, effarouché; son sourire, quand il souriait, était triste plus que railleur; tout ce pauvre être, enfin, semblait avoir été à la longue abattu par quelque secrète pensée importune qui faisait pencher sa tête et alanguissait tous ses mouvements. Il y avait dans sa démarche, dans son geste, du découragement, de l’abandon;–de la colère, jamais.
Il était sauvage pourtant. Si les besoins journaliers de la vie l’obligeaient à échanger quelques paroles, il se hâtait, visiblement, pour abréger l’entretien. Il sortait peu de chez lui. Le dimanche, seulement, il venait parfois s’asseoir, à l’écart, sur la place, contre le parapet du petit pont, à l’angle de la route, et regardait jouer les enfants–de loin. Cette sauvagerie était-elle la cause ou l’effet de sa méchante réputation? fuyait-il les hommes parce que les hommes l’avaient repoussé, ou le repoussaient-ils parce qu’il les avait fuis? On pouvait pencher pour cette dernière opinion, puisque dès son enfance on l’avait connu tel qu’on le voyait.
Sauvagerie ou timidité, il avait toujours vécu à l’écart, ne parlant guère, se sauvant dans les champs et préférant la société des bêtes à celle de l’homme. Un peu plus tard, à l’âge où l’instinct nous pousse vers la famille et où la vue d’une belle fille fait battre le cœur et monter le sang au visage, Jacques n’avait pas mis les pieds à la danse, n’avait fait d’avances à personne. Il était resté garçon.
Pourquoi?… Hé mais, parce que c’était un être à part, un sauvage, un mauvais gars! Les gens du pays ne s’étaient pas donné la peine de chercher d’autre raison à cet étrange isolement volontaire. Ils ne s’étaient pas dit que Jacques doutait de lui peut-être, qu’il aurait bondi de joie si une des filles du village lui avait tendu la main; ils ne s’étaient pas demandé si Jacques, ayant porté ses vues sur une fille trop riche qu’il désespérait d’obtenir, ne s’était pas juré à lui-même de n’être à personne, puisqu’il ne pouvait être à celle-là. Ils avaient dit: «Jacques est un mauvais gars;» c’était plus tôt fait; et depuis lors on en avait si bien pris l’habitude, qu’il n’y avait plus à revenir là-dessus.
Jacques Fauvel était un mauvais gars.
Il habitait, à l’entrée du village, une maisonnette de pauvre apparence, au milieu d’un petit clos qui tenait d’un côté, comme disent les notaires, à la commune, de l’autre à la route du Plessis, et du côté du village, au potager de Claude Pichard, dont il n’était séparé que par une haie.
Claude Pichard, adjoint au maire, était un des gros bonnets du pays. On le disait riche. Il tenait à ferme les terres de M. de La Haudraye, et cultivait en outre son bien à lui, qui s’arrondissait tous les jours. En dépit de la distance morale qui les séparait. Jacques Fauvel et Claude Pichard, sans être à tu et à toi, n’avaient jamais fait, à proprement parler, mauvais voisinage. Jacques se tenait chez lui, restait dans son droit, et tout allait bien. Quelques mots un peu vifs échangés de temps à autre ne comptent pas; entre voisins qui ne sont séparés que par une haie, c’est chose inévitable et qui ne tire pas à conséquence. Mais cela suffisait à Claude Pichard pour déclarer avec tout le monde que Jacques était un mauvais gars. Aussi, quand il le voyait sourire à ses mioches et faire mine de les appeler, s’écriait-il à pleine voix:
–Rentrez, galopins!
Claude Pichard avait quatre enfants, dont une fille de son premier mariage, Etiennette, qu’on appelait Tiennette, une belle fille qui pouvait avoir alors une vingtaine d’années. C’était l’âge pour la marier. Mais Claude ne se pressait pas. Il arrondissait la dot, estimant que Tiennette pouvait attendre et qu’elle y gagnerait. Quand Jacques, bêchant son coin de terre, entendait par hasard dans le potager du voisin résonner sur le sable les sabots de Tiennette, il enfonçait sa bêche en terre d’un grand coup de pied, croisait ses deux bras sur le manche, et, sans en avoir l’air, la suivait un moment des yeux; puis il s’essuyait le front d’un revers de main et se remettait à la besogne en murmurant:
–Travaille, vieille bête!
Quant à la belle Tiennette, cela va de soi, elle ne songeait pas plus au voisin que si le voisin n’eût jamais existé. Elle n’en parlait que pour dire avec tout le monde: «C’est un mauvais gars.» Ëlle l’avait si souvent entendu dire par tout le monde et par son père!
Mais que pouvait donc reprocher Claude Pichard à ce pauvre Jacques Fauvel? D’où venait–sans parler de sa mauvaise réputation, un fait acquis– cette animosité sourde que l’adjoint dissimulait mal et qui se faisait jour, deci delà, par des mots acérés et des menaces?
D’une chèvre, tout simplement;–la Grise, comme l’appelait Jacques, une vieille chèvre maigre, pelée, d’aspect misérable; le seul être vivant pour lequel il eût des paroles douces et des caresses. Ah! c’est qu’il l’aimait, la Grise! Songez donc! Quand il paraissait à un bout du clos, la Grise, attachée à l’autre bout, tournait la tête, agitait les oreilles en bêlant, et tirait sur sa longe pour venir à lui! Elle l’aimait, cette bête! Ce que les hommes lui avaient .toujours refusé, une bête le lui donnait. N’était-ce pas justice de l’aimer?
Une véritable communion d’idées s’était à la longue établie entre ces deux êtres. Ils se comprenaient.. Parfois, pendant les grandes chaleurs de l’été, quand, sous les feuilles immobiles, l’air alourdi n’est plein que du bourdonnement sourd des insectes, à cette heure où l’on ne travaille pas, Jacques se couchait dans l’herbe à côté de la Grise, lui prenait la tête, et, gravement, à demi-voix, lui contait ses peines, tous les secrets qui lui remplissaient le cœur, qu’il n’avait jamais dits à personne et que personne n’aurait voulu entendre. Quand il cessait de parler, la Grise allongeait son mufle luisant et humide et lui effleurait le visage. Et le pauvre homme pleurait là, tout seul, en face de sa chèvre. Pour sa chèvre il aurait donné sa maison, son clos, tout! Il aurait, lui, supporté peut-être des injures, des coups même; mais il ne fallait pas toucher à la Grise. Aussi, quand il entendait parfois, contre la haie, le voisin Pichard s’écrier:–Veux-tu t’en aller, sale bête! le rouge lui montait au visage, et il répliquait Dieu sait comment. Pour son malheur, la pauvre chèvre était devenue la bête noire de l’adjoint. Disons tout; ce n’était pas sans raison. Jacques tenait habituellement sa chèvre à l’attache. Mais quand elle avait brouté toute l’herbe dans le circuit de sa longe, elle bêlait si plaintivement, elle s’étranglait de si bon cœur, que la pitié lui en venait et qu’il lui donnait sa liberté. Le premier soin de la Grise était alors de courir à la haie mitoyenne, derrière laquelle on entrevoyait un Eden plein de tentations. Elle allongeait le cou dans le fouillis épineux, jouait des cornes, jouait des pattes, finissait par passer la tête et par saisir à tout hasard quelque bonne aubaine; et, dame, un bourgeon de pommier ne pesait pas plus devant elle qu’un bourgeon de saule. A la longue elle avait fini par se frayer dans la haie un ou deux passages où elle glissait la moitié du corps, puis le corps tout entier, et à plusieurs reprises elle avait gambadé et brouté à plein gosier dans le potager. De là les grandes colères de Pichard, qui avait dit à Jacques:
–Méfie-toi! Si elle y revient…
Effrayé par cette menace, Jacques, pendant quelque temps, serra la corde. Mais tout le monde sait ce qu’il faut croire des feintes sévérités d’un père. pour son enfant gâté. Il se trouva, comme par hasard, que la corde était vieille et peu solide. La Grise, en tirant un peu, la cassa et recommença ses escapades.
Il était écrit que, sans le savoir, la pauvre bête rendrait à son maître le mal pour le bien, et qu’elle payerait cher elle-même son ingratitude inconsciente.
Un jour, c’était au printemps de1869, Jacques, parti dès l’aube pour aller travailler aux champs, avait, comme de coutume, attaché la Grise. Il avait choisi l’endroit du clos où l’herbe nouvelle était la plus verte et la plus douce. Il avait laissé la corde assez longue pour que la Grise eût sous la dent déjeuner, dîner et au besoin souper tout ensemble. Mais les bêtes sont comme les gens: ce qu’elles ont ne vaut jamais ce qu’elles voudraient avoir. L’herbe nouvelle était tendre et appétissante sous le gai rayon de soleil qui glissait à travers les branches des pommiers; une brise tiède en courbait doucement les tiges flexibles; toutes sortes de bonnes senteurs se dégageaient de ce coin de terre. Où la Grise pouvait-elle être mieux que là? où? Mais précisément où elle n’était pas; dans le potager du voisin Pichard, où brillaient les longues traînées des poiriers, des pommiers, des pêchers en fleur. C’était une immense nappe blanche, comme s’il y avait neigé pendant la nuit; et le soleil, resplendissant sur tout cela, dorant de reflets inattendus les petits points roses de toutes ces fleurs amoncelées, en faisait jaillir d’irrésistibles tentations. La Grise, mâchonnant son herbe à petits coups, avec ces airs dédaigneux si jolis, même chez une chèvre vieille et pelée, roulait ses deux yeux et regardait le potager du voisin Pichard. De temps en temps elle bêlait en sourdine, tirait sur sa corde, puis, subitement étranglée, se secouait et revenait à son herbe. Mais ce n’était que.de l’herbe. Et là-bas il y avait de si belles et de si bonnes choses de toute espèce! Quel régal! Et le nouveau coup sur la corde était un peu plus fort que le précédent. Bref, l’heure de la sieste n’était pas encore venue, que la corde était cassée; autant dire que la récolte du voisin Pichard était perdue. Pendant toute une journée la Grise piétina dans les plates-bandes, mâchonna les bourgeons, rongea les fleurs;–un vrai carnage!
On se lasse de tout cependant. Quand Jacques rentra, il trouva sa chère Grise détachée, il est vrai, mais couchée bien tranquillement à l’ombre de son pommier, l’air calme, comme si elle avait eu la conscience nette. Le voisin Pichard, qui était dans son potager, ne dit rien, ne souffla mot, et Jacques, ignorant tout, se coucha sans rattacher la Grise. A quoi bon? Elle ne bougeait pas, la pauvre bête, et ne gênait personne.
Le lendemain, quand il s’éveilla dès l’aube, la première pensée de Jacques fut pour sa chèvre, comme toujours. Il ouvrit la porte et cria:
–Viens dire bonjour, la Grise; viens, ma fille!
La Grise ordinairement ne se le faisait pas répéter. Elle était plutôt la première à donner le bonjour du matin, et le plus souvent Jacques la trouvait bêlant à sa porte si elle était libre; dans son étable, s’il l’y avait attachée la veille. Mais ce matin-là rien ne lui répondit.
–Ah! la coquine! pensa-t-il, elle a fait quelque mauvais coup. Pourvu qu’elle ne soit pas allée chez Pichard. ça en serait une histoire!
Il s’approcha de la haie, regarda dans le potager et ne vit rien; il appela de nouveau; rien. Est-ce qu’un mauvais drôle était venu pendant la nuit lui voler sa chèvre? Il en eut froid jusque dans la moelle des os. Mais non; à quoi eût-elle servi au voleur, la pauvre bête? le peu de lait qu’on en pouvait tirer ne valait pas le prix de la nourriture et du gîte, et pourtant la Grise n’était pas là. Jacques fit le tour du clos, regarda dans l’étable, fit un tour en plaine en criant:–La Grise! hé! là Grise! et rentra, triste, inquiet, n’ayant rien trouvé. Comme il traversait son clos pour rentrer chez lui, les yeux machinalement tournés vers le potager du voisin Pichard, il crut voir, dans l’épaisseur de la haie mitoyenne, une tache noire par terre. Son cœur battit dans sa poitrine. La Grise! c’était elle! Il se baissa et doucement:
–Viens donc, grosse bête, lui dit-il, voilà plus d’une heure que je t’appelle.
Comme la Grise ne répondait pas, il allongea la main.
La Grise était froide–morte! Effaré, il prit le corps de la pauvre bête et l’attira vers lui, mais sans pouvoir l’arracher à cette haie maudite où la retenait un lien invisible. A demi fou il plongea, tête en avant, pour voir dans cette forêt d’épines. La Grise avait le cou pris dans un nœud coulant en fil de fer. Le voisin Pichard avait mis un collet dans la haie! le voisin Pichard avait tué sa chèvre! Un flot de rage lui monta à la face. Il prit le corps de la Grise dans ses bras, d’un bond escalada la haie et se précipita chez Pichard en criant:
–Ah! le gredin! il a tué ma chèvre!
Pichard mangeait la soupe en famille avant de partir aux champs. Tout le monde était là, Tiennette, les garçons de ferme et les mioches. Jacques était bien effrayant sans doute, car toutes les cuillers restèrent en chemin, comme par enchantement, toutes les bouches béantes, et les enfants se mirent à pleurer.
–C’est toi, Pichard, qui as fait ça? demanda-t-il.
–Je t’avais prévenu, répondit l’adjoint.
–Tuer ma chèvre!
–Va voir un peu mon potager et tu m’en diras des nouvelles. Elle n’y a rien laissé, ta sale bête.
–Sale bête!
L’homme qui avait tué la Grise, le seul être qu’il aimât, osait la traiter de sale bête! Jacques en eut comme un éblouissement; il laissa tomber la pauvre morte, et sans rien répliquer, sans crier gare, se jeta furieux sur Pichard. La lutte n’était pas égale. Jacques était, grand, nerveux, solide; Pichard était un petit homme replet sans grande vigueur. Du premier coup il l’envoya rouler dans un coin, et, tombant sur lui, se mit à cogner sans savoir où. Les garçons de ferme avaient beau le tirer en arrière, Tiennette avait beau supplier, les enfants avaient beau crier, les coups de poing pleuvaient dru, et Dieu sait ce qu’il en serait advenu si Jacques, sentant son adversaire râler sous sa main, n’avait de lui-même lâché prise.
Il se releva, ramassa le corps inanimé de la Grise, et rentra chez lui en pleurant comme un enfant. Sa
colère était apaisée; il s’était vengé. De ce désastre, il ne lui restait plus que la douleur.
Mais ce n’était pas fini. La rixe avait fait tapage. Du dehors on avait entendu des trépignements et des cris. On avait vu sortir Jacques affolé, sa chèvre dans les bras; et lorsqu’on vit à son tour Pichard, les vêtements en désordre, la face ensanglantée, ce ne fut qu’un cri:
–Jacques a tenté d’assassiner Claude Pichard!
Aveuglé par la rage, celui-ci n’était pas et ne pouvait pas être d’humeur à atténuer les faits. Le procès-verbal qu’il en fit dresser par le maire en présence du garde champêtre et des témoins était accablant. Jacques l’avait à demi étranglé. Sans ses garçons de ferme, il était mort. Le soir même un exprès fut chargé de remettre la plainte de la victime et les dépositions des témoins entre les mains du procureur impérial.
Jacques était dans son clos pendant ce temps-là. Il avait creusé une fosse, y avait couché sa chèvre, et, après l’avoir longuement enveloppée d’un dernier regard, avait rej eté sur elle, en pleurant, les quelques pelletées de terre qui l’en séparaient pour toujours. Puis il était resté là, immobile, stupide, hébété par cette grande douleur dont on riait dans le village. Tant de bruit pour une vieille chèvre pelée!
Oui, mais dans les yeux de cette vieille chèvre Jacques avait trouvé ce qu’il n’avait trouvé dans aucun œil humain: un regard qui cherchait le sien, un embryon d’âme qui venait chercher son âme.
Il en fallait prendre son parti cependant, et se remettre au travail. Huit jours après, s’il n’avait pas oublié la Grise, s’il ne passait pas sans un frémissement douloureux près du pommier où la pauvre bête dormait de son éternel sommeil, il avait oublié du moins, ou semblait avoir oublié le voisin Pichard. Un peu plus triste seulement, un peu plus sauvage, il avait repris le cours de sa vie accoutumée, sans se douter qu’un épouvantable orage s’amoncelait sur sa tête. Comment s’en serait-il douté? Le voisin Pichard était là, lui aussi, comme autrefois, dans son jardin, vaquant à ses travaux de tous les jours. Rien n’était changé. La belle Tiennette, comme autrefois, lui apparaissait de temps en temps, sans plus se soucier de lui qu’autrefois. On ne semblait chez le voisin ne l’aimer ni le haïr plus qu’avant cette échauffourée. Dans le pays, quand il y mettait lepied, c’était toujours le même accueil: un peu de gêne mêlée à beaucoup de peur. Rien de changé, enfin.
Aussi fut-ce pour lui un coup de foudre sans éclair lorsqu’un matin d’août il se vit brusquement en face de deux gendarmes.
–Qu’est-ce que vous me voulez? demanda-t-il.
–On vous dira ça là-bas.
–Vous m’arrêtez?
–Il paraît.
–Pourquoi ça?
–Ce n’est pas notre affaire. En route!
Jacques eut un moment l’idée de résister. Il fit un pas en arrière, allongeant le bras pour saisir sa cognée. Mais les gendarmes étaient prévenus: «Jacques était un homme dangereux.» Avant d’avoir pris son arme, il fut désarmé. Un des gendarmes lui mit les menottes, l’autre le poussa dehors, et en route!
Vaincu par la douleur et par la honte, Jacques, sans même jeter un dernier regard sur la pauvre maison qu’il abandonnait, baissait la tête pour ne pas rencontrer les regards curieux qui le harcelaient. Mais il les sentait, chargés de raillerie ou de haine, se glisser jusqu’à son cœur et le déchirer. Derrière lui, les gamins ameutés couraient. Jusqu’au bout du village il entendit le bruit de leurs sabots sur la route, le murmure confus de leurs voix; puis tout s’éteignit; il n’entendit plus que le pas des deux chevaux à côté de lui et le cliquetis des sabres contre l’étrier.
Arrêté! il était arrêté! Qu’allait-on faire de lui? L’avenir l’effrayait, mais confusément. Ses idées n’étaient pas bien nettes. Il y avait en lui plus de surprise que de peur, plus d’abattement que de colère. Ah! s’il avait été méchant, quels projets de vengeance! quels serments de n’oublier jamais! S’il avait été méchant, Claude Pichard, à compter de ce jour-là, aurait sagement fait de se tenir sur ses gardes.
Et c’était précisément le conseil que tout le monde lui donnait déjà. L’avis général était, à Vaudoy, qu’il aurait été plus sage de ne pas donner suite à l’affaire.
Avec un homme tel que Jacques, c’était jouer bien gros jeu. Poussé à bout par ce procès et l’inévitable condamnation qui en devait être la suite, ne devait-on pas craindre que, le jour où il sortirait de prison, il ne sacrifiât au désir de se venger le peu d’avenir qui lui restait? Et dans ce cas il y allait, pour Claude Pichard, de la vie, ou tout au moins d’une part de son bien. C’est bientôt fait de mettre le feu, ou d’empoisonner un troupeau, l’hiver, quand les bêtes sont au fourrage sec. Pichard, quand on lui parlait de tout cela, faisait le brave et haussait les épaules, mais il n’était pas tranquille au fond. Quant à la belle Tiennette, toute pleine de cette idée que le voisin Jacques Fauvel était un méchant homme capable de tout, elle tremblait franchement pour son père.
Ce qui les rassurait un peu, c’est qu’ils se croyaient loin, bien loin de toutes représailles possibles. Ils comptaient avec tout le monde sur une condamnation exemplaire, en cour d’assises bien entendu. La police correctionnelle était trop peu pour un chenapan de cette espèce. Ce n’étaient pas de méchantes gens pourtant que les Pichard; mais ils jugeaient dans leur propre cause, et avec les préventions enracinées depuis vingt ans, ou plus, dans le pays.
Heureusement pour Jacques, après le garde champêtre etles gendarmes, il y avait les juges. Au cours même de l’instruction, le parquet n’avait pas tardé à découvrir le mal fondé de tous les méchants bruits qui couraient sur le compte du prévenu. Cancans de village, rien de plus. Les antécédents écartés, l’affaire se simplifiait, la tentative de meurtre se réduisait à un mouvement de colère, à quelques coups de poing trop vigoureusement appliqués. Il ne s’agissait plus que d’une comparution en police correctionnelle.
Jacques n’en fit pas moins un mois de prévention, au bout duquel les juges, croyant user d’indulgence, le condamnèrent à trois mois de prison, décision qui le frappa aussi cruellement qu’une condamnation aux travaux forcés.
Sait-on ce que c’est que trois mois de prison pour un pauvre diable? les juges qui prononcent l’arrêt le savent-ils bien eux-mêmes, habitués qu’ils sont à ne voir que des misérables, hôtes habituels de toutes les prisons, qui ne sortent de l’une que pour rentrer dans une autre, et qui remercient le tribunal de leur assurer un gîte en les condamnant? Trois mois de prison! c’est la ruine, la misère quand on en sort, avec la misère le découragement peut-être; c’est une vie brisée qui finira par le suicide ou par le bagne.
Mais on ne pouvait pas acquitter Jacques. Jacques fit ses trois mois de prison. On trouvait à Vaudoy que ce n’était guère; il trouva, lui, que c’était trop, et cela, sans savoir encore, le pauvre homme! qu’après ce châtiment il en devait subir un autre que la loi n’a pas voulu prévoir.
Le jour où on l’avait arrêté, c’était en août, il venait de faucher sa petite moisson, toute en blé cette année-là, c’est-à-dire qu’il avait fait rendre à sa terre tout ce qu’elle pouvait donner. Tandis qu’il était en prison, sa récolte, que personne ne prit soin de rentrer, pourrit sur place. Les fruits de son clos, que personne ne prit soin de cueillir, pourrirent sur l’arbre et tombèrent. Sa provision de pommes de terre, qu’il avait laissée dans un sac devant sa porte, exposée à la pluie pendant quatre mois, s’était changée en une masse boueuse sans forme et sans nom. Le jour enfin où, sortant de prison, il rentra chez lui, il n’y trouva plus rien que la misère, la misère effrayante, car elle arrivait avec l’hiver. De la neige partout; pas de travail possible; pas un sou de réserve au logis, pas de pain dans la huche; pas de crédit chez le boulanger! Lorsque, après un moment d’hésitation et de stupeur, il eut enfin conscience de tout cela, Jacques, debout sur le pas de sa porte, étendit le bras vers. Claude Pichard, qui traversait son potager, et, le poing fermé, lui cria:
–Malheur à toi!
Et cela d’une telle voix, avec un tel accent, que Pichard en frissonna de peur. Il se barricada chez lui cette nuit-là. Il ne sortit plus qu’armé d’un gourdin et suivi de son chien. Encore un peu, il aurait prié le garde champêtre de ne s’occuper plus de rien que de sa sûreté personnelle.
C’était se donner bien du mal inutilement.
Jacques, sa première colère épuisée, n’avait plus songé qu’à vivre. Il était allé vendre à Provins le plus clair du peu qui lui restait, quelques hardes, une vieille montre d’argent, des riens; il en avait le jour même échangé le produit contre les choses les plus indispensables à la vie, et depuis on ne l’avait pas revu. Il ne sortait pas. Mais à quoi pouvait-il songer, tout seul, sinon à tirer vengeance de ses trois mois de prison et de sa ruine? A quoi? Le pauvre garçon lui-même aurait peut-être eu grand’peine à le dire. Il était malheureux, voilà tout, misérable et seul. Tout l’accablait; et sans résignation ni révolte, machinalement, il subissait sa destinée. Comme tous les êtres d’instinct, il souffrait sans analyser sa souffrance, et comme tous les êtres nés bons, sans en accuser personne. Ce qui se détachait le plus nettement dans sa pensée, c’était le souvenir de la Grise, une morte, et l’image de la belle Tiennette, une vivante celle-là, mais plus morte que l’autre pour lui. Et, tout en soupirant à fendre l’âme, avec des larmes parfois –car ces rudes natures pleurent aussi–il travaillait pour faire face aux besoins du printemps qui allait venir.
Aux premiers rayons du soleil d’avril, on le vit, la bêche sur l’épaule, partir aux champs et reprendre sa vie d’autrefois. Il ne se montra pour le voisin Pichard ou pour les gens du pays ni plus acerbe ni plus humble. En cela du moins il avait conscience de sa force. Sa condamnation ne le déshonorait pas à ses propres yeux. Il avait le droit de ne baisser la tête devant personne, et ne la baissait pas. C’en était assez pour justifier une fois de plus la haine et les soupçons qu’il inspirait.
C’était un mauvais gars toujours; et l’on se préoccupa fort des secrètes pensées qu’il roulait dans sa tête, jusqu’au jour où des préoccupations autrement graves détournèrent de lui l’attention.
On était à la fin de juillet1870. La guerre venait d’être déclarée. Quinze jours après, l’armée française avait fondu comme un flocon de neige au soleil; il n’en restait rien.
Les Prussiens, n’ayant plus personne à combattre, marchaient sur Paris. D’un jour à l’autre, on allait les voir à Vaudoy. Il y eut une minute d’affolement. Les vieux, il y en avait encore quelques-uns qui se rappelaient l’invasion de1815, avaient beau dire: «Restez chez vous, c’est le plus sage,» une partie des habitants,–ce fut le plus petit nombre, il est vrai,–empaquetèrent à la hâte le plus précieux de leur bien et se sauvèrent dans la forêt de Chenoise. Les autres s’assemblèrent en tumulte à la mairie pour délibérer. Délibérer? à quel propos? pourquoi? Les Prussiens étàient les plus forts. On était vaincu, il n’y avait qu’à subir la loi du vainqueur. Tel parut être, du moins, au bout de cinq minutes, le résultat de la délibération. On ne s’était assemblé que pour se demander mutuellement un peu de courage; et tout semblait dit, quand une voix s’écria:
–Il n’y a donc pas de fusils dans la commune?
C’était Jacques Fauvel, qui, tranquillement, sans forfanterie, demandait cela du fond de la salle.
–Pourquoi demandes-tu ça? riposta sèchement Claude Pichard.
–Parce que, s’il y a des fusils dans la commune, nous sommes bons pour nous en servir.
–Et après?
–Après.? dame, nous nous serons conduits en bons Français., et c’est quelque chose.
–Et ça nous aura servi.?
–A en démolir une cinquantaine., autant de moins pour les autres communes qui voudraient faire comme nous.
–Qui de cent mille ôte cinquante., dit en ricanant Claude Pichard, reste., fais le compte.
–On ne peut pas tout tuer.
–Et il en restera toujours assez pour mettre le feu aux quatre coins du village et massacrer les habitants.
–Possible! mais, répéta Jacques, s’il y a des fusils dans la commune.
–Oui, ça ferait joliment ton affaire, cette bagarre-là.
–Parce que?
–Parce que, dit Pichard en serrant les dents, ça serait une bonne occasion de me loger une balle dans la tête et de venger la Grise. Ni vu ni connu, pas vrai?
Jacques leva dédaigneusement les épaules, mit ses deux mains dans ses poches, et, sans qu’une lueur de colère traversât même son regard, s’adossa au mur. Si l’on s’était alors prononcé pour la résistance, il n’aurait pas pris de fusil. Mais on n’y songea pas. Jacques avait été seul à prendre au sérieux sa proposition. Il fut décidé qu’on allait rentrer chacun chez soi et attendre. C’était bien la peine de délibérer.
On n’attendit pas longtemps. Dans les premiers jours de septembre, un soir, vers six heures, à la brune, des gens qui passaient en carriole, à toute bride, crièrent sans s’arrêter:
–Les Prussiens!
Il pleuvait à verse. En plaine, l’horizon disparaissait derrière un rideau d’un gris laiteux, sur lequel, çà et là, quelques arbres se dessinaient, vaguement estompés, comme des ombres chinoises.
Dans le village, les rues étaient devenues des ruisseaux où la pluie s’éclaboussait et faisait, en tombant, des milliers d’étoiles. Sous le ciel bas et lourd qui semblait toucher les toits, on n’entendait que le susurrement monotone et triste de l’eau, le clapotement des mares et le ron-ron des gargouilles. Une soirée sinistre!
Au premier cri d’alarme, tout le monde était accouru,–l’angoisse était trop vive, on ne sentait pas la pluie.–Qu’allaient faire les Prussiens? Massacrer, piller, incendier? On avait peur. Tous ces pauvres gens n’en avaient pas encore vu, de Prussiens. Ah! comme ils devaient en voir après ceux-là!
Des gamins qui s’étaient aventurés jusqu’à l’entrée du pays revinrent tout à coup en criant:
–Les v’là! les v’là!
Derrière eux, en effet, retentit bientôt un roulement sourd qui s’approchait, puis le bruit cadencé d’une troupe en marche. L’avant-garde entrait dans le village, cinq minutes après sur la place. C’étaient des Bavarois. Le bleu clair de leurs uniformès semblait noir sous la pluie qui les avait traversés; les chenilles de leurs casques pendaient effilochées sous l’averse; leurs bottes à mi-jambes étaient blanches de boue. Ils marchaient par files de quatre, alignés, impassibles comme à la parade, sans souffler mot, sans tourner la tête. En moins de rien, la place en fut couverte; le détachement s’arrêta, l’arme au pied. Pas un homme n’avait bougé de son rang. Harassés de fatigue, mourant de faim, grelottant sous cette pluie glacée d’automne, ils attendaient un ordre et restaient là comme des statues. L’officier qui les commandait, un maj or, mit pied à terre devant la mairie. C’était un grand et bel homme, blond, comme presque tous, les yeux bleus, barbe en éventail, qui n’avait rien de dur ni d’effrayant. Grandes manières, du reste, et belle prestance de soldat.
–Le maire? dit-il d’une voix brève.
–C’est moi, répondit Claude Pichard.
–Bon. Suivez-moi, reprit le major en gravissant les marches du perron.
Il parlait le français en homme qui le parle depuis longtemps, correctement et presque sans accent. Les habitués du boulevard des Italiens l’auraient reconnu sans doute; ils avaient dû le voir plus d’une fois au café Anglais ou chez Bignon.
Il avait pris une chaise et s’était assis dans la salle de la mairie, devant la table, au-dessous du buste de l’empereur, à la place du maire.
–Huit cents hommes à loger, dit-il, et quarante chevaux. Distribuez ça, que tout soit prêt dans une demi-heure.
–Mais.
–Les observations sont inutiles. Vous me fournirez deux cents bottes de paille et dix sacs d’avoine. Le pain de mes hommes est mouillé, huit cents rations; pour la viande, quatre vaches et dix moutons.
–On ne peut pourtant donner que ce qu’on a.
–Les Allemands payent, riposta fièrement le major.
Et il allongea la main pour prendre sur la table une feuille de papier. Il allait sans doute donner à Pichard un bon sur la commandature. Mais il n’eut pas plutôt jeté les yeux sur la feuille, qui portait comme en-tête: «Commune de Yaudoy, mairie» qu’il défonça la table d’un coup de poing en s’écriant:
–Vaudoy!… nous sommes à Vaudoy?
–Mais, dame, oui, répondit Pichard.
C’était clair, le major ne se croyait pas à Vaudoy. Il avait fait fausse route. Ce n’était guère, on le sait, dans les habitudes de nos ennemis, mais une fois n’est pas coutume. D’un bond, il se précipita dehors, échangea vivement quelques paroles en langue allemande avec ses officiers et rentra dans la mairie.
Pendant ce temps-là, toujours alignés sous la pluie, toujours immobiles, toujours silencieux, sans même un signe d’impatience, les soldats attendaient, l’arme au pied.
–Combien d’ici à Courpalais? demanda le major.
–Quatre bonnes lieues par les routes.
–Et par les traverses?
–On peut gagner une lieue.
–En partant d’ici à trois heures du matin, nous pouvons y être au petit jour?
–Dame. oui. quand on sait les chemins.
–Vous me donnerez quelqu’un pour me guider.
Un des deux garçons de ferme de Pichard se trouvait là.
–Colinet, lui dit l’adjoint, peux-tu conduire ces messieurs?
–Tout de même, répondit Colinet en se balançant d’un air bête que démentaient ses yeux vifs et le sourire gouailleur de ses lèvres.
–A trois heures, dit le major, et fais attention. il fera nuit noire. mais j’y verrai assez clair pour te brûler la cervelle en cas de besoin.
Colinet ricana bêtement et répondit:
–Faudra voir.
Une demi-heure après, tout dormait ou semblait dormir à Vaudoy; hommes et chevaux étaient dans leur gîte. On n’entendait plus rien que la pluie qui tombait toujours, et d’instants en instants, un hennissement ou un coup de pied de cheval impatient dans la porte de son écurie. Çà et là des lueurs brillaient aux. fenêtres et dansaient dans les flaques d’eau de la route. Un passant ne se serait pas douté que l’invasion venait de commencer et que l’ennemi veillait dans ce village silencieux et calme. Les sentinelles mêmes étaient invisibles. Il y en avait pourtant. On aurait pu, en prêtant l’oreille, entendre plusieurs fois pendant la nuit leur Wer da? impérieux.
A trois heures du matin, toutes les portes s’ouvrirent.
A la lueur des lanternes, les Bavarois remirent sac au dos, et, toujours sans bruit, se massèrent sur la grande place; puis le détachement, guidé par Colinet, se mit en marche, pour arriver à Courpalais avant le jour..
Claude Pichard, qui s’était levé pour assister au départ, se refourra dans ses draps en se frottant les mains et en se disant:
–Après tout, si ce n’est que ça, l’invasion!… Ça nous coûtera quelques bottes de paille. et encore. s’ils les payent.
Tout s’était bien passé, oui. Mais Pichard se hâtait un peu trop de se réjouir.
Au petit jour, comme il rouvrait les yeux, il lui sembla entendre un crépitement de détonations. Il rêvait sans doute.
–Tiennette, cria-t-il à sa fille, qui couchait dans la pièce voisine, entends-tu?
–Oui, père, on dirait qu’on se bat.
Il s’habilla à la hâte et courut sur la place; on savait peut-être quelque chose. Il y avait déjà beaucoup de monde, en effet. Mais on ne savait rien, sinon que la fusillade, qui avait commencé vers quatre heures du côté des bois du Plessis, se rapprochait sensiblement, et les conjectures allaient leur train, lorsqu’une vingtaine de Bavarois débouchèrent tout à coup sur la place, par les ruelles.
Ils étaient couverts de boue et de sang; l’un d’eux tomba devant l’étal du boucher et ne se releva plus; puis on entendit quelques coups de feu très rapprochés et la colonne entière qui était partie cette nuit-là même de Vaudoy y rentra, mais visiblement réduite. Il y devait manquer plus de cent cinquante hommes.
Le major arriva le dernier, à cheval, surveillant sa retraite. Il était pâle comme un mort; un mince filet de sang lui coulait du front sous son casque. Il mit pied à terre, marcha droit sur Pichard, le prit par sa blouse et, sans rien dire, le colla au mur de la mairie, ou deux soldats, sur un signe de lui, vinrent se placer à ses côtés; puis il escalada les marches, entra dans la salle et en ressortit bientôt, un papier à la main.
–Le garde champêtre? cria-t-il.
Le garde champêtre, qui se trouvait là, s’approcha tremblant.
–Prenez votre caisse, lui dit-il, et tambourinez ça dans le pays.
Le garde obéit, ébaucha un roulement;– ses mains tremblaient si fort!–et lut à haute voix:
«Le2e bataillon du4e régiment bavarois a été volontairement égaré cette nuit et jeté dans une embuscade de francs-tireurs, par un guide appartenant à la commune de Vaudoy.
«En conséquence, le major Schlembach a décidé que le maire de la commune, ou l’homme qui s’est donné comme tel, serait fusillé. Ordre à tous les habitants de la commune d’assister à l’exécution, qui aura lieu dans un quart d’heure.»
Tiennette, que tout ce bruit avait attirée dehors, arrivait sur la place, avec les enfants, au moment même où le garde champêtre donnait lecture de cét arrêt de mort.
Elle se jeta désespérée au cou de son père, en disant:
–Je ne veux pas! je ne veux pas!… Mon père!
Les enfants, voyant pleurer leur grande sœur, se mirent à sangloter et s’accrochèrent avec elle aux vêtements du pauvre Pichard. C’était comme une grappe humaine suspendue à son cou, et qui le couvrait de larmes et de baisers affolés.
Le major Schlembach roulait une cigarette, appuyé à la balustrade de l’escalier. Le peloton d’exécution était déjà sorti des rangs et s’était venu placer à dix pas devant Pichard, toujours enveloppé dans l’étreinte désespérée de ses enfants. Autour. d’eux, il y avait un grand espace vide. Personne n’osait approcher. Seul, Jacques Fauvel avait eu l’audace de venir se planter debout à côté du major, appuyé comme lui à la balustrade de l’escalier de la mairie. Il regardait le pauvre Pichard, et dans son regard il y avait comme de l’envie. «Est-il heureux d’être aimé comme ça!» semblaient dire ses yeux; «mourir comme lui vaudrait mieux que vivre comme moi.»
Sur un geste du major, on avait arraché Tiennette et les enfants des bras de leur père; et le regard de Claude, qui les suivait, rencontra celui de Jacques.
–Ah! lui dit-il amèrement, ce n’est pas toi, Jacques, qui vengeras la Grise. On s’en charge, tu vois!
Jacques haussa les épaules. Tranquillement il s’approcha du maj or et lui mit la main sur l’épaule.
Rien que cela, c’était risquer sa vie. Il y eut, dans la foule amassée déjà sur la place, un frémissement de surprise. Que voulait Jacques à cet Allemand?
Jacques n’était capable de rien de bon, et cependant on lui savait presque gré de son audace.
–Vous allez fusiller cet homme-là? dit-il enfin au major, d’une voix calme, au milieu d’un silence de mort.
L’officier, frappé malgré lui de l’attitude imposante et ferme de ce paysan, hésita une seconde et répondit:
–Oui.
–Et qu’a-t-il fait? que lui reprochez-vous?
–J’ai perdu cent cinquante hommes cette nuit. Je n’en prends qu’un ici. Vous devriez me remercier. J’aurais pu vous fusiller tous.
–C’est pour l’exemple alors?
–Oui.
–Si ce n’est que pour ça, qu’est-ce que ça vous ferait d’en fusiller un autre à sa place?
Le major ne répondant pas, Jacques reprit:
–C’est un homme bien inoffensif. Tandis qu’il y en a dans le pays qui pourraient bien aller vous guetter en plaine et vous loger une balle dans la tête. Un homme vaut un homme pour l’exemple. J’en ferais peut-être autant à votre place. mais, voyons, lui ou un autre.
–Hé! peu m’importe! dit le major en tournant le dos, comme impatienté. S’il trouve quelqu’un pour ça, qu’il s’arrange.
Jacques alors, toujours impassible, toujours calme, alla droit à Pichard, et l’arrachant de la muraille où le clouait la peur:
–Sauve-toi, lui dit-il, et vivement.; l’affaire est arrangée.
En même temps il avait pris sa place contre le mur et s’y plantait debout, les bras croisés, devant le peloton.
Pichard, ahuri, le regardait sans bien comprendre et murmurait:
–Non. non. c’est trop!… ça ne se peut pas!
Mais Tiennette, qui avait tout vu, tout entendu, tout compris, l’entraînait folle de joie; les enfants le Liraient de leur côté; et il s’éloigna en répétant:
–Ça ne se peut pas! ça ne se peut pas!
Jacques, immobile entre les deux Bavarois, avait, lui, regardé toute cette scène sans émotion apparente. Mais une larme pendait à ses cils; et quand Tiennette disparut à l’angle de la ruelle, on aurait pu l’entendre murmurer:
–Ça se comprend.
Et cependant il y avait un amer reproche dans ce pardon. Reproche injuste, car Tiennette revint. La tète haute, elle traversa l’espace vide qui la séparait de Jacques. Quand elle fut tout près de lui, elle s’agenouilla dans la boue et, comme Madeleine au Christ, lui baisa les pieds en disant:
–Pardon! pardon! pardon!
Elle sanglotait, la pauvre fille.
–Pardon, oui, répondit doucement Jacques; mais à une condition, c’est que vous mettrez sur ma tombe une croix de bois noire, et que sur cette croix on écrira: «Ci-gît un mauvais gars!»
–Oh! Jacques! Jacques! murmura Tiennette en s’enveloppant la tête dans sa blouse; vous étiez trop grand pour nous autres.
En ce moment le major regarda sa montre, la remit dans sa poche, jeta sa cigarette et se retourna. Occupé avec ses officiers, il n’avait certainement rien vu de tout ce qui venait de se passer; car, en apercevant Jacques devant le peloton d’exécution, il s’écria:
–Qu’est-ce que vous faites là, vous?
–Dame, répondit Jacques, vous voyez, j’attends.
–Quoi?
–Qu’on me fusille. et même, si ça vous était égal d’en finir. j’aimerais mieux ça.
–Vous avez pris la place de cet homme?
–Il paraît.
–Vous voulez mourir à sa place?
–Écoutez donc. je n’ai pas d’enfants, moi.
Il y avait dans ces quelques mots, dans le ton dont ils étaient dits, une si sublime résignation, un si amer regret de toute une vie manquée, tant de larmes refoulées, une telle explosion du cœur enfin, que le major, involontairement, se redressa et fit le salut militaire à l’homme qui allait mourir.
Qui allait mourir? Même à ce Bavarois, la chose parut impossible alors. D’un geste, il écarta les soldats, renvoya le peloton, et s’adressant à Jacques:
–Va-t’en! lui dit-il, que je ne te revoie plus!
Une acclamation s’éleva dans la foule.
–Silence! cria le major, ou je mets le feu aux quatre coins du pays!
Il sentait comme une rage secrète d’avoir été vaincu par ce paysan.
Une heure après, les Bavarois étaient partis; la place était vide. Les gens de Vaudoy étaient rentrés chez eux commentant cette aventure incroyable, dont le dénouement était bien facile à prévoir.
Dans les premiers jours du printemps suivant, Jacques épousa Tiennette; et si quelqu’un s’était avisé de dire que c’était un mauvais gars, Claude Pichard, au risque de faire à son tour.six mois de prison, aurait assommé ce quelqu’un-là.