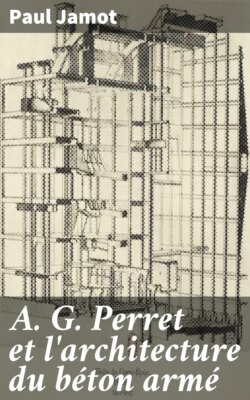Читать книгу A. G. Perret et l'architecture du béton armé - Paul Jamot - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1898-1910
ОглавлениеIl est naturel qu’une découverte comme celle du béton armé, c’est-à-dire d’une matière possédant des vertus éminentes de plasticité, de solidité et de bon marché, retentisse profondément sur les conceptions des architectes et le style de leurs ouvrages. Car, en tout temps et en tout pays, une règle primordiale s’impose au bon sens: sauf exception et pour de petits monuments de destination spéciale et de caractère précieux, l’architecte doit employer la matière et le procédé de construction dans lesquels il trouve le plus de facilité et d’économie. Mais, pour faire porter à cette règle tous ses fruits, il faut l’intervention d’une intelligence prédestinée, d’une volonté, d’un courage.
Dès le milieu du siècle dernier, l’emploi du fer, avant celui du béton armé, aurait dû marquer l’avènement d’un style approprié à des matériaux nouveaux et à de nouvelles méthodes. Roger Marx rappelle que la mise en œuvre rationnelle des découvertes de la science et de l’industrie a été souhaitée, espérée; par des hommes qu’on n’accusera pas d’être des contempteurs du passé : Prosper Mérimée, Léon de Laborde, Eugène-Melchior de Vogüé. Mais bien rares furent les praticiens qui comprirent l’efficacité d’un tel programme pour la rénovation de l’architecture, La plupart s’obstinèrent à répéter, en les amalgamant avec plus ou moins de tact, les formes et les décors des modèles anciens. Comme il est naturel, ces formes et ces décors, n’étant plus commandés ni par les propriétés des matériaux ni par la destination des monuments, prirent un aspect de plus en plus factice. L’appareil extérieur, au lieu d’annoncer la structure interne, devint un masque sur lequel les facilités fournies par les procédés modernes firent croître une ornementation surabondante et dépourvue de sens. Le goût du pastiche et du faux luxe fut encore favorisé par l’influence des Expositions universelles. Dans ces foires où un plan d’ensemble est presque impossible, que ferait la simplicité au milieu de bâtisses hâtives et prétentieuses? «Un son de voix clair, mais modeste et harmonieux, se perd dans une réunion de cris assourdissants et ronflants .» On put craindre que le goût français ne se fût dépouillé de ses qualités natives, quand certains, plus audacieux, pour réagir contre des redites fastidieuses, prétendirent créer de toutes pièces un style qui ne devrait rien à la routine. La double faute de ces novateurs fut d’oublier que la simplicité, la raison, la clarté sont le fond solide et permanent de notre esprit national, et de substituer à l’imitation du passé l’importation des modes étrangères. Là aussi bien qu’ailleurs, ce désir de nouveauté, qu’il n’est pas nécessaire d’appeler progrès et où il suffit de reconnaître le mouvement, signe de la vie, doit se concilier avec ce respect de la tradition qui fait que les générations successives sont reliées entre elles par un même esprit et un même sang, comme les âges de l’individu.
Les noms assez malencontreux d’ «art nouveau» et de «modern style» ne servirent guère d’étiquettes qu’à des tentatives incohérentes et avortées.
Il y a trois quarts de siècle que le béton armé fut inventé par un jardinier de Boulogne, Joseph Monnier. Ce fut, en 1849, la trouvaille fortuite d’un homme qui faisait de la rocaille pour bancs, kiosques et ponts de jardin et qui cherchait à rendre ses produits plus économiques et plus solides. Les ingénieurs virent, non pas tout de suite, mais ils furent les premiers à voir, l’intérêt de cette découverte. Depuis vingt ou vingt-cinq ans surtout, de magnifiques travaux d’art, viaducs, ponts de chemins de fer, usines, qui eussent été impossibles sans l’emploi du béton, furent exécutés en France et à l’étranger. Mais personne, avant Auguste Perret, ne se rendit pleinement compte des immenses ressources qui s’offraient à l’architecture.
Suivant le cours ordinaire des choses humaines, il est presque inévitable qu’une révolution esthétique rencontre d’abord une vive et tenace opposition dans le public et même chez les artistes. Car le public est l’animal dont les cent mille têtes sont enserrées dans le réseau de l’habitude, et, sous une forme plus noble, sous l’étiquette infiniment respectable de la tradition, l’habitude gouverne aussi l’esprit d’un très grand nombre d’artistes. Au nom des maîtres dont ils se disent les héritiers et des chefs-d’œuvre qu’ils croient continuer, ils protestent contre des nouveautés qu’ils déclarent pernicieuses.
Pl. II
Mais, en art, c’est l’opinion d’un petit nombre qui finit toujours, au bout d’un temps plus ou moins long, par devenir celle de la majorité. Je crois que l’heure de ce revirement est sur le point de sonner pour Auguste Perret. Le moment est donc opportun pour juger l’œuvre qu’il a déjà accomplie et sa part, qui est prépondérante, dans une rénovation architecturale que le public est bien près d’accepter. Auguste Perret est à la fois un initiateur et un réalisateur.
Ce qui le mit mieux à même de prendre sur ses contemporains une telle avance, ce fut sans doute l’éducation spéciale qu’il avait reçue et l’expérience pratique dont il fut de bonne heure pourvu, en sa qualité de fils d’entrepreneur, bientôt appelé à diriger avec ses frères la maison paternelle. Il eut ainsi l’occasion d’employer largement le béton armé pour le compte des autres, du moins dans les usages auxiliaires où il était alors confiné, et ainsi d’en étudier la fabrication et les modes d’application.
Les frères Perret sont nés à Bruxelles, Auguste le 12 février 1874, Gustave le 14 mars 1876, Claude le 7 juillet 1880. Leur père était Bourguignon, des environs de Cluny. N’est-il pas curieux que l’artiste, dont la destinée était d’orienter l’architecture vers un style nu et sans ornement, vienne de cette région où l’Ordre de Cluny donna, il y a huit siècles, un magnifique essor à l’architecture romane et où la célèbre abbaye du même nom se construisit une église, la plus grande autrefois de toute la chrétienté, dont la beauté résidait, presque sans l’aide du décor ni de la sculpture, dans la pureté et la hardiesse des lignes et la justesse des proportions?
Auguste et Gustave Perret se succédèrent de près à l’École des Beaux-Arts dans l’atelier de Guadet. Celui-ci se souvint toujours du brillant élève qu’il avait eu en la personne d’Auguste Perret. Pour des raisons de famille, son père ayant besoin de lui, Auguste quitta l’École avant d’avoir conquis le diplôme. Mais il avait remporté toutes les autres récompenses depuis le jour où, à dix-sept ans, il avait l’honneur de voir un de ses premiers dessins (quatre colonnes et un fronton) officiellement proposé à l’admiration de ses camarades. Il parle encore volontiers de ce qu’il dut alors à l’enseignement sévère et rationnel du bon théoricien qui fut son maître.
Au cours même de ses études à l’École, il poursuivait d’ailleurs son apprentissage pratique. Ce fut pour lui un avantage dont quelques raisons plausibles et surtout des préjugés privent de nos jours la plupart des architectes. Au lieu de devenir, comme tant d’autres, un homme qui fait, ou fait faire, dans un bureau, des plans et des dessins, sans daigner savoir comment ni par qui ni par quels moyens ils seront réalisés sur le terrain, il ne sépara jamais dans son esprit la tâche de l’artiste et celle du constructeur. Par là, il se trouvait acheminé vers une conception heureuse qui a fait ses preuves au moyen âge. Car c’est par des maîtres d’œuvre ainsi instruits et entraînés que furent élevées nos grandes cathédrales. Rien ne le préparait mieux que cette expérience acquise sur les chantiers à réfléchir aux problèmes qui se posent de nos jours devant l’architecte.
Au compte de ces années de débuts, je crois bon de citer un vaste bâtiment rue du Faubourg-Poissonnière. Il n’y était pas encore question de matériaux nouveaux ni de nouveaux procédés de construction. Mais on y voit le souci de donner satisfaction par un plan bien étudié aux besoins modernes. Tout aménagé en bureaux, ce fut, à la date de 1898, le premier exemple réalisé à Paris et adapté aux nécessités françaises d’un type de bâtiment créé par les Américains.
Presque au même moment (1898-1899), un ouvrage de beaucoup plus important, le Casino municipal de Saint-Malo (pl. II), montre déjà des tendances plus personnelles. Le béton y est employé pour le plancher à vaste portée qui couvre le bar. Mais, à cette époque, une municipalité, faisant les frais d’un casino, n’aurait pas voulu d’une construction où le ciment armé fût apparent. Les frères Perret jugèrent que le mieux était d’employer les matières qu’on trouvait sur place, granit, brique, ardoise et aussi, dans une certaine mesure, les formes traditionnelles de l’architecture rustique du pays. Mais ce qui fait le mérite principal de l’œuvre, c’est la logique et la clarté du plan, avec un goût certain de la sobriété.
Enfin, en 1902, étant tout à fait maîtres de leurs actions, puisqu’ils agissaient pour leur propre compte sur un terrain qui leur appartenait, ils construisirent la maison, sise 25 bis, rue Franklin, dont le rez-de-chaussée est toujours occupé par leurs bureaux (pl. III). C’est la première maison de rapport, tant en France qu’à l’étranger, dont le plan tout entier soit en fonction du béton armé . Ce sont les poteaux de l’ossature qui dessinent la façade et c’est grâce au béton que l’architecte a tiré un parti extrêmement ingénieux d’un terrain exigu. Perret supprime cette cour intérieure qui presque partout n’est qu’un triste puits sans air ni lumière et dont la surface imposée par le règlement (56 mq. 66) aurait rendu ici tout revenu impossible.
Pl. III
Par un décrochement hardi qui creuse sur la façade une espèce de cour extérieure entre deux tours en surplomb , il obtient un développement qui semble paradoxal de pièces prenant toutes, largement, jour sur la rue. Le seul reste de l’esthétique de 1900 qui subsiste dans ces formes si nouvelles et si pratiquement calculées, c’est le revêtement en grès avec un dessin de feuillages, élégant et discret, ton sur ton, mais peut-être insuffisamment stylisé. On peut regretter d’ailleurs que la première intention d’Auguste Perret n’ait pas été suivie; il voulait donner à ce dessin de feuillages un caractère purement géométrique, dans le genre de la rosace qu’il devait bientôt dessiner pour une baie vitrée au Garage de la rue de Ponthieu. Deux ou trois ans plus tard, il se serait sans doute abstenu de tout décor; loin de meubler les surfaces nues, c’est dans leur rapport avec les baies et les divisions de la façade qu’il aurait cherché le rythme de sa composition. Tout compte fait, une grande considération est due à ce premier essai de construction en béton armé, et, s’il faut défendre le revêtement de grès, on peut bien dire, sans y mettre, je crois, d’exagération sophistique, que cette marqueterie de feuilles, par son aspect réel de légèreté autant que par l’idée qu’elle suggère, était bien faite pour souligner le caractère fondamental d’une architecture où toute l’autorité réside dans l’ossature des poteaux, le reste n’étant qu’un léger remplissage dont la matière est presque indifférente.
Restait encore à trouver, cependant, la véritable esthétique de cette architecture nouvelle. En d’autres termes, il fallait montrer qu’un édifice uniquement régi dans son ensemble et dans toutes ses parties par l’emploi rationnel du béton armé, avec la plus grande économie possible de matière et de main-d’œuvre, pouvait avoir sa beauté propre et, malgré l’absence de tout ornement superflu, être une œuvre d’art.
C’est la démonstration qui fut faite, avec l’élégance et la perfection d’un théorème, au Garage de la rue de Ponthieu (pl. IV et fig. 1). Il s’agit là d’un bâtiment destiné à un très modeste et très pratique usage. Mais de simples écuries, à Versailles ou à Chantilly, n’ont-elles pas inspiré des chefs-d’œuvre à nos architectes du XVIIe et du XVIIIe siècle? C’est un grand mérite d’Auguste Perret que d’avoir l’un des premiers compris ce qui sera, ce qui doit être un principe directeur de l’architecture moderne. Grâce aux matériaux et aux procédés actuels, toute construction à usage commercial ou industriel peut satisfaire aux exigences de notre goût, pourvu qu’elle ne cherche pas à se déguiser sous des apparences ou des conventions arbitraires et que tout y soit calculé avec franchise et justesse en vue de la meilleure utilisation possible. Une usine bien faite vaut mieux, même esthétiquement, qu’un théâtre ou un «palace» surchargé de faux luxe dans le style prétentieux et incohérent qu’a trop répandu naguère le mauvais goût issu des Expositions universelles. L’architecte, de nos jours, doit concevoir le plan de son œuvre en ingénieur et le réaliser en artiste; mais l’art n’y doit pas être ajouté comme en surcroît; il n’est qu’une floraison naturelle produite par la logique du plan, la justesse et l’harmonie des proportions, le soin donné à l’exécution. Aujourd’hui tout le monde admire les Hangars d’Orly et se rend compte que cet immense vaisseau sans points d’appui à l’intérieur, fait pour permettre aux dirigeables d’entrer et de sortir en plein mouvement, a une beauté qui n’est pas indigne d’être comparée à celle des nefs gothiques, précisément parce que rien n’y prétend imiter l’architecture ogivale et qu’on s’est contenté de pousser jusqu’à l’extrême de la hardiesse, sans dépasser les limites de la sécurité, cette prodigieuse carcasse nue que rend possible la puissance du béton.
Au cours de ces dernières années, les frères Perret eux-mêmes ont manifesté cette imagination de l’ingénieur sûr de ses calculs dans des constructions purement industrielles du même genre. Tels, ces Ateliers de confection, avenue Philippe-Auguste (1919), où ils avaient à doubler une vaste nef existante, construite en fer (pl. XXXIII). L’architecture en fer semblait naguère la seule propre à obtenir un maximum de légèreté et de clarté. Aujourd’hui on peut comparer les deux ateliers parallèles: la supériorité de la nef de béton est éclatante. Tels aussi les Docks de Casablanca (1916), avec leurs minces voûtes surbaissées; elles ont 3 centimètres d’épaisseur, et ce sont les premières aussi minces qui aient été faites, en France ou ailleurs. Un jeu de briques en claire-voie assure la ventilation et prend la valeur d’un décor, suivant la juste et constante règle d’Auguste Perret, qui veut qu’on ne tourne en ornement que ce qui est nécessaire; et l’on constate que ces Docks on ne peut plus modernes, que domine une éolienne en acier, s’harmonisent très bien avec la ville arabe (pl. XXXII).
Fig. 1. — Garage d’automobiles, rue de Ponthieu. Plan.
En 1905, théoriques ou pratiques, de telles vues étaient bien rares, ou plutôt il n’y avait guère qu’Auguste Perret qui y songeât. Au Garage de la rue de Ponthieu, la façade ne fait pour ainsi dire que laisser transparaître l’ossature de la construction. Il n’y a que du verre, pour introduire à flots la lumière, et des poteaux verticaux coupés par quelques horizontales. Le seul décor est l’espèce de rosace géométrique dont les cercles concentriques unis par des rectangles et des losanges occupent la grande verrière centrale. Mais il a suffi de galber les poteaux et de marquer avec franchise et netteté les divisions naturelles pour donner à cette sorte d’épure un visage harmonieux, élégant et ce je ne sais quoi de vivant qui décèle la construction adaptée aux besoins humains. Le Garage de la rue de Ponthieu est une date décisive dans une histoire qui fera honneur à notre pays devant la postérité. C’est le premier édifice où s’affirment clairement et sans compromis des principes dont on n’aura plus ensuite qu’à développer les conséquences. Ces développements, d’ailleurs, les frères Perret seront longtemps les seuls à en fournir les exemples. Car on ne comprit pas tout de suite la valeur insigne de cet ouvrage qui du premier coup définissait en ses linéaments fondamentaux l’esthétique du béton armé.
Des travaux divers remplissent les années suivantes, et on ne doit pas négliger même ceux qui ne sont que des arrangements de bâtisses plus ou moins anciennes, comme par exemple, cette transformation d’une maison de campagne à Bièvres (1909-1910), où Auguste Perret mit tant d’intelligence, d’ingéniosité et de goût (pl. XXXVII). Cependant il faut aller jusqu’au Théâtre des Champs-Elysées pour que l’attention générale se porte sur ce jeune architecte qui était jusque-là inconnu du grand public. De longues discussions s’élevèrent. A des détracteurs violents, des admirateurs convaincus répondirent; mais bien peu nombreux furent alors ceux qui de l’avenue Montaigne poussèrent jusqu’à la rue de Ponthieu, si voisine, et qui se doutèrent que la façade du Garage de 1905 était le prélude déjà très arrêté de la façade du Théâtre des Champs-Élysées, dessinée en 1911, et dont la construction, commencée en 1912, fut achevée en 1913.
Pl. IV