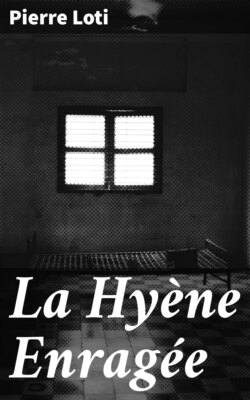Читать книгу La Hyène Enragée - Pierre Loti - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
LE DRAPEAU QUE NOS MARINS-FUSILIERS N'ONT PAS ENCORE…
ОглавлениеTable des matières
Décembre 1914.
On les avait d'abord mandés à Paris, nos chers matelots, pour leur confier le soin d'y faire la police, d'y maintenir le bon ordre, le silence, la bonne tenue,—et je n'avais pu m'empêcher de sourire: cela leur ressemblait si peu, ce rôle tout nouveau que l'on imaginait de leur faire jouer!… Car enfin, soit dit entre nous, la correctitude dans les rues des villes n'a jamais été leur principal triomphe, à mes braves petits amis… Tout de même, à force de s'appliquer et de se donner des airs sérieux, ils s'en étaient à peu près tirés à leur honneur, jusqu'au moment où on les délivra de cette insoutenable contrainte, en les envoyant dehors, garder des postes dans le camp retranché. C'était déjà un peu mieux, un peu plus dans leurs moyens. Et enfin le jour de joie et de belle griserie arriva, où on leur dit qu'ils allaient tous aller au feu!
S'ils avaient eu ce jour-là un drapeau, comme en ont leurs camarades de l'armée de terre, je ne prétends pas qu'ils seraient partis avec plus d'entrain et de gaieté, car ce n'est pas possible; mais certes ils seraient partis plus fiers, groupés autour de ce hochet sublime, que rien ne remplacera jamais, quoi qu'on dise ou qu'on fasse. Plus que tout autre peut-être, les marins ont ce culte du drapeau, entretenu chez eux par le touchant cérémonial que l'on observe sur nos navires, au son du clairon, chaque matin quand il s'agit de le déferler et chaque soir quand on le replie, officiers et équipage se découvrant en silence, pour le saluer bien bas.
Oui, ils auraient beaucoup souhaité avoir un drapeau pour s'en aller au feu, les marins-fusiliers; mais leurs officiers leur disaient: «On finira sûrement par vous en donner un, dès que vous l'aurez gagné là-bas.» Et ils partirent en chantant, tous avec la même ardeur de héros; tous, dis-je, non pas seulement ceux qui gardent encore l'admirable tradition de notre vieille Marine, mais ceux même des nouvelles couches, qui étaient déjà un peu gangrenés—rien qu'à la surface, bien entendu—par les sales sornettes antimilitaristes, et qui soudain s'étaient repris et ennoblis au son du canon allemand; tous, unis, décidés, disciplinés, sages,—et rêvant d'avoir un drapeau à leur retour…
On les envoyait en hâte à Gand, pour protéger la retraite de l'armée belge. Mais, en route, on les arrêta à Dixmude, où les «barbares à couenne rose» étaient en nombre, dix fois plus fort qu'eux, et où il fallait tenir coûte que coûte, pour empêcher que l'abominable ruée se propageât plus loin.
On leur avait dit: «Le rôle qu'on vous donne est dangereux et solennel; on a besoin de vos courages; pour sauver tout à fait notre aile gauche, jusqu'à l'arrivée des renforts, sacrifiez-vous; tâchez de tenir au moins quatre jours.»
Et ils ont tenu vingt-six mortels jours! Ils ont tenu presque seuls; les renforts, par suite de difficultés imprévues, ayant été insuffisants et tardifs. Et ils ne sont plus aujourd'hui que trois mille, sur six mille qu'ils étaient au départ!…
Ils avaient tout juste et à peine le nécessaire. En quittant Paris, où il faisait une tiédeur d'été, ils ne prévoyaient pas le froid si brusque; la plupart ne portaient sur la poitrine que le «tricot» réglementaire, en coton rayé de bleu, aux jambes des pantalons légers avec rien dessous, et, pour recouvrir tout cela, il est vrai, d'insolites capotes d'infanterie où s'empêtraient leurs mouvements. Comme provisions, rien que quelques boîtes de «confiture de singe»; personne, n'est-ce pas? ne s'attendait à ce quasi-isolement, pendant vingt-six longs jours. A leur place, des troupiers, même de courage égal, n'auraient jamais su s'en tirer. Mais il y a ce «débrouillage» maritime, qui s'apprend au cours des pénibles traversées, ou aux colonies, dans les îles, et grâce auquel un vrai matelot fait face à tout; un débrouillage spécial, si légitime somme toute, et d'ailleurs si bon enfant, si tempéré par un tact insinuant et drôle, qu'il ne fâche jamais personne.
Donc, ils s'étaient débrouillés, car, après ces trois ou quatre semaines épiques pendant lesquelles, nuit et jour, ils avaient combattu comme des diables, dans le feu et dans l'eau, on retrouva les survivants à peu près bien nourris et à peine enrhumés.
Le seul reproche que j'aie entendu leur faire, par des officiers qui avaient eu l'honneur de les commander au milieu de la fournaise, c'est qu'ils se résignaient mal à ramper. Ramper, c'est une allure introduite dans la guerre moderne par la sournoiserie allemande, et on sait qu'il faut y préparer longuement nos soldats. Eux, on n'avait pas eu le temps de les y habituer; quand il s'agissait d'attaquer, ils partaient bien comme on venait de leur dire, en se traînant à quatre pattes; mais, l'ardeur tout aussitôt les emportant, ils se redressaient pour prendre le pas de course, et la mitraille les fauchait par trop.
L'un d'eux me contait hier en ces termes comment sa compagnie, ayant reçu l'ordre de se transporter à un autre point de la bataille—mais sans se faire voir, en marchant accroupis au fond d'une longue et interminable tranchée—n'avait vraiment pas pu tout à fait obéir: «Elle était déjà moitié pleine de nos pauvres morts, cette tranchée. Et vous comprenez, commandant, aux endroits où il y en avait trop, marcher sur eux ça nous faisait de la peine, nous ne pouvions pas; alors, plutôt, nous sortions du trou pour courir à toutes jambes le long des talus, et les Boches qui nous voyaient se dépêchaient de nous tuer.
»Mais, continua-t-il, à part ces petites désobéissances comme ça, je vous assure, commandant, qu'on s'est bien conduit. Ainsi je me rappelle des officiers de tirailleurs, des officiers de chasseurs à pied, qui avaient vu la bataille de la Marne et celle de l'Aisne. Eh! bien, quand ils venaient, des fois, causer à des officiers de chez nous, nous les entendions leur dire: «Nos soldats, c'étaient des braves, oh! ça, oui. Mais, de voir vos matelots, comme ils se battent, tout de même ça nous en bouche un coin!»
Et ce Dixmude, où ils ont pu tenir pendant vingt-six jours, devenait peu à peu quelque chose comme une succursale de l'enfer. La pluie, la neige, l'inondation charroyant de la boue noire au fond des tranchées; du sang qui sautait partout, des toits qui croulaient, écrasant pêle-mêle les blessés, ou les morts en décomposition; sans aucune cesse, des cris, des râles, mêlés au continuel fracas d'un tout proche tonnerre. On se battait dans chaque rue, dans chaque maison, par les fenêtres crevées, derrière des pans de mur, de si près que parfois on s'étreignait les uns les autres pour s'étrangler. Il y avait même souvent, la nuit, quand on ne savait déjà plus où frapper, il y avait d'affolantes traîtrises d'Allemands qui tout à coup se mettaient à crier en français: «Cessez le feu, malheureux! Mais c'est nous qui sommes là, vous tirez sur les vôtres!» Et on perdait tout à fait la tête, comme dans un cauchemar dont on ne peut plus se réveiller ni sortir.
Enfin arriva le jour où la ville fut prise. Les Allemands venaient soudain de renforcer terriblement leur artillerie lourde, et les «marmites» tombaient partout comme grêle, ces énormes marmites du diable qui creusent des trous de six ou huit mètres de large sur quatre mètres de profondeur. Il en arrivait cinquante, soixante à la minute, et, dans ces trous qu'elles faisaient, c'était aussitôt une dégringolade de murailles, de meubles, de tapis, de cadavres, en un chaos d'une horreur sans nom. Continuer de rester là, devenait vraiment au-dessus des forces humaines; c'eût été se faire massacrer jusqu'au dernier, et d'ailleurs sans résultat utile, car l'abandon de cet amas de ruines et de ce charnier qu'était devenue la pauvre petite ville flamande, n'avait plus d'importance; elle avait résisté juste le temps qu'il fallait. L'essentiel était d'avoir empêché les Allemands de passer sur l'autre rive de l'Yser, alors que toutes les chances avaient pourtant semblé pour eux; l'essentiel était surtout qu'ils n'y passeraient plus jamais, maintenant que les renforts venaient d'arriver pour les arrêter par le Sud, et maintenant que l'inondation gagnait tout, barrant la route par le Nord. La poussée des barbares se trouvait, de ce côté, enrayée définitivement. Et c'étaient nos fusiliers-marins qui, presque à eux seuls, sans faiblir devant le nombre écrasant, avaient soutenu là notre aile gauche, tout en perdant la moitié de leur effectif et quatre-vingts pour cent de leurs officiers…
Alors ils s'étaient dit, ceux qui restaient: «Cette fois, nous allons l'avoir, notre drapeau!» D'ailleurs de grands chefs de la Guerre, touchés et émerveillés de tant de bravoure, le leur avaient promis, et de même le chef suprême du gouvernement français, un jour qu'il était venu les féliciter.
Mais, hélas! ils ne l'ont pas encore, et ils ne l'auront peut-être jamais,—à moins que les grands chefs précités, qui avaient un peu engagé leur parole, n'interviennent pendant qu'il est temps encore, avant que tous ces héroïsmes soient tombés dans l'oubli.
Mon Dieu, qu'on le leur donne, à nos fusiliers-marins, leur drapeau! Et même, avant de le leur envoyer, on pourrait bien, il me semble, y attacher la croix!
P.-S.—La semaine dernière, la brigade des fusiliers-marins a été citée en tête de l'ordre du jour de l'armée, pour avoir fait preuve de la plus grande vigueur et d'un entier dévouement dans la défense d'une position stratégique très importante.