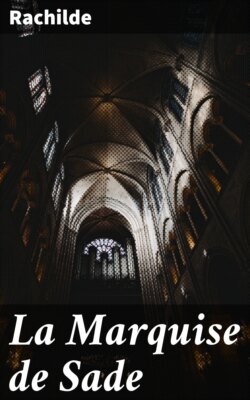Читать книгу La Marquise de Sade - Rachilde - Страница 4
II
ОглавлениеLa vie de garnison était, en ce temps-là, une vie de famille. On avait peu de relations avec le bourgeois, parce qu'on ne faisait que passer, et que l'habitant des villes se défie toujours du pantalon garance.
Le 8e hussards restait donc chez lui, trouvant en lui-même les plus riches éléments de distraction.
D'abord il y avait la femme d'un capitaine, madame Corcette, qui amusait tous les frondeurs, une femme ahurissante aux toilettes venant de Paris et aux allures sentant le café-concert. Les sous-lieutenants l'aimaient beaucoup; le capitaine Corcette le leur rendait ... ils n'avaient pas d'enfant! madame Corcette portait des chignons Schneider plus gros que ceux de la Schneider, et des suivez-moi jeune homme qui s'allongeaient derrière ces costumes chic (ce mot devenait à la mode) pareils aux rênes d'une jument dressée pour le manège. Elle avait le teint vert, le nez retroussé, les yeux chinois, le front bombé, une femme très laide, mais drôle.
Son mari était un blond, de type exquisement distingué, n'eût été son œil un peu clignotant, son sourire sceptique avouant trop de choses.
Le capitaine Corcette, sortant de Saint-Cyr, avait, chuchotait-on, traîné ses débuts de beau cavalier dans le cabinet de toilette d'un général célèbre... Madame Corcette le savait, en riait tout en fumant des cigares, les deux jambes, qu'elle avait superbes, étendues sur les genoux de son mari. L'ordonnance du capitaine Corcette racontait que, dans l'intimité, monsieur grisait madame qui disait alors des folies extrêmement divertissantes.
Il y avait ensuite la femme du lieutenant Marescut, la légende du 8e hussards, à cause de son économie fabuleuse. Cette petite madame Marescut n'avait jamais eu de bonne, et, malgré les timides remontrances de son mari, elle allait faire son marché en cheveux, avec un tablier de colon, se faisait prendre pour une domestique de la ville, traversant la rue populeuse de Clermont, un énorme panier de provisions au bras, et taillant des bavettes avec les officiers qui descendaient au café. Elle ne ressentait point la honte de sa situation ridicule, elle répondait à sa propre porte, quand par hasard il lui arrivait une visite: «Madame Marescut n'y est pas!» s'exhibant les mains poisseuses, la figure barbouillée de graisse. Elle fabriquait ses robes, elle recouvrait ses chaises, et taillait des pantalons de drap noir dans les pantalons de drap rouge de son mari qu'elle faisait teindre; elle prétendait que c'était moins salissant, des culottes noires. A la vérité, son petit logement reluisait de propreté; seulement on la trouvait toujours par terre, le chignon défait, lavant le plancher.
Puis la femme du trésorier, une mégère haute en couleur, perpétuellement sur le point d'accoucher, ayant déjà, six filles et comptant sur un garçon. Celle-là était la terreur de son mari, un peu buveur d'absinthe, elle avait fait une scène un soir, dans le café des officiers, au malheureux trésorier en train d'oublier les six filles d'Adolphine dans un carambolage des plus savants.
Dominant ces ménages d'inférieurs, la femme du lieutenant-colonel comte de Mérod apparaissait quelquefois aux visites de corps; une élégante mondaine s'occupant de faire arriver son mari du côté des généraux, une comtesse ayant été reçue aux Tuileries, sachant son grand monde et ne laissant aucune prise à la médisance.
Dans l'escadron volant des officiers à marier, il y avait le jeune Zaruski qui faisait grimper les escaliers de la cathédrale à son cheval Trompette; le bon Jacquiat, lequel se trouvait toujours entortillé par des farces extraordinaires d'où il ne sortait qu'en offrant un punch aux camarades; le maigre Steinel au masque de don Quichotte, étique à force de fumer de mauvais tabac; monsieur de Courtoisier, complètement fou, achetant tous les bibelots des antiquaires et toutes les filles à vendre; une santé ruinée, mais une charmante figure et un musicien accompli. Enfin, le grognard Pagosson, l'utilité publique du 8e, peignant à l'huile, découpant sur bois, culottant des pipes, tournant des pieds de meubles, préparant des cannes, et tressant des tapis avec de vieux galons pour les femmes qu'il respectait.
Le colonel Daniel Barbe n'était pas très aimé de son régiment, mais on ne se permettait pas de réflexion à son sujet, car dans l'état militaire on ne dit rien de son colonel, ni devant ni derrière. Il réunissait ses officiers une fois par mois: pour maintenir la bonne harmonie entre les chefs. Le jour, les dames venaient saluer la colonelle qui les recevait entre deux accès de toux, entourée de fioles, vêtue d'un peignoir idéal de fraîcheur; le soir, les hommes arrivaient par groupe de cinq ou sept, les uniformes flambants, les têtes droites hors du faux col d'ordonnance. Le salon s'éclairait de bougies roses, au chiffre du colonel, une bagatelle fort en vogue vers la fin de l'empire, et les plateaux circulaient, garnis de liqueurs coûteuses. A neuf heures, au milieu du brouhaha des toasts, Madame Barbe passait avec un triste sourire pour recevoir les saluts empressés, elle gagnait sa chambre et leur laissait Mary, qui devenait la maîtresse de la maison.
La petite fille, très raide dans une robe de mousseline blanche ornée d'un velours courant sous des entre-deux de valenciennes, faisait les honneurs, aidée de mademoiselle Tulotte. Jacquiat, le lieutenant, l'arrêtait pour lui glisser des fadeurs comme à une grande personne. Jacquiat songeait que cette conquête, plus facile à tenter que les autres, lui faciliterait un avancement rapide.
—Mademoiselle, disait-il de sa grosse voix de perroquet muant, vous avez pensé à notre voyage au Puy de Dôme dans le break de papa?... Je vous laisserais nous conduire... Nous verserions dans un fossé et nous écraserions des Auvergnats... C'est ça qui serait drôle!... Voulez-vous?... hein?
Mary, sentant toute la dignité de son rôle, répondait par une inclination de la tête, imitant sa mère, dédaigneuse et polie, son œil bleu gardant son indifférence pour l'inférieur qu'elle ne voulait pas favoriser au détriment du voisin.
En réalité, elle préférait Courtoisier; il lui envoyait des dattes, et sa moustache élégante avait un tour très particulier.
Quand Mary allait se coucher, elle saluait du seuil, les mains réunies sur sa bouche gracieuse, mais pas réchauffée encore, ne trouvant pas son camarade parmi ces uniformes qui blessaient sa vue couleur de ciel. Peut-être son camarade aurait-il été celui qui, sans s'occuper du chef, serait tout d'un coup monté sur une table pour exécuter des tours de force.
Mademoiselle Tulotte, à son aise dès que Mary était sortie, faisait circuler de nouveaux plateaux; alors, le colonel se levait comme poussé par un ressort; le silence s'établissait et il débitait un speech, toujours le même d'ailleurs.
Cela roulait sur la prospérité du règne de Napoléon III, la grandeur de la France, les probabilités de guerres lointaines, l'excellente tenue du 8e hussards, le poil brillant de ses chevaux, la camaraderie de ces messieurs, les nouvelles promotions de l'armée, les croix qu'on pourrait recevoir et surtout la douleur profonde qu'il ressentait de la maladie de sa femme qui le privait de ses réunions intimes où chacun se retrempait pour le devoir du lendemain. Peu de politique, une horreur absolue d'une manifestation quelconque autre que des manifestations de sentiments militaires, un mépris arrogant de ce qu'on pensait, soit dans le peuple, soit dans la bourgeoisie.
A minuit moins le quart, tous les officiers se trouvaient du même avis sans savoir de quoi il s'agissait, des «Oh! certes, mon colonel!» des «Parbleu, vous avez raison,» se croisaient en tous sens. Jacquiat commentait avec chaleur la phrase sur le poil brillant des chevaux. Marescut avançait un adjectif timide, tandis que le trésorier, bien d'aplomb sur ses deux jambes écartées, expliquait à Zaruski de quelle façon on attrape des écrevisses dans la vallée de l'Allier.
Corcette, tutoyant tous les camarades comme il avait la dangereuse habitude de le faire chez sa femme, pérorait en semant ses discours d'imitations que n'aurait pas reniées un acteur. Pagosson et Steinel fouillaient sans relâche la boîte aux cigares. Le comte de Mérod, seul près d'une croisée ouverte, s'absorbait dans la contemplation de sa chevalière, une merveille de gravure.
Minuit sonnait; Mademoiselle Tulotte, réveillée d'un somme ébauché à l'ombre d'un écran, regardait la pendule. Le colonel s'arrêtait court au milieu d'un geste oratoire, et subitement ces messieurs prenaient congé comme un seul homme, descendaient l'escalier en évitant de faire sonner leurs éperons, puis s'éloignaient à travers la place du cimetière.
—Ce sont de braves cœurs!... disait le colonel Barbe qui avait une pointe.
—Ah! il faudrait les réunir plus souvent, ils ne voient pas assez leur chef, il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre! répondait Tulotte, fronçant les sourcils.
Et le lendemain, le colonel Barbe, ayant perdu sa pointe, les punissait de nouveau, bougonnant au sujet du poil du régiment, lequel poil le ferait remarquer un beau jour par le ministre de la guerre.
Le colonel Barbe avait, après ces soirées de parades, l'ennui lourd de son ménage gâté, de la maladie irrémédiable et des sentiments de sa femme. Il ne savait plus pourquoi il commandait ce régiment inutile et pourquoi il devait courir de département en département, toute la France, sur l'ordre d'un monsieur inconnu, n'ayant ni le temps de soigner Caroline, ni le temps d'élever Mary.
Du reste, ceci à sa louange, personne ne se doutait de ses préoccupations lorsqu'il montait, aux revues, le Triton, son cheval bai, dans son uniforme chamarré, à la tête de son régiment, sa musique jouant un air de bravoure, lui, saluant de l'épée scintillante quelques notables enthousiasmés de son profil martial, de ses yeux verts presque cruels. Et ainsi s'écoulait sa vie d'officier supérieur, monotone malgré ses changements de décor, jusqu'à ce que, les promesses de guerre se réalisant, il fût nommé général de brigade ou tué par un éclat d'obus.
Au-dessus de lui et de tous, il y avait à Clermont, dans un hôtel du Cours, le général d'Apreville, un petit homme bas sur ses jambes, la tête bouffie d'importance, qui recevait aussi, mais de préférence les enfants de ses officiers, car il adorait les femmes, et les mères ne manquaient point de lui amener leurs progénitures sans leurs époux. Il avait inventé soudainement des collations monstres avec des flûtes à champagne, et sa fille, une fille de quinze ans, dirigeait la bande. Mademoiselle d'Apreville, ayant perdu sa mère de bonne heure, savait monter à cheval avant de savoir lire, tirait au mur, mettait des balles dans les casquettes dorées de son père, sortait accompagnée d'un nègre qu'elle appelait Jolicœur, et avait déjà des aventures d'amour. Elle réalisait le type féminin qu'on aimait chez l'impératrice. Elle créait des modes en province, initiait les officiers d'ordonnance aux secrets de ses poudres de riz et ne jurait que par madame de Metternich, sa marraine, dont elle portait la couleur, au bal, un vert intense résistant aux lumières. Jane d'Apreville, à Clermont, dans ce grand cirque entouré de montagnes, imaginait des folies que les régiments de son père admiraient.
Nul doute que si la petite madame Marescut se fût permis des fantaisies de ce genre, on aurait fait permuter son mari; mais Jane d'Apreville était la loi et les prophètes. A part le comte de Mérod, le lieutenant-colonel, très en dehors des opinions reçues, les hussards, l'infanterie, le génie ne tarissaient plus d'éloges. On citait, par exemple, l'escapade du théâtre: elle était allée seule, un soir que l'on jouait de l'Offenbach, dans une loge de face, ayant pour tout chaperon son nègre Jolicœur. Une autre fois, elle avait suivi une revue de son père, à cheval, une toque ornée de trois étoiles sur la tête, et elle avait chassé le renard, l'hiver dernier, en compagnie d'un prince russe, dans une propriété qui n'appartenait pas au général.
De là un procès dont le père lui-même s'amusait comme d'un bon tour joué aux bourgeois d'Auvergne. Elle faisait, du reste, profiter le haut commerce de ses extravagances et devait, disait-on, des sommes à sa couturière.
Ce fut dans les salons de l'hôtel du Cours, que Mary fit ses débuts mondains. Jane d'Apreville, à la fin de juillet, offrit une collation féerique à mesdemoiselles de tous les régiments de la garnison. Par déférence pour le chef, le colonel Barbe n'osa pas refuser l'invitation. On décida que Mary serait conduite par Tulotte à la collation.
Elle avait encore un peu de fièvre. Le médecin de sa mère prétextait la croissance, un mal très anodin. Lorsqu'elle entra dans les salons du général, Mary eut un sourire de ravissement. Les croisées en portiques étaient ouvertes et festonnées de guirlandes, des suspensions de fleurs retombaient au centre de chaque portique, et le bleu éblouissant du ciel formait un fond infini comme un rêve à ces tableaux merveilleux. Une trentaine d'enfants polkaient dans des jonchées de roses; des consoles recouvertes de velours supportaient des joujoux bariolés. A droite et à gauche d'un gros orgue de Barbarie, que tournait le nègre Jolicœur, s'élevaient des buffets en étagères ornés de pièces montées qui représentaient le numéro et les armes des régiments invités.
Un grand drapeau de soie enveloppait de ses plis les pyramides de brioche, de savarins et de pains fourrés. Des valets déguisés en cantiniers, le bonnet de police sur l'oreille, versaient les sirops et découpaient les gâteaux. Pour les mamans, on avait installé une tente sur la terrasse, derrière l'hôtel, d'où elles pouvaient surveiller les jeux du jardin. Ces dames avaient des tapisseries et brodaient, en devisant de la joie universelle.
Au jardin, après les danses, une surprise attendait les petites filles: on avait fait venir des champs un troupeau de vrais agneaux qu'on était en train de garnir de rubans. Pour les petits garçons, il y avait des chevaux de bois équipés en guerre, avec des roulettes sous les pieds. Le général d'Apreville, plus apoplectique qu'à l'ordinaire, allait du salon à la terrasse, se frottant les mains, embrassant les fillettes de douze ans dans le cou, pinçant au hasard les jeunes mères, répétant:
—Un génie, ma fille, un vrai génie... Elle ne me laisse rien à faire ... et elle sait dépenser comme une femme!
En effet, mademoiselle d'Apreville n'y regardait pas.
Mary, tout étourdie, se tenait au seuil du salon, penchant de côté sa figure de brune pâle d'où les yeux semblaient jaillir comme deux étoiles.
—Oh! l'amour!... s'écria Jane, lâchant le collégien avec qui elle valsait pour s'emparer de Mary.
Jane était une grande jeune fille, svelte, blonde, très jolie, mais fanée par ses hardiesses de soldat en maraude.
Elle appela son cousin Yves de Sainte-Luce, le collégien, qui vint en ajustant son monocle.
—Tiens! fit-il d'un ton connaisseur, pas mal la petite du colonel ... ça promet!
—Un peu maigre! riposta Jane d'une jalousie féroce, et pas encore assez femme pour dédaigner une enfant de sept ans.
—Je trouve qu'elle a des yeux, voilà ... déclara nettement le collégien assez homme, lui, de par le récent duvet de ses lèvres, pour avoir le droit d'imposer sa volonté.
Jane d'Apreville laissa glisser à terre Mary qu'elle avait soulevée.
—Hein? des yeux bleus ... mais. Georges, tu disais que tu n'aimais pas les yeux bleus!
Et ses prunelles brunes jetaient des flammes.
Georges saisit le bras de Mary et la conduisit au buffet sans répondre.
Désormais, la petite du colonel avait une ennemie.
Après les rondes, les colins-maillards, Mary, fatiguée, descendit au jardin pour voir les moutons. Elle en choisit un taché de noir qui était tout drôle et bien enrubanné. Les petites filles se précipitèrent sur les autres, pendant que les petits garçons tâtaient leurs chevaux inanimés.
Il y eut une scène indescriptible. Chacun voulait un animal vivant. On en vint aux claques. Le jardin fut transformé en champ de bataille, le général tonnait du haut de la terrasse avec l'état-major des mères. Jane se multipliait, se tordant de rire et excitant les combattants. Yves de Sainte-Luce, le seul grand de la bande, les mains derrière son dos, s'écriait: scha! pille! pille! comme pour une meute.
Les moutons, affolés, trottaient dans les plates-bandes en bêlant d'une façon lamentable, et les petits garçons se servaient à présent de leurs chevaux démolis pour taper sur les fillettes désolées. Durant le combat, Mary s'était retirée avec son mouton, le taché de noir, derrière un bassin où il y avait des poissons; elle souriait, heureuse de passer inaperçue et de pouvoir embrasser un animal qui ne grillait pas.
Soudain, le petit Paul Marescut, invité dans le tas, s'élança furieux sur Mary.
—En voilà un ... il est à moi ... rends le mouton ... tu prendras le cheval!...
Maryse se plaça devant son bien.
—Non, dit-elle, je ne veux pas.
Mary n'avait pas beaucoup de phrases: elle voulait ou ne voulait pas.
—Attends, dit Paul, fort de ses dix ans, je vais te faire faire ta madame, toi! D'abord, le mouton vivant, c'est pour les hommes.
Mary eut peut-être la vague souvenance des brebis de l'abattoir.
—Tu veux le tuer! s'écria-t-elle.
—Si ça me plaît! riposta le gamin mis en goût par la fureur de la dispute..... On nous a dit d'en faire ce que nous voulions, rends-le.
Mary étendit sa jupe de taffetas blanc devant l'agneau.
—Non!
Alors Paul déchira la jupe, envoya rouler Mary sur le gazon et, saisissant l'agneau par une patte, il l'entraîna victorieusement.
Mary se releva, elle courut au grand collégien qui criait au massacre sans se déranger.
—Monsieur, il veut tuer mon mouton; et elle contenait ses larmes.
Mademoiselle d'Apreville vint s'informer de la chose.
—Bah! fit-elle, tant pis pour toi... Est-ce qu'une fille de militaire pleure pour ça! Fallait le défendre au lieu de lui laisser casser la patte... Tiens! voilà qu'il faut l'emporter.
En effet, on emportait le mouton dont le membre démis pendait lamentablement.
—Pauvre Mimi! soupira le collégien en caressant les nattes flottantes de Mary interdite.
Mais tout d'un coup une révolution s'opéra dans la passivité de la petite colonelle; un cri rauque, un cri de chatte en colère sortit de sa gorge crispée; elle rejoignit Paul Marescut d'un seul bond et, tombant sur lui à l'improviste, elle le cribla d'égratignures.
Elle venait de déclarer sa première guerre au mâle.
On fut obligé de lui arracher ce garçon complètement défiguré.
—L'horrible petite créature! bégayait Jane d'Apreville, expliquant à son père que ce devait être un sale colonel que le colonel Barbe, puisqu'il élevait si mal ses enfants.
La journée s'acheva par un quadrille dans lequel le général, un peu ivre de cette jeunesse qui lui grimpait aux bottes, esquissa un pas fantastique que tous les bambins, excepté Mary, mise en pénitence, répétèrent à l'unisson.
—T'es-tu amusée? demanda madame Barbe à la petite fille de retour, la robe déchirée, les yeux brillants.
—Non, maman! Elle aurait dit pourquoi sans la crainte de Tulotte.
—Allons!... allons!... murmura la jeune malade avec un sourire d'espoir, il lui faut des petits frères, je vois cela, ils lui formeront le caractère.
Le colonel, tout ragaillardi par la certitude acquise le jour même, ajouta:
—Sans doute, un petit polisson de frère comme Paul Marescut!
Madame Barbe, en dépit de ses douleurs perpétuelles, était enceinte. Le docteur attribuait ce retour à la santé aux brises vivifiantes du pays. Il jurait que tout se passerait très bien si on restait à Clermont-Ferrand, et le colonel fit des vœux pour que son régiment demeurât des mois encore dans cette bonne ville.
Madame Corcette se chargea d'annoncer la chose. Bientôt on sut que ce brigand de colonel... Eh! eh! ce n'était pas Corcette qui pourrait ces choses-là, aurait-il eu pour aide un régiment tout entier. Le trésorier lui souhaitait un garçon, sa femme Adolphine se récriait en pensant que ce serait comme une chance de moins pour elle. Ah! ces femmes poitrinaires, ont-elles du bonheur! Le garçon existait déjà, on le voyait naître... Parbleu!... puisque le colonel en voulait un!
Caroline continuait les cures de sang. Elle buvait ce remède, qu'on était obligé de cacher aux petites filles, sans trop de répugnance. Elle finissait peut-être par y prendre goût, sentant que son état exigeait à présent une plus forte dose. Elle parlait moins du cimetière, et, profitant de la douceur de l'automne, elle avait accepté le bras de son mari pour descendre au jardin. Mais ce moment de joie intime ne dura guère: le 8e hussards reçut brusquement l'ordre de partir pour Dôle. Du Centre il fallait sauter à l'Est, changer de climat, de coutumes, de mœurs, de maison. Cela renversait en une seconde toutes leurs espérances, et qui savait même si on aurait le temps de mettre au monde un garçon, voire une fille dans la nouvelle garnison?... Impossible de répondre de la tranquillité d'une malade avec ce sacré métier. Plusieurs officiers s'inquiétèrent de savoir d'où partait cette vexation, car ils se trouvaient tous très bien à Clermont: les logements étaient vastes et à bon marché, la nourriture exquise; on avait des eaux minérales, des excursions, des sites. On alla aux renseignements, car on disait qu'il suffisait d'un mécontent influent pour déplacer tout un corps d'armée. Il n'y avait pas un an qu'on était installé; on respirait seulement... Bref, on délégua de Courtoisier chez la fille du général, et quelle ne fut pas la stupeur de ces bons ahuris d'officiers inférieurs lorsqu'ils apprirent que mademoiselle Jane d'Apreville ayant désiré voir les hussards au diable ... le papa, pour avoir la paix, avait glissé une note au ministre ... et le 8e hussards allait au diable[1]!
Le colonel ne broncha pas, mais il redevint de mauvaise humeur, parla de renvoyer sa femme chez ses parents, en Bretagne. Celle-ci fit une scène de désespoir, elle ne voulait pas se séparer de son mari tant qu'Estelle serait à son service; d'ailleurs elle ne pouvait se dispenser des soins de médecins coûteux, ses parents étaient pauvres, les femmes de militaires ne doivent-elles pas mourir à leur poste?
—Jure-moi que tu garderas mon cercueil avec toi quand je ne serai plus! dit-elle au colonel, dans un accès de sentimentalité qui la mit sur sa chaise longue pour une semaine.
Tulotte déclarait que si son frère était un homme, il écrirait au ministre.
Daniel Barbe haussait les épaules. Cependant, quand il aperçut Estelle pleurant entre ses deux ordonnances parce que Sylvain et Pierre feraient l'étape loin d'elle, il fut ému; Estelle la cuisinière était la gaîté de la famille; à tort ou à raison son humeur influait. Au quartier, le colonel passa une inspection des chambres désastreuses, il doubla toutes les punitions, et le 8e hussards, qui allait du Centre à l'Est parce qu'une jeune fille de quinze ans le voulait, fut mis, pour une bonne moitié, aux arrêts parce que la cuisinière de son colonel avait pleuré. Un régiment est une famille, n'est-ce pas?... Ce qui touche ses chefs le touche. Ce sont là des choses bien naturelles.