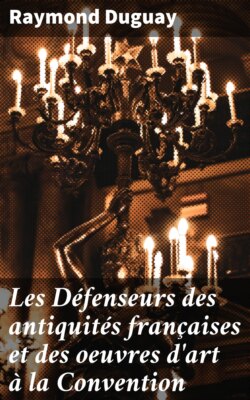Читать книгу Les Défenseurs des antiquités françaises et des oeuvres d'art à la Convention - Raymond Duguay - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HISTORIQUE
ОглавлениеTable des matières
Grégoire et Gabriel Vaugeois, son principal collaborateur. Alexandre Lenoir, Sieyès, Lakanal, Sergent-Marceau, Boissy-d’Anglas, Marie-Joseph Chénier, David, Gracchus Babeuf.
THIERS, Lamartine, Victor Hugo, Buchez et Roux-Lavergne, dans leurs ouvrages sur la Révolution, désignent Gabriel Vaugeois, grand vicaire de Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, comme l’un des principaux acteurs de la journée du 10 août, mortelle pour la royauté. L’Histoire de la Révolution française de Thiers, accueillie par le parti libéral sous Charles X comme une œuvre de réhabilitation de la convention, préparait Les trois Glorieuses et, par voie de conséquence, l’avènement de Louis-Philippe; l’Histoire des Girondins était la préface de l’appel au pays, dont douze départements élurent Lamartine à la constituante; dans Quatre-vingt-treize, tableau romantique, poussé au noir, Victor Hugo, membre de l’assemblée nationale, essayait, avant la discussion des lois constitutionnelles, de dégager du chaos l’idéal républicain. Pour les besoins de leur cause, les uns et les autres ont reproduit, avec quelques variantes, les récits des girondins Pétion et Carra qui, accusés de modérantisme par les jacobins, se préoccupaient avant tout, dans leurs mémoires, de se montrer sous un jour différent. Trente ans après, quand Thiers commença son histoire de la Révolution, on pensait à autre chose, et bien peu se souvenaient des conventionnels utiles, mais la plupart connaissaient les noms et les effigies des pires terroristes. C’est l’usage. Par une singulière tournure de l’esprit français, relevée par Rousseau, les mauvais côtés des hommes, ceux qui donnent prise au dénigrement, intéressent plus que les bons la curiosité publique.
Aucune des biographies de cette époque, aucun dictionnaire historique n’a recueilli le nom de Vaugeois. En dehors de la mention ci-dessus, honorable pour les uns, discutable pour les autres, et d’une courte nécrologie dans le Constitutionnel du 1er août 1839, journal où Mignet, Thiers et les libéraux avaient mené une campagne contre Polignac, les autres ultras et les ordonnances, on ne trouve rien, ainsi que le constatait, non sans mélancolie, Léon Duchesne de la Sicotière, son biographe à l’association normande. La vie publique de Gabriel Vaugeois et une partie de son œuvre, d’une érudition profonde, méritaient pourtant les déférences d’usage, ne fût-ce qu’au titre de défenseur, avec l’abbé Grégoire, des antiquités et des œuvres d’art que le passé nous a léguées comme autant de souvenirs de la tradition et du génie français. Par contre, l’histoire de Sieyès, Lakanal, Boissy d’Anglas et des autres collaborateurs de Grégoire, est trop connue pour offrir un intérêt particulier.
Né dans le Haut-Perche, à Tourouvre, le 15 avril 1753, Jean François Gabriel Vaugeois avait d’abord étudié le droit avec Brissot, né en 1754 à Ouarville, village voisin de Chartres, et avec Pétion, fils d’un procureur au présidial de Chartres. Mais l’étude des lois était alors un véritable dédale, un mélange hétéroclite de lois féodales, de coutumes et d’arrêts rendus par les parlements, et la procédure n’était qu’une basse chicane où dominait une finasserie dépourvue d’attrait pour un esprit droit. Certains édits, enregistrés par un ou plusieurs parlements, n’étaient pas enregistrés par d’autres, qui les repoussaient comme mauvais. La coutume de Paris contredisait d’autres coutumes, ayant force de loi. «Voulez-vous avoir de bonnes lois? Brûlez les vôtres, disait Voltaire, et faites-en de nouvelles.» Après avoir travaillé à la Théorie des lois criminelles de Brissot, bientôt connu par ses publications sur l’inégalité des conditions sociales, incarcéré même à la Bastille, Vaugeois un peu désorienté, étudiant pauvre à la recherche d’une situation, s’intéressa, soit par goût naturel, soit par désœuvrement, à l’histoire de la cathédrale médiévale de Chartres, l’un des plus beaux monuments de pierre et de verre peint enfantés par le génie humain, et lut les ouvrages du bénédictin Montfaucon, puis les dissertations archéologiques de Winckelmann, où l’auteur, malgré sa manie raisonnante, faisait aimer les antiquités par l’élévation de ses vues sur la nature de l’art. La philosophie de l’art et peut-être d’autres considérations, car il est difficile de se rendre compte des menus rouages qui font agir les cérébraux, l’amenèrent à l’étude de la métaphysique, et, comme sa famille ne pouvait subvenir aux frais d’études de pure érudition, il se décida à entrer dans les ordres.
Sieyès devint vicaire général de Chartres en 1784, puis conseiller commissaire de ce diocèse à la chambre supérieure du clergé de France. Appelé à donner son avis sur la convocation des états généraux, il publia en janvier 1789 la brochure qui eut un si grand retentissement: «Qu’est-ce que le tiers état? Tout. — Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique? Rien. — Que demande-t-il? A devenir quelque chose.» Sieyès concluait: «Si les deux ordres privilégiés refusent de délibérer avec lui, le tiers doit se constituer en assemblée nationale.» On conçoit l’influence que devait avoir un tel projet de réforme sociale sur un ancien étudiant en droit, épris des idées nouvelles et arrivé à l’âge où l’homme las de remuer des mots, des idées, veut passer aux actes, manifester sa personnalité. Vicaire dans le même diocèse, Vaugeois connaissait les abus qui amenèrent le 2 novembre 1789, sur une motion de Talleyrand-Périgord, évêque d’Autun, le vote du décret laconique qui enlevait au clergé régulier et séculier ses bénéfices, ses abbayes et ses dîmes. Un mémoire présenté le 11 janvier 1788 par l’abbé Delalande, curé d’Illiers-l’Evêque, syndic député des curés du diocèse d’Evreux, chargé de relever les inégalités qui existaient dans la répartition des charges publiques, établissait, au sujet du rôle des décimes, le revenu des bénéfices suivants et les taxes correspondantes: l’évêché d’Evreux, d’une valeur annuelle de 36.000 livres, était taxé 1.283 livres, au lieu de 6.000; l’abbaye de Lyre, qui dépendait de la congrégation de Saint-Maur, payait 6.000 livres, au lieu de 16.000 livres, et la mense conventuelle de Lyre, d’une valeur de 45.000 livres, était taxée 2.283 livres, au lieu de 7.500 livres. Il en était de même pour les riches abbayes et la plupart des évêchés de France. Les cures, au contraire, étaient imposées avec une rigueur injuste: celle de Saint-Martin de l’Aigle, casuel réuni, et celle de La Ferté-Fresnel, paroisses qui appartenaient alors au diocèse d’Evreux, payaient le triple de leur valeur réelle. Les paroisses de Saint-Barthélemy de l’Aigle, de Saint-Sulpice-sur-Risle avec le prieuré, de Crulai, Vitrai et Irai, dépendirent pendant plus de cinq siècles de l’abbaye de Saint-Lomer de Blois et de Moutiers-au-Perche, par suite d’une donation faite par Engenouf, second baron de l’Aigle. Pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, les monastères avaient reçu de toutes mains une telle étendue de terres que la pénurie de frères convers obligea les abbés à donner à bail à des laïques une grande partie de leurs biens ruraux. Sous le règne de saint Louis, les procureurs des abbayes ont baillé, fieffé, accensé des milliers d’hectares. Et les moines tenaient bien ce qu’ils tenaient.
Immensément riche, le haut clergé menait une existence fastueuse et mondaine, vivait dans des palais somptueux comme celui de l’évêque de Strasbourg, le cardinal Louis de Rohan, dont les revenus dépassaient 600.000 livres. Les évêchés étaient devenus des apanages de cadets, transmis d’oncle à neveu. Gabriel Le Veneur fut nommé par le roi évêque d’Evreux dès l’âge de quatorze ans, à la place d’Ambroise Le Veneur, son grand-oncle, bien que le pape refusât d’abord les bulles. Quelques années plus tard, il devint abbé commendataire de Lyre, de Jumièges et de Saint-Evroul. Tous les bénéfices riches étaient mis en commende, c’est-à-dire réservés pour être donnés comme gages de faveur, ou à des cadets de maisons nobles qu’on faisait pour cela entrer dans le clergé, ou à des ecclésiastiques qui n’appartenaient nullement à l’ordre auquel les biens avaient été donnés. Ces clercs privilégiés, et pour la plupart oisifs, jouissaient d’énormes revenus sous le nom d’abbés et de prieurs commendataires. L’abbé de Clairvaux, dont dépendaient cent soixante monastères, touchait 390.000 livres par an. A l’âge de onze ans, Armand Le Bouthillier de Rancé, le futur réformateur de la Trappe, était en possession des commendes ou bénéfices suivants: abbé de la Trappe, de Notre-Dame-du-Val, de Saint-Symphorien de Beauvais, de Saint-Clémentin-en-Poitou; prieur de Boulogne, près de Chambord, et chanoine de Notre-Dame de Paris. En 1789, on évaluait les seuls immeubles ruraux du clergé, non compris les bois et forêts d’une valeur à peu près égale, à plus d’un milliard de livres. Mais, par suite de la dépréciation des assignats, on vendit ces biens de mainmorte à vil prix, et le trésor n’a jamais pu établir d’une manière précise le produit de cette gigantesque opération foncière. Comme on objectait à Mirabeau qu’il était impossible de trouver des acquéreurs pour tant de terres à la fois, il répondit: «Mieux vaut les donner pour une apparence de prix que de les laisser incultes; après un an, elles produiront des fruits qui augmenteront la fortune publique.» La prévision de Mirabeau se réalisa. L’opération foncière sur laquelle on avait gagé les émissions de papier-monnaie avorta, mais la plupart des biens nationaux vendus restèrent entre les mains des détenteurs, des laboureurs, qui surent en tirer parti par leur travail et leur âpreté.
Le bas clergé, curés de campagne et vicaires, était pauvre. Sous Louis XVI, la portion congrue des desservants était fixée à 700 livres pour les curés, à 375 livres par les vicaires. Las de chercher le bonheur par une série de renoncements, ils avaient le souci obsédant d’effacer les inégalités injustifiées, de supprimer les privilèges. D’autre part, sortis du peuple, vivant au milieu de gens simples et rudes dont ils partageaient l’existence difficile, ces prêtres furent parmi les premiers adeptes des réformes, et les députés du bas clergé contribuèrent au renversement de la monarchie. Instruits, les vicaires des paroisses urbaines avaient lu les œuvres des économistes et des philosophes, de Rousseau principalement, le théoricien de la souveraineté du peuple, l’apôtre de l’égalité sociale. Philosophes, économistes et encyclopédistes déclaraient qu’on doit agir conformément à des principes vérifiés par la raison, reconnus justes par elle, pourquoi dès lors ces prêtres n’auraient-ils pas eu le sentiment de valoir, par leur intelligence et leur culture générale, leurs supérieurs ecclésiastiques d’origine noble, qui les traitaient de haut? La plupart se rallièrent à la formule de Sieyès, comme l’avait fait d’emblée, le 14 juin 1789, l’abbé Grégoire, alors curé d’Emberménil, qui fut l’un des secrétaires de la réunion du Jeu de Paume.
Entré dans ce courant d’idées, Vaugeois s’accoutuma, par l’étude de Locke et par la lecture de l’Encyclopédie, «tableau général des efforts de l’esprit humain dans tous les genres», suivant le prospectus, mais formidable publication contre les institutions du passé, à méditer avec une complète indépendance de pensée, avec l’esprit de subjectivisme, sur les institutions politiques. Sous l’habit ecclésiastique, c’était un de ces hommes qui, suivant l’appréciation de Lamartine, cachaient le cœur d’un philosophe. «Novateurs par l’esprit, prêtres par état, sentant la contradiction profonde entre leur opinion et leur caractère, une religion gallicane leur paraissait le seul moyen de concilier leur situation et leur politique.» Ils se proposaient de ramener le catholicisme à un code de morale, à l’évangile où le dogme ne serait plus qu’un symbole dépouillé des fictions sacrées, mais n’excluant rien, ne déterminant rien, si ce n’est le sentiment, ainsi que le voulait, suivant Renan, l’initiateur du monde à un esprit nouveau.
En correspondance suivie avec Brissot qui publiait, sous le pseudonyme de Warville, des libelles et des pamphlets, Vaugeois collabora au journal le Patriote français et, sur la demande de Brissot dont l’influence sur les fédérés était grande, il traduisit des ouvrages anglais pour la société des Noirs, présidée par Grégoire. Dans son ouvrage sur la littérature des nègres, ce dernier soutenait que les aptitudes et les qualités morales des noirs sont analogues à celles des blancs et, contrairement à l’ironique plaidoyer de Montesquieu, il proclamait que «Dieu qui est un être très sage, a mis une âme bonne dans un corps tout noir» — ce qui justifiait la propension ultra-moderne à faire du nègre.
Fidèles aux doctrines gallicanes et peut-être jansénistes, quand l’assemblée constituante jugea à propos de s’immiscer dans les questions de l’ordre ecclésiastique, de mettre la main à l’encensoir, Grégoire, Vaugeois et Jarante, évêque d’Orléans et baron fossier de Normandie, acceptèrent les principes de la constitution civile du clergé et furent au premier rang des prêtres ayant prêté le serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques; mais dans l’intérêt des pauvres secourus par les prêtres, ils auraient voulu qu’une dotation en biens-fonds fût spécialement assurée aux curés assermentés, et s’ils se rallièrent au principe de l’élection des évêques, parce qu’ils y voyaient un retour aux usages de l’église primitive, ils critiquèrent la singulière admission des non-catholiques dans le corps électoral. A ce point de vue, il faut bien reconnaître que la réforme qui attribuait un tel pouvoir à l’élection publique usurpait sur le spirituel.
Grégoire, ayant été appelé à l’épiscopat constitutionnel par les deux départements de la Sarthe et de Loir-et-Cher, opta pour ce dernier département et choisit pour son vicaire général Vaugeois. Dès lors ce dernier devint l’actif collaborateur de Grégoire, qui avait été nommé le 18 janvier 1791 président de l’assemblée nationale, et il l’accompagna à Paris, où il retrouva ses anciens camarades de Chartres, Brissot et Pétion, devenus les chefs des Fédérés. Il partageait leurs idées sur les institutions incompatibles avec les réformes politiques et sociales dont la nécessité s’imposait, il partagea leurs travaux et participa à la lutte contre le pouvoir royal jusqu’à la proclamation de la république, le 25 septembre 1792. Homme de 1789, il estimait que la loi, expression de la volonté générale, se place au-dessus des trônes comme au-dessus de toutes les volontés particulières et il voulait substituer au pouvoir absolu ou à l’anarchie un état de loi, ou plus exactement, comme disaient les conventionnels, le règne de la loi.
L’influence et la popularité de Brissot et de Pétion ne devaient avoir qu’une durée éphémère. Connaissant l’intégrité et la compétence de Vaugeois, qui avait renoncé au ministère ecclésiastique, ils le firent nommer d’abord commissaire national du pouvoir exécutif en Belgique, puis accusateur public en Normandie et en Bretagne, où il présida la commission révolutionnaire à l’armée des côtes de Brest.
A la même époque, Grégoire avait été chargé avec trois autres membres de la convention, Hérault de Séchelles, Jagot et Simon, de se rendre en Savoie et dans le comté de Nice, réunis à la République en exécution du vœu spontané des populations, pour y organiser l’administration française dans les départements du Mont-Blanc et des Alpes-Maritimes. Revenu de sa mission en mai 1793, Grégoire trouva la Convention bien différente de l’assemblée qu’il avait quittée six mois auparavant. «Ce n’était plus, écrit-il, l’assemblée qui fondait la république, mais une sorte de club où régnaient deux ou trois cents scélérats, puisque la langue n’offre pas d’épithète plus énergique.» — «Ce qui constitue une république, disait Saint-Just, c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé.» Sentant qu’il ne pouvait pas empêcher les proscriptions ni s’opposer aux mesures sanguinaires, Grégoire se tint à l’écart et se consacra au comité d’instruction publique où avec les autres membres, Sieyès, Lakanal, Fourcroy, Marie-Joseph Chénier, Boissy d’Anglas et le peintre David, il a rendu aux sciences, aux lettres et aux arts, d’inoubliables services .
Des sociétés populaires puis des comités révolutionnaires avaient été créés dans la plupart des communes sous des dénominations pompeuses, de nature à donner carte blanche à la bêtise humaine et à déchaîner les plus basses passions: sentinelles de la liberté, yeux de la nation, surveillantes de l’autorité — qualifications qui expliquent bien des choses, certaines âneries incompréhensibles autrement, car c’était déléguer des pouvoirs exorbitants à n’importe qui, investir d’une mission politique des esprits bornés, obtus, dépourvus d’instruction mais non de vanité, de rancune et de sectarisme. A une circulaire adressée par le comité d’instruction publique aux administrations de district, l’une de ces surveillantes de l’autorité répondait que: «dans son arrondissement toutes les plantes indigènes et exotiques croissaient naturellement; et une autre, par contre, assurait que dans le sien on n’en trouvait ni des unes ni des autres». En sorte que de ces deux coins de la France, ainsi que le constatait Grégoire, l’un aurait réuni toute la végétation du globe, et l’autre aurait été pareil aux sables de l’Arabie.
Le conseil de la commune de Paris qui exerça une redoutable dictature après les journées des 31 mai et 2 juin 1793, à la suite des excitations de Marat au pillage et au meurtre, donnait des instructions féroces aux sociétés et comités révolutionnaires de province. Paris était un séjour de sécurité à côté des villes où instrumentaient les représentants en mission tels que Carrier, Collot d Herbois, Couthon, Fouché, Lebon et Saint-Just. Au moment de la grande Terreur, où les comités révolutionnaires étaient peuplés d énergumènes, où les moindres paroles et les actes les plus inoffensifs pouvaient recevoir la pire interprétation, où les dénonciations étaient si facilement accueillies avec la ténébreuse loi des suspects, on se rend compte des dangers auxquels étaient exposés non seulement les ci-devant, mais tous ceux qui possédaient une situation susceptible d’exciter les convoitises. Soupçons, prétextes, tout était bon pour s’approprier le bien d’autrui. «Le mot de friponnerie, dit Grégoire, rappelle les anciens comités révolutionnaires, dont la plupart étaient l’écume de la société, et qui ont montré tant d’aptitude pour le double métier de persécuter et de voler.» En procédant à des inventaires ou à des ventes après le décès des héritiers des anciens agents nationaux ou des membres des comités révolutionnaires, les commissaires-priseurs de province eurent assez fréquemment la surprise, pendant la première moitié du dix-neuvième siècle, de trouver parmi des meubles communs des objets de luxe, des bonheurs-du-jour, des coiffeuses ou poudreuses, des commodes en bois de rose, des bergères sculptées, voire des clavecins, tous meubles du dix-huitième siècle, dont ils ne s’expliquaient pas la présence dans un pareil milieu où dominaient les hardes et les grabats.
Dès l’année 1790, sur l’initiative de l’archéologue Alexandre Lenoir, une commission des monuments, composée de savants et d’artistes, avait obtenu de l’assemblée nationale constituante l’autorisation de rassembler à Pans, dans l’ancien couvent des Petits-Augustins, les statues, tableaux, châsses et autres objets d’art, dignes de conservation, provenant des églises et couvents supprimés, ainsi que les mausolées et tombeaux sculptés qui seraient placés dans le jardin attenant à l’ancien cloître des Augustins. Lenoir fut nommé, le 4 janvier 1791, conservateur de cette collection qu’on appela musée des Petits-Augustins, ou musée des monuments français, poste qu’il occupait encore en 1815. Un décret du 24 octobre 1893 défendit de détruire ou de mutiler les monuments des arts, sous prétexte d’en faire disparaître les signes de la féodalité. Mais pendant la terreur, sous peine d’être traité en suspect, Lenoir dut limiter ses interventions, sur l’injonction du comité de salut public et sous les menaces de la commune de Pans, et devint impuissant à sauvegarder les objets mobiliers. Chaumette, dit Anaxagoras, fils d’un cordonnier de Nevers, procureur syndic de la commune, Fournier l’Américain, Hébert et Jacques Roux, surnommé le prédicateur de sans-culottes, provoquaient ouvertement la destruction des objets d’art.
Paris s’emplit du mobilier provenant des palais royaux, des châteaux et des manoirs des condamnés et des émigrés, des objets cultuels des églises et des abbayes, de ce qu’on appelait les dépouilles de la royauté et du nobilisme, les hochets du fanatisme. Chez les marchands de bric-à-brac, on trouvait des mitres et des couronnes à côté de bonnets phrygiens; des statues en pierre et en bois des vieux saints de France voisinaient avec les bustes en plâtre de la Liberté, de Marat et de Robespierre. Dans les boutiques des fripiers s’entassaient les ornements cultuels, des robes à traîne en soie lamée d’or ou d’argent, des gilets brodés de ci-devant, à côté de carmagnoles et de cotillons rouges, à vendre au décrochez-moi-ça. Sur les murs, les peintures représentant des nymphes, des amours, des bergères, toute l’idylle galante du XVIIIe siècle, s’effaçaient à côté des images populaires violemment coloriées, encadrées des emblèmes d’usage: faisceaux, chaînes, haches et piques.
Depuis le 25 août 1793, on vendait aux enchères publiques, tous les dimanches, à Versailles, en exécution de la loi du 10 juin 1793, les meubles et les chefs-d’œuvre de tous les arts accumulés depuis Louis XIV dans le château et à Trianon. Cette vente formidable dont le procès-verbal ne remplit pas moins de trente-cinq registres in-folio, se prolongea pendant toute la durée de la terreur, éparpillant les meubles royaux au gré des amateurs étrangers, des Anglais principalement. Dès le 16 septembre 1792, le garde-meuble, dépôt qui contenait les plus riches dépouilles de la royauté, avait été pillé une première fois et la partie la plus précieuse de ce qu’il contenait avait passé dans des mains inconnues.
A Paris, la commission des arts devait, en principe, examiner avant la vente du mobilier des émigrés les objets d’art susceptibles d’être conservés dans les bibliothèques et musées nationaux. Mais cette commission, vite débordée, circonvenue ou indifférente, éprouvait de grandes difficultés pour s’acquitter de sa mission qui était loin d’être une sinécure, car depuis la publication de l’Encyclopédie et des œuvres de Buffon, tout personnage de la noblesse et de la finance, tout bourgeois gentilhomme possédait un cabinet, un petit musée et un pavillon quelconque, fût-ce un vide-bouteilles ou un belvédère, appelé Trianon, avec cette fantaisie ironique et cette facilité d’illusion qui caractérisent le Français. Dans la plupart des hôtels particuliers et des châteaux, il y avait une collection artistique ou scientifique de tableaux, dessins et estampes, de livres, de monnaies et de médailles, de pierres gravées, d’armes, d’objets d’histoire naturelle. La vente après décès du mobilier de la marquise de Pompadour, qui avait pourtant légué au roi son cabinet de pierres gravées et à Marigny son frère, ses tableaux, livres et objets d’art, durait encore en 1765, un an après sa mort. En 1793, les commissaires aux inventaires du département de la Seine procédaient à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur. Ils vendaient tout, sans aucun ordre, presque sans publicité : les candélabres, les flambeaux et les appliques en bronze ciselé et doré avec les chandeliers en cuivre; les fines tables de trictrac et de brelan en bois des îles avec les tables de cuisine; les bergères et les fauteuils couverts en tapisserie de Beauvais, portant l’estampille de Jacob, avec les chaises en paille et les escabeaux. On vidait les maisons de la cave au grenier, à n’importe quel prix, ainsi que dans les ventes par autorité de justice, au grand profit des agents étrangers qui se faisaient adjuger pour des assignats les plus beaux modèles des meubles français, malgré les réclamations de Riesener, des menuisiers-ébénistes, des dessinateurs, sculpteurs, doreurs, de tous ceux qui vivaient de la fabrication des meubles de luxe comme Georges Jacob, qui fut incarcéré jusqu’au 9 thermidor.
Depuis le décret du 17 septembre 1793, les huissiers-priseurs de Paris et «les huissiers ci-devant de l’hôtel» avaient cessé les fonctions attribuées à leurs offices. Les notaires, greffiers et huissiers restaient autorisés à faire les prisées et les ventes de meubles «sur toute l’étendue de la République». En réalité, la direction des ventes mobilières était abandonnée à des commissaires-artistes ou à des agents d’affaires affiliés aux comités révolutionnaires. Il fallait mettre le holà à ces malversations, sous peine de voir disparaître tout ce qui avait un caractère artistique ou une valeur comme antiquité.
Admirateur des choses du passé dont le goût idéalisé avait déterminé son stage ecclésiastique, «tout le secret d’une vie d’homme, suivant Taine, étant de s’incorporer à quelque chose de plus grand que soi», Vaugeois avait signalé à Grégoire, au cours de ses missions comme commissaire du pouvoir exécutif, accusateur public, puis chef du bureau des lois, la destruction ou la vente à vil prix de manuscrits, de chartes et d’anciens documents précieux pour notre histoire. Ce n’était pas sans un sentiment de regret, sinon de remords, que bien des acteurs de la révolution, en particulier les anciens prêtres, assistaient à la démolition de tant de monuments historiques, à la destruction de tant de merveilles qu’on brisait, qu’on faisait fondre, qu’on brûlait; ils commençaient à se rendre compte qu’ils avaient livré la civilisation aux barbares d’en bas. Toutes les grandes crises sociales augmentent d’ailleurs notre attachement aux choses du passé dont on pressent la disparition. C’est à l’intervention de Lenoir, Dussaulx et Vaugeois, auprès du conventionnel Sergent, né à Chartres, plus connu comme dessinateur et graveur sous le nom de Sergent-Marceau, qu’on doit attribuer le décret de la convention nationale du mois de novembre 1793, mettant «une somme de 100.000 livres par an à la disposition du gouvernement, pour faire acheter dans les ventes particulières des tableaux ou des statues qu’il importe à la République de ne pas laisser passer dans les pays étrangers». Jusqu’ à la fin du XIXe siècle, ce crédit annuel, affecté au budget de l’Etat, a constitué la seule dotation régulière des musées du Louvre, de Versailles et du Luxembourg.
Le comité d’instruction publique de la convention ayant été saisi de nombreuses plaintes, en dehors des ventes irrégulières, signalées par Gabriel Vaugeois et par Lenoir, administrateur du musée des Petits-Augustins, Grégoire entreprit une campagne de préservation des œuvres d’art, des bibliothèques et des monuments, dont un grand nombre avaient déjà été détériorés ou détruits par des ignorants et des spéculateurs, et il demanda à Lenoir et à Vaugeois, en raison de leurs connaissances en archéologie et en bibliographie, de lui transmettre tous les documents utiles à la préparation d’un rapport sur le vandalisme et les moyens de le réprimer, qu’il présenterait à la Convention, au nom du comité d’instruction publique, ainsi qu’il l’avait déjà fait en nivôse an II, pour les inscriptions des monuments publics.
Les travaux si variés de Grégoire, en dehors de ses interventions à la tribune, les ouvrages publiés par lui qui témoignent de son érudition, à défaut de méthode et d’esprit critique, ont été un objet d’étonnement même pour ceux qui connaissaient son activité et son extrême facilité de travail. Voici, pour une partie de son œuvre, l’explication de cette production intense. Il écrivait vite, et plus orateur qu’écrivain, il ne s’inquiétait pas de faire tantôt grand ce qui est petit, et tantôt petit ce qui est grand; puis, au lieu de classer par ordre les divers éléments d’une enquête, il les transposait pour y intercaler des citations empruntées à l’histoire grecque ou romaine, alors si en vogue. Avec ces additions et interpolations, on ne comprend souvent l’importance de certains faits rapportés par lui qu’en lisant les ouvrages de Lenoir et les études archéologiques et historiques de Vaugeois, où l’on trouve la genèse ou le commentaire, forme et fond, de différentes parties des rapports du 14 fructidor an II, des 8 brumaire et 24 frimaire an III.
Pour ses rapports sur l’instruction publique, Grégoire ne fut parfois que le porte-parole du comité, ce qui ne diminue pas sensiblement son mérite, parce qu’il fit preuve d’un réel talent de manœuvrier politique et d’une grande ténacité pour assurer la prise en considération des avis du comité d’instruction publique dont il était l’organe. Il avait le don du mot bref, du mot qui porte, qui fait mouche, et à l’exemple des anciens prédicateurs, aux sermons macaroniques, qui vitupéraient en chaire, il avait l’habitude de tonner à la tribune. Sieyès, Lakanal et même Fourcroix, penseurs doués d’un esprit géométrique, se reconnaissaient peu aptes à discuter en public, leur souci de la dialectique et de la pureté des formes leur interdisait les clameurs non mesurées; il en était de même, pour des motifs différents, du peintre David et du poète M.-J. Chénier, l’auteur du Chant du Départ. A raison de sa facilité d’élocution et de son caractère combatif, ils chargeaient donc Grégoire, avide de propager son dogme, de présenter et de soutenir leurs propositions. C’est ainsi qu’il fut, le 10 octobre 1794, rapporteur du projet de décret qui créa le conservatoire des arts et métiers, puis de la proposition relative à la création du bureau des longitudes.
A la suite de plusieurs délibérations, le comité d’instruction publique avait arrêté le texte du décret sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, dont Grégoire était chargé d’exposer les motifs à la convention. Dans ce rapport, rédigé dès les premiers mois de l’an II et dont l’exorde reproduit textuellement un réquisitoire de Vaugeois contre un accapareur belge qui, sous prétexte de bien public, voulait faire incarcérer les principaux fabricants de drap de Verviers, Grégoire avait la précaution d’attaquer d’abord les fripons, qualification de nature à impressionner favorablement Robespierre, puis il s’en prenait aux moines et, suivant la formule d’usage, aux tyrans, enfin aux contre-révolutionnaires qui, «le poignard levé pour assassiner les arts», espéraient que, de l’excès du mal, sortirait ce qu’ils considéraient comme le bien, le rétablissement de la monarchie. Il terminait son rapport par cette phrase sensationnelle: «L’impunité du crime est un outrage à la vertu, une plaie au corps social.»
Cet exposé ne rassura pas Sieyès ni l’ancien doctrinaire Lakanal, ennemis des appels à la vertu et du mode exalté, qui exprimèrent l’avis de surseoir au dépôt du rapport, en soulevant les objections suivantes. Les gens du commun, aux sens grossiers, étaient incapables de faire une différence entre les œuvres d’art et les objets usuels; on ne pouvait leur faire un crime de cette incompréhension congénitale, incompréhension commune à la plupart des agents nationaux révolutionnaires et des administrateurs des districts ruraux. Et comment n’en aurait-il pas été ainsi alors que, depuis des siècles, quelques privilégiés possédaient des objets usuels merveilleusement ouvragés, tandis que des millions d’hommes étaient dépourvus non seulement du luxe, mais de l’utilité, de l’usage des mêmes objets.
Que penserait Robespierre? Avec sa susceptibilité d’halluciné, ne venait-il pas de faire saisir et brûler les manuscrits de Timoléon, tragédie de M.-J. Chénier, sous un prétexte futile. L’idée de réprimer les actes de vandalisme ne venait pas de lui qui considérait ses seules idées comme bonnes et les assimilait à des dogmes intangibles. D’autre part, son austérité systématique et son mépris du confort lui faisaient dédaigner les objets d’ameublement somptueux, tout le superflu. Cela n’existait pas pour lui, et il prétendait être le modèle impeccable sur lequel tout devait se régler. Le mobilier de sa chambre, chez le menuisier Duplaix, se composait d’un lit en noyer, d’une table, de quatre chaises et de planches de sapin fixées à la muraille en guise de bibliothèque. Quel accueil ferait-il à ce réquisitoire, lui qui considérait le luxe «corrupteur» comme un vice pour l’individu et pour la société ?
Le comité d’instruction publique décida, malgré l’urgence, de surseoir au dépôt du rapport sur le vandalisme, conformément aux observations de Sieyès et du président Lakanal, et d’attendre des temps meilleurs.
La mort de Robespierre, qui symbolisait la violence, bien qu’elle fût l’œuvre des terroristes, eut pour conséquence la disparition des éléments néfastes, la fin du régime de la terreur et le retrait, imposé par l’opinion publique, de la plupart des mesures révolutionnaires. Le comité de salut public remanié fut placé sous la surveillance de la convention et Sieyès en fut nommé membre, les pouvoirs de la commune furent transférés à des membres de la convention, où on rappela les dantonistes survivants et ceux des girondins qui avaient échappé à la proscription. Gabriel Vaugeois fut élu député suppléant de Paris. Alors commença la seconde période vraiment organisatrice de la convention, celle où elle fonda ou réorganisa les principaux établissements scientifiques ou artistiques, qui succéda à celle de destruction où le gouvernement révolutionnaire méritait, dans toute l’acception du mot, l’accusation de vandalisme et de barbare incompréhension.
Un mois après le 9 thermidor, dès la séance du 14 fructidor an II de la république, Grégoire donna lecture de son premier rapport, le plus important, sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, rapport suivi du décret de la convention nationale.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit:
1° Les bibliothèques et tous les autres monuments de sciences et d’art appartenant à la nation, sont recommandés à la surveillance de tous les bons citoyens; ils sont invités à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et dégradations des bibliothèques et monuments.
2° Ceux qui seront convaincus d’avoir, par malveillance, détruit ou dégradé des monuments de science et d’art, subiront la peine de deux années de détention, conformément au décret du 13 avril 1793.
3° Le présent décret sera imprimé dans le bulletin des lois.
4° Il sera affiché dans le local des séances des corps administratifs, dans celui des séances des sociétés populaires, et dans tous les lieux qui renferment des monuments de sciences et d’arts.
5° Tout individu qui a en sa possession des manuscrits, titres, chartes, médailles, antiquités provenant des maisons ci-devant nationales, sera tenu de les remettre, dans le mois, au directeur du district de son domicile, à compter de la promulgation du présent décret, sous peine d’être traité et puni comme suspect.
6° La convention décrète l’impression du rapport et l’envoi aux administrations et aux sociétés populaires.
Ce premier décret du 14 fructidor an II fut suivi de celui du 8 brumaire an III, sanctionnant les mesures répressives proposées par le comité d’instruction publique, à la suite du second rapport de Grégoire sur le vandalisme.
Dans ce rapport, ainsi que dans le suivant, Grégoire dénonçait la malfaisance et l’ignorance de certaines municipalités et administrations de district: «Malgré vos décrets et vos invitations réitérées beaucoup d’administrations ne rendent aucun compte, et surtout elles n’ont garde de s’expliquer sur certains objets qu’il faudra bien retrouver.
«Quelques administrations paraissent encore composées d’après le système désorganisateur qui repoussait tous les talents: l’une nous marque qu’elle ne possède en objets d’art que quatre vases, qu’on lui a dit être du porphyre; une autre nous observe qu’elle n’a aucun monument, parce qu’on ne trouve dans son arrondissement ni usine, ni fabrique, ni manufacture; une troisième nous annonce que la confection de ses catalogues bibliographiques est retardée, parce que son commissaire ne sait pas la «diplomatique». Des symptômes d’une ignorance aussi prononcée font présumer l’absence de beaucoup de notions usuelles.
«Des esprits pusillanimes trouveront peut-être que cette ignorance rappelle des événements que l’on doit ensevelir dans un profond oubli; mais il importe, au contraire, à la nature humaine, que l’on en montre les ridicules dans toutes leur hideuse nudité, afin d’en prévenir le retour. Déjà l’on a observé que dans les places où il fallait de la tête, se trouvaient des hommes qui n’avaient que des bras. Si chacun était à la place que comporte son talent, on n’aurait pas vu des subordonnés faire distribuer, pour cataplasmes dans les hôpitaux, une précieuse cargaison de graine de lin de Riga, prise sur un bâtiment ennemi, tandis qu’on pouvait la remplacer par d’autres.»
Décret du 8 brumaire an III. — Article premier. — Les agents nationaux et les administrateurs de district sont individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises dans leurs arrondissements respectifs, sur les livres, les antiquités et autres monuments de sciences et arts, à moins qu’ils ne justifient de l’impossibilité réelle où ils ont été de les empêcher.
Art. 2. — Dans la décade qui suivra la réception du présent décret, ils rendront compte à la commission d’instruction publique de l’état des bibliothèques et de tous les monuments de sciences et d’arts qui sont dans leur arrondissement, ainsi que des dégradations et dilapidations qui auraient été commises.
Art. 3. — La commission d’instruction publique et la commission temporaire des arts prendront toutes les mesures nécessaires pour l’exécution | du présent décret, sous la surveillance du comité d’instruction publique; il dénoncera à la convention nationale les administrations qui auraient négligé de s’y conformer.
Le 24 frimaire an III, la Convention décréta également l’impression du troisième rapport de Grégoire, son insertion au bulletin des lois et l’envoi aux autorités constituées.
Si les mesures de répression édictées, assez anodines au lendemain de la Terreur, n’exercèrent pas une grande impression sur la masse, de même que les sentences philosophiques, les objurgations et les recommandations à la surveillance des bons citoyens, il n’en fut pas de même de la crainte des dénonciations aux autorités constituées, des provocateurs et des auteurs responsables des dilapidations, par suite de la publicité donnée aux rapports. C’était inquiétant, parce que les vices des hommes, s’ils sont toujours à peu près les mêmes, varient dans leurs formes selon les circonstances. Insensibles au regret d’une mauvaise action, au remords, ils ne l’étaient pas à la crainte d’avoir des «ennuis». «Si la délation est odieuse, disait le rapporteur, la dénonciation civique est une vertu: c’est un devoir de dénoncer les détenteurs de livres et autres objets enlevés chez les moines et les émigrés.» Puis, sans aucune hésitation, Grégoire avait remplacé le mot tyran par le nom de Robespierre, qu’il vouait aux gémonies en tant que dictateur, lui et ses suppôts, les jacobins. «Dans la plupart des communes, annonçait-il, est encore un petit Robespierre, et tandis que le moderne Catilina a expié sa férocité sur l’échafaud, ses lieutenants sont tranquilles. Dans les divers lieux où les arts ont reçu tant d’outrages, les auteurs, pour la plupart, sont connus, et les agents nationaux deviennent complices en ne les dénonçant pas aux accusateurs publics. On parle souvent de frapper les fripons, mais des mots ne les atteignent pas; plusieurs jouissent de fortunes colossales, et dont l’origine est très équivoque. Indépendamment des peines prononcées par la loi, on devrait inscrire les noms des coupables en lieu public, particulièrement sur les monuments dégradés.»
On aurait tort de croire que cela ne signifiait absolument rien. Tous ceux qui n’avaient pas la conscience nette, tous ceux qui avaient péché en eau trouble, tous ceux qui avaient gardé par devers eux quelques parcelles des biens nationaux, quelques miettes du «gâteau des rois» ou du «pain bénit» de l’église, plus ou moins directement visés par ces réquisitoires renfermant bien des griefs d’accusation, éprouvèrent le sentiment d’inquiétude qui est le commencement de la sagesse, avec d’autant plus d’appréhension qu’ils prévoyaient une inévitable réaction, les risques d’une terreur blanche après une terreur rouge. C’est ce qui explique le nombre des restitutions jusqu’à la Restauration, au début de laquelle la dauphine reçut une boîte en porcelaine de Sèvres, ornée de seize médaillons représentant les portraits de la famille royale, exécutée à l’occasion du mariage de Louis XVI, prise le 10 août sur le bureau du roi aux Tuileries.
La tragédie où avaient péri tant de victimes, n’avait perdu ni tous ses acteurs ni tous ses témoins. Les jacobins s’en aperçurent les premiers. David, lui-même, membre du comité d’instruction publique, qui avait abandonné son ami Robespierre avant le 9 thermidor, fut décrété d’accusation et emprisonné, malgré les efforts de Boissy d’Anglas et de M.-J. Chénier. Elargi sur la demande de Merlin, de Douai, il fut encore retenu quelque temps chez lui sous la surveillance d’un gardien. Les jacobins n’avaient pas d’ailleurs complètement désarmé. Ils essayèrent de reconstituer leur club, sous le nom de société des Egaux, en vue de compléter la révolution politique par une révolution sociale, par le communisme ou collectivisme. Les conventionnels n’allèrent pas jusque-là. Terribles démolisseurs, ils ne se transformèrent pas en incendiaires, et laissèrent debout les Tuileries, le Louvre, l’Hôtel de Ville et le Palais-Royal, brûlés par les pétroleuses en 1871. «L’élite crée, la plèbe détruit», suivant l’aphorisme du docteur Gustave Le Bon.
Gracchus Babeuf, chef des Egaux, dans son journal, le Tribun du peuple, n° du 28 frimaire an III, protesta avec véhémence contre les rapports de Grégoire sur le vandalisme: «Les sans-culottes devraient bien couvrir de boue un certain rapport de l’abbé Grégoire, au nom du comité d’instruction publique de la convention, sur ce qu’il appelle le vandalisme, où il regrette la basilique de Chartres, celle de Nîmes et celle de Strasbourg, la résurrection du frère Luc, à Verdun, les vitraux de Gisors, les tableaux des sept sacrements de Grasse, le mausolée du maréchal de Saxe à Strasbourg, les stalactites et les stalagmites de Coutances, et autres turpitudes tombées sous le fer destructeur des hochets du fanatisme et du nobilisme.» Parmi les «turpitudes» détruites, Babeuf rangeait, par anticipation, les cathédrales de Chartres et de Strasbourg, ainsi que le mausolée du maréchal de Saxe, bien que cet ancien commissaire à terrier, véritable novateur, qui voyait plus loin que les autres, fût loin d’être un illettré, si l’on en juge par ses publications sur la république des égaux, l’avènement de la justice et du bonheur au moyen de la communauté des biens, du communisme égalitaire, théories reprises par Blanqui. Le babouvisme est la première doctrine socialiste qui ait manifesté ses tendances par un programme de réformes.
La France énervée par l’anarchie et les luttes incessantes des partis, ayant perdu confiance dans des cadres sociaux qui avaient mal résisté, avait besoin de stabilité à l’intérieur, et, pour en jouir, elle se résignait, tant d’événements ayant fait prendre en grippe par l’opinion publique désabusée les dogmes politiques et les formes de gouvernement, à accepter tout chef qui lui assurerait, avec cet avantage, par l’organisation rationnelle des institutions, les réformes durables que la Révolution avait accomplies, la liberté civile, celle du travail et l’égalité devant la loi, sauf à reprendre un jour avec plus d’ordre, de méthode, la marche vers le progrès, mirage de l’humanité.
Ce furent ces sentiments qui amenèrent Vaugeois, alors accusateur public à Namur, à accepter sa nomination par arrêté du premier consul, en date du 17 messidor an VIII, de président du tribunal criminel de Namur qui plus tard, sous sa présidence, prit le nom de cour criminelle. Les tribunaux avaient été invités à émettre leurs idées sur l’élaboration du code pénal, Vaugeois, que ce travail ramenait à ses premières études de droit, alors qu’il collaborait, à Chartres, avec Brissot à la Théorie des lois criminelles, rédigea et fit imprimer, sous le nom du tribunal de Namur, un travail magistral sur la matière, car si les lois changent, et aussi les juridictions, sous ces transformations de la législation, les principes de la justice naturelle ne varient pas. Toutes les propositions de Vaugeois ne furent pas adoptées, parce que les nécessités du temps y firent obstacle, mais les réformes apportées depuis au Code pénal répondent au programme élaboré par lui. Pour reconnaître la valeur de ce travail, il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur, le 24 prairial an XII, puis conseiller à la cour de Liège. Chargé de présider les assises des départements de l’Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër, il contribua, dans cette région, au développement de l’influence française, de concert avec les grands administrateurs que furent les préfets Alexandre de Lameth, Beugnot, de Lézay-Marnezia et l’ancien démagogue Jean Bon Saint-André. L’invasion de la Belgique par les alliés et les événements de 1815 lui enlevèrent sa situation, en échange de laquelle la Restauration ne lui alloua qu’une pension minime de 697 francs. Et pourtant depuis son entrée dans la magistrature, il avait renoncé à toute politique. Mais on lui faisait grief de ses anciennes relations avec Grégoire, resté dans l’opposition, aussi combatif sous la Restauration qu’il l’avait été sous l’Empire, en démocrate incorrigible, suivant l’expression de Napoléon, et dont l’annulation de l’élection comme député de l’Isère, en 1819, devait soulever de vifs débats et polémiques.
Revenu dans son pays, à l’Aigle, où habitait son frère Gilles-René Vaugeois, adjoint au maire depuis 1813, puis président du tribunal de commerce, Vaugeois passa une dernière fois du droit criminel à l’étude des antiquités. De la Normandie et du Perche où il était né, tout lui était cher, car ce que l’homme cherche inconsciemment dans les survivances locales, c’est lui-même, les souvenirs de son enfance, les traces laissées par ses ascendants, l’empreinte du passé. N’ayant plus qu’à suivre cette voie conforme à ses goûts, à son esprit chercheur, en actif protagoniste de l’histoire provinciale, il se mit en rapport avec les sociétés savantes des départements. Depuis sa mise à la retraite, il était membre de l’Académie celtique, devenue la société des antiquaires de France, puis de la société des antiquaires de Normandie, ensuite présidée par Arcisse de Caumont. Dans les Annales de la société libre des arts et belles-lettres de l’Eure, il publia des recherches historiques et ethnographiques sur la ville de Verneuil, des notices sur les monuments celtiques, les forges gauloises et les antiquités romaines de Condé-sur-Iton, puis un travail sur les voies romaines, larges chaussées suivant la ligne de faîte des collines d’où la vue s’étend sur des échappées en plaine, désignées encore sous les noms de chemins de César, chemins ferrés, perrés ou pierrés. Membre de la commission des antiquités et des archives de l’Eure, Vaugeois fut nommé en dernier lieu conservateur honoraire des monuments historiques de l’Orne. Sous la Restauration, en 1824, il se départit un instant de sa réserve, après avoir cherché inutilement dans les environs de Chartres et de Mortagne des monuments celtiques dont il ne trouva plus que des débris, parce que des entrepreneurs de routes avaient jugé plus expédient de les briser à la mine que d’aller chercher plus loin quelques tombereaux de pierres. Indigné, l’ancien adversaire du vandalisme demanda à la société des antiquaires de France de contresigner une réclamation si péremptoire que l’administration des ponts et chaussées respecta à l’avenir les monuments mégalithiques, les dolmens et les menhirs de la Beauce et du Perche. Après cet intermède, il reprit son existence toute de silence et d’effacement.
Travailleur un peu oublié au soir de sa vie, dans le milieu provincial bourgeois, positif et pratique, où dominaient les qualités moyennes d’ordre, de prudence, d’économie, et la peur du qu’en-dira-t-on, contempteur par conséquent d’une vie mouvementée comme la sienne, qui avait eu son éclat et ses dangers, Vaugeois s’en consolait par le souvenir des grands événements de l’histoire contemporaine auxquels il avait pris part et par l’étude des survivances locales qu’il synthétisait dans le cadre exigu de son Histoire des Antiquités de la ville de l’Aigle et de ses environs.
Contrairement à Grégoire dont les obsèques avaient provoqué en 1831 les mêmes manifestations qu’aux funérailles de Benjamin Constant, le 12 décembre 1830, où la jeunesse libérale et romantique avait, au sortir de l’église, dételé les chevaux du char funèbre pour le traîner à bras jusqu’au cimetière, Vaugeois mourut sans bruit, le 1er juin 1839, à l’Aigle. Quitter la vie avec éclat lui eût paru un manque de discrétion. Le monde oublie vite ceux qui l’oublient, ainsi que le constatait La Sicotière, son collègue à l’association normande. Aucune des biographies des contemporains, ancienne ou moderne, n’a cru devoir recueillir son nom. Les sociétés savantes aux travaux desquelles il avait pris une part active, ont seules rendu hommage à sa mémoire.
Que son nom passe ou demeure, nous devons lui être reconnaissants, au même titre qu’à Grégoire et à Lenoir, d’avoir pris l’initiative de défendre et d’assurer ainsi la conservation des œuvres qui présentent un intérêt national au point de vue de l’histoire, de l’archéologie ou de l’art. Sans ces hommes qui n’hésitèrent pas à faire violence à la Convention pour en obtenir des lois protectrices, que seraient devenus tous nos chefs-d’œuvre: les meubles précieux, les tableaux et les statues des musées et palais nationaux; les objets de science, d’histoire et d’archéologie, réunis dans les musées spéciaux et les autres établissements de l’état; les manuscrits, les estampes, les médailles des bibliothèques faisant partie du domaine mobilier de l’Etat, toutes ces merveilleuses collections artistiques qui font, avec les monuments historiques, la renommée de notre pays dans le monde? Tout cet idéal qui résume l’effort des siècles et symbolise le génie de notre race, idéal de beauté et d’art d’une civilisation lointaine, aurait en partie disparu, ainsi que des milliers d’objets mobiliers, d antiquités, qui garnissent les édifices cultuels, disséminés dans toutes les églises de France, classés par l’administration des beaux-arts, par application de la loi sur les monuments historiques. Voilà les résultats de l’œuvre poursuivie par Grégoire, dont les rapports à la Convention sont de grandes pages, non seulement de l’histoire de l’art, mais de l’histoire de France, qui servirent de modèles à des écrivains comme Montalembert et aussi à Victor Hugo, dans sa Guerre aux démolisseurs.
Emile Egger fit réimprimer en 1867 ces trois rapports qui constituent une importante documentation historique, archéologique et ethnographique. Mais les actes de vandalisme y sont énumérés pêle-mêle, à la suite les uns des autres; puis c’est de l’archéologie politique, entremêlée de considérations sociales, de truismes et de paraphrases qui s’accordent mal avec les idées de simplification moderne, avec des notations brèves. Pour comprendre toute la portée de l’œuvre accomplie par le comité d’instruction publique de la Convention, une division par chapitres, facilitant le classement par matières et l’évocation des principaux faits, avec des notes explicatives s’impose, méthode qui permet d’éviter les juxtapositions d’éléments disparates, toujours mal venues et mal vues en français.
Georges JACOB
Collection Meurice