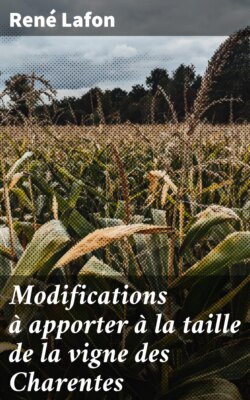Читать книгу Modifications à apporter à la taille de la vigne des Charentes - René Lafon - Страница 3
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
Dans les Charentes, dès le début de la reconstitution du vignoble, les systèmes de taille Guyot simple ou double furent employés de préférence aux systèmes de taille courte, parce que, tout en étant faciles et rapides à exécuter, ils permettaient d’obtenir une production élevée et régulière.
Nous avions donné la préférence à la taille Guyot simple, et fréquemment recommandé son emploi pour tous les cépages blancs de notre région.
L’objet de cette brochure est d’indiquer les raisons pour lesquelles notre opinion s’est modifiée, et pourquoi nous sommes amené à préconiser l’emploi d’une taille nouvelle, que nous appellerons taille Guyot-Poussard. Et après les avoir exposées, nous décrirons, avec le plus de clarté possible, cette méthode de taille; nous compléterons enfin cette étude par des observations sur l’apoplexie de la vigne et l’indication du traitement préventif et du traitement curatif formulé à la suite de longues et patientes recherches par M. Poussard. Nous y ajouterons quelques considérations personnelles.
Jusqu’à ces derniers temps, on s’accordait à penser que les vignobles ayant produit d’abondantes récoltes pendant une période de vingt à vingt-cinq années (à l’exception de ceux situés dans des sols frais, profonds et riches), devenaient trop onéreux à cultiver pour mériter de continuer à l’être.
En effet, leur production, quoique les frais de culture restent les mêmes — la superficie du vignoble n’ayant pas varié — se trouvait réduite non seulement à cause des pieds de vignes manquants, mais aussi à cause des pieds affaiblis, le nombre des uns et des autres augmentant d’ailleurs chaque année. Il fallait donc se résoudre, après ce laps de temps, à arracher les vieilles souches encore existantes pour replanter le vignoble.
Les capitaux importants exigés par des plantations nouvelles, le manque à gagner résultant des trois ou quatre années qui s’écoulent avant leur production, ont amené un certain nombre de viticulteurs à essayer d’enrayer ou d’éviter l’abaissement des rendements dans les vignobles âgés, en remplaçant les pieds manquants, les uns par des producteurs directs, les autres par des provins. Mais les producteurs directs furent très peu employés, en raison des difficultés d’adaptation au sol, de l’insuffisance de leur résistance phylloxérique dans la plupart des terrains, et du manque de qualité du vin ou des eaux-de-vie qu’ils produisaient. Les provins furent plus souvent utilisés.
Le remplacement des manquants par ce que les vignerons Charentais appellent un «provin» et les jardiniers une «marcotte», puis le provignage de tous les ceps vigoureux furent pratiqués, pour la première fois depuis la reconstitution, par M. A. Verneuil, dans des pièces de vignes dont il avait décidé l’arrachage, afin de leur faire produire le maximum possible de récolte avant leur disparition. Nous continuons à penser que ce procédé est très avantageux à employer dans les vignes dont l’arrachage est décidé en raison du nombre de manquants, de l’utilité de changer le greffon ou d’apporter une modification dans les écartements des rangs et des ceps, etc. etc., et souvent pour plusieurs de ces raisons à la fois.
Mais, provigner une pièce de vigne dont la production baisse, ne permet de la conserver que durant le nombre d’années pendant lequel les suppléments de récolte, dus aux provins, font que le rendement de l’ensemble de la pièce demeure rémunérateur. Aussi, fallut-il chercher mieux; c’est alors que quelques viticulteurs s’étant’ rendu compte que le dépérissement des vieux vignobles était imputable à la taille, qui provoque des plaies plus ou moins considérables et que la taille Guyot simple ou double occasionnant de nombreuses coupes hâtait la disparition précoce des ceps, s’efforcèrent à conserver la vigueur des pieds de vigne, à maintenir leur vitalité et à prolonger leur durée, en un mot à remédier aux causes de dépérissement par une modification des systèmes de taille usités ou même par l’emploi d’une taille nouvelle. — On avait en effet remarqué :
1° Que dans les plantations âgées de 20 à 25 ans et plus, ayant beaucoup de pieds faibles et de manquants, un certain nombre de ceps se maintenaient avec une vigueur et une fructification très satisfaisantes;
2° Qu’à l’emplacement des ceps manquants, le porte-greffe, lorsqu’il n’avait pas été arraché, continuait à se développer normalement, émettant des rejets très abondants utilisables comme bois à greffer;
3° Que les ceps en voie de dépérissement progressif émettaient, les uns de nombreux gourmands au voisinage de la soudure, les autres des rejets au porte-greffe.
De ces observations, on pouvait avec raison conclure que le système radiculaire et une partie du porte-greffe restant sains et vigoureux, la disparition du greffon français ne pouvait résulter que des mutilations de la taille opérée sur les bras ou le tronc du cep. Il en résultait que le système de taille devait être changé ou amélioré afin d’éviter ou de réduire au minimum possible lesmutilations qni provoquent le dessèchement et la mortification des tissus intérieurs ou extérieurs, détériorant plus ou moins complètement les conduits de la sève.
Cette détérioration progressive des tissus où circule la sève est le plus souvent aggravée par la présence du champignon de l’apoplexie, qui en se développant dans les tissus desséchés et ceux en voie de dessiccation, ainsi que nous le verrons plus loin, finit par interrompre complètement la circulation de la sève et par occasionner ainsi la mort soudaine d’une partie du cep ou même du cep entier (apoplexie).
Parmi les viticulteurs qui avaient fait ces constatations, M. E. Poussard, spécialiste de la taille à Pérignac (Charente-Inférieure), est le premier dans notre région qui en ait tiré les véritables conclusions pratiques.
C’est en effet à un modeste vigneron qui, très jeune, commença à apprendre la taille dans le Pays-Bas, puis vint ensuite, comme journalier, sous la direction de MM. Mériot, régisseur, et Sauvignon, chef dé culture, du domaine d’Ars, appartenant alors à M. Emmanuel Castaigne, c’est à ses patientes recherches, à son esprit d’observation, à son intelligente obstination, à ses expériences nombreuses et persévérantes que nous devons de pouvoir présenter notre nouvelle étude sur la taille et l’apoplexie. Il nous plait de le reconnaître et de lui en faire revenir le mérite.
Les résultats des recherches de M. Poussard peuvent être ramenés aux trois point suivants:
1° Efficacité du «curetage» contre l’apoplexie permettant de guérir les ceps partiellement apoplexiés, à la condition qu’une partie du greffon reste saine au-dessus de la soudure, que le sujet soit sain ou partiellement atteint;
2° Un remède préventif contre l’apoplexie;
3° Un système de taille, qui, par son mode d’établissement, évite les plaies sur le tronc du cep et à la base des bras, et qui, dans son exécution annuelle situe toujours les plaies du même côté des bras, assurant ainsi la circulation à peu près ininterrompue de la sève, sur tout le calibre du tronc et dans la plus grande partie des bras porteurs des bois de production (lattes et crochets).
Ce système de taille, en évitant les mutilations sur le tronc même du cep et en assurant la circulation de la sève dans de bonnes conditions, réduit autant que possible les cas de dépérissement et d’apoplexie. Il permet d’obtenir une végétation et une fructification qui se maintiennent meilleures pendant beaucoup plus longtemps qu’avec les systèmes de taille Guyot simple ou double, et ainsi prolonge considérablement la durée des vignes.
Ce système de taille appliqué aux vieilles vignes, augmente leur vigueur et leur fructification.
M. Poussard taille depuis 10 ans une pièce de Folle et Colombard sur Riparia, que le propriétaire avait entreplantée entre les ceps, pour l’arracher 3 ou 4 ans après en raison de son état de rabougrissement et de sa faible production.
Le système de taille Guyot-Poussard double appliqué à cette vigne (soumise jusqu’alors à la taille Guyot double), — sans autres modifications à la culture et à la fumure — en a augmenté la vigueur et la fructification de cinquante pour cent.
Telles sont les conclusions de M. Poussard. Nous les avons étudiées avec soin et nous sommes persuadé qu’elles sont fondées.
Nous allons nous efforcer, dans les chapitres suivants, d’exposer les réflexions qu’elles nous ont suggérées et les études auxquelles elles nous ont conduites, lorsqu’elles nous furent révélées.
René LAFON.