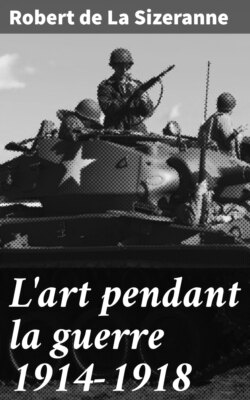Читать книгу L'art pendant la guerre 1914-1918 - Robert de la Sizeranne - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE I
LA PEINTURE ALLEMANDE ET BOECKLIN
ОглавлениеTable des matières
«Depuis un siècle, au moins, les Allemands n’étaient plus maîtres. Ils faisaient figure de petites gens réduites au crédit des voisins, courbées sous une férule de régent. Ils s’avouaient de pauvres lourdauds éternellement stériles qui, incapables de jamais rien produire, devaient toujours se tenir au service, à la discrétion des Anciens, de leurs voisins plus intelligents et à des livres de classe. Ils ébranlaient le monde du tonnerre victorieux de leurs armes; leur science, leur technique, leur industrie envahissaient l’univers: les plus privilégiés d’entre eux cependant languissaient dans une servitude misérable. Oui, leurs chefs commandaient à des armées monstrueuses, à des forces et à des trésors sans nombre; et, touchant la vie intellectuelle, affinée, ils érigeaient la soumission aux idoles des temps morts en dogme patriotique. Vit-on jamais grand peuple en progrès et capable de se créer une civilisation particulière, choir dans une si horrible perversité? Certes, nous étions assez instruits pour savoir qu’il n’y a, pour l’homme, d’honneur à vivre que s’il domine la vie, que s’il lui imprime le sceau de sa puissance, le sceau de sa déification, c’est-à-dire la Beauté. Mais nous n’osions y tendre de nos mains[1]....» Ainsi gémissait, il y a une quinzaine d’années, un critique allemand, s’exprimant en français,—ou à peu près,—dans une des revues d’art les plus répandues outre-Rhin.
Ce gémissement révèle une blessure assez peu connue de la vanité allemande. Nous savions bien qu’il n’y avait plus d’art très original au pays des Holbein et des Dürer,—exception toujours faite pour la musique,—mais nous n’imaginions pas qu’on dût en souffrir à ce point. D’ailleurs, au moment où ces lignes paraissaient, on pouvait voir à l’œuvre, ensemble, Lenbach, Uhde, Hans Thoma, Liebermann, Menzel et quelques autres, dont les portraits ou les scènes modernistes de l’Évangile, ou les tentatives impressionnistes ou les anecdotes sur la vie du grand Frédéric n’étaient pas si méprisables. Mais la jeunesse les méprisait. C’était un art européen, dérivé des Hollandais, des Flamands et des Français. «Vous êtes couverts des signes du passé, leur disait Nietzsche, et ces signes, vous les avez peinturlurés de nouveaux signes..., le visage et les membres barbouillés de cinquante taches..., ô gens du présent! Qui est-ce qui pourrait encore vous reconnaître? Sût-on sonder les reins, qui pourrait croire que vous en avez encore, des reins? Vous êtes pétris de couleurs cuites et d’étiquettes collées les unes contre les autres...» On était dominé par cette idée,—une des plus fausses de la mentalité contemporaine,—qu’un grand peuple, puissant par son négoce ou ses armes, doit nécessairement procréer un grand art. Il y avait disproportion, semblait-il, entre Hambourg et le Palais de Cristal, entre Essen et la galerie Schack. Et les petits racontars de Menzel lui-même, si spirituels et si savoureux qu’ils fussent, donnaient mal l’impression d’un gigantesque effort national. Assez de dîners à Sans-Souci, de Frédéric jouant de la flûte, assez de moines égarés dans les caves ou de jeunes ménagères dévorant des lettres d’amour, assez de promenades sentimentales sur le vieux fleuve, en face des ruines romantiques, au son de la harpe, assez de villageois lutinés par les kobolds, au fond de la vieille forêt germanique, ou de seigneurs en équipages surannés traversant leurs vieilles villes du Tyrol,—tout ce que Menzel, Grützner, Defregger, Richter, Schwind, Spitzweg et tant d’autres avaient chuchoté, si longtemps, sans autre prétention que de les divertir, à leurs auditoires ébahis! Tout cela n’était que de petits côtés de l’Allemagne, traduits par un art aussi bien flamand ou hollandais qu’allemand. A un grand peuple il fallait un grand art, nettement national et inspirateur de grandes actions. L’Art devait être l’éducateur des masses et non leur amuseur. Rembrandt avait été un «éducateur».
De plus, ce n’est pas une culture étrangère, c’est-à-dire «inférieure», que l’Art devait apporter aux peuples germaniques: c’était une culture germanique, par conséquent empruntée au sol même de la patrie. On répétait ces mots du poète Stephan Georg: «Ce qui est le plus nécessaire à l’Allemagne, c’est un geste qui soit, enfin, allemand! Cela est plus important que la conquête de dix provinces!» Voilà où en étaient les jeunes artistes et la jeune critique d’outre-Rhin, dans le dernier quart du XIXe siècle. Ils cherchaient le maître qui ne devait rien aux nations rivales, ni au sentiment latin, pour en faire leur maître. Ils cherchèrent longtemps, tous leurs peintres à cette époque étant plus ou moins infectés de l’esprit et de la technique des Français. Enfin, ils crurent apercevoir celui qui devait les libérer et concentrer les aspirations de Berlin, de Weimar, de Munich, de Darmstadt, de Dresde, de Hambourg. Ils l’aperçurent, debout, au seuil de l’Allemagne, sur les bords du Rhin, tenant la clef du grand art entre ses mains. Ils se précipitèrent vers cet Allemand-type: c’était un Suisse.
Certes, il y a beaucoup à prendre en Suisse et à en apprendre. Les exemples que ce pays nous donne, dans la paix et dans la guerre, seraient bons, par toute l’Europe, à méditer. Et quand on considère que le Suisse en question était de Bâle, il n’est pas très surprenant, au premier abord, qu’une tradition purement alémanique ait pu revivre en lui. A la vérité, il n’habitait point Bâle: il habitait San Domenico, près de Florence, à mi-côte de Fiesole, et vivait entouré de cosmopolites. Mais ce ne sont là que des contingences. Malgré son obstination à vivre loin de sa patrie, on pourrait imaginer qu’il est resté fidèle à sa race, en son volontaire exil. Mais si l’on voit une seule de ses œuvres, on est tout de suite fixé. Tout l’art de Bœcklin est un effort furibond, têtu, désespéré, pour se brancher sur l’antiquité classique et méditerranéenne. C’est la perpétuelle nostalgie d’une race et d’un pays et, plus encore, d’une culture dont il n’était pas ou dont il n’était plus, si, comme le disent ses admirateurs, il en avait été dans quelque «existence antérieure.» Il prend à cette antiquité et à sa mythologie ses sirènes, ses centaures, ses néréides, toute son animalité à figure humaine, mais il les vide, aussitôt, de leur esprit antique, je veux dire la mesure, la pureté des lignes, l’harmonie. C’est Phidias chez Breughel, l’Olympe chez Téniers, quelque chose d’énorme et de débraillé, qui fait songer aux anamorphoses que subirait une statue antique, si elle se trouvait entourée de miroirs déformants ou de boules panoramas. Plus coloriste, il eût approché Rubens, plus spirituel, amusé comme Doré, c’est-à-dire, en tout état de cause, tourné le dos à l’antique. Tel qu’il est, sa prétention au grand art peut intéresser, mais ne touche guère, d’autant que, comme métier, c’est le plus composite et le moins original qui soit. Malgré tous nos efforts,—et Dieu sait si nous avons été hospitaliers aux génies étrangers!—nous n’avons jamais pu admirer ce parti pris violent de mépriser la mesure, dès l’instant qu’il n’aboutissait pas à quelque trouvaille de métier ou d’art.
Fût-il, d’ailleurs, le maître original que quelques-uns ont cru, Bœcklin n’avait plus rien d’allemand, à moins qu’on n’appelle précisément «allemande» depuis Cranach jusqu’à Cornelius, cette foncière inaptitude à comprendre l’Antique. Sur tous les points et avec une application constante, il prenait le contre-pied des vertus qui avaient fait les grands artistes de la vieille Allemagne: la minutie, la conscience, l’étude des visages, analytique et serrée, le goût des joies de la vie intime et recueillie. Aussi est-ce un des plus surprenants phénomènes de mimétisme, que l’engouement des Allemands, et des seuls Allemands, pour ce renégat de toutes leurs traditions esthétiques. Ils avaient tant d’autres modèles! Dans la ville même de Bœcklin, à Bâle, quand on visite les salles hautes de ce curieux musée qui se dresse à pic sur le Rhin, on éprouve une des émotions les plus profondes que puisse donner l’Art: le commerce familier avec des hommes ensevelis depuis plusieurs siècles, dans un subit dédoublement de notre personnalité, qui nous fait assister à la vie de quelques êtres privilégiés bien avant que la nôtre ait commencé. On est devant Holbein: la famille de Thomas Morus, Erasme, Jacob Mayer et sa femme, Dorothée Kannengiesser, Amerbach. Ces figures nous révéleraient, si nous savions les lire, tout le mystère de leur destinée. Les artistes allemands de l’école moderne ont passé devant elles sans y prendre garde. Puis, non loin de ces merveilles, on voit de lourdes caricatures de l’Antique: des allégories où le modèle d’atelier, figé en sa pose, attend patiemment l’heure de se rhabiller, des Naïades jouant dans la mer avec les soubresauts que la foule du dimanche, au jardin d’Acclimatation, se divertit à observer au déjeuner des otaries: la négation constante des utiles leçons d’Holbein, une constante prétention aux grands contours synthétiques aux vastes symboles, à la décoration murale, à la philosophie, exprimée par le dessin le plus commun, le plus banal et le plus lamentablement académique. C’est là que les artistes allemands se sont arrêtés, là qu’ils ont cru trouver l’idée rénovatrice de la peinture allemande! Franz Stuck, Max Klinger, Trubner, Wilhelm Bader, cent autres sont sortis de là.
A la vérité, Bœcklin avait trouvé quelque chose: c’était de prendre les êtres fantastiques créés par l’art antique et de les remettre dans des paysages vrais, les paysages d’où ils étaient venus, où ils avaient été, pour la première fois, aperçus ou devinés par l’imagination apeurée des bergers: de renvoyer Pan et les faunes et les satyres dans les bois, les sirènes et les naïades dans l’eau, les nymphes au creux des sources, et de faire galoper les centaures par les prés et les rochers sauvages. Il tirait l’homme-cheval de sa métope et l’envoyait, d’un coup de fouet brutal, bondir en plein marécage; il dévissait le faune de son socle ou de son cippe, et le jetait à la poursuite d’une femme à travers la feuillée des grandes forêts; il persuadait aux néréides de quitter les trois ou quatre volutes, par quoi sont figurés les «flots grecs», sur les terres cuites ou les mosaïques antiques, pour piquer une tête dans le golfe et faire une pleine eau. De là, mille apparitions imprévues, bien que logiques, d’un ragoût savoureux, qui faisaient écarquiller les yeux des archéologues et rugir d’aise les rapins: des corps de monstres ou de demi-dieux fouettés par les branches, tigrés par la boue, ruisselants d’embruns, pris dans l’écheveau vert des varechs et roulés par le ressac. C’était une idée.
Il en avait une autre, corollaire de la première, et aussi féconde. Étant donné telle forme fantastique mi-humaine, mi-bestiale: le centaure, par exemple, ou le triton ou la néréide, en déduire toutes les postures qu’elle peut prendre, qu’elle doit prendre en certaines occasions et ne pas s’en tenir aux attitudes réglées par la statuaire antique: par exemple conduire son centaure chez le maréchal ferrant, le faire ruer, sauter des obstacles, montrer des néréides qui jouent et s’ébrouent comme des phoques, ou qui font «l’arbre droit», des bébés tritons qui sautent sur les nageoires de leurs pères, une Vénus à demi liquide au sortir des eaux, des faunes ou des ægypans vieillis, blanchissants, obèses, la peau plissée sur des ventres incoercibles, aux confins de la caricature, en un mot, toute une mythologie réaliste. Cela aussi était une idée. Sans doute, l’antiquité en avait donné des exemples, sinon dans ses chefs-d’œuvre, du moins dans ses petites figurines décoratives, sur la panse de ses vases ou au plat de ses murs peints, comme à Herculanum et à Pompéi. L’artiste antique avait, déjà, en plus d’un endroit, suggéré des gestes assez libres à ses tritons et à ses centaures, imaginé des centauresses, voire des ichtyo-centaures, des hippocampes, des panthères marines, des pistris ou serpents-dauphins et même un peu flairé le «grand serpent de mer». Sans remonter si haut, et en s’en tenant à ce qu’on voit au musée de Bâle, Bœcklin avait pu observer de très savoureux gestes de centaures dans les vieux dessins d’Ursus Graf ou de Baldung Grien. Mais ce que nul n’avait jamais fait, c’était les plonger en pleine nature, dans le milieu humide ou herbeux, ou parmi les mystères sylvestres, au fond des paysages découverts par Corot; telle fut l’idée de Bœcklin.
Le malheur de ces idées-là, en art, c’est qu’elles ressemblent trop à des découvertes d’ordre scientifique. On peut les communiquer par de simples mots. Le moindre dessinateur, en les entendant énoncer, voit, tout de suite, le parti qu’il peut en tirer et, sans avoir connu l’œuvre de Bœcklin, il en reproduira l’aspect, à peu près. C’est si vrai qu’il y a eu, dans la vieillesse de Bœcklin, un procès pour savoir si tel tableau était de lui:—et il n’a su le dire, l’ayant oublié! Puis il suffit de tirer les conséquences logiques d’une idée, en art, pour choir inévitablement dans l’absurde. Aussi bien, quand il fut parvenu à la fin de sa vie, le peintre de Bâle, s’exagérant lui-même, rendit-il son système insupportable à ceux qu’il avait, un instant, charmés. La modernité de la Fable avait vécu.
Toutefois, il en était l’inventeur et l’on pardonne beaucoup aux inventeurs. Mais que dire des Allemands, des Stuck, des Klinger, des Bader, des Trubner, des Paul Burck, parfois même de Hans Thoma, qui, venus après Bœcklin, la formule étant trouvée, l’ont systématisée, développée, amplifiée, en un mot exploitée, comme on fait un brevet d’invention? On ne peut s’empêcher, en les voyant, de penser à cette caricature de Bruno Paul dans le Simplicissimus: un jeune rapin famélique, carton sous le bras et pipe à la bouche, est debout auprès de son père, vieillard moribond qui tient un basset sur ses genoux, et le vieillard lui dit: «Mon fils, je ne te laisse rien que ce basset: ce sera ton gagne-pain. Tu pourras chaque semaine, envoyer une blague sur lui aux Fliegende Blaetter»,—faisant allusion aux plaisanteries sans nombre que la petite bête, courte sur jambes, longue sur reins et tout en oreilles, inspire aux humoristes de la feuille célèbre. Bœcklin a fait comme ce vieillard. Il a légué son centaure à Stuck et à Klinger, et c’est merveille ce qu’ils en ont fait et toutes les sauces à quoi ils l’ont accommodé! Ce centaure poursuit, encore là-bas, une carrière extrêmement profitable. La magnifique villa antique de Stuck, à Munich, a été payée par ce centaure. Les idées,—même les idées d’autrui,—ne demeurent pas improductives en Allemagne.
Enfin, Bœcklin avait fait une dernière trouvaille: son Ile des Morts. Il en était si satisfait qu’il l’a répétée, nul ne sait combien de fois. C’est la page de lui qu’on connaît le mieux à l’étranger: une cuve de pierre, pleine de cyprès, baigne dans un lac noir, échancrée en toute sa hauteur pour qu’on puisse voir qu’il ne s’y passe rien, une barque glisse sur les eaux endormies et ramène à la «bonne demeure» un hôte debout en son linceul. C’est une création très artificielle. On sent que l’artiste a réuni, méthodiquement, tout ce qui peut donner l’idée de l’insensible et du perpétuel: une île escarpée et sans bords, une eau sans mouvement, un crépuscule éternel, l’ombre, une nature où rien ne change, où rien ne naît, où rien ne souffre, où rien ne meurt. L’impression produite, bien qu’artificielle, est assez forte. Ainsi se clôt le cycle des découvertes du peintre suisse. La passion de l’antique, la recherche du brutal, enfin le terrifiant,—voilà tout l’Art de Bœcklin.
Et c’est tout l’Art allemand contemporain. Les deux plus notables représentants de cette école sont Franz Stuck et Max Klinger, tous deux à peu près du même âge, entre cinquante et soixante ans. Klinger doué de la figure classique du herr professor à lunettes, broussailleux, soupçonneux, hirsute, l’œil vif sous le sourcil épais, plus petit serait Mime, et Stuck, bonne tête ronde de feldwebel, l’œil rond, extasié, impérieux, plus grand, jouerait les Siegfried, tous deux sculpteurs autant que peintres et décorateurs autant que sculpteurs, menant tout de front, visant à tout, appelés artistes et maîtres seulement en Allemagne, répondant à ce que, dans tous les autres pays, on honore du nom d’«amateur».
Ils se sont partagé le royaume de Bœcklin: Stuck a pris la terre et Klinger a pris la mer. Tous deux ont gardé le centaure. Seulement, Stuck lui donne quelques nouveaux agréments. Il lui met quelquefois une crinière, il lui rase la tête à la manière «hygiénique» allemande et lui ôte la barbe qu’il portait au Parthénon. Il en fait un cerf que poursuit un centaure, chasseur et archer. Il a même imaginé un centaure nègre, une sorte de bon géant courtisant une jeune blanche, au grand ébahissement de ses compagnes. Il a fait des centauresses blondes fuyant, les cheveux dénoués et en riant comme des folles, la poursuite des centaures mâles, ou encore, attendant paisiblement couchées comme un cheval dans son box, l’issue de la lutte entre deux rivaux. Tous ces centaures ont appris à galoper à l’école de M. Muybridge ou, tout au moins, de M. Marey. Ils respectent les enseignements de la chronophotographie. Aussi offrent-ils un mélange de réalisme, de modernité, d’archaïsme, de pédantisme et de fantaisie, qui atteint sans effort la plus haute bouffonnerie.
Klinger, lui, a conduit son centaure dans la mer, parmi les néréides et les ordinaires chevaux marins, les mouettes et les goélands, l’a englouti à demi, dans les vagues, échevelé dans le vent du large, balafré d’écume. Telles sont, notamment, ses peintures décoratives pour la villa Albers, conservées dans les musées de Berlin et de Hambourg. Il est parvenu, ainsi, à insuffler à son Chiron, ou à son Nessus, une vie brutale et joyeuse qui, au premier abord, séduit. L’attrait de la nature méridionale pour l’homme du Nord y éclate. C’est une ruée vers la mer bleue, l’horizon d’or dentelé par l’étrave des caps, la Méditerranée convoitée au loin, par delà les lacs trop calmes et trop froids, par delà les Chiemsee et les Constance, l’art qui cherche à déboucher en «eau chaude», comme l’Empire lui-même, et y tend d’un effort vertigineux.
Dans tout cela, qu’est devenue la vieille Allemagne, la vie paisible, les drames ou les joies intimes de la famille, les rêveries sentimentales que nous peignaient, hier encore, les maîtres, et qui sont encore sensibles dans l’œuvre de Hans Thoma? Il n’y en a plus trace... Les gens que Ludwig Richter nous montrait passant l’Elbe, sur une petite barque, en face d’un vieux château en ruines; les jeunes amoureux, la main dans la main, le vieillard penché sur sa harpe, le jeune touriste debout, sac au dos s’adonnant avec ferveur aux joies esthétiques de la contemplation, et le poète échevelé, pensif, qui va noter quelque chose de profond, ou, tout au moins, d’obscur,—que sont-ils devenus? Un souffle a passé sur les ateliers allemands, qui en a chassé toute cette humanité naïve, parfois mesquine, mais touchante et, en tous cas, vraie. Il n’est plus resté que des figurants de théâtre, laborieusement travestis en symboles, guindés dans leur archaïsme et empêtrés dans leur philosophie.
C’est une fatalité, en effet, que les artistes allemands cherchent toujours à réaliser ce à quoi ils sont le moins propres: le symbole, et sous les formes qui sont le moins dans leur génie: les formes classiques. Certes, leur passion pour l’antique n’est point nouvelle. On chantait, il y a longtemps déjà, dans leurs ateliers:
Des Deutschen Künstlers Vaterland, Ist Griechenland, ist Griechenland!
Mais c’est une passion toujours malheureuse. Elle a perdu Cornélius et son école, elle a donné à Munich et à Berlin leur faux grec. Dès qu’elle saisit son homme, elle le tue. Moritz de Schwind, par exemple, au milieu du XIXe siècle, anime d’une vie très divertissante les figurines sentimentales ou grotesques, qu’il conduit à travers les mystères de la forêt germanique, mais ses figures symboliques sont vides de toute substance. Il réussit toujours le nain: il manque toujours la Walkyrie, à plus forte raison, la déesse antique. Cornélius croit s’inspirer de l’antique: il le surmoule. Tout l’imprévu, toute la netteté, toute la hardiesse et la force, tout l’accent de l’antique est perdu. On ne sent plus ses os. Pareillement, de nos jours, Trubner croit beau de montrer l’empereur Guillaume Ier, en triomphateur, accompagné des Walkyries: il n’évoque autre chose que l’idée d’un vieux monsieur égaré dans les praticables de Bayreuth, au moment où l’on prépare la figuration.
Les nouveaux venus, il est vrai, ont cru sauver leurs pastiches de l’antique en y introduisant deux caractères que l’antique offre bien rarement: le colossal et le terrifiant. Mais c’est encore une erreur, ni l’un ni l’autre n’étant dans les moyens du Germain,—je veux dire dans ses moyens plastiques. Habich modelait, en perfection, de petites statuettes de bronze, propres à mettre sur une table, comme encriers ou presse-papiers: il a fait pour la Künstler Kolonie, à Darmstadt, des statues gigantesques d’Adam et d’Ève, qui passent les bornes du ridicule. Klinger réussit fort bien, aussi, la statuette de bronze: il a imaginé des Beethoven ou des femmes en marbre polychrome, dont les meilleures, si elles étaient plus spirituelles, eussent dû aller chez Mme Tussaud. Hildebrand, à force de fréquenter les Antiques et les Florentins, chez eux, à San Francesco di Paolo, arrive à des approximations fort agréables du quattrocento dans les petits sujets: rêve-t-il de monuments, il choit dans le pire banal. Frantz Metzner parvenait, çà et là, dans de simples bustes inspirés par des figures réelles, à exprimer un sentiment saisissant; il a voulu se hausser aux colosses d’Égypte, ou peut-être d’Assyrie, en sa figure de la Force, dans le monument de Leipzig: le résultat est lamentable. Évidemment, il a été impressionné par le Pugiliste au repos des Thermes de Dioclétien, mais il lui a trouvé l’air trop intelligent. Il a regardé, avec sympathie, le Penseur de Rodin, mais il lui a trouvé les extrémités trop fines. Il a voulu bâtir un hercule où tout ce qui n’est pas brutal disparaît, mais alors le crétinisme pathologique, où il est parvenu, enlève à son demi-Dieu non seulement toute sa divinité, mais toute son humanité et, par là, toute sa vraisemblance. C’est un pantin colossal et qui ne fait plus peur.
La peur, cependant, ou plutôt la terreur, tel est le sentiment que l’Allemand cherche le plus, depuis quelque vingt ans, à inspirer. Il semble que ce soit pour lui un moyen de triompher en art, comme chez ses théoriciens militaires de triompher dans la guerre. La toile la plus fameuse, peut-être, de Stuck est précisément son allégorie de la Guerre: un entassement de cadavres nus sous le cheval du triomphateur. Les sphinx, les chasses infernales, les furies, les harpies, tout ce qui menace l’homme dans l’ombre et lui rappelle l’énigme de sa destinée, lui paraît admirable à peindre. C’est si vrai que, depuis la guerre, les caricaturistes allemands, lorsqu’ils veulent symboliser la terreur qu’ils s’imaginent inspirer à leurs ennemis, n’ont qu’à reproduire quelque page célèbre, de Sascha Schneider, dont ils détournent le sens. Ainsi, le Destin, batracien dégoûtant, guette l’homme nu, désarmé, qu’il encercle de ses griffes inévitables: c’est, dans leur pensée, Hindenburg guettant le grand-duc Nicolas.
Malheureusement, cette entreprise de terrorisme échoue de façon misérable. Le Lucifer de Stuck ressemble à un jeune Anglais qui suit passionnément les péripéties d’un match de boxe ou de football. Son Remords est un marin en permission qui a pris le pas gymnastique pour ne pas manquer le dernier canot. Son triomphateur de la Guerre est un gars de la campagne qui revient, le soir, sa journée finie, sur son cheval fourbu. Son Vice et toutes les femmes fatales, qu’il a entortillées d’un boa ou d’un python, semblent tout simplement des charmeuses de serpents. Son Guerrier est un jeune valet de chambre qui époussette une statuette de la Victoire avec un plumeau fait de feuilles de laurier. Son Ange du Paradis perdu est une manière de suisse qui, debout, raide, les jambes écartées, tient son épée flamboyante fichée en terre en face de lui, comme un portier de Rome sa canne à boule, sous le portique d’un somptueux palais. Tout cela rappelle le piteux effet que produit, à la scène, l’apparition du dragon Fafner. Mais, à côté de ces horrifiques images, figure-t-il quelque faunin luttant, tête contre tête, avec un jeune bélier, dans un cercle d’autres petits faunes ébahis, ou dessine-t-il des paysans allemands en visite dans un musée, pour les Fliegende Blaetter,—et voici la main d’un artiste vrai, particulier, spirituel, qui reparaît.
Sur un point, toutefois, cet appel à la terreur est émouvant: dans la Danse des Morts. Klinger a fait toute une suite d’eaux-fortes intitulée De la Mort, fort ingénieuses, à la manière de M. André de Lorde, pour entretenir, chez l’être périssable que nous sommes, l’appréhension du mystère et l’horreur de l’étroit passage. Ses Miséreux au carcan; son bébé assis sur le rigide cadavre de sa Mère endormie; sa figure d’homme en train de se noyer; sa Pietà, où saint Jean a pris la tête de Beethoven; sa Mort guérisseuse, conçue à la manière du «libérateur céleste» de Lamartine, tout cela est nouveau et d’un artifice assez adroit à nous émouvoir. Cela doit tenir à quelque caractère foncier de la race, car, à toutes les époques, les Allemands ont excellé dans le squelette. La suite d’Holbein est géniale. On pourrait croire qu’il avait épuisé les ressources tragiques et comiques du macabre,—mais à chaque génération, l’Allemand sait le renouveler. Encore au XIXe siècle, Alfred Rethel, médiocre dans tout le reste, a trouvé un étonnant symbole du mouvement révolutionnaire de 1848, avec sa Mort à cheval. De nos jours, un artiste de second plan, Joseph Sattler, en figurant la Mort, sur des échasses, qui passe sur les feuillets des livres et y laisse ses traces, a prouvé que le don ancien de fantaisie macabre n’est pas perdu. Cette Mort, sortie d’un cabinet d’anatomie, grimace et fait des mines de vieille coquette,—dolichocéphale, bien entendu. Chez Hans Thoma, le squelette, bien droit sur ses apophyses épineuses, tend un drap, avec le geste du garçon de bain, derrière Adam et Ève, prêt à les envelopper dès qu’ils auront cueilli la pomme.... C’est un rien, mais il fallait le trouver. On n’en finirait pas de citer toutes les facéties funèbres de ces morticoles hilares. On ne voit guère que Liebermann qui s’abstienne d’épouvanter ainsi ses contemporains. Ainsi, le macabre, chez les Austro-Allemands, est une industrie nationale. Et cela encore, ils l’avaient trouvé dans l’œuvre de Bœcklin: si peu Allemand qu’il fût dans son art, il avait pourtant cru devoir enseigner l’équitation à une Mort en habits carnavalesques, dans la Guerre, et figurer un squelette raclant du violon derrière son propre portrait.
Il ne faut pas croire, cependant, que Bœcklin, seul, serve aux Teutons de modèle. L’artiste allemand prend son bien un peu partout. Liebermann a toujours pastiché nos impressionnistes, Hohlwein pastiche Nicholson, Frederyk Pautsch pastiche Brangwyn, Georg Merkel pastiche Maurice Denis, Otto Barth et Junghanns pastichent Segantini: Paul Burck, aussi, à l’occasion, et maint autre, car Segantini a fait, outre-Rhin, une impression presque aussi profonde que Bœcklin. Hans Thoma, dans plus d’un endroit, a pastiché Holman Hunt, et Max Klinger, dans son Aphrodite, a pastiché Watts. Adolf Brütt pastiche Rodin, Joseph Wackerle pastiche Thorwaldsen, Max Neumann pastiche Toulouse-Lautrec, Sascha Schneider pastiche de Groux, Hildebrand pastiche, à merveille, les della Robbia et moins bien Verrocchio. En sculpture, il semble toujours qu’on ait déjà vu, «dans un monde meilleur», l’anatomie et le geste que produit le statuaire allemand. En art appliqué, c’est la même chose, et à peine a-t-on pénétré dans quelque salle de «style moderne», que le faux Copenhague, le faux Gallé, le faux Doulton, le faux Delft, le faux Rozenburg, le faux Roerstrand, le faux Tiffany éclatent aux regards. On a souvent parlé de créer un Musée des pastiches, c’est inutile: il suffit d’entrer dans une exposition d’art allemand contemporain.
Le plus singulier est que ces emprunts perpétuels au génie étranger n’entament pas la confiance de l’Allemand en la supériorité de son génie propre. Il a, au moment même où il imite les autres, un immense contentement de soi-même. Il revendique l’esprit du voisin comme un trait de sa race à lui, égaré hors de ses frontières, et qui doit lui faire retour par conséquent. «Ceci est beau, dit-il, donc cela doit venir de moi, ou de mes ancêtres.» Par exemple, un de leurs critiques loue Courbet et Millet d’avoir «introduit des éléments absolument allemands dans la peinture française[2]». C’est une forme de folie raisonnante très curieuse à observer. Ruskin, qu’on me pardonnera de citer cette fois encore, parce qu’il serait difficile de mieux voir aujourd’hui même ce qu’il démêlait, il y a longtemps déjà, avec une lucidité singulière, écrivait dans Fors Clavigera, en 1874: «Il n’y a de bonheur que pour les doux et les miséricordieux et l’Allemand ne peut être ni l’un ni l’autre: il ne comprend même pas ce que ces mots signifient. C’est là qu’est l’intense, l’irréductible différence entre les natures allemande et française. Un Français n’est égoïste que lorsqu’il est vil et déréglé; un Allemand est égoïste dans les plus purs états de vertu et de moralité. Un Français n’est sot que lorsqu’il est ignorant: aucune somme de science ne rendra jamais un Allemand modeste. «Seigneur, dit Albert Dürer en parlant de sa propre œuvre, cela ne peut être mieux fait.» Luther condamne, avec sérénité, l’Évangile de saint Jean tout entier, parce qu’il arrive que saint Jean n’est pas précisément de son avis. De même, lorsque les Allemands occupent la Lombardie, ils bombardent Venise, volent ses tableaux (dont ils sont incapables d’apprécier un seul coup de pinceau) et ruinent entièrement le pays moralement et physiquement, laissant derrière eux le vice, la misère et une haine intense déchaînée contre eux, sur tout le sol que leurs pieds maudits ont foulé. Ils font précisément la même chose en France, l’écrasent, la dépouillent, la laissent dans la misère, la rage et la honte, et s’en retournent chez eux, se pourléchant d’aise, chanter un Te Deum[3].»
Tout ceci, je ne prétends pas que ce soit, et ce ne peut être, en effet, un diagnostic de l’âme allemande. Il y a d’autres éléments à considérer que l’art dans la psychologie d’un peuple, surtout quand cet art est, comme ici, voulu, guindé, composé de toutes sortes d’emprunts. Mais l’artifice même, que dévoile cette recherche, et l’échec total où elle aboutit sont de précieux indices. A ne considérer l’âme allemande que dans son art, il ne semble pas du tout que le brutal, le colossal, et le terrifiant en soient des caractères fonciers. Ce sont manifestement des caractères acquis et assimilés par une forte volonté. Tandis que la grâce, l’ordre, la mesure sont, chez l’artiste français, si naturels que, pour y manquer, il faut qu’il fasse quelque effort, ce caractère hautain et brutal de l’Allemand est si manifestement voulu que le même artiste, fort médiocre quand il se l’impose, devient tout de suite meilleur lorsque, d’aventure, il cesse de se suggestionner et se remet, comme ses ancêtres, à peindre des petites filles dans des prairies, des vieillards lisant leur Bible, ou des gnomes lutinant des fées dans la forêt. Hans Thoma, Max Klinger, Franz Stuck peuvent, là-dessus, servir de contre-épreuve. Il semble donc bien qu’ils expient, en ce moment, leur infidélité au penchant naturel de leur race. La génération précédente: les Ludwig Richter, les Moritz de Schwind, les Defregger, les Spitzweg, les Menzel, n’étaient pas de très grands artistes, mais leur art n’était nullement emprunté. Ils faisaient tranquillement leur petite besogne locale et de terroir. Ils balayaient devant leur porte.
Leurs successeurs n’ont pas été si sages, ni si heureux. En se juchant, tout d’un coup, sur un Sinaï de pacotille, en enflant la voix pour annoncer des choses qui dépassent de beaucoup leur compréhension et tenter des prodiges qui excèdent de beaucoup leur puissance, ils ont oublié ce qu’ils avaient à dire et n’ont rien trouvé d’autre. L’artiste allemand ressemble à un bon comptable qui s’imagine, un jour, avoir le génie des affaires: il emprunte à tout le monde, monte une entreprise gigantesque, s’y ruine, et donne à rire aux passants, jusqu’au jour où il regrimpe sur son tabouret et se remet à faire ses petits calculs, à la satisfaction générale.