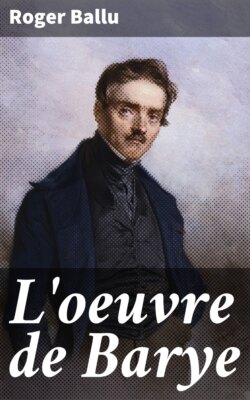Читать книгу L'oeuvre de Barye - Roger Ballu - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BARYE THÉORICIEN
ОглавлениеTable des matières
Parmi les plus grands artistes, il en est qui se font de la science un puissant auxiliaire, et qui cherchent en elle la sûreté de leur inspiration. On dirait qu’ils lui empruntent ses méthodes et ses procédés: ils ne créent rien, sans avoir mûrement observé et ils ne représentent les formes qu’après en avoir acquis la connaissance certaine. Savoir est pour eux un premier besoin, un devoir rigoureux et comme un point d’honneur. Si brillamment doués qu’ils soient, ils n’exercent jamais leur talent, sans faire appel à des informations précises et sans interroger leur conscience: leur vie est un perpétuel hommage rendu à la vérité. Mais cette subordination volontaire ne les amoindrit pas. Grâce au sentiment de l’art dont ils sont animés, ils transportent la réalité dans un domaine supérieur; la nature, telle qu’ils nous la rendent, est toute pénétrée de leur idéal. En même temps, le principe de sincérité et de logique d’après lequel ils se sont guidés, reste acquis à leurs successeurs. Et si leur génie dans sa personnalité reste insaisissable, ils laissent un exemple salutaire et ouvrent une voie dans laquelle d’autres, après eux, s’avancent sans crainte de s’égarer.
Tel fut le statuaire Antoine Louis Barye en l’honneur de qui ce livre est publié. Une exposition récemment ouverte à l’École des beaux-arts a permis d’admirer le caractère et la beauté de son œuvre: l’essai qui va suivre est destiné à en faire ressortir la souveraine raison.
Barye a embrassé son art tout entier, depuis l’orfèvrerie jusqu’à la sculpture monumentale, depuis les sujets les plus modestes, jusqu’aux figurations héroïques. Il a rendu avec une égale supériorité les hommes et les bêtes. Mais dans l’opinion générale sa plus grande gloire lui est venue de ce qu’il a élevé au premier rang un genre d’ouvrages qui, jusqu’à lui, avait été considéré comme secondaire: il a excellé dans la représentation des animaux.
A vrai dire, jamais en France, depuis la Renaissance, cette partie de l’art n’avait été négligée. Au XVIIe et au XVIIIe siècle nous avions eu des hommes qui s’y étaient particulièrement distingués. Mais les peintres y avaient marqué bien plus que les sculpteurs. Ainsi Van der Meulen traitait les sujets de vénerie dans des tableaux que le bas-relief ne pouvait égaler; et Desportes, Oudry et Bachelier, en peignant des animaux aux prises, faisaient oublier Van Clève et Houzeau. Cependant Girardon, Desjardins, Guillaume Coustou et d’autres statuaires de leur école s’étaient surtout appliqués à bien connaître et à bien rendre le cheval. Ils avaient été secondés en cela par des physiologistes spéciaux, comme Solleysel, et comme Vincent et Goiffon qui l’avaient étudié jusque dans ses allures. Plus près de nous, ils avaient reçu les leçons de Bourgelat qui, à l’imitation de Léonard de Vinci et de Lomazzo, avait réduit les formes du cheval en une règle de proportion. Au commencement de notre siècle, Bosio, Lemot et Cartellier, chargés d’exécuter des statues équestres, avaient au besoin profité de ces traditions, altérées cependant par une imitation directe de l’antique. De sorte que si l’on en excepte un Chien de Grégoire Giraud que l’on voit au musée du Louvre, rien n’indiquait alors que l’attention des sculpteurs se fût sérieusement portée sur les animaux.
D’ailleurs, qu’étaient ces ouvrages à côté des peintures de Gros, et même de Carle Vernet? Ces deux peintres ont été comme les initiateurs d’une école aujourd’hui florissante: sans en avoir eu l’idée, ils ont préparé la venue de Géricault et de Barye.
Géricault peut être considéré comme l’artiste à qui l’école qui a pris pour tâche de représenter les animaux est avant tout redevable: il lui a donné son esprit scientifique. Il a laissé de nombreux dessins d’anatomie exécutés avec une précision admirable. Il étudiait les animaux avec la même passion que l’homme et avec le même désir d’en pousser la connaissance à fond. Sa carrière, à son apogée, a été très courte: en 1819 il exposait le Radeau de la Méduse et il mourait en 1824. Mais c’est de ce moment que date le mouvement d’idées qui a porté certains peintres et certains sculpteurs à se livrer spécialement à l’étude des animaux. Géricault, qui les rendait avec une grande justesse de caractère, avec une expression de vie supérieure, pouvait reconnaître que généralement on procédait dans ce travail sans préparation suffisante. Ne devait-on pas joindre au sentiment qui fait l’œuvre, l’exactitude irrécusable des formes que nos galeries d’anatomie, nos informations sur la nature morte et vivante, nos ménageries enfin, nous permettent de réaliser? Il le pensait; et lui-même, s’étant proposé cet objet, avait prêché d’exemple.
Tel a été le point de départ et tel a été le programme d’une école nouvelle. Géricault lui a montré la voie. Mais Barye a été son chef et son plus illustre représentant.
Dans la vie de Barye, rien n’est à négliger. Il est remarquable que, dans la carrière des grands artistes, les circonstances qui tout d’abord pourraient être considérées comme fâcheuses, que les obstacles qu’ils ont rencontrés, que les nécessités qu’ils ont subies, tristes à leur jour, se trouvent en définitive avoir servi par quelque côté au développement de leur talent et de leur caractère.
Ce fut le cas pour Barye. Il ne faut pas oublier qu’à l’âge de treize ans il fut mis en apprentissage chez un graveur industriel nommé Fourier et qu’il fut occupé par son maître à graver de ces creux ou poinçons qui servent à exécuter les repoussés. Les repoussés embrassent un nombre considérable de travaux, depuis les boutons simples ou portant un numéro ou une lettre, par exemple, jusqu’ aux pièces les plus délicates de l’orfèvrerie. En même temps, il s’initia à tout ce qui intéresse l’art de la ciselure dans lequel il devait exceller; et ainsi, de proche en proche, le maniement des métaux lui devint familier. Bientôt, le goût de l’art se développant chez lui, il entra chez Bosio qui alors tenait école. Cet artiste ne pouvait exercer sur la vocation encore indéterminée de son élève une grande influence. Cependant il a exécuté la statue équestre de Louis XIV qui est sur la place des Victoires et le quadrige qui couronne l’arc de triomphe du Carrousel. Mais Barye semble avoir été indifférent à ces ouvrages. Encore indécis, il ne se bornait point à recevoir les conseils d’un sculpteur; il allait peindre dans l’atelier de Gros, l’auteur de la Bataille d’Aboukir et de ce tableau plus connu encore, Napoléon visitant le champ de bataille d’Eylau, ouvrages dans lesquels, cette fois, les chevaux sont traités avec supériorité.
Au bout de quelques années, en 1819, Barye prend son parti d’embrasser la carrière des arts: il entre à l’École et concourt presque immédiatement pour le grand prix de Gravure en médailles. Ouvrier graveur expérimenté, il connaissait d’avance la technique du médailleur; dès ses débuts, il trouvait l’emploi de son habileté professionnelle. Curieuse rencontre! le sujet était Milon de Crotone dévoré par un lion, et l’on remarque, car il reste un exemplaire de la médaille exécutée par le débutant et qui lui valut une mention honorable, que c’est une étude ferme, et où, ce que l’on voit du lion, est assez bien étudié. En 1820, il concourut de nouveau pour le prix de Rome, comme sculpteur alors et sur ce programme: Caïn maudit. Il obtint un second prix, mais la figure qui lui avait valu cette récompense a été malheureusement détruite. Il continua de concourir sans succès jusqu’en 1825, époque à laquelle il quitta l’École des beaux-arts. On voudrait pouvoir le suivre dans ses études, pendant les cinq années où il fut engagé dans la voie académique; mais il n’en reste que très peu de chose. On conserve de lui, dans les galeries de l’École, une esquisse en bas-relief qui est de ce temps: Hector reproche à Pâris sa lâcheté. Bien qu’elle ait valu une récompense à Barye, elle est dépourvue de caractère. Impossible, à qui la verrait sans être averti, de prévoir l’avenir de son auteur.
En 1823, Barye, qui était obligé, en même temps qu’il étudiait, de travailler pour vivre, entrait dans l’atelier d’un orfèvre qui jouissait alors de quelque réputation; il s’appelait Fauconnier. Là, il fut plus particulièrement employé à modeler des animaux. Dans quelles conditions? On ne le sait pas. Mais il est probable qu’il s’était réservé une partie de son temps et qu’il devait jouir, au milieu des travaux qu’il exécutait, d’une certaine liberté. On peut dire, sans crainte de se tromper, que c’est à cette époque qu’il a commencé à regarder la nature en face, qu’il a entrepris ses études d’histoire naturelle et que son originalité s’est dégagée dans un travail qui semblait devoir l’étouffer. C’est alors que sa vocation s’est décidée et que le caractère de son talent s’est formé.
Comme il serait intéressant de connaître les ouvrages d’orfèvrerie sortis de la maison Fauconnier et d’y chercher la main de Barye! Il doit certainement en exister encore. On pourrait en trouver la trace dans des livres de commerce qui peut-être n’ont pas disparu, et dans les actes de vente qui ont fait passer les modèles de cette maison dans d’autres mains. Là on découvrirait, avec la mention des achats et des commandes, les noms des clients et des successeurs de Fauconnier. Quoi qu’il en soit, c’est en travaillant en anonyme que Barye est devenu un grand modeleur et un grand ciseleur, un grand artiste à la manière des Grecs et des maîtres de la Renaissance, ou plutôt à sa propre manière, car il égale ses devanciers sans les rappeler.
En 1832, peu de temps après qu’il eut quitté ce patron, Barye, si bien armé par des études de tout genre, modela le groupe du Lion écrasant un serpent que l’on voit aux Tuileries sur la terrasse du bord de l’eau. Cet ouvrage, exposé en 1833, produisit une grande sensation. Certes tout ce que Barye avait exécuté jusque-là devait présenter un caractère très particulier, mais on commençait à voir de lui des chefs-d’œuvre.
Étudions un instant celui-ci qui, dans le nombre, a été le premier en date. Ce n’était pas absolument un coup d’essai. Deux ans auparavant avait paru le Tigre dévorant un gavial, dont le caractère est des plus remarquables. Mais la composition n’offre pas une scène animée. Au contraire, le groupe du Lion écrasant un serpent est très mouvementé. La pensée en est hardie et vraie; l’exécution empreinte d’un savant naturalisme. C’est une œuvre absolument originale. Qu’a-t-elle retenu du séjour de son auteur dans les ateliers de Bosio et de Gros? Au premier coup d’œil, absolument rien. Mais si l’on est informé des choses de ce temps, on reconnaît qu’il faut attribuer aux influences de ce premier milieu le goût de composition qui paraît dans l’ouvrage du jeune maître et qui est une de ses beautés. Il faut l’examiner de près, et cela est facile. On peut tourner autour, et alors on voit que, sous tous ses aspects, la composition en est également intelligible et bien ordonnée. Cela peut surprendre d’entendre dire que ce soit chez Bosio que Barye a puisé tant de style. A vrai dire en effet, Bosio entendait bien une statue, surtout quand elle était nue; mais il n’avait qu’une médiocre intelligence des grandes compositions. Ainsi donc il rendait parfaitement les formes. Nous avons au Louvre, dans le musée moderne, une petite statue, Hyacinthe couché, qui est charmante; il nous reste aussi, de lui, un Aristée d’une harmonie parfaite. Ses bustes sont également pleins de finesse. Au point de vue de l’étude délicate du modelé cela est tout à fait remarquable. Mais quant aux œuvres devant avoir un caractère monumental, Bosio ne s’y entendait pas, témoin son groupe qui représente l’Histoire et les Arts consacrant les gloires de la France. Mais il se passait dans son atelier une chose assez singulière. Ses élèves s’appliquaient assidûment à acquérir ce qui manquait à leur maître, et, grâce à cet effort dont l’honneur leur revient, plusieurs d’entre eux se sont distingués dans l’art des ensembles et de la haute décoration.
Le théoricien le plus considérable de l’école française, celui qui a le mieux possédé la science des mouvements et des arrangements, Duret, était aussi élève de Bosio. Un peu plus jeune que Barye, il avait étudié dans le même milieu et sous l’influence des mêmes idées. Cet atelier présentait donc le phénomène assez inattendu d’élèves suivant une voie différente de celle dans laquelle leur maître était engagé. Mais à cette époque cela n’était pas aussi nouveau qu’on pourrait le croire: on avait déjà vu Géricault et Delacroix étudier chez Guérin. Si les élèves de Bosio travaillaient avec cette indépendance, ils tenaient cependant de leur maître une manière affinée de rendre la nature. Barye, sous ce rapport, ne relève plus que de lui-même. Il traduit les formes avec énergie et précision, sans complaisance pour le morceau. Son modelé est savant, mais il n’a rien de la rondeur et de la plénitude qui sont propres aux œuvres académiques. Dans le Lion écrasant un serpent, il est méplat et même un peu maigre. Ce n’est pas un animal engraissé : c’est le lion du désert qui vit de la proie qu’il lui faut trouver chaque jour. Son poil est rude, toute sa peau en est couverte. La crinière est hérissée, mais elle est noble, bien qu’inculte. La tête est expressive; son rictus est mêlé de férocité et d’une horreur instinctive. Elle n’a pas cette physionomie humaine que l’on trouve à la plupart des animaux peints ou sculptés par les modernes: c’est l’horrible reniflement des fauves qui rugissent également en exhalant leur souffle et en le reprenant. Si l’on compare un pareil ouvrage au lion que l’on avait fait jusque-là, au lion bien accommodé, solennel, conçu comme un ornement, encore reconnaissable si l’on veut, mais dépourvu de toute fierté native, ayant une majesté apprise et non celle que lui a départie la nature; au lion de nos jardins, banal et devenu insipide par une sorte de domestication traditionnelle, on voit qu’il y a dans l’œuvre de Barye une nouveauté dont les éléments essentiels peuvent être saisis par nous.
Elle consiste d’abord dans une observation sincère des habitudes de l’animal, et ensuite dans une connaissance approfondie de sa structure. Il y a là, sans contredit, l’influence de Géricault, non pas l’influence directe, non pas celle qui vient du commerce que l’on a avec un homme, mais influence d’idées, de doctrines, de direction. Les études savantes du peintre faisaient grand bruit; on en parlait sans s’y soumettre. Seul, Barye les poursuivait après lui.
Les dates présentent souvent des coïncidences singulières. Géricault exposait le Naufrage de la Méduse l’année même où Barye débutait dans les arts. Géricault mourait peu avant que Barye abandonnât les concours de l’Académie: ces dates appartiennent à la fois à la vie des deux initiateurs. Mais ce qu’il faut remarquer, c’est que cette période a été signalée par l’apparition de l’œuvre maîtresse de Géricault, par les débuts de Delacroix et par l’animation que prit alors la querelle des classiques et des romantiques. Il n’est pas douteux que, dès le principe, Barye ne se soit jeté dans la lutte. Le Lion écrasant un serpent est un ouvrage romantique et il porte la marque du romantisme militant. Il se rattache à ce qu’il y avait de meilleur dans la doctrine nouvelle: il indique un retour sincère à la nature et à la science; l’art qu’il représente s’appuie sur des données d’observation. Le lion de Barye est un lion sauvage; c’est là le côté que l’artiste a puissamment fait ressortir, et c’est par là que son œuvre nous émeut. La gueule et la griffe sont accentuées avec une décision extraordinaire. Les anciens aussi ont marqué avec force ces parties de l’animal qui sont les instruments caractéristiques de son énergie, celles qui sont le plus nécessaires à la satisfaction de ses instincts. Barye en agit de même; mais ici il n’y a aucune trace ni de simplification architectonique, ni d’un symbolisme imité de l’Orient. Le spectacle que l’on a sous les yeux n’a rien non plus des scènes théâtrales et humainement pathétiques que peignaient Rubens, Snyders et leur école. Non! Ici l’animal est considéré en lui-même. Il est pris dans la nature et il n’est pas rabaissé pour cela. Au désert, le lion est toujours roi; mais, obéissant à ses instincts, il agit avec une sorte de naïveté terrible et grandiose, avec la beauté inculte et la dignité native qui conviennent à la liberté. Grâce à une observation persévérante et à des intuitions de génie, Barye affranchit les animaux des habitudes de la captivité et des entraves de la convention. Il leur rend l’indépendance; et c’est un des traits de son originalité.
Le Lion écrasant un serpent excita, à son apparition, de grandes admirations et aussi de vives critiques. On comprit qu’on était en présence d’un artiste qui entrait dans la carrière avec un talent puissant, mais aussi avec des théories différentes de celles qui prévalaient dans l’enseignement officiel. De là des enthousiasmes d’une part, et de l’autre un sentiment hostile dont Barye fut longtemps l’objet. Il resta impassible; il n’éleva pas école contre école; il n’appela point d’élèves à lui. Il fut insensible aux critiques qui lui étaient adressées et qui émanaient de personnes qui, par aveuglement ou par intérêt, ne pouvaient le comprendre. La louange d’ailleurs ne l’émouvait pas plus que le blâme. Il poursuivait imperturbablement ses études, sûr de lui-même et certain d’être dans la vérité.
C’est dans cette première phase de sa carrière féconde que Barye connut et approcha le duc d’Orléans. Le prince, par l’ouverture de son esprit et par ses encouragements, exerça sur l’artiste une heureuse influence. Il lui commanda plusieurs groupes destinés à un surtout de table dont l’ensemble devait être superbe. Il était composé de neuf groupes reliés entre eux par une architecture décorative. Les principaux, au nombre de cinq, représentaient des chasses: Chasse au tigre, Chasse au taureau, Chasse aux ours, Chasse au lion et Chasse à l’élan. Ces ouvrages ont été décrits en détail et avec une admiration très sincère par Gustave Planche, qui était grand appréciateur de Barye et dont le jugement doit compter. Plus tard, ils ont été dispersés et l’on n’en a revu que deux à l’exposition des œuvres du maître qui eut lieu en 1875 à l’École des beaux-arts: la Chasse au lion et la Chasse au taureau. Dans le premier, deux cavaliers arabes disputent un buffle à un lion qui le terrasse. Dans le second, des cavaliers espagnols, avec des dogues de grande taille, attaquent un taureau sauvage: les cavaliers portent le costume du XVe siècle. Ces deux sujets sont rendus avec une variété, avec un pittoresque tout à fait surprenants. L’exécution en est accomplie. Les figures ne sont pas de grandes dimensions: elles sont dans une proportion appropriée à leur destination et à l’ensemble décoratif auquel elles appartiennent. Un surtout de table ne doit pas s’élever très haut, pour ne pas arrêter la vue et empêcher les convives de communiquer. Ces groupes sont donc assez bas, mais la ligne en est heureuse et variée. La fonte en est parfaite. Ce sont de véritables pièces de musée, des exemples qu’il faudrait que l’on eût toujours sous les yeux.
Mais, à mon sens, ils ont encore ce grand intérêt de nous donner une idée des premières œuvres de Barye et de les résumer. Par la nature du travail et les dimensions des figures, ils nous offrent, pour ainsi dire, la somme des études faites par l’artiste pendant le temps qu’il demeura chez Fauconnier: c’est de haute et superbe orfèvrerie. Pour répondre aux exigences d’une pareille entreprise, il fallait plus que du talent: une expérience consommée était nécessaire; et si ce n’était pas trop de l’étude profonde que Barye avait faite sur les animaux et de la connaissance qu’il avait acquise de leur structure, de leurs mœurs et de leurs habitudes quand ils attaquent ou se défendent, l’auteur devait encore posséder à fond la technique du métal, depuis la fonte qu’il lui fallait diriger, jusqu’à la ciselure et à la patine qu’il avait à parfaire. Dans ce bel ensemble, l’artiste, le savant et le praticien consommé se trouvèrent associés d’une manière qui certainement, chez nous, était sans précédent. Barye n’avait pas à regretter ses commencements. Grand artiste, son habileté d’ouvrier ne le desservait pas.
Le surtout du duc d’Orléans, commencé vers 1835, fut, non point un pas en arrière, mais comme un temps d’arrêt dans la carrière de Barye. En définitive, c’était une œuvre qui rentrait dans l’ordre de ses travaux de jeunesse. Non que j’entende par là qu’on doive la considérer légèrement et la traiter comme le firent certains critiques du temps, qui ne voulurent y voir qu’un travail de genre et d’un ordre inférieur; mais parce que Barye n’aborda plus ces compositions compliquées et ne s’arrêta désormais qu’à des données plus simples et plus conformes aux conditions générales de la statuaire.
Envisageant donc son art de la manière la plus large, il montra combien il était capable d’en élever l’expression. En exécutant le Lion écrasant un serpent, cette œuvre absolument nouvelle, il avait enfermé sa composition dans des lignes sculpturales; mais, au point de vue de l’exécution, ses admirateurs les plus fervents avaient cru pouvoir lui adresser quelques critiques, ou tout au moins quelques observations. Ils disaient que les formes de l’animal manquaient de cette accentuation et de cette amplification dont la sculpture a besoin, qui sont sa raison d’être et qui la distinguent du moulage sur nature. Faire ressortir les proportions du corps et le caractère de ses divisions, c’est en effet ce qui donne à la sculpture son cachet. On prétendait donc que ce lion, si beau qu’il fût, manquait dans certaines parties, et principalement dans les plus expressives, du caractère sculptural. Cette réserve a été faite par Planche, à l’opinion de qui je ne puis, cette fois, absolument me ranger; mais on trouvait alors qu’elle n’était pas sans justesse. Qu’en pensait Barye? Il était capable de comprendre toutes les observations qui lui étaient adressées, ne fussent-elles fondées qu’en apparence. Autant il était indifférent aux attaques passionnées et injustes, autant il était accessible à la raison. Et sans prétendre que Planche ait exercé quelque influence sur un homme aussi indépendant d’esprit et d’un talent aussi supérieur, on peut croire que celui-ci accepta la critique comme une sorte de défi, se promettant de montrer plus tard qu’il pouvait s’élever au grand style.
En 1847 parut le Lion assis, qui est placé, avec sa contre-partie, devant une des portes des Tuileries. C’est un ouvrage de premier ordre, qui nous montre le talent de Barye singulièrement agrandi. L’exécution en est large, puissante. Cette fois les principales divisions du corps, les attaches des membres, les masses musculaires, la tête, la crinière, tout est marqué avec une simplicité et une énergie qui rappellent ou plutôt qui égalent les plus beaux animaux sculptés en Égypte et en Assyrie. Il y a quelque chose de plus, parce qu’ici l’ampleur et la simplicité ne tiennent rien des canons égyptiens. Quoique grave et imposant, ce lion n’a pas la froideur, l’impassibilité architectonique d’un ouvrage fait au compas et dans lequel les plans sont immédiatement établis en vertu d’une règle de proportion. Le Lion assis est un type de généralisation savante, donnant par l’accumulation et par la condensation d’éléments observés la somme de l’être; tellement que l’animal reste réel au fond et qu’il pourrait vivre. Le détail anatomique, le détail vivant n’échappe pas à un œil exercé : au besoin il pourrait saillir; mais il est subordonné à la masse. Il laisse à celle-ci sa grandeur et son autorité.
Ce n’est pas à dire que le statuaire eût adopté, à toutes fins, cette manière d’interpréter la nature. Il savait approprier son art au caractère de ses sujets et à la destination de ses ouvrages; c’est là ce qui donne à ses productions une variété infinie. D’après cela, chez lui, l’accentuation sculpturale est mesurée aux œuvres, soit qu’il faille mettre en jeu tout le détail des formes, comme dans les combats et les chasses, soit que toute l’étude doive être résumée dans une synthèse d’un caractère monumental comme dans le Lion assis.
D’ailleurs il portait dans son travail une droiture de sens admirable. Il avait pour les formes animales un véritable respect. Avec le don qu’il possédait d’en dégager les traits essentiels avec énergie, il n’a jamais, en cela, dépassé la mesure. Il n’était pas porté à en pousser le caractère jusqu’à une exagération violente ou ridicule. Il considérait qu’il eût été aussi contraire à la dignité de l’art de charger l’animal, que de chercher à l’embellir. Pareil à la nature qui ne se profane point, il n’abaissait jamais son sujet; artiste, il se gardait d’en faire une caricature ou un épouvantail. En aucune façon ses animaux, même les plus monstrueux, ne sont des monstres.
Cependant Barye ne négligeait point la figure humaine. En 1831 il exposait une statue de saint Sébastien qui a disparu, et il y a de nombreux personnages dans ses groupes. Néanmoins, ses détracteurs affectaient de le considérer comme irrévocablement voué à un art qui, n’ayant pas l’homme pour objet, devait être considéré comme secondaire; ils l’y confinaient de propos délibéré. Mais en dépit de ses adversaires il embrassait son art tout entier. Ses premières études avaient eu la figure humaine pour objet. Depuis il avait beaucoup ajouté à son éducation académique. Ses cavaliers, par exemple ceux qui se trouvent dans ses chasses, sont remarquables, parce qu’en même temps qu’ils sont traités comme hommes et comme écuyers ils sont envisagés au point de vue de la race et du temps auxquels ils appartiennent. Barye a souci de l’histoire et de l’ethnographie aussi bien que des lois physiologiques: ce sont encore des données nouvelles, qui empruntent leur valeur à la science et viennent au secours de l’art.
Bien plus, l’anatomie comparée lui fournit des ressources et le parti qu’il en tire est un des mérites du groupe d’Angélique et Roger dont le motif est cependant purement poétique.
Il y avait de grandes difficultés à composer un pareil sujet; mais, préparé comme il l’était, Barye en triompha en maître. Angélique et Roger forment un groupe charmant sur le cheval fabuleux qui les emporte. Ceux qui ont vu ce bronze, ne peuvent oublier cet hippogriffe lancé au galop. C’est un cheval dont certaines parties sont fantastiques; mais elles ne sont pas purement imaginaires, leurs éléments sont pris dans la nature. La bouche et les ongles sont empruntés à d’autres animaux de races vivantes ou éteintes qui ont des affinités avec le cheval. On l’a remarqué : les ailes sont bien placées, et avec une telle vraisemblance qu’elles semblent capables de se mouvoir. Cependant on ne peut se dissimuler qu’il est difficile d’accoler à des omoplates, auxquelles sont attachées des jambes, une paire d’ailes par surçroît. Telle est pourtant la puissance d’harmonier dont l’artiste dispose, que l’hippogriffe ne nous choque point. Toute la composition est portée par un cétacé qui a la tête d’un dauphin et se termine en serpent. C’est encore l’œuvre d’une imagination qui, nourrie de la science du naturaliste, trouve moyen de créer un être hybride, impossible à la vérité, mais vivant en apparence. Quoique les personnages ne soient pas très grands, ils n’ont pas plus de 40 centimètres de proportion, la figure d’Angélique est une belle étude qui montre par son charme à quel point Barye, qui est un sculpteur de force, sait cependant, quand il le veut, atteindre à la grâce.
Mais nous arrivons à des œuvres d’un caractère encore plus élevé et qui sont parmi les plus importantes qu’un statuaire puisse traiter. Barye a fait plusieurs petites figures équestres, parmi lesquelles je citerai d’abord celles de Charles VII et de Gaston de Foix. Portées à de grandes dimensions et érigées en des places convenables, elles feraient, on peut le croire, un très grand effet. J’y songeais, il y a quelques années, en visitant, près de Ravenne, le lieu où s’est donnée la bataille dans laquelle Gaston de Foix a trouvé la mort; je pensais qu’une statue colossale, qui ne serait autre que la statue de Barye amplifiée, produirait une impression profonde au sein du paysage mélancolique que j’avais sous les yeux.
C’est un redoutable problème de sculpture que la statue équestre. Il offre les plus grandes difficultés, et nous voyons les maîtres de notre temps travailler longuement et avec une passion scrupuleuse et délicate à en mener à bien la solution. Barye s’y était exercé dans des ouvrages de petites dimensions, et si vous examinez ses figurines, vous verrez combien elles sont parfaites. On lui a reproché de donner trop d’attention au cheval. Mais quoi! la perfection d’une statue équestre consisterait-elle à ce que l’homme fût excellent et le cheval médiocre? Non certes. L’essentiel est de se faire une idée de ce qu’est une statue équestre. Notre langue si logique et si claire la définit, ce me semble, par la manière dont elle la dénomme. C’est une statue portée par un cheval. L’homme en est le sujet: sa pensée et sa personne dominent tout l’ouvrage, le cheval est subordonné ; il y a là quelque chose de hiérarchique. Mais il faut bien penser aussi qu’il doit y avoir harmonie entre le cavalier et sa monture. Il faut que tous deux soient dans un parfait accord, dans une instantanéité de vie, d’action, de moment qui en fasse un tout indissoluble. L’exécution doit achever de donner à l’œuvre son unité. Cependant, si l’homme doit commander le cheval, celui-ci ne peut être indigne du cavalier. Barye l’a compris; mais il sortait de l’habitude où l’on était de considérer volontiers le cheval comme un accessoire négligeable.
Cela posé, voyez avec quelle maîtrise l’œuvre est présentée! Là encore, à une conception générale pleine de raison se joint la vérité historique. Elle réside dans la physionomie des personnages, dans leur costume, dans leur armement. Elle ne paraît pas moins dans le caractère de l’animal qui les porte et dans son harnais: et à tout cela le sentiment vient ajouter son expression.
Ce n’est pas sans préparation que Barye aborda à la fin de sa vie de grands travaux qui lui furent confies, qu’il eut à faire, pour le guichet du Carrousel, un bas-relief représentant Napoléon III, et à traiter, dans un style héroïque, la statue de Napoléon Ier érigée à Ajaccio. Nous avions déjà de lui, outre les ouvrages que j’ai nommés, les statuettes équestres du Général Bonaparte et du Duc d’Orléans, le Cavalier arabe qui tue un sanglier, le Cavalier africain surpris par un serpent, le Guerrier du Caucase, qui sont pleines de caractère; et d’autres morceaux encore dans lesquels l’artiste a fait preuve d’une imagination bien informée et pleine de nouveauté. Dans ces figurines, on ne saurait assez admirer à quel point l’homme et l’animal sont, pour ainsi dire, compatriotes et contemporains; combien est parfaite la connaissance des costumes qui, loin de tourner au travestissement, sont ajustés avec un sentiment curieux de l’habitude. Ces petites figures du maître nous rendent difficiles pour ses œuvres plus considérables.
Entre les ouvrages qui ont mis le sceau à la réputation de Barye, et qui, aux yeux du plus grand nombre, ont particulièrement assuré sa gloire, sont ceux qu’il a exécutés sur des sujets empruntés à l’antiquité et à l’allégorie.
Le premier en date est le groupe qui représente Thésée combattant le Minotaure: il est de 1843. On a voulu le comparer à un ouvrage un peu plus ancien qui a été pendant longtemps dans le jardin des Tuileries, au Thésée vainqueur du Minotaure d’Etienne Ramey; aujourd’hui ce groupe est au Louvre, dans une salle du musée français. Le parallèle qu’on voulait établir alors entre ces deux sculptures avait un caractère polémique. En louant Barye, on prétendait démontrer que Ramey était un artiste sans talent: il appartenait à l’Académie. Or, il faut le dire, le groupe de Ramey diffère en tout point de celui de Barye; mais néanmoins il est fort beau.
Chez Barye, Thésée saisit le Minotaure qui est debout, et va le frapper mortellement de son épée; c’est le dénouement du duel. Les formes des deux combattants sont puissantes et larges; cependant, il y a une grande différence entre le personnage de Thésée, qui est calme, et celui du Minotaure, qui, doué d’une force matérielle plus grande peut-être, mais aveuglé et affaibli par sa brutalité même, est sur le point d’être vaincu. Le groupe de Ramey est tout différent. Le Minotaure renversé fait un dernier effort: il est déjà frappé et à moitié terrassé. Le héros, dans un mouvement où sa beauté se déploie, va l’achever d’un coup de massue à la tête. C’est un autre combat, ce sont d’autres- armes et d’autres attitudes, ce sont d’autres formes.
Les proportions chez Ramey sont élancées, la tête du héros est petite, tandis que les figures de Barye sont de proportions plus courtes et avant tout vigoureuses. Au premier coup d’œil, on reconnaît qu’il y a entre le goût des deux artistes une grande différence. Elle vient de ce que l’un s’inspire d’une tradition érudite, et l’autre d’une science originale. Mais au fond le résultat est équivalent. Si l’on compare ces ouvrages à l’antique, on voit que le premier pourrait se référer à l’école attique, tandis que le second ne serait pas indigne d’un maître dorien.
De même, le groupe du Lapithe et du Centaure qui suivit, pourrait être signé par un artiste grec. Les anciens ont fait beaucoup de combats de centaures et il nous en reste de nombreux et célèbres exemples. Nous en voyons dans les frises du temple de Thésée et du temple d’Apollon Épicourios, et aussi dans les métopes du Parthénon. Il était donc assez hardi de choisir un pareil sujet, que tout le monde connaissait déjà par tant de documents. Barye n’hésita pas et il a fait, sur cette donnée antique, un chef-d’œuvre moderne. La composition en est très vive et la hardiesse de la donnée est extrême. Le héros, Thésée lui-même, s’est élancé sur son adversaire moitié cheval et moitié homme: il l’a saisi à la gorge et va lui briser le crâne avec sa massue. Le centaure se renverse et se défend avec une vigueur furieuse et désespérée. Les lignes générales, le mouvement et les formes, tout dans ce groupe présente une décision, une énergie, une beauté extraordinaires.
Il faut en avoir un instant le modèle à sa disposition, pouvoir en détacher un à un tous les membres, les tenir dans ses mains, les regarder sous tous les aspects et à tous les jours. Il est rare que la sculpture moderne supporte ce fractionnement et surtout cet examen du morceau. Mais ici la perfection de la construction, la vérité de la musculature, la logique des actions, permettent le contrôle. C’est une merveille à voir: c’est un ouvrage qui est non seulement fait d’ensemble, mais dont chaque détail est rendu avec savoir et avec amour. Il défie la critique.
Ce groupe peut-il se comparer à un ouvrage grec? Rien n’est plus facile que de s’en rendre compte. Que l’on mette à côté, par exemple, et je l’ai fait, quelqu’une des métopes du Parthénon. Ce sont des représentations d’un même sujet. L’une a été exécutée sous la direction de Phidias, l’autre par un statuaire parisien. Ces œuvres sont d’origine bien différente, et cependant elles se tiennent parfaitement l’une à côté de l’autre. L’antique ne fait aucun tort au moderne: les deux arts sont à la même hauteur.
Notre sentiment ne serait pas le même si nous rapprochions du chef-d’œuvre de Barye un groupe bien connu de Jean de Bologne, Hercule et le Centaure Nessus, grand marbre qui se trouve à Florence, sous la loge des Lanzi. Il y a là, en même temps qu’un manque absolu de caractère, une faiblesse dans l’action, et quelque chose de fastueux dans l’exécution qui n’est ni conforme à la tradition antique, ni inspiré de la nature. Si on voulait encore faire un autre parallèle, évoquer le groupe de Canova qui est à Vienne, le Thésée tuant le Centaure, il faudrait aussi reconnaître que cet ouvrage ne saurait supporter la comparaison ni avec la sculpture du Parthénon, ni avec celle de Barye. En résumé, celle-ci rappelle l’antique par sa valeur et non par l’apparence. C’est un ouvrage dans lequel l’antiquité est égalée par la profondeur savante de l’étude et par l’intensité du génie sculptural. L’œuvre est classique, grâce à l’ordre d’idées supérieur auquel elle se réfère et grâce à sa puissance.
Nous arrivons aux groupes du Louvre qui ont une si grande importance. On ne peut pas les étudier facilement: ils sont placés sur la façade des pavillons du centre, à la hauteur du premier étage. On les voit donc mal, et, cependant, l’architecte Lefuel a eu une bonne et généreuse pensée en les commandant à Barye: il rendait ainsi au maître le plus légitime hommage. Un jour, je l’espère, on les moulera et on les coulera en bronze pour les mettre sous nos yeux: et nous aurons alors un spectacle magnifique.
Ces groupes sont au nombre de quatre, se faisant pendant deux à deux: la Guerre et la Paix; la Force assurant le travail et l’Ordre protégeant les arts et l’industrie. Telles sont ces allégories; je relève ici les termes du programme.
L’allégorie est un genre ingrat, parce que, le plus souvent, les mots ont plus de sens que les choses. En disant: «l’Abondance», on éveille plus d’idées que n’en peut exprimer une statue qui d’une corne renversée répand largement des fleurs et des fruits, toutes sortes de richesses. Cependant le génie symbolique des anciens s’est appliqué à ces jeux de la raison, et l’art de tous les peuples nous en offre des exemples. Dans les groupes du Louvre, on ne voit aucun trait emprunté à l’antiquité. Les éléments nécessaires à l’intelligence du sujet, comme les formes elles-mêmes, sont tirés de la nature; la nature seule en a fait les frais. Avec quelle énergie et quel aspect imposant dans sa simplicité n’est-elle pas rendue! La voilà traduite sans emprunt ni réminiscence, sans autre appui que la connaissance que l’artiste en possède et la forte impression qu’elle lui a causée. Nous trouvons ici toute la science du maître. Je l’ai fait remarquer à propos du Lion assis: cette science, résumée dans une généralisation savante, est cependant exempte de toute affectation. On se demande ce que seraient devenus de pareils sujets entre les mains d’artistes de la Renaissance et des temps qui ont suivi. Lorsque l’on y songe, on voit tout de suite apparaître des compositions théâtrales, une exécution redondante et vide. Mais en face des groupes du Louvre, on est touché de la simplicité et de la sincérité avec lesquelles ils sont traités. Là où la forme humaine eût été ramenée à une convention ornementale, Barye l’a figurée dans des conditions essentiellement organiques; et cependant son œuvre est hautement décorative.
Les petits modèles des groupes du Louvre existent en bronze et en plâtre; ils sont la propriété de M. Barbedienne. Les bronzes portent certaines morsures du burin et du rifloir qui sont des coups de maître. Sur les plâtres, on voit partout l’empreinte de la main et de l’ébauchoir de Barye. Les touches que l’on y observe, sont énergiques et personnelles. Elles nous montrent l’artiste marquant, avec une décision rapide, l’impression qu’il reçoit de la nature, en songeant à son sujet. Elles sont profondément sincères et vivantes et par là donnent à l’exécution un caractère qui relève un genre enclin à la banalité. En dépit d’elle-même, l’allégorie nous rend ici pensifs et nous émeut.
Telle a été la marche ascendante suivie par Barye. Le développement de son admirable carrière a été profondément logique. La science de l’art, l’étude passionnée de la nature, le respect de la vérité, voilà le secret de sa force.
Avant d’aller plus loin, il importe de faire la part de ces éléments et d’établir, au risque de quelques redites, ce que Barye doit à l’éducation qu’il a reçue et à celle qu’il s’est donnée.
Au sortir de l’École des beaux-arts, quelle pouvait être la somme de talent acquise par le jeune sculpteur? Telle est la première question que nous devons nous poser. Malheureusement, nous sommes réduits sur ce point à un petit nombre de témoignages. Le Caïn maudit, qui obtint un second prix de Rome n’existe plus; nous savons seulement que l’Académie avait ainsi motivé son jugement: «La figure est parfaitement dans l’expression du sujet. La tête est d’un beau caractère, et quoique la figure ne soit pas terminée, elle manifeste un grand sentiment de force et de vérité qui donne les plus grandes espérances.» Nous n’en savons pas davantage, mais cela n’est pas indifférent.
J’ai parlé d’une esquisse de Barye, d’une composition en bas-relief qui est restée à l’École des beaux-arts. Certes il est impossible de trouver dans ce travail fait en un jour, je ne dis pas du talent, mais l’indice même éloigné d’une vocation originale. Cependant on y remarque une bonne entente de plans, entente qui est une partie importante de l’art et qu’il a possédée dans une admirable mesure. A cet égard, il suffit de citer un exemple: le Lion de la colonne de Juillet, œuvre superbe et, dans son originalité, toute pleine du style classique le plus pur. C’est à l’École des beaux-arts, alors très occupée des questions de théorie, que Barye a appris les lois du bas-relief.
Je dois remarquer encore que la note inscrite au procès-verbal de la séance où fut rendu le jugement de l’Académie est encourageante, et que si Barye éprouva l’injustice de ses rivaux, la bienveillance de ses maîtres du moins lui fut acquise. Cela n’est pas inutile à rappeler, car la carrière de Barye a eu des traverses cruelles, et il importe de dire que ses maîtres, à l’encontre de ce que l’on pourrait prétendre, ne l’ont pas entravée.
Quoi qu’il en soit, Barye quitta les concours. Plus d’une fois nous avons vu des jeunes gens, après de brillants débuts, arriver à un moment fatal où ils sont réduits à l’impuissance. C’est un mystère, et c’est aussi une extrême difficulté pour ceux qui enseignent de distinguer entre les véritables promesses du talent et de trompeuses annonces qui sont le signe de son avortement prochain. Ce n’était point le cas pour Barye. A tous risques, il tournait ailleurs son énergie. Peu à peu, il avait négligé la gymnastique des concours, et hardiment suivi son inclination. Mais il n’avait point perdu son temps à l’École des beaux-arts. Mis à l’étude de l’antique, il avait fait son choix parmi les chefs-d’œuvre; il était allé aux plus larges et aux plus puissants. Son attention s’était fortement portée sur la sculpture égyptienne que Champollion rangeait alors au Louvre. De la sorte il s’était initié aux conditions de son art les plus hautes et les plus nécessaires. Il avait appris ce qui constitue la sculpture et l’œuvre sculpturale, le style. Tel fut le profit qu’il tira de son stage académique et reconnaissons qu’il ne fut pas médiocre.
Quand il commença à modeler des animaux, la variété qu’offrait ce monde nouveau le conduisit à des études que personne n’avait faites avant lui. Dans l’ordre de sujets qu’il présentait, on devait renoncer à consulter l’antique, eût-on à sa disposition la galerie des animaux du Vatican. Il fallait absolument fonder ses études sur quelque autre chose que le souvenir, et c’est ainsi qu’il fut conduit à travailler directement d’après nature. Il comprit bien vite qu’il n’y avait qu’un moyen de représenter tant d’êtres divers et de s’en rendre maître: c’était de les étudier scientifiquement. Il l’a fait avec énergie et, après plusieurs années de constance, il a exposé le Lion écrasant un serpent dont j’ai déjà longuement parlé. Voilà ce qu’il avait appris à l’école de la nature. Mais entre les études classiques et les études naturalistes il fallait établir un compromis. Malgré le succès de l’œuvre, on trouva que l’artiste ne s’était pas tenu dans une juste mesure. Ses admirateurs les plus éclairés estimèrent que si ce groupe était bien imaginé et bien observé, que s’il présentait sous tous les aspects une belle silhouette, l’exécution en certains endroits n’en était pas suffisamment sculpturale. L’anatomie leur en parut un peu pauvre et point assez simplifiée. Certes, on pouvait répondre que le Lion au serpent n’avait pas une destination monumentale, que c’était un sorte de drame fait pour être mis sous les yeux, un sujet d’expression auquel le marbre eût, peut-être, aussi bien convenu que le bronze...
Barye ne répondit point, connaissant trop bien son art, pour ne pas savoir à quelle diversité d’interprétations il peut se prêter. Il montra qu’il était capable d’agrandir sa manière et il fit paraître la belle figure du Lion assis. Là on put constater à quelle haute interprétation du naturel s’était élevé le statuaire. Cet ouvrage, par la grandeur du caractère par la simplicité et la largeur des formes, peut être placé à côté de ce que les arts de l’Orient ont produit de plus imposant. Je l’ai dit et j’y appuie, parce que ce lion marque un des points culminants de l’œuvre du maître et qu’il est un exemple. Ce qui le distingue, c’est qu’en lui, sous une sorte de rigidité, on sent la vie cachée, la vie subordonnée, mais possible. Ce lion architectonique est cependant vivant. Si donc son aspect est imposant, si, par l’accentuation des formes, il appartient à la grande décoration, il reste néanmoins un ouvrage vu et étudié sur nature. Rien n’y manque, et l’amplification sculpturale qui faisait défaut, disait-on, au Lion écrasant un serpent, se trouve ici réalisée par une généralisation savante.
Dans ces conditions, Barye a résolu le problème dont la solution s’impose aux modernes. L’art, on ne saurait se le dissimuler, n’a plus absolument son point de départ idéal; il s’élève à l’idéal, en prenant pour base l’observation de la nature et l’imitation. Notre grand statuaire, tout en restant vrai, atteint par la force du sentiment et par son énergie plastique à une expression sculpturale supérieure.
En dépit de ceux qui croyaient l’amoindrir en le traitant d’animalier, il n’était pas inférieur quand il représentait la forme humaine. Il n’a cessé de s’appliquer à la rendre avec tout son caractère et en toute vérité. Depuis ses débuts au Salon, où il montra des bustes et un saint Sébastien; depuis les cavaliers des Chasses du duc d’Orléans jusqu’au groupe charmant d’Angélique et Roger, il a poursuivi sa tâche. Il a véritablement touché le but dans le groupe de Thésée combattant le Minotaure. On pouvait être surpris que Barye, voué à l’étude de la nature, appartenant à l’école romantique, et ayant abandonné de son plein gré les études classiques, n’ait point hésité, pour donner la mesure de son talent, à recourir à des sujets empruntés à la mythologie. C’est que son esprit, par son étendue, déconcertait aussi bien ses admirateurs que ses contempteurs aveuglés. C’est qu’il était d’un pays, où la pensée et l’inspiration ont tant de sources grecques et latines que l’esprit y est naturellement ramené. Un pareil retour était comme un hommage au génie de notre race.
Volontaires ou non, ces ressouvenirs du passé lui portaient bonheur. Le Lapithe et le Centaure marque encore un plus grand progrès du maître: dans cet ouvrage plus que dans le précédent, l’antiquité est restituée dans sa puissance et dans sa beauté ; il pourrait être grec. On y retrouve quelque chose de la proportion et de la carrure doriennes sans aucune visée archéologique; c’est conformité de génie. Mais, il faut bien le dire, le sens mythologique dont témoigne un si bel ouvrage ne naît pas en nous de lui-même. En cela, encore, l’influence des premières études reparaît. C’est grâce à elles que Barye a si bien figuré son Lapithe et si bien représenté l’héroïsme grec dans sa hauteur et sa moralité. Thésée, car c’est lui, combat avec toute l’énergie humaine, et cependant porte dans la lutte l’âme d’un dieu. Une pareille idée ne s’invente point.
Barye ne s’en est pas tenu là : il me semble s’être élevé plus haut encore dans les groupes du Louvre. Les petits modèles n’en donnent pas l’idée: la grande dimension y ajoute. Je les ai vus de près et, je le répète, un jour on devra les couler en bronze pour nous les montrer tels qu’ils sont. Jusqu’ici j’écarte autant que possible les descriptions. Mais je ne puis m’empêcher d’arrêter un instant la pensée sur la composition de ces beaux ouvrages. Voici la Guerre: un guerrier s’éveille au son de la trompette qu’embouche un jeune garçon. Il va saisir son épée et la tirer du fourreau; il est assis déjà sur son cheval de bataille; il sera bientôt debout. Voici la Paix: il faut remarquer le caractère de calme profond, la demi-somnolence du pâtre familièrement groupé avec le bœuf confié à sa garde et qui rêve doucement tandis que, près de lui, un enfant joue de la flûte. C’est une idylle magnifique; un sentiment pénétrant s’en dégage. L’Ordre nous montre un homme assis en maître sur un tigre rugissant. Enfin, la Force est représentée par un guerrier qui, dans un calme qui s’impose, parait trôner sur un lion.
Tous ces personnages sont d’une puissante structure. Le caractère de leurs formes est exclusivement emprunté à la nature et inspiré d’elle. Ici encore, par la puissance du génie de l’artiste, ce naturalisme fondamental est élevé au caractère le plus héroïque, au style le plus haut, à une sorte de magnificence.
C’est dans ce sens que le génie de Barye a progressé dans son développement. Comme les plus illustres maîtres de la Renaissance, il s’est élevé à un idéal dont la nature lui avait fourni les éléments et son génie la mesure.
Il reste à examiner par quel enchaînement de faits, par quels moyens Barye est arrivé à un pareil résultat. Par là j’achèverai de traiter mon sujet.
L’École des beaux-arts avait été définitivement organisée en 1818, et un cours d’anatomie humaine y était professé par un savant chirurgien, Jean-Joseph Süe, le père d’Eugène Süe le romancier. Barye avait donc pu apprendre l’anatomie de l’homme. Mais comment connaître celle de tout le monde animal? Cela était plus difficile, car l’ensemble de cette science n’était pas compris dans l’enseignement classique. Sans doute, et assez facilement, il avait pu ajouter à ses premières études celle du cheval dont il y avait déjà beaucoup d’écorchés. C’était une indication, et il n’hésita pas un instant sur la voie qu’il devait suivre.
C’est alors qu’il se mit à fréquenter le Muséum d’histoire naturelle, sa ménagerie et ses galeries d’anatomie comparée. A la ménagerie, il observait les animaux, et dans la galerie il étudiait leur structure. Quand un animal venait à mourir, Barye trouvait le moyen d’en être averti. Il accourait, et alors il pouvait voir, dessiner de près et mesurer librement les animaux les plus féroces. Quelquefois même il obtenait d’en faire le moulage, soit dans l’état où ils étaient, soit après qu’ils avaient été disséqués. En même temps les cours du Muséum lui étaient ouverts. Je n’entends pas dire qu’il les suivit en vrai disciple de la science. Mais, à la manière des artistes, il saisissait les idées par leur généralité et les faits par leur physionomie. C’était l’époque des Cuvier; le temps où le plus jeune des deux, Frédéric, publiait l’Histoire naturelle des mammifères en collaboration avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, ouvrage qui parut de 1818 à 1837. Frédéric Cuvier faisait aussi paraître ses recherches sur l’instinct et l’intelligence des animaux. Or c’était là pour Barye l’objet d’un travail incessant. Il les observait à tous les instants de leur vie. Mais, pour les fauves, le moment où on leur donne leur nourriture était celui qui attirait surtout son attention. L’étude qu’il en a faite lui a permis de saisir et de fixer des attitudes et des gestes qu’aucun artiste n’avait remarqués avant lui. Le premier aussi il sut demêler, au milieu des contraintes de la captivité, les libres allures des animaux et vraiment pénétrer leurs habitudes ingénues. D’un autre côté, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ne fut pas inutile. Ce savant professait sur l’anatomie des êtres organisés des idées qui avaient alors un grand retentissement. Il considérait l’unité de composition des êtres, comme la loi première et suprême du règne animal entier. La théorie des analogues, théorie profonde, servait de base à ce système: toutes les recherches d’anatomie étaient des recherches d’analogie. Ces conceptions, dans leur généralité, frappaient Barye. Elles l’aidaient à créer, au besoin, des animaux fabuleux. J’ai expliqué que l’hippogriffe qui porte Angélique et Roger est un être fantastique, mais d’un fantastique pour ainsi dire scientifique et rationnel: et c’est en se fondant sur l’unité de composition et sur l’analogie, que l’artiste a donné à ce cheval une tète et des extrémités qui sont en dehors de la nature, et cependant tout à fait plausibles.
Mais celui qui dut rendre le plus de services à Barye fut Frédéric Cuvier, nommé en 1804 Garde de la ménagerie. C’était à lui qu’il fallait s’adresser pour obtenir l’autorisation de mouler et de mesurer les animaux, et quelquefois, quand ils n’étaient pas féroces, d’entrer dans les compartiments qui leur étaient réservés. Grâce à ce concours de circonstances et de relations, Barye se donna une éducation de naturaliste. Mais dans son travail il y avait deux choses: d’une part, l’observation et les idées, et de l’autre un ensemble d’exercices pratiques. Le dessin et le modelage y tenaient le premier rang, et Barye leur donnait un caractère d’extrême précision: il faisait un usage incessant du compas. Le compas est un instrument assez dédaigné par les artistes, mais qui cependant leur est indispensable et dont il faut qu’ils apprennent à se servir. Tout le monde ne sait pas mesurer, et parfois, avec la meilleure volonté, on se trompe par inexpérience, et aussi par quelque complaisance que l’on a pour soi-même. Barye avait la science et la conscience du compas. Il prenait donc ses mesures, il les inscrivait sur ses croquis et il fallait qu’elles se retrouvassent dans ses figures. Il ne se lassait pas de refaire, jusqu’à ce que le squelette fût bien contenu dans les formes et celles-ci bien établies sur les os. Personne n’a poussé plus loin le respect de l’ordre naturel.
Voilà donc quelles étaient les études scientifiques de Barye. Géricault avait pu en introduire le goût parmi les artistes; mais la théorie qui consiste à envisager l’anatomie comme base de l’art de représenter les formes était-elle bien nouvelle alors? C’est ce que je voudrais examiner.
On ne doit pas oublier qu’en 1801 l’Institut national avait mis au concours la question de savoir quelles ont été les causes de la perfection de la sculpture antique. La classe compétente décerna le prix à un mémoire intitulé Recherches sur l’art statuaire considéré chez les anciens et les modernes, dont l’auteur était Émeric-David. On ne lit plus guère les livres de ce savant, et cela est regrettable. Émeric-David était un esprit pénétrant, un érudit, et il a eu beaucoup d’idées qui sont encore des nouveautés. Dans l’ouvrage couronné par l’Institut, il développe cette idée que les sculpteurs grecs exécutaient leurs statues d’après une méthode anatomique, procédant par le squelette et arrivant successivement aux muscles et à la peau. Voilà sa théorie, et il l’appuie sur des textes et aussi sur des monuments. Il invoque surtout le témoignage de pierres gravées antiques. Et, en effet, il en est plusieurs qui donnent à réfléchir. L’une d’elles représente Prométhée modelant un squelette; et c’est vraiment une indication curieuse; un autre Prométhée vérifiant l’équilibre d’une figure au moyen du fil à plomb, une troisième, enfin, nous montre le même Prométhée pesant des membres humains dans une balance. Telles sont les autorités figurées sur lesquelles Émeric-David s’appuyait pour dire que, traditionnellement dans leurs ouvrages, les sculpteurs anciens commençaient par établir l’ostéologie, appliquant ensuite sur les os les différentes couches de muscles et recouvrant enfin le tout de l’épiderme. Partant de là, il indique quelle marche doit suivre le sculpteur dans l’exécution de sa statue, et il résume ainsi sa pensée: «le dessous avant le dessus»; ce sont ses expressions. Comme moyen pratique, il estimait que, travaillant d’après nature, les Grecs la mesuraient pour la mieux rendre, ce qui les avait conduits à formuler des règles de proportion, et qu’en tout cas, pour mieux copier, ils faisaient, sans relâche, appel au compas.
D’une manière générale, il semblerait résulter de tout cela que les Grecs auraient débuté par copier des modèles vivants. Si telle était l’opinion d’Émeric-David, elle serait erronée. Une pareille doctrine serait absolument contraire à la conception de l’art telle qu’elle existait chez les Grecs. Bien au contraire, leur art, né de la poésie, est, bien qu’anthropomorphique, purement idéal. Leurs premières œuvres ne témoignent d’aucune complaisance ou naïveté naturalistes. Elles sont volontairement de proportions très élancées ou très massives; et les formes qu’elles présentent, divisées durement, y tendent à une sorte d’architecture.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage d’Émeric-David fit grand bruit. Il occupa l’opinion, sans cependant exercer beaucoup d’influence sur les artistes; un petit nombre entra dans ses vues. Cependant elles appartenaient pour une bonne part à quelqu’un d’entre eux; Émeric-David n’avait pas tiré cette théorie de son propre fonds. Dans une courte préface placée en tête de la première édition de son ouvrage, il déclare que les idées qu’il expose sont nées de son commerce avec le sculpteur Giraud.
Il y a eu deux Giraud, dont le nom est à peu près oublié, et qui, cependant, méritent d’avoir ici un souvenir. L’un, Jean-Baptiste Giraud, a vécu de 1752 à 1830; l’autre, Pierre-François-Grégoire Giraud, de 1783 à 1836. C’est Jean-Baptiste qu’Émeric-David avait rencontré en Italie et avec qui il avait fait amitié. Les Giraud étaient-ils frères? Les dictionnaires biographiques nous le disent. Il y a cependant entre la naissance des deux un intervalle assez considérable: c’est un écart de trente et un ans. Partant de là, on en est venu à penser qu’ils n’étaient même point parents et que la conformité du nom et des goûts les aurait rapprochés. En tout cas, ils vivaient ensemble, professaient la même théorie et avaient la même manière de procéder. Ils eurent de grands talents. Il y a quelques années, il restait d’eux des modèles de statues et de bas-reliefs en cire et une belle collection de moulages qu’ils avaient légués à M. Vatinelle, graveur en médailles, le même qui avait concouru en 1819 avec Barye et remporté le prix. Qu’il me soit permis de dire quelques mots des ouvrages de ces excellents artistes. Dans le nombre, on pouvait admirer un Faune assis à terre et jouant de la flûte, statue entièrement achevée, et un Homme qui bêche encore à l’état d’écorché : ces modèles étaient de Jean-Baptiste Giraud. Grégoire Giraud avait fait le tombeau de sa femme, et un bas-relief, la Mort d’Épaminondas, conçu dans le goût de la frise du Parthénon. La méthode dont relèvent ces ouvrages est la méthode anatomique, et par le style ils appartiennent au grand art.
Barye a tenu quelque chose des Giraud, peut-être sans les avoir connus autrement que par ses entretiens avec son camarade Vatinelle, qui vivait auprès d’eux. En tout cas il a suivi la même voie; il est arrivé comme eux, par des moyens scientifiques, à des œuvres sculpturales du plus grand caractère. Détail curieux! il employa les mêmes moyens pratiques et se servit pour ainsi dire des mêmes instruments que ses devanciers. Les Giraud avaient créé tout un arsenal d’ébauchoirs dentelés pour travailler la cire: on voit sur les modèles de Barye la trace de ces mêmes outils dentelés.
Mais cela est de peu d’importance. La science avait plus d’autorité sur Barye que les personnes, la science seule le guidait. J’engage le lecteur à visiter un jour la galerie d’anatomic comparée, au Muséum. Elle est assez basse et peu de lumière y pénètre. En la parcourant, on éprouve un grand sentiment de respect: tous les squelettes qui sont là sont en quelque sorte historiques. Sur un grand nombre a travaillé Georges Cuvier, sur d’autres Geoffroy Saint-Hilaire et ses élèves; chacun a son souvenir et sa légende. Au fond de cette salle, un escalier communique avec l’étage supérieur où la collection se développe. C’est là que Barye a étudié, c’est là qu’il a mesuré tant de squelettes par pieds, par pouces et par lignes, comme en témoignent une foule de ses croquis.
En entrant de plus en plus dans la connaissance des conditions de l’être et de la vie, en approfondissant non seulement la loi d’unité de Geoffroy Saint-Hilaire, mais encore celle de Georges Cuvier sur la corrélation des formés. Barye nourrissait son esprit par de nombreuses lectures. Il lisait avec passion les poètes anciens et modernes; les historiens de tous les temps, les ouvrages de mythologie et d’histoire naturelle.
Quand il commença le surtout du duc d’Orléans, le prince, qui l’aimait, lui prêta un grand nombre de livres de chasses, de combats et de voyages. Ce fut pour l’artiste une nouvelle source d’informations et de créations inattendues. En même temps qu’il savait davantage, son talent devenait plus riche, mais aussi son esprit plus difficile. On dit qu’il abandonna Buffon, dont il s’était longtemps nourri, trouvant que ses descriptions s’arrêtaient trop à la surface. Il avait besoin d’aller au fond des choses: les ouvrages des Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire convenaient mieux à la nature de son esprit.
L’histoire des applications scientifiques à l’art nous offre à ce moment un curieux épisode. Tandis que Barye se confiait décidément à la science, un sentiment tout différent se manifestait dans l’école française. Ingres, revenant d’Italie, exposait avec un brillant succès le Vœu de L’ouis XIII et ouvrait un atelier d’élèves. Ingres, à l’égal des plus grands artistes, aimait la nature et la rendait avec un caractère et une énergie admirables; ses dessins sont comparables à ce que les maîtres de la Renaissance ont produit de meilleur en ce genre. Il mettait la forme pour ainsi dire en mouvement sous les yeux du spectateur, tant il apportait de précision et de force à en exprimer les accents. C’est la vérité même, et avec quelle profondeur! Cependant il éprouvait pour l’anatomie une répugnance invincible. Au moment où Barye, encore inconnu, adoptait cette méthode anatomique qu’il a toujours suivie, la répugnance d’Ingres éclatait contre elle. Son antipathie était fondée sur un dégoût instinctif et aussi sur la crainte que la science de la forme ne portât préjudice à la sincérité, à la naïveté de l’artiste. Il est certain que si cette connaissance devait engendrer la manière, que si l’on devait, sous le prétexte que les choses existent réellement, les montrer telles que la dissection les met à découvert, et non avec leur variété, qui est infinie, il faudrait s’en défier. Mais, envisagée comme propre à rendre compte de l’organisme, elle est indispensable à qui veut représenter des êtres vivants. Il n’est pas inutile de bien comprendre ce que l’on voit et ce que l’on fait: cela n’est pas contraire à la naïveté, qu’il ne faut pas confondre avec l’ignorance.
La naïveté est assez délicate à définir: en tout cas, son caractère essentiel est d’être inconsciente. Une naïveté préméditée qui se bouche volontairement les yeux et les oreilles, qui se confesse à elle-même et se dit: «Je commence ici et je finis là, je dois savoir telle chose et négliger telle autre» ; — une pareille naïveté n’est plus dans les arts qu’une convention. Elle ne vaut pas mieux que la convention contraire qui consisterait à dire: «Je sais ce qui est; je ne le vois pas, mais je le sais et je le fais».
Les maîtres des XIIIe et XIVe siècles ne pouvaient pas étudier comme nous, et je dirai même qu’ils n’en avaient pas l’idée. Sous le rapport du morceau, ils se bornaient à une apparence. Mais nous, qu’une civilisation avancée et une éducation savante ont conduits à connaître les formes, nous pouvons encore, en les voyant et en les rendant telles qu’elles sont, leur conserver l’aspect simple et non encore analysé qu’elles ont à première vue. En s’oubliant soi-même (ce qui ne veut pas dire qu’on oubliera ce qu’on sait), en ne cherchant point à se faire valoir ou à substituer quelque idole à ce qu’on a sous les yeux, on peut encore être naïf aujourd’hui. Ingres s’écriait: «Ah! si j’avais dû apprendre l’anatomie, je ne me serais jamais fait peintre; c’est une science affreuse et une horrible chose.» Je suppose que, dans sa jeunesse, il s’était soumis à des études que plus tard il pouvait dédaigner, en ayant tiré tout le profit nécessaire. Et, en effet, il semble difficile de croire que ces nus, si admirables par l’intelligence de la construction et du mouvement, aient pu être dessinés par un homme absolument ignorant des dessous. Si bien doué que l’on soit, il y a des choses que l’on ne devine pas.
L’anatomie, science modeste, n’engendra point de bruyantes querelles. Celles qui, en 1825, divisaient les écoles à propos du dessin et de la couleur suffisaient à occuper les esprits. Les dissentiments ne sortirent point des ateliers. Et Barye continua des études qui lui semblaient logiques, son système répondant aux besoins de son esprit, qui ne voulait rien hasarder.
A ses débuts chez un graveur et chez un orfèvre, il n’avait été occupé que de sculpture en métal. Il continua à travailler dans les conditions que l’emploi des métaux exige, et plus particulièrement au point de vue du bronze.
La fonte des premiers ouvrages de Barye avait très bien réussi. Il s’était rencontré un fondeur habile nommé Honoré Gonon, qui, avec l’infatigable passion des chercheurs, avait entrepris de mouler en bronze les modèles que lui livraient les artistes, sans même en altérer l’épiderme. Pour cela il avait recours à la fonte à cire perdue, procédé qui présente de grandes garanties de fidélité, mais qui est d’un maniement difficile. Gonon, dans son genre, n’en a pas moins fait des chefs-d’œuvre. Non seulement il a fondu le Lion écrasant un serpent, mais aussi les chasses et, précédemment, un groupe qui se trouve au musée du Louvre, le Tigre dévorant un gavial. Il a écrit sur la plinthe de celui-ci: «Fondu par Gonon et ses fils.» On doit également à son industrie le Danseur napolitain de Duret: ce sont là ses meilleurs travaux. Mais, je le répète, le procédé est délicat et ne donne pas absolument ce que l’on en attend. On croirait que, sortant d’un moule qui est d’une seule pièce, l’œuvre pourra se passer de retouches. Mais ce moule doit avoir des évents qui, remplis par la matière en fusion, forment autour de l’objet fondu une sorte de broussaille. Il reste certaines branches de métal, des jets souvent assez forts, qu’il faut détacher de la pièce, et qui laissent des cicatrices qu’on doit absolument faire disparaître avec la lime et le ciseau. En définitive, la fonte, quelque procédé que l’on emploie pour l’obtenir, a toujours besoin que le sculpteur ou le ciseleur vienne lui donner la dernière main.
Quand Gonon mourut, ses deux fils étaient jeunes et encore sans situation personnelle. Barye eut alors l’idée de se faire fondeur et, en 1838, il s’associa avec un fabricant de bronzes. En cela, il ne pensa point déchoir. L’art et l’industrie, tels qu’il les entendait, étaient une même chose; et certes il avait une autorité suffisante pour professer une pareille opinion. A tout prendre, il était artiste à la manière des anciens statuaires grecs et d’autres grands maîtres de la Renaissance, qui étaient, en même temps que sculpteurs, fondeurs et ciseleurs. Pour lui, en prenant la direction de la fonte, il en assura les résultats. Il employa aussi bien le procédé plus généralement répandu du moulage au sable que celui de la cire perdue. Quant aux retouches indispensables, elles se faisaient sous ses yeux et suivant le cas il s’en chargeait lui-même. L’ancien ouvrier de la maison Fourier n’y avait pas fait un vain apprentissage; rien ne l’arrêtait dans les travaux les plus délicats de la ciselure. Chez lui, l’artiste était doublé d’un praticien hors ligne, l’artiste était complet. C’est un fait sur lequel j’appelle l’attention, parce qu’il est unique dans notre temps. Ce fut une des originalités de Barye, une de ces particularités qui comptent dans l’histoire d’un artiste.
Après cela, il me semble qu’on a besoin de se figurer le milieu dans lequel tant de choses étaient conçues, poursuivies, achevées. On voudrait connaître, en même temps que le sculpteur, ce qui l’entourait. En vérité, il faudrait que, pour l’histoire d’une pareille carrière, il existât des descriptions et des inventaires nous disant chaque année quels plâtres, quels dessins, quels livres, quels ouvrages se trouvaient dans l’atelier. Rien ne devait ressembler davantage à la bottegha d’un Florentin du XVe siècle. On m’a parlé de celui qu’il avait occupe dans une maison de la Montagne Sainte-Geneviève. On peut s’en faire une idée: quartier silencieux, local plus que simple, selles couvertes de modèles en terre ou en cire, le poêle obligé, des sièges en petit nombre et une foule de moulages posés sur des tablettes ou pendus à la muraille; mais, au milieu de tout cela, point d’antiques, si je suis bien informé. Barye les admirait, les comprenait plus profondément que personne, en avait l’idée, mais ne les voulait point sous ses yeux.
Il travaillait à la fois à un grand nombre d’ouvrages. L’exposition faite après sa mort à l’École des beaux-arts a montré sa fécondité rare et de combien de sujets son esprit était occupé. J’ai relevé, dans le catalogue, la mention de cinquante esquisses en plâtre et en terre, cela indépendamment de compositions, achevées pour tout autre, mais qu’il retouchait encore avant de les signer. Il y avait ainsi seize sujets absolument inédits. En général, les modèles de Barye étaient de petite dimension. Mais, quand on entrait dans son atelier, il y avait toujours quelque ouvrage considérable en cours d’exécution. J’ai, à cet égard, le témoignage d’un artiste qui est lui-même, et de tout point, un sculpteur éminent, le témoignage de M. Frémiet. M. Frémiet, étant allé en 1846 visiter Barye, se trouva en présence du Lion assis, qui n’était encore qu’à l’état d’ébauche. Toutes les lignes en étaient arrêtées. La préparation était anatomique. Ce n’était pas, si l’on veut, le squelette lui-même avec tous ses détails, mais bien le crâne, la colonne vertébrale, la cage des côtes, les os des membres antérieurs et postérieurs mis en place et rigoureusement déterminés dans leurs conditions normales. Cette larve du lion, ce spectre vivant et décharné avait, paraît-il, quelque chose de fantastique et de souverainement imposant. M. Frémiet en a conservé un souvenir très vif, en est resté profondément frappé. En effet, bien que la forme n’existât pas encore, l’idée du lion était irrévocablement fixée rien que par les proportions et par l’ossature, indispensable support du reste.
L’artiste était toujours au travail et toujours debout. Près de lui, on peut se figurer la digne compagne qui lui a survécu, Mme Barye, lui faisant la lecture. Elle me l’a raconté : par moments, il l’interrompait; il avait besoin de n’être pas distrait de sa pensée ou des idées que le livre lui suggérait. Il interrogeait, quelque observation brève sortait de sa bouche, son regard s’éclairait. Puis il priait de continuer, revenant ainsi à ce qu’il avait désiré qu’on lui lût ce jour-là.
Telle était la physionomie morale de cet intérieur, telles étaient les personnes qui contribuaient à la lui donner. Puis, si l’on considérait les objets dont elles étaient entourées, on pouvait voir, à côté de l’artiste et servant directement à son œuvre, des plâtres qu’il consultait ou quelques dessins qu’il tirait d’un carton. Après sa mort, j’ai fait acheter un grand nombre de ces dessins pour l’École des beaux-arts: il y en a plus de deux cents. Ils ne sont pas de ceux que l’on destine à être montrés; ce sont des renseignements que l’artiste préparait pour lui-même, des relevés de squelettes cotés en chiffres comme je l’ai dit, et mesurés avec un soin extrême. Ils servaient au contrôle perpétuel que Barye exerçait sur ses ouvrages. J’ai été surpris de trouver, au milieu de ces documents empruntés à la nature morte, le Discobole, attribué à Naucydès, relevé par les mêmes procédés rigoureux. Cela m’a rendu curieux de savoir si je retrouverais les proportions de cette statue appliquées soit au Thésée, soit au Lapithe combattant le Centaure. Il y a, en effet, quelques rapports dans les longueurs et de l’analogie entre les têtes. Mais l’admiration, je pense, avait surtout porté le sculpteur à accomplir ce travail. Le Discobole était une des statues antiques qu’il préférait, et il l’avait mesuré pour l’amour de l’art.
Et maintenant que nous connaissons les procédés du grand artiste, voyons-le à l’œuvre et suivons-le dans l’exécution d’un de ses ouvrages les plus justement célèbres. Ce sera mon dernier développement.
Prenons pour exemple le Jaguar dévorant un lièvre. Quelle férocité originale! Comme l’animal en dévorant sa proie se traîne sur le ventre, et quelle sorte de volupté il trouve à assouvir son instinct! Remarquez le mouvement des épaules; comme l’omoplate droite est appliquée contre les côtes, tandis que l’autre fait saillie! C’est la vie, c’est la nature même saisie dans ses habitudes les plus particulières et dans ses formes.
Comment Barye s’y est-il pris pour arriver à ce résultat saisissant? Avec une simplicité qui est vraiment démonstrative. D’abord il avait conçu son sujet à la ménagerie en regardant un jaguar prendre sa nourriture; puis il était allé dans la galerie d’anatomie mesurer un squelette. Mais quelque liberté qu’il y eût, il y rencontrait cependant des impossibilités. Les squelettes étant montés sur des supports rigides et soutenus par des armatures en fer, il ne pouvait pas les plier comme il l’eût fallu pour se rendre compte du mouvement du corps et du jeu des membres. Pour parer à cet empêchement, voici ce qu’il avait imaginé. Il prenait un chat mort, le mettait dans la position qu’il souhaitait et profitait de la rigidité cadavérique pour le faire mouler. Avec cette donnée misérable, il était maître de son sujet. Et, en effet, le document existe; il est conservé à l’École des beaux-arts. Quand on le place à côté du beau bronze du Jaguar, on est frappé de la ressemblance comme de la différence qu’il y a entre eux. Sur l’œuvre d’art on retrouve le mouvement et jusqu’aux plis de la peau présentés par le moulage: rien n’en a été négligé. Mais l’artiste y a mis sa marque: la puissance et la vie. A côté de son pauvre congénère, le Jaguar qui, avec un singulier déploiement de férocité, brise une proie qui ne lui offre aucune résistance, et, en quelque sorte, en triomphe comme d’un ennemi digne de lui, est un animal terrible et magnifique. L’importance du document s’oublie. Le bronze est un chef-d’œuvre et le plâtre un je ne sais quoi.
Au milieu de ses créations, Barye devait s’interrompre pour veiller sur l’atelier où l’on exécutait ses bronzes. Il y portait un scrupule extrême. Quand une pièce n’était pas bien venue, il la renvoyait au creuset, et, quand la retouche avait de l’importance, il revêtait le tablier vert du ciseleur, mettait la pièce à l’étau et, avec son habileté à travailler le métal, il avait raison des imperfections de la fonte, ou réparait la maladresse d’un ouvrier. Dans plus d’une pièce, on reconnaît sa main. C’était aussi avec un sentiment de l’art extraordinaire qu’il donnait la patine à ses bronzes, recherchant cette couleur verte qu’on admire dans les antiques, y atteignant et sachant la varier sans que l’unité de l’œuvre eût à en souffrir. Enfin il ne sortait rien de chez lui qui ne le satisfît complètement. La conscience entrait dans sa théorie.
Barye, armé d’une méthode aussi excellente, eût été, il faut le reconnaître, un professeur incomparable: mais il n’eut pas à proprement parler d’élèves autour de lui, travaillant à ses ouvrages, vivant de sa vie. Néanmoins il a fait une école brillante et durable. Il n’avait point à l’établir au Muséum d’histoire naturelle quand il y fut nommé professeur de dessin. Les personnes qui se rencontraient là, il les voyait seulement à l’heure de son cours et il ne pouvait exercer sur elles l’influence d’un maître. On sait d’ailleurs pour quel objet ce cours a été créé : on a voulu former des. dessinateurs pour l’histoire naturelle. L’enseignement de Barye au Muséum était ce qu’il devait être; au point de vue de l’art, il ne pouvait porter des fruits. Mais, au dehors, le maître faisait des prosélytes par l’exemple et par la raison. Sa méthode était connue; des chefs-d’ œuvre en témoignaient. Ce qu’il eût pu dire à des élèves, il le pratiquait sans mystère. J’ai suffisamment expliqué quels étaient ses procédés; ils étaient à la portée de tous. Quelques artistes les ont adoptés à leur grand profit et au nôtre. Il a eu des imitateurs. Mais on peut appliquer sa théorie sans lui ressembler. Elle porte en elle de quoi soutenir les écoles de l’avenir.
Il nous reste maintenant à résumer ce qui précède et à en tirer la conclusion. Nous avons exposé la méthode du maître et décrit ses procédés. Nous avons consulté ses critiques pour les suivre ou pour redresser leurs jugements. Nous devons examiner, pour conclure, si sa doctrine est conforme à une saine théorie de la sculpture.
Je n’hésite pas à le dire, l’art de Barye est de tout point conforme à cette théorie. Si le caractère de la sculpture est de représenter l’élément fixe, essentiel et constitutif des êtres, il faut avouer que le grand artiste a pris le plus sûr moyen de satisfaire à ce principe. Rien de plus certain, en effet, pour arriver à déterminer les conditions de cet élément permanent et immuable, que l’information scientifique. Aussi chaque animal que figure le maître est-il, avant tout, le représentant d’un genre, d’une espèce et d’un instinct.
Le sculpteur a-t-il obéi à cette grande loi de son art qui veut que l’artiste ne prenne pour objet de ses représentations que ce qui est dans l’esprit de son sujet, que ce qui se laisse parfaitement exprimer par l’enveloppe extérieure, par la forme corporelle?
La réponse n’est pas douteuse. On ne pourrait rien relever, fût-ce dans la moindre de ses esquisses, même dans celles qui nous laissent incertains de savoir s’il voulait les abandonner ou s’il avait l’intention de les reprendre et de les développer, rien qui soit un manquement à cette règle de raison. Aucune mise en scène, aucune complaisance pour un faux pathétique. L’art de Barye a cela de commun avec l’antique, que, renfermée sous ses traits invariables, la vie des êtres reste concentrée en elle-même et que chacun d’eux vit pour ainsi dire en soi, et comme absorbé dans son individualité ; et que si c’est un animal, il accomplit sa fin sans se dérober à la fatalité qui le régit. Si Barye n’a jamais abaissé et jamais avili son sujet; jamais il ne l’a, non plus, tiré de la sphère qui lui était propre. Il n’a donné à aucun de ses modèles une autre expression que celle que la nature leur a départie. Personne n’a mieux distingué que lui entre l’instinct qui s’exerce en aveugle et la vie réfléchie qui délibère et se conduit.
Si nous considérons en elle-même la doctrine de Barye, tout d’abord nous serons tentés de dire qu’elle est un pur naturalisme. Mais en voyant ses effets et ce que l’artiste en a tiré, nous en aurons une opinion plus juste: nous penserons que si la nature sert de base à son travail, ses œuvres sont idéales.
L’étude de la nature est le fond des arts d’imitation; mais il y a bien des manières de l’aborder et d’en tirer parti. Dans un temps comme le nôtre, on a peu de chances de voir la réalité telle qu’elle est, c’est-à-dire affranchie des traditions et des idées héréditaires. On peut au moins s’efforcer de la connaître dans son intégralité ; et c’est ce que Barye a fait avec une conscience infatigable. Ensuite, et sans qu’il s’inquiétât du comment, sa personnalité s’ajoutait aux données acquises. Ses matériaux étant scrupuleusement rassembles, son génie faisait le reste.
J’ai assez appuyé sur le caractère qu’il a donné aux animaux. S’éloignant également du symbolisme oriental et de l’idée qui avait inspiré aux Grecs de subordonner à l’homme ce genre de représentation, Barye a fait de la sculpture antique avec le goût et le savoir d’un moderne. Et en cela il a si bien réussi qu’il ne craint aucun rapprochement et que si, d’un autre côté, l’on décrivait d’après ses sculptures les espèces qu’il a figurées, on ferait un livre de zoologie parfait.
Je suis encore plus frappé de la manière dont Barye a traité la figure de l’homme. Il l’a rendue d’une façon extraordinaire dans sa puissance physique: chaque personnage a une vigueur immense. A cet état supérieur répond le calme idéal, la sûreté de soi que ses héros gardent jusque dans leurs actions les plus violentes. Et ce calme gagne le spectateur et le laisse dans une admiration qu’aucune inquiétude ne vient troubler. C’est par là que Barye est un grand statuaire: chez lui, la vie physique décèle une vie morale élevée, intense, soutenue par un développement corporel imposant. Ces deux énergies, il les a toujours intimement associées l’une à l’autre. Il a tendu toute sa vie à une généralisation des formes et à une identification de celles-ci avec l’idée qui sont les conditions fondamentales de la sculpture.
Aussi ne trouverait-on rien dans ses sujets, si petites que soient leurs dimensions, qui pût les faire considérer comme des ouvrages de genre. Sa manière d’envisager la sculpture comme devant avoir un caractère très général était telle qu’à partir de sa maturité il n’a jamais fait de portraits. Avec son esprit très vif et le don qu’il avait de bien observer, il eût saisi à merveille le trait caractéristique des visages et des physionomies. Mais consacrer par la sculpture le désordre relatif que les formes individuelles présentent, cela ne le tentait point. Il restait fidèle à son idée de généralisation. Que de personnes cependant eussent été désireuses d’avoir leur portrait de sa main!
Après avoir reconnu que Barye a satisfait aux grandes lois de son art, qu’il en a rempli les conditions les plus hautes, demandons-nous encore s’il en a bien entendu la technique.
Observons d’abord que les sujets qu’il a traités ne comportent pas l’expression des passions: il n’y a là ni joie ni tristesse. Les héros combattent impassiblement, les animaux satisfont fatalement leurs instincts. Or, étant donné qu’il voulait rendre avant tout des sujets de mouvement, il a choisi la matière la plus propre à les traduire: il a employé le métal. En effet, ceux-ci ne conviennent pas bien au marbre. Pour en assurer la solidité, on est obligé de recourir à des supports purement artificiels qui troublent la représentation et l’embarrassent. Dans les animaux reproduits en bronze, au contraire, l’équilibre de l’œuvre n’est pas en question, parce que le métal a une ténacité qui permet aux parties faibles de porter les parties fortes et que partout le sujet est à jour et se découpe nettement.
Cela étant donné, on ne peut contester que le caractère essentiel de ce genre de sculpture ne réside dans le dessin. Or les ouvrages de Barye sont admirablement dessinés. Il était né dessinateur, et remarquons que dans son enfance le premier signe qu’il donna de sa vocation fut de découper avec du papier noir des silhouettes d’animaux. Le bronze, de couleur foncée, ne s’éclaire point par de délicates dégradations de clair-obscur, mais par de brusques éclats de lumière et par des taches sombres. Il n’est pas dans les conditions du marbre; les formes s’accusent surtout par les contours. Semblable en cela aux plus anciens statuaires grecs, Barye dessinait, ce me semble, encore mieux qu’il ne modelait; il avait plus de souci des lignes que des surfaces. Celles-ci sont d’une fermeté singulière. Tout y est analysé et résumé par de larges méplats. Mais la construction y ressort avec plus de force que le modelé, c’est un art d’architecture. Aussi observe-t-on dans certains de ses ouvrages une puissance un peu rude et une simplicité violente qui leur donnent un air archaïque. Cette impression d’antiquité que nous ressentons devant eux les recule en quelque sorte dans le temps et leur a prêté, dès leur apparition, une autorité que, d’ordinaire, un travail dans sa nouveauté ne possède pas.
En dernière analyse, la théorie de Barye repose sur l’union de l’art et de la science: une pareille association est-elle possible? Nous pourrions nous dispenser de répondre, l’œuvre que nous venons d’analyser se chargeant de parler pour nous. Mais cette question se rattache à l’un des plus grands problèmes qui se posent aujourd’hui. A entendre d’éminents esprits, les deux éléments, loin de pouvoir s’accorder, seraient, en principe, dans un antagonisme irrémédiable. Bien plus, l’art devrait disparaître un jour et la science occuper tout le domaine du sentiment: la poésie toucherait à sa fin. Que la science prenne dans l’avenir une place toujours plus considérable, cela n’est pas douteux. Que notre besoin de connaître trouve de plus en plus à se satisfaire, cela est conforme à l’idée de progrès. Mais, à cause de cela, la faculté d’éprouver les profondes émotions qui naissent du rapprochement de notre âme avec la nature cessera-t-elle d’exister, et n’éprouverons-nous plus ces impressions particulières que nous avons besoin de traduire au moyen des formes? On ne saurait l’admettre. Pour en arriver là, il faudrait que la science eût le pouvoir de supprimer une partie de l’homme.
Pour rentrer dans mon sujet, je dirai d’abord que les facultés de sentir et de connaître que l’analyse philosophique isole, sont inséparables dans nos esprits; que le sentiment n’exclut pas le savoir et que savoir n’empêche pas d’être ému. Loin de là, les deux facultés se pénètrent et s’entr’aident. Le savant imagine le sujet de ses recherches. Pourquoi l’artiste ne pourrait-il pas créer en sachant? En tout cas, la science l’aidera toujours à introduire dans ses ouvrages l’ordre, qui est une des conditions de la beauté.
Au fond, l’art et la science ont pour objet la vérité. Ils ont pour but suprême d’isoler les faits généraux de la multitude des détails et des accidents, pour faire apparaître cette vérité dans toute sa splendeur. Il faut donc reconnaître qu’ils ne sont pas divisés en principe et qu’ils ne s’excluent pas. Ils s’appliquent à deux côtés des choses qui sont nécessaires aussi bien que distincts. A tout prendre, chaque fiction de l’art se présente à nous comme vraie et elle a, tout au moins, besoin d’être plausible. Or ne sera-t-elle pas d’autant plus vraisemblable qu’elle contiendra une plus grande somme de vérité ?
Ces idées nous sont suggérées par Barye. Ses ouvrages, du fait de sa théorie, sont destinés à durer; ils sont placés à la fois au-dessus de la critique de l’artiste et de celle du savant. Nous pouvons les présenter à la postérité avec la conviction que nos jugements sont déjà ceux de l’histoire. En même temps ils restent pour nous tous comme une leçon féconde.
N’est-ce pas en définitive à faire profiter l’art des sûretés de la science que l’enseignement doit s’appliquer?
EUGÈNE GUILLAUME.