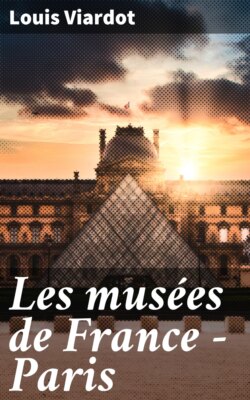Читать книгу Les musées de France - Paris - Viardot Louis - Страница 4
PRÉFACE.
ОглавлениеLorsque j'achevais le quatrième volume des Musées d'Europe, qui, dans ma pensée, devait être le dernier de la série, je disais, en prenant congé du lecteur:
«....Arrivé au terme de ma tâche, d'une tâche ingrate et difficile, je dois prier le lecteur de montrer une juste indulgence pour la sécheresse et l'aridité toujours croissantes du long ouvrage que je termine enfin. Parlant sans cesse, quatre volumes durant, des mêmes choses et des mêmes hommes, je ne pouvais répéter, à tous les chapitres, les observations générales sur quelques parties de l'art, ou les détails biographiques sur quelques artistes, qui auraient jeté de la variété et de l'intérêt dans un chapitre fait isolément. Plus j'avançais, plus j'étais privé de ressources accessoires et réduit à mon seul sujet; en finissant, il ne me restait guère à tracer qu'une simple nomenclature....»
Je croyais donc bien l'ouvrage terminé. Mais des amis, trop bienveillants sans doute, et même un éditeur, ce qui est beaucoup plus rare en ce temps-ci, m'ont fait observer que ce titre: Musées d'Europe, serait mensonger tant que la France manquerait à la série, et m'ont engagé à compléter l'ouvrage par un travail sur les Musées de France. Comme leur désir me faisait honneur et plaisir à la fois, j'ai facilement cédé.
Mais, puisque j'avais trouvé si difficile de mener à fin le quatrième volume, comment oserais-je entreprendre le cinquième? C'est la réponse que j'ai faite d'abord, à moi comme à mes amis. Puis, avec un peu de réflexion, j'ai reconnu qu'il y avait peut-être moyen de rajeunir le sujet, et de renouveler en quelque sorte la matière. Lorsqu'un amateur de livres, me suis-je dit, fait le catalogue raisonné d'une bibliothèque, il a soin, après avoir inscrit les œuvres et les éditions qu'il rencontre, d'inscrire dans un second catalogue celles qu'il serait désirable que la bibliothèque possédât aussi. Ces œuvres et ces éditions absentes d'une collection de livres se nomment, si je ne me trompe, ses desiderata. Eh bien, puisque je m'adresse, en parlant des musées de France, aux Français qui ont le Louvre au milieu de Paris, et qui peuvent fort bien sans moi savoir ce qui s'y trouve, je vais du moins leur dire aussi ce qui ne s'y trouve pas. En faisant le catalogue des richesses de nos musées, je ferai, comme un bibliophile, des desiderata. Ce, sera plus nouveau, et ce sera plus utile.
Avant que les Espagnols eussent pris l'habitude de regarder un peu par-dessus les Pyrénées pour voir ce qui se passait dans le reste du monde, j'avais été frappé de leur crédule et naïve confiance que rien de supérieur, que rien d'égal, en aucun genre, ne se trouvait hors de la Péninsule. Depuis, ils ont eu le bon esprit de se rendre à l'évidence, et d'imiter bien des choses dont ils ne soupçonnaient auparavant ni l'avantage, ni même l'existence. Les Français, qui ne voyagent guère plus que les Espagnols, bien que placés au centre de l'Europe, et qui se contentent habituellement de savoir leur langue, qu'ils croient universelle parce que les autres peuples, en effet, prennent la peine de l'apprendre, les Français ont encore un peu la croyance qu'avaient naguère les Espagnols; seulement, elle est moins naïve et plus entêtée, partant plus choquante. Je ne sais s'ils croient sincèrement, mais ils soutiennent volontiers que la supériorité française s'étend, comme la science d'Aristote, à toute chose quelconque et quibusdam aliis. C'est un travers, et c'est une erreur; ils pourront, en reconnaissant l'une, se corriger de l'autre.
Que le poëte dise:
Plus je vis l'étranger, plus j'aimai ma patrie,
on applaudira sans réserve à sa pensée. Oui, il faut aimer son pays, non-seulement quand il est glorieux et libre, mais encore quand il est malheureux, enchaîné, même quand il est coupable. Mais si le poëte eût dit:
Plus je vis l'étranger, plus j'admirai la France,
on eût pu se permettre un peu de contradiction. Soyons de notre pays, c'est bien; soyons même fiers de notre pays, c'est bien encore. Mais tâchons de le servir autrement que par cette aveugle et niaise adoration qu'ont les peuples enfants pour leurs fétiches; elle ne nous ferait voir ni ses défauts, ni les qualités des autres nations. Et, par exemple, ne pourrions-nous, sans tomber dans l'anglomanie, souhaiter à la France, outre la puissance industrielle et commerciale de l'Angleterre, outre la perfection de son agriculture et l'étendue de ses voies de communication, outre le grand nombre de ses vaisseaux et le petit nombre de ses soldats, un peu de la stabilité, de la force et de la grandeur de ses institutions politiques? Ne pourrions-nous souhaiter que la France eût, comme l'Angleterre, la connaissance, la pratique, le respect de la liberté, du droit et du devoir?
Pour revenir à l'objet qui nous occupe, aux musées de France, et pour parler aux Français de ce qu'ils ont chez eux, quel est, de ces deux partis, le meilleur à prendre?—Ou tout louer, tout admirer, tout exalter, prétendre que notre musée du Louvre l'emporte à la fois sur ceux du reste de l'univers, qu'il est au grand complet, qu'il réunit toutes les époques, toutes les écoles, tous les genres, tous les maîtres, et qu'il possède les meilleures œuvres des maîtres, des genres, des écoles et des époques;—ou bien reconnaître que, s'il est réellement supérieur à tous les autres musées dans son ensemble, et par l'universalité de ses collections, il est, dans chaque partie, surpassé par quelqu'un des autres; qu'à côté de richesses véritables, précieuses, et quelquefois surabondantes, il offre souvent une misère qui va jusqu'à la nudité, des vides absolus, des lacunes regrettables, impardonnables quelquefois, de trop grandes parts pour de petites renommées ou de trop petites œuvres pour de grands noms; puis signaler ces imperfections diverses, non certes pour le triste plaisir de blâmer, mais dans l'espoir qu'elles seront corrigées avec le temps? Je le répète: de ces deux partis quel est le meilleur à prendre? Assez d'autres s'arrêtent au premier; moi, j'adopte le second, et je croirai non-seulement donner à mon travail une fin plus utile, non-seulement tenir plus près de la justice et m'avancer plus loin dans le progrès, mais aussi mieux comprendre et mieux pratiquer le véritable amour de la patrie.
Cela dit, puisque tout livre doit avoir sa préface, de même que sa raison d'être, et puisque j'en fais une à celui-ci, je demande la permission d'expliquer—non point mon système, mot trop ambitieux pour qu'il me puisse appartenir—mais du moins ma pensée sur le droit de critique dans les arts.
Si l'on admet l'innéité des facultés humaines, on peut dire qu'en principe, et à l'état latent, comme s'expriment les philosophes, elles existent toutes en tout homme, à un degré quelconque. Mais, quant à l'exercice de ces facultés, une distinction se présente: les unes, par nature, sont immédiates et nécessaires; les autres seulement médiates et seulement possibles. Accordons à l'homme, sans hésiter, l'instinct du bien et du mal, le sentiment inné du juste et de l'injuste. Il l'avait à son apparition sur la terre, avant de le cueillir à l'arbre de la science; il le garde autant que la vie; il l'exerce avec sûreté toutes les fois que l'intérêt personnel ne parle pas assez haut pour couvrir la voix de la conscience. Le public, pris en masse, est donc le meilleur juge de la moralité des actions. En ce sens, vox populi, vox Dei; à tel point que les vérités morales, non moins divines assurément que les vérités naturelles et physiques, ne peuvent s'appeler ainsi que par le consentement universel. Accordons encore à chaque homme une part à peu près égale dans les passions diverses qui agitent l'humanité, et même, malgré les variétés infinies des caractères, des conditions, des circonstances environnantes, une part à peu près égale dans l'expérience des choses de la vie. Le public, pris en masse, surtout lorsqu'il reçoit une impression collective, sera donc encore, si l'on veut, le meilleur juge de la représentation des passions humaines, dans leurs causes, leurs développements et leurs effets, au moins sous le rapport de la fidélité. Ici encore sa voix sera celle de Dieu, ne laissant d'ailleurs d'autre appel contre ses arrêts qu'à Philippe éveillé. Il me suffit de fournir en preuve de ces deux propositions, pour l'une, l'heureuse institution du jury; pour l'autre, la légitime souveraineté du parterre.
Mais le même principe doit-il s'étendre à toutes sortes de jugements? La même règle peut-elle s'appliquer à l'appréciation des arts? En d'autres termes, l'homme compte-t-il, parmi ses instincts innés, le sentiment du beau comme celui du bon? Oui, en principe, puisque l'innéité est la condition de toutes les facultés humaines; mais, comme nous le disions tout à l'heure, rien de plus qu'à l'état latent. Celui-là est seulement possible, et seulement médiat. Le sentiment du bon, qui marque l'extrême supériorité de l'homme sur les animaux, qui l'élève à la connaissance de Dieu, de l'âme, de l'immortalité, de la justice et de la vertu, qui forme le commun fondement de toutes les sociétés, est un élément essentiel de notre nature, un don forcé de la Providence; sans lui, l'homme ne serait pas l'homme. Au contraire, le sentiment du beau, moins nécessaire, et pouvant être rare, étant superflu, est une acquisition de l'intelligence, lente, laborieuse, incertaine, et souvent refusée aux plus sincères efforts. L'un ne coûte, comme la noblesse, que la peine de naître; l'autre exige, comme toute science acquise, une aptitude préalable, une sorte de révélation où le hasard souvent doit aider à la nature; enfin du temps, de la réflexion, du travail d'esprit dans le loisir du corps. Aussi, le premier mouvement de l'homme, en fait de bon, est presque toujours juste; en fait de beau, presque toujours faux. Écoutez la foule appréciant dans son criterium moral un événement passé sous ses yeux: quel bon sens, quelle justesse, quelle pénétration, quelles intentions droites, quelles sympathies généreuses! Puis écoutez-la discourant sur le mérite des œuvres d'art: quelle pauvreté de goût, quelles erreurs grossières, quels risibles enthousiasmes, quel triste et complet égarement! Voit-on jamais le public des dimanches, au musée, se presser devant un débris de l'antique, devant Poussin ou Raphaël? Non; c'est une figure de cire, habillée de clinquant, qui aura sa préférence sur la Vénus de Milo; c'est quelque misérable trompe-l'œil qui l'emportera sur le Déluge et la Sainte Famille. Veut-on des preuves encore plus évidentes et plus palpables de la grande distance qui sépare, dans l'esprit humain, la connaissance du bon et celle du beau? Un jury de cour d'assises, bien qu'il prononce sur la liberté, la vie et l'honneur, se tire simplement au sort, tout citoyen pouvant également bien apprécier, sur des témoignages et des débats, la vérité d'un fait et sa moralité. Prend-on dans la même liste, et par la même voie, le jury qui doit décerner le prix d'un concours? Non; il faut alors choisir parmi les plus spéciaux et les plus habiles.
Mais d'ailleurs qu'est-il besoin de démontrer ce que dit à chacun sa propre expérience? Parmi ces hommes habiles et spéciaux, quel est celui qui ne confesse avoir été d'abord, et longtemps, la dupe de son ignorance? Quel est celui qui ne reconnaisse que le goût des arts, et plus encore le goût dans les arts, ne lui sont venus qu'à la longue, après des rencontres heureuses et souvent fortuites, après des études soutenues, des comparaisons multipliées, un continuel exercice des facultés de voir, de comprendre, de sentir, de juger? Qui ne sait enfin, pour l'avoir appris sur soi-même, que, dans les arts (sauf la musique peut-être, elle pénètre à l'insu même de ceux qui l'écoutent), les émotions viennent à la suite du raisonnement, et que si le feu sacré s'allume au fond des âmes, c'est en quelque sorte au frottement prolongé des facultés de l'intelligence?
Ceux qui voudraient étendre libéralement à tous les hommes le sentiment du beau avec celui du bon, ne trouvent guère, pour appuyer leur opinion sur un fait, que l'exemple d'Athènes, où, disent-ils, le concours pour les arts s'ouvrait sur la place publique, où tout le peuple formait l'aréopage. Cet exemple est trompeur, et je le prends au contraire à mon profit. Sans faire valoir le génie particulier de la Grèce antique parmi les autres nations du monde, et du peuple athénien parmi les peuples de la Grèce, je ferai simplement remarquer que ce peuple d'Athènes, si petit par son territoire et sa population, si grand par ses œuvres et sa gloire, se composait d'environ cinquante mille citoyens libres, servis par quatre cent mille esclaves. Or, les esclaves, étant chargés de tous les travaux manuels et exerçant tous les métiers, rachetaient leurs maîtres du labeur corporel, les faisaient hommes de loisir, les vouaient au culte exclusif de l'intelligence, comme tête d'un corps dont ils étaient les membres agissants et soumis. Cette démocratie athénienne, si jalouse qu'elle fût de l'égalité absolue entre les citoyens, était donc une véritable aristocratie; et l'on conçoit fort bien que le jugement des œuvres d'art appartînt à la foule, lorsqu'elle se composait entièrement d'hommes si éclairés par l'éducation et l'expérience, qu'on pouvait, sans grand danger pour la république, distribuer au sort parmi eux tous les emplois et toutes les magistratures. En politique, en législation, en morale, que la démocratie sagement organisée triomphe et règne, c'est mon vœu le plus cher; mais l'empire des arts, bien qu'il ne connaisse pas plus de frontières que la science, bien que, parlant aussi une langue universelle, il s'étende sur le monde entier, ne peut se gouverner que par une étroite oligarchie. Je crois donc qu'en écoutant avec déférence les avis de ceux qui savent donner raison de leurs avis, on peut se dispenser d'accorder une grande attention aux jugements aveugles et tumultueux que prononce la multitude et qui font tout au plus la vogue. Dans les arts, la voix publique est celle d'un fort petit nombre, mais intelligente, exercée et passionnée avec désintéressement. Celle-là seule donne aux vivants les récompenses de la réputation; celle-là seule donne aux morts l'immortalité de la gloire.
Hâtons-nous d'ajouter que, si cette élite de connaisseurs a le privilége de la critique, il ne s'ensuit pas que chacun de ses membres ait le don d'infaillibilité. Loin de là; elle est comme cette démocratie aristocratique d'Athènes où chaque citoyen n'avait que son vote personnel, et ne pouvait dominer qu'à la condition de convaincre. Comme il n'y a qu'une autorité dans l'empire du bon, la conscience, il n'y a qu'une autorité dans l'empire du beau, le goût. Seulement la conscience parle à tous les hommes le même langage, tandis que le goût, au contraire, même le goût acquis et formé, est aussi multiple que les tempéraments, les passions et les idées. Il varie de pays à pays, et d'époque à époque; dans chaque pays et chaque époque, il varie d'homme à homme, et, dans chaque homme, d'âge en âge.
Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre?
Est-ce à la tienne à juger de la nôtre?
L'ours a raison. Donc, on a beau se faire un devoir de lire tous les livres, d'écouter tous les avis, de consulter des hommes qu'on tient pour plus habiles que soi, d'appuyer son propre jugement de jugements plus sûrs et plus considérables, il n'est permis à personne, dans la critique des arts où manque la règle absolue, de se croire une autorité; on n'est qu'une opinion.
Cela bien entendu, le critique se met plus à l'aise. Il sait que, même en prenant des formules un peu absolues, et qui semblent peut-être trancher de la sentence, il ne fait qu'exprimer sa propre pensée, et n'engage que son goût personnel. C'est ce que j'ai fait, pour mon compte, dans les précédents volumes, lorsqu'après avoir, par un rare privilége, visité et étudié presque tous les musées de l'Europe, j'ai pu entreprendre et compléter seul un assez grand travail, lui donnant pour principal mérite celui de joindre à tant de variété dans la matière l'unité de goût, d'opinion et de jugement. C'est ce que j'ai fait encore dans ce nouveau volume, auquel je voudrais, comme aux autres, donner pour épigraphe ce mot du vicaire savoyard: «Je n'enseigne point mon sentiment, je l'expose.»