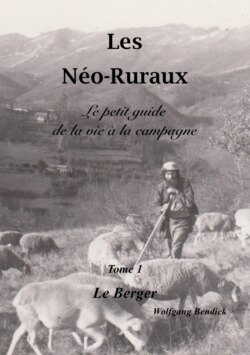Читать книгу Les Néo-Ruraux Tome 1: Le Berger - Wolfgang Bendick - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’ÉTÉ
ОглавлениеAyant fauché toute la colline au-dessus de la maison, nous commençâmes à ratisser les fougères en andains, en rangées. Pour les enfants, j’avais fabriqué des râteaux et des fourches rudimentaires avec des branches de noisetier. Ils nous aidèrent. Mais notre chien aussi. Seulement celui-ci, au lieu de ramasser les fougères, les éparpillait quand il venait à trouver un trou de souris. Il y avait encore de la vie dans le sol ! Nous avions prévu d’engranger les fougères plus tard, comme litière pour l’hiver. Mais nous en fûmes empêchés par un Elie essoufflé qui monta la colline à pied pour nous demander de couper son herbe plutôt que les fougères qu’aucun animal ne mangerait ! Sa faucheuse était en panne, en plus il avait le cœur fatigué et était interdit de travail. Il nous convainquit définitivement en nous promettant cinq tonnes de foin. Alors nous laissâmes tout tomber, chargeâmes la motofaucheuse sur la remorque et descendîmes avec lui au village.
En raison de l’avance de la végétation dans le fond de la vallée l’herbe dépassait déjà les genoux. Souvent il s’agissait de petites parcelles qu’il ne pouvait pas faucher avec son tracteur AVTO géant. Une fois le foin sec, il y amena la botteleuse, une sorte de presse avec le tracteur. Nous y poussions les andains de foin ou les apportions avec la fourche. Au fond de la vallée les terrains étaient assez plats. Souvent, les parcelles appartenaient à quelqu’un d’autre, comme nous apprîmes avec le temps. Parfois des arbres, en général des peupliers, étaient plantés dans les prés, et le terrain devait être entretenu jusqu’à ce que les arbres soient grands. Cela rendait la coupe plus compliquée et ne permettait pas à l’herbe de sécher rapidement. Souvent le propriétaire passait et touchait les arbres pour vérifier qu’on ne les avait pas coupés. C’était arrivé quelques fois parce que je coupais le plus près possible des arbres. Ensuite quelqu’un finissait de couper l’herbe autour des arbres à la faux. Il en était de même pour les bordures des prés et là où le terrain était trop raide pour la faucheuse. Quel travail ! L’herbe était très haute. Je marchais derrière la motofaucheuse, pendant que Marcelle me suivait en écartant avec la fourche une étroite bande d’herbe coupée, afin que celle-ci ne bourre pas la barre au passage suivant. Étant trop haute, l’herbe tombait par-dessus les planches à andains, fixées à chaque extrémité de la barre de coupe. Avec le temps, elle et moi formâmes une équipe bien rodée. Au début ça sentait l’herbe verte partout. Mais chaque jour, non, chaque heure, l’odeur changeait jusqu’à ce qu’enfin le parfum sucré et magnifique de foin s’épande partout, un parfum qui avait empli mon enfance et que je considère, ainsi que celui du fumier de vaches, comme le meilleur du monde !
Une fois l’herbe légèrement séchée, elle était retournée et empilée soigneusement afin que les brins légèrement raidis par le soleil maintiennent l’herbe encore verte en suspens. Les râteaux glissaient vite mais aussi en douceur sur le sol, sans accrocher. L’herbe devenait plus légère avec chaque geste et se transformait peu à peu en foin odorant. Les fourches le jetaient en l’air quand il était trop compact, le retournaient simplement quand il était plus aéré, ou bien le grattaient vers le bas quand il se trouvait sur une pente abrupte. Chaque geste était précis, exercé mille fois, transmis d’une génération à l’autre. Bien sûr, nos enfants participaient avec leurs outils simples faisant en sorte que le foin s’envole en l’air comme ils avaient vu faire les chiens toujours présents, quand ceux-ci chassaient les rats sous les andains. Leurs outils n’étaient guère différents de ceux des paysans. Leurs fourches aussi étaient faites de branches d’arbres qu’ils avaient trouvées en gardant leur troupeau et qu’ils avaient façonnées au couteau en suivant les animaux. Pareillement, les râteaux étaient en bois, du frêne de préférence. Le manche était fait d’une branche de noisetier écartée sur un côté. Concernant la manipulation et l’entretien des machines, nous nous y connaissions mieux qu’eux, mais pour le travail manuel ils étaient les maîtres incontestés !
A cause de la rosée nocturne, le foin était mis en andains le soir, ce qui avait l’avantage que même l’herbe collée au sol par le passage des machines était ramassée. Si des nuages indiquaient qu’un orage menaçait, le foin était empilé manuellement en tas avec les fourches. Ce n’était pas si facile que ça ! Il fallait le superposer en couches minces et le coiffer avec une sorte de toit qui descendait sur les côtés. Si on en avait le temps, on peignait les herbes à l’extérieur avec le râteau ou les dents de la fourche vers le bas, afin de permettre un bon écoulement de la pluie. Évidemment, avec une telle minutie on ne pouvait faire que des petites surfaces chaque jour. Le lendemain il fallait tout secouer et éparpiller de nouveau. Même après quelques jours de mauvais temps le foin ainsi apprêté était encore de couleur verte et utilisable ! Si le foin prenait une couleur jaune ou noire, il était de moins bonne qualité et il fallait un séchage plus rigoureux afin que plus tard, une fois dans la grange, il ne moisisse pas ou pire encore, se mette à chauffer au risque de mettre le feu à l’étable. Elie, « le pauvre », comme l’appelait sa mère depuis qu’il était malade du cœur, était couché sur une bâche à l’ombre ou s’occupait de préparer quelque chose à manger. Une chape de chaleur lourde couvrait les prés les après-midis. Souvent tout le clan était présent, sa sœur d’Auret avec sa fille et son mec, et tout autre membre de la famille se trouvant dans la vallée. Il régnait une bonne ambiance, on se racontait des blagues ou des évènements rigolos des autres années. Quand Esther, la mère d’Elie était là, elle commandait mais mettait aussi la main à la pâte. Avec elle on était assurés que le moindre petit brin d’herbe serait ramassé ! Même les grandes surfaces travaillées uniquement avec les machines devaient être ratissées manuellement quand tout était fini !
Quand le foin était sec, Elie posait son chien loulou sur son tracteur avant de se hisser lui-même en haut. Puis il démarrait le moteur. Son bruissement de bulldozer remplissait alors la vallée. Comme une bête affamée, la presse accrochée latéralement à l’arrière avalait, fourche après fourche, du foin parfumé ou léchait les andains du sol pour les recracher derrière en forme de balles. Tout ça dans un nuage de poussière et le vacarme rythmique du mécanisme de compression de la machine. Parfois il manquait une ficelle. Alors on portait la balle à l’avant, coupait la ficelle restante et redonnait le foin à la « bête ». Les balles finies, appelées « bottes » étaient groupées et posées de chant afin de les protéger contre l’humidité, mais aussi pour faciliter le chargement, car ça réduisait le nombre d’arrêts du tracteur. La mère d’Elie, de teint sombre, était toujours habillée en noir malgré la chaleur. Ses cheveux blancs noués en chignon, elle dominait le chantier en prêtant aussi main forte, malgré son âge proche des quatre-vingts ans. Elle faisait sans arrêt des commentaires, surtout dès qu’elle voyait quelqu’un. Personne ne trouvait grâce à ses yeux !
Quand elle n’était pas au travail, elle était devant sa maison qu’elle habitait avec son petit-fils Jean-Paul et qui surplombait le virage comme une tour de guet scrutant la route et les gens qui montaient ou descendaient. De son poste de surveillance, elle avait aussi le village dans sa ligne de mire et faisait des commentaires sur tout le monde. Les plus jeunes, surtout les enfants, dont les parents avaient une maison secondaire au village, la craignaient et l’appelaient « la sorcière ». Personne n’osait lui faire un « tustet », une farce. Les plus anciens l’appelaient mauvaise langue ou langue de vipère.
*
Doucement la grange à côté de chez Esther se remplissait de foin. Là étaient habituellement abritées leurs brebis qui se trouvaient en ce moment en montagne. Il leur fallait du foin plus fin. Le foin plus long et plus grossier fut apporté dans deux autres granges longeant la route de Lourein. Ils y enfermaient leurs quelques vaches, dont deux dressées pour être attelées au joug afin de tracter la charrette. Celle-ci servait à passer dans les chemins trop étroits pour leur tracteur russe et sa remorque, un ancien camion découpé. Moyennant une sangle de presque dix mètres, découpée en cercles dans une seule peau de vache, les deux vaches étaient attachées au joug par les cornes, l’une à côté de l’autre. Comme un bateau qu’on attache à une bitte ou un taquet. Il y avait des vaches « droites » et « gauches ». Rarement pour les deux côtés. Au milieu du joug massif, qui épousait la forme des têtes des vaches, était fixé par une grosse goupille en fer le timon de la charrette, qui passait entre les vaches. La charrette était un cadre solide fait en bois de frêne peint en bleu pastel, muni des deux côtés de ridelles en bois, à côté desquelles tournaient les roues à rayons de la taille d’un homme.
Elie marchait le plus souvent devant ses bêtes, les guidant avec des mots ou en les touchant légèrement avec un bâton, lourdement, à l’allure des vaches, suivi par son attelage. Dans presque chaque village il y avait un paysan travaillant avec un attelage de vaches. Les chevaux étaient trop rapides pour le terrain et plutôt adaptés aux terrains plats. Les bœufs étaient utilisés seulement par de gros paysans ayant beaucoup de surface fourragère. Ici en montagne, où chacun ne possédait que peu de terre, on avait besoin d’une « vache multifonction » qui, pendant son temps libre, produisait du lait et engraissait un petit veau destiné au boucher. Afin d’empêcher les vaches d’ingurgiter le foin trop frais et d’avoir des problèmes de digestion, Jean-Paul leur avait mis une muselière fabriquée par lui-même à l’aide de grillage à poules. Pour les défendre contre les taons il leur avait passé un peu d’huile de cade aux endroits fragiles à l’aide d’une plume d’oie. Je me sentais comme sur un navire où de tout cordage émane la même odeur. Cette huile de cade semblait être le remède miracle pour les paysans, car on en retrouvait l’odeur dans chaque étable et on en trouvait toujours une boîte avec un pinceau quelque part sur une poutre. Je regrettais qu’on ne puisse pas l’utiliser sur nous !
Le premier jour, nous étions descendus aider en short et chemise à manches courtes. Ça avait engendré une hilarité générale. Bientôt on allait savoir pourquoi. Tout le monde fit de grands yeux en voyant les jambes de Doris qui était en short. Apparemment ici ce n’était pas la mode, du moins pas pour les foins. Tout le monde portait des vêtements épais, impénétrables pour les trompes des « taouas » (taons). Plus le soleil montait, plus ces sales bêtes éclosaient ou se réveillaient, et par manque de donneurs de sang (les animaux étant pour la plupart en estive), ils se précipitaient sur nous. Nous n’arrivions presque plus à travailler, car tout le temps il y avait quelque part un taon à écraser ou à éloigner. Quand on en avait raté un, une bosse se formait rapidement à l’endroit de la piqûre, celle-ci démangeait alors pendant des jours et risquait de s’infecter à cause de la poussière du foin ou d’autres saletés. Il était contre-indiqué de mettre du parfum ou de l’after-shave. Mais ce risque était inexistant pour moi, j’avais ma barbe ! Nous nous aperçûmes que les vieux portaient même des caleçons longs et des tricots de corps à manches longues. Mais surtout pas parce qu’ils avaient froid ! De même ils portaient tous des chaussures hautes ou des bottes à cause des vipères. Nous dérangeâmes pas mal d’entre elles en fauchant ou en retournant le foin le matin, alors qu’elles étaient figées par la fraîcheur. Petit à petit nous nous habituions à leur présence. Et malgré leur grand nombre, personne ne fut mordu ! Mais souvent on se racontait des histoires de gens qui avaient été mordus. Mais la plupart du temps ça remontait à loin.
Autour de St. Girons, les paysans avaient déjà engrangé leur foin un mois plus tôt, fin mai. Nous avions vu ça en allant en ville. Petit à petit on commençait aussi à l’engranger dans les villages plus en amont. Bizarrement dans les terres basses le climat était différent. Est-ce que les montagnes faisaient pleuvoir les nuages ? L’ensilage, comme il en existait dans les Alpes, était inconnu ici. Tout le monde faisait du foin. Les riches exploitants, qui avaient des terres plates, utilisaient des presses qui hachaient le foin et façonnaient des balles rectangulaires pesant jusqu’à 30 kilos. Les deux ficelles maintenant le foin, étaient en sens longitudinal. Ils avaient besoin de tracteurs costauds et de bras solides ! Ces balles avaient l’avantage de supporter une petite pluie, surtout en les mettant debout les unes contre les autres.
Les autres paysans employaient des « botteleuses », qui pressaient le foin comme un accordéon. Dans ce cas les ficelles partaient en travers, sur le côté étroit de la balle. Ces balles pesaient 15 à 20 kilos et avaient l’avantage de pouvoir finir de sécher dans la grange, quand le mauvais temps obligeait à les rentrer plus tôt. Dans ce cas-là, nous les posions en couches et les saupoudrions de gros sel. Nous déposions les bottes les plus lourdes (et les plus humides) en périphérie du tas de foin, afin que la chaleur qui se produisait pendant leur fermentation puisse s’échapper et ainsi éviter de provoquer un incendie. Malheureusement ces bottes supportaient mal la pluie et souvent nous devions les ouvrir et sécher de nouveau, quand nous n’avions pas réussi à les rentrer à temps. Pour ce genre de lieuse, un petit tracteur avec peu de force suffisait.
*
Là où aucun tracteur ne pouvait plus circuler, les paysans fauchaient leur herbe à la faux ou au moyen de motofaucheuses fortement élargies, souvent équipées de roues jumelées ou en fer, dont les crampons devaient les empêcher de glisser ou de se renverser. Parfois quelqu’un marchait au-dessus, sécurisant la faucheuse par une corde. Ou encore marchait en-dessous, la soutenant avec une fourche à foin. Le fanage du foin se faisait à la main ou avec des accessoires spéciaux qui se fixaient par brides sur le bloc moteur de la motofaucheuse. Au lieu de retourner le foin, on le descendait en ratissant petit à petit pour finir de le sécher afin de le presser dans un endroit plus plat, ou on le rentrait à la grange en paquet, sur la tête. Ce paquet ou fagot, « fayot » en patois, était formé soit avec une grande toile en lin dans laquelle on enfermait le foin en nouant les coins ensemble, soit avec une longue corde, qui passait à travers un bout de bois d’environ 40 cm. On posait la corde en U sur le sol afin que se trouvent d’un côté la pièce en bois, polie par des usages fréquents, et de l’autre côté les deux bouts de la corde. Le foin était alors posé soigneusement en couches sur les cordes parallèles, de manière à ce qu'il dépasse de façon égale de chaque côté, jusqu’à obtenir un bon tas. Puis on faisait passer les deux bouts de la corde par-dessus le tas et autour de la pièce en bois en les serrant le plus possible. Ensuite on nouait les cordes autour du bois, de la même façon qu’on arrimait un bateau à un taquet. Le fagot était alors saisi et soulevé par deux hommes pour permettre au porteur, reconnaissable à un morceau de tissu noué autour de la tête et qui descendait par-dessus les épaules, de se poser dessous et de prendre les cordes avec les mains. Une fois en équilibre, les autres lâchaient leur prise et le porteur s’éloignait en titubant en direction de la grange pour s’y appuyer de dos devant l’entrée surélevée. Là on le débarrassait de son fardeau.
Des bruits aigus sonnaient à travers la vallée quand un paysan martelait sa faux. Quand une faux ne taillait plus, malgré l’affûtage à la pierre (une pierre oblongue, d’un grain fin, dans notre vallée souvent en ardoise), portée dans le « coupet », une corne de vache, autour du ventre, il fallait taper la lame. On se mettait à l’ombre et plantait l’enclumette dans la terre. Dans la région c’était une pièce oblongue en fer forgé, équipée dans son tiers inférieur d’une rosace métallique, afin qu’elle ne s’enfonce pas dans le sol, dont le haut formait une étroite enclume, légèrement arrondie. On s’asseyait au sol, les jambes étirées et écartées, afin que l’enclume se trouve devant soi. Puis on y posait la lame de la faux, si possible démontée du manche, la partie courbée vers le haut, le tranchant vers soi. A l’aide des cuisses on pouvait stabiliser la lame. Moyennant un marteau légèrement convexe, on frappait la tôle fine du tranchant afin de l’aplatir et de la rendre coupante. Au moins en trois passages, d’un bout à l’autre. Au premier il ne se passe pas grand-chose. Mais ensuite on s’aperçoit que la lame s’affine, plus fine qu’une lame de rasoir, et s’élargit. A chaque passage, il faut procéder doucement et éviter d’aplatir trop à la fois, car sinon la lame peut se fissurer ou s’onduler. Mieux vaut s’exercer d’abord sur une vieille faux ou une faux cassée, car une bonne faux coûte très cher ! Quand le tranchant se plie sous la pression d’un ongle, le martelage a été parfait ! Un petit passage avec la pierre à aiguiser et on continue ! Mais pour faucher à la faux il y a la même règle que pour le martelage ou l’affûtage : c’est en faisant qu’on apprend ! A partir du moment où l’on arrive à se détendre on fait du bon travail ! Pas de gros efforts, pas de précipitation ! Que de la patience…
Moi-même je préférais taper la faux à la maison, assis sur une souche aménagée spécialement pour cette tâche. C’était plus confortable et l’enclumette ne pouvait pas s’enfoncer dans le sol. Au début on est crispé. Mais avec le temps la main devient plus légère et on entend au son de la frappe si la lame est bien positionnée et si on tape bien. Le martelage de la pointe de la faux demande plus d’efforts que le reste.
Dans d’autres régions l’enclumette est large et le marteau étroit. Dans ce cas il faut poser la faux avec la courbe vers le bas et le tranchant vers soi. Je possédais les deux systèmes, mais préférais le premier, celui avec l’enclumette étroite.
Au remontage de la faux il faut faire en sorte que sa pointe B se trouve environ 3 cm plus bas que le « talon » C. Pour le réglage on pose la faux par terre. On place un objet par terre au « talon », l’endroit le plus large de la lame. Puis on pose le pied sur la poignée au bout du manche afin de faire un pivot et on bouge la faux vers la droite, afin que sa pointe arrive à l’objet placé auparavant. Ensuite il faut régler la pointe de sorte qu’elle arrive 3 à 4 cm plus bas que cet objet, puis procéder au serrage de la bride.
Selon la taille du faucheur il faut régler l’angle de la lame par rapport au manche. Soit en mettant des cales, soit en aplatissant le bout du manche avec une râpe. Le fauchage est plus facile le matin quand l’herbe est mouillée par la rosée ! Il fait aussi plus frais. Sur les talus, il faut avancer parallèlement à la pente et faucher vers le bas. Les cailloux et les taupinières sont très mauvais pour la faux. Quand la faux taille mal et qu’il ne reste plus grand-chose à couper, on peut « booster » la faux en urinant dans le « coupet », la corne qui contient la pierre.
A cause de nos bêtes nous devions être à la ferme matin et soir. En dehors de ces périodes, nous étions, surtout moi, pendant les trois semaines à venir chaque jour au village pour donner des coups de main. Car ce n’était pas seulement Elie qui avait « pris possession » de moi, mais aussi d’autres paysans demandaient mon aide, car soi-disant aucune motofaucheuse au village n’était en état de marche. Souvent on m’invitait pour manger et on me payait pour le travail, malgré mon refus. Bien sûr que nous avions besoin d’argent, car on en dépensait plus qu’on en gagnait !
Nous apprenions que dans la haute vallée, normalement on ne fait qu’une coupe. On n’en faisait une deuxième que dans les fonds de vallée. En haut on faisait paître les animaux dans l’herbe poussant après le foin, le « regain », quand ceux-ci revenaient de la montagne. Et nous qui avions cru qu’ici on pouvait faire quatre coupes comme en Bavière ! Je me mis à calculer : en Bavière on comptait deux vaches par hectare, en faisant quatre coupes. Ici on n’en faisait qu’une. Ça signifiait qu’il nous fallait quatre hectares pour nourrir deux vaches ou deux hectares par bête ! Ayant environ vingt hectares de surface, cela nous permettait, en théorie, de garder dix vaches. Mais lentement des doutes m’envahissaient ! C’était probablement le cas plus bas, où l’herbe était épaisse. Mais pas chez nous, où on pouvait compter les brins ! Je demandai à Esther, qui était originaire d’en dessous de chez nous, ce qu’elle en pensait. Elle réfléchit un moment, puis elle demanda : « Voulez-vous vraiment le savoir ? » J’acquiesçai. « Deux, trois au maximum ! », fut sa réponse.
*
Un des maquignons nous proposa des génisses noires et blanches. Nous crûmes que c’étaient des Holstein, comme je les connaissais dans le nord de l’Allemagne. Nous attendîmes qu’elles grandissent, mais elles grossissaient plutôt. Plus tard quelqu’un nous apprit qu’elles étaient des « Bretonnes », une race de la Bretagne. Sur l’autre versant de notre montagne, deux frères s’étaient installés. Ils avaient quelques vaches de cette race et avaient commencé à faire du fromage. Comparé aux autres vaches, les leurs étaient des naines. Nous voulions leur rendre visite. Nous montâmes la route forestière le plus haut possible. Quand ça commença à être trop raide nous abandonnâmes le combi et continuâmes à pied en direction du Col de la Croix. Nous avions le souffle coupé ! Devant nous s’étalait un panorama montagnard couvrant tout l’horizon ! Nous nous retournâmes pour regarder d’où nous étions venus. Là aussi, que des montagnes ! Étant en altitude, nous pouvions regarder par-dessus la chaîne de montagnes qui limitait notre vallée au nord, loin vers la plaine brumeuse, où quelque part devait se trouver Toulouse. Nous grimpâmes sur une petite colline et nous nous laissâmes tomber dans un creux plein de bruyère. Puis nous regardâmes un bon moment les montagnes, heureux d’avoir un si bel endroit pas si loin de la ferme ! Les enfants venaient de découvrir quelques schistes contenant de la pyrite et je dus les sortir de la roche. A la maison ils rejoindraient leur collection de pierres remarquables.
Lentement nous continuâmes notre chemin. Nos yeux étaient plutôt rivés sur les montagnes majestueuses, alors que les enfants scrutaient les bordures du chemin en quête de trésors. Au début nous suivions un chemin creux qui plus bas passait par-dessus des rochers en forme d’escaliers naturels vers la vallée. Le premier être humain que nous croisâmes était Clément, un Français chevelu qui vivait là-haut dans la solitude montagnarde. Il était en train de fumer une clope qui sentait fortement l’herbe. Non loin de là broutaient, au son de leurs cloches, quelques chevaux Fjord, une race plutôt exotique ici dans les Pyrénées, avec leur robe beige clair et la queue et la crinière tombant d’un côté poivre-et-sel. Il nous raconta qu’il faisait des transports de matériaux avec ses animaux. Quand l’hélicoptère ne lui piquait pas le boulot. Il nous expliqua le chemin vers les frères fromagers.
Nous descendîmes lentement le chemin. Apparemment dans le temps on y avait débardé du bois, ce qui avait si profondément creusé le chemin. Mais l’écoulement des eaux avait aussi participé aux dégâts. Nos yeux étaient en permanence attirés par les montagnes. Dans leurs crevasses se trouvait encore un peu de neige sale, sans doute à cause de la poussière charriée par le vent venant de l’Afrique. Quelle immensité de ce côté ! Notre montagne était belle aussi, mais très proche. Elle limitait la vue. Ces montagnes-ci l’ouvraient ! Sous nos pieds s’étirait une vallée, le fond couvert de prairies bordées par des haies. Parfois elle se partageait, contournant des collines, se vêtant, plus en haut, d’une forêt éparse avant de rejoindre les sommets rocheux et toucher la ligne céleste bleu clair.
Des rapaces aux envergures jamais vues tournaient sans bouger les ailes dans la profondeur d’un ciel sans nuages. Nous les prîmes pour des aigles. Mais quelqu’un nous expliqua que c’étaient des vautours. Nous aperçûmes un tuyau noir en bordure du chemin. Clément nous avait dit qu’il nous amènerait chez les frères. Nous le suivîmes et peu après nous nous trouvâmes devant une longue grange bâtie comme tous les édifices en pierres sèches, sans ajout de mortier mais avec de la terre à la place, au toit en ardoise. Une moitié avait été transformée en habitation, l’autre servait d’étable. Dans le pré devant la grange se trouvaient trois petites vaches noires et blanches aux pis énormes. Non loin de là, dans un petit pré entouré de haies de noisetier, deux jeunes gars étaient en train de retourner le foin. Un parfum de tisane nous enveloppait. Ils posèrent leurs fourches contre le mur et nous saluèrent. En cueillant quelques brins de serpolet, un genre de marjolaine sauvage, ils nous invitèrent à boire une tisane dans leur cuisine-salon. Là, dans la pénombre fraîche, ils posèrent une casserole sur le réchaud à gaz. Ils venaient de Paris, ayant vécu un moment en Bretagne, avant de s’installer en Ariège. C’est de là qu’ils connaissaient cette race de vache : petite, rude, idéale pour la montagne ! « Mais l’altitude, la terre maigre ? », remarquai-je. « Tout comme vous, on vient d’ailleurs et nous nous sommes adaptés. Les animaux en sont capables aussi », répondirent-ils. « Vous ne pensez pas que par rapport aux autres vaches elles font moins de lait ? » « Nous, en tout cas, nous en sommes contents. Mais nous ne savons pas combien elles produisent exactement, car nous laissons téter leurs deux veaux et nous transformons le lait restant en fromage. Vous voulez le goûter ? » D’un appentis minuscule, en partie enterré dans la colline derrière la maison, ils sortirent un petit fromage rond et le coupèrent en deux. Il nous rappelait le fromage que nous avions fabriqué en Allemagne. Pas parfait, mais bon quand-même ! Bien sûr, pas comparable aux fromages qu’on fabriquait dans les Alpes ! « C’est un fromage lactique. Nous sommes encore en train de l’améliorer. Quand parfois il est moins bon, on cuisine avec. Rien ne se perd ! » Nous étions d’accord avec eux.
Ils nous racontèrent que pas loin d’ici habitait Daniel, un autre « Baba Cool » qui avait des chevaux « Castillonnais » avec lesquels il faisait du portage. Après cette dégustation ils repartirent faire leur foin, pendant que nous reprenions le chemin du retour, car nos vaches nous attendaient pour la traite. En espérant qu’elles soient encore là !
*
Les gendarmes semblaient nous porter dans leur cœur, car ils nous avaient encore rendu visite. Étant dans le coin, ils avaient voulu en profiter… Bien sûr, nous n’avions pas la carte de séjour qu’ils réclamaient. Bien sûr qu’ils le savaient ! Nous l’avions demandée à la préfecture de Foix. Mais l’administration travaillait lentement aussi en France ! Elle avait besoin de temps. Elle vivait du retard ! Le retard lui donnait sa raison d’être. Cela faisait plus de trois mois que nous étions ici. Entre-temps nous étions allés en Espagne, avions dû sortir et rentrer sur le territoire. Comment s’imaginaient-ils que nous ferions ? Si ça continuait comme ça, nous allions monter un troupeau itinérant et franchir la frontière tous les trois mois !
Nous avions aussi reçu récemment une convocation pour un entretien de la DDA, la Direction Départementale de l’Agriculture. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, la sécurité sociale des paysans, avait aussi des nouvelles nous concernant. Je m’y rendis seul, pourquoi traîner toute la famille à travers les institutions ? Et quelqu’un devait prendre soin des animaux !
D’abord je me rendis à la préfecture. Un concierge, qui gardait les lieux, m’ouvrit la barrière mobile. Car, contrairement aux agriculteurs l’administration commençait à travailler tard, j’étais en avance et dus attendre. Grâce à ça je fus le premier. Heureusement qu’on n’était pas lundi, l’accueil fut amical. On me remit un titre de séjour provisoire pour six mois. D’ici là le définitif devrait être établi.
Par contre les nouvelles de la MSA ressemblaient à une douche froide. On me fit savoir qu’on ne pouvait pas être reconnus comme agriculteurs, car ce n’était pas la surface de la ferme qui comptait pour être assujetti à la MSA, mais le revenu cadastral. Le nôtre était de 95 francs, et il en fallait au moins 120 ! Alors il faudrait louer des terres ou en acheter ou chercher du travail pour être assuré auprès d’un autre organisme. En clair, nous n’étions toujours pas assurés et n’avions pas droit aux allocations familiales !
Il n’était pas encore midi, j’avais donc assez de temps pour passer à la Chambre d’Agriculture qui n’était pas loin. A vrai dire, je n’attendais plus rien. Après avoir atterri deux fois dans un mauvais bureau, on m’amena enfin au bon. Dans ce bureau il y avait quelques jeunes conseillers qui, tout en buvant du café, se racontaient des blagues. On m’en offrit un et me demanda s’il y avait un problème. Je sortis la correspondance de la MSA de mon classeur, les actes de propriété et expliquai la situation. Dans une armoire ils stockaient des microfilms avec les relevés du cadastre et les informations concernant les anciens propriétaires. Ils examinèrent tout. Et ils découvrirent que les données de la caisse n’avaient pas été mises à jour avec le cadastre depuis 10 ans ! Peut-être parce que notre ferme avait été déclarée comme friche, et les terres déclassées afin que le propriétaire puisse économiser des charges… D’après les dernières données du cadastre, notre ferme avait un revenu cadastral de 124 francs, alors plus que le minimum ! Ils m’assurèrent qu’ils allaient s’occuper du problème. Dans peu de temps tout devrait être arrangé ! Il était aussi possible « d’arranger » le revenu cadastral en ajoutant des « cultures spéciales » comme des ruches ou une « exploitation forestière ». J’étais soulagé ! J’avais du mal à m’imaginer travailler dans un de ces bureaux, sans devenir morose ou devenir un « bureaucrate » comme à la MSA. Ici au moins on s’occupait et faisait tout pour nous aider !
Il me restait encore à aller voir la DDA, l’administration qui était en charge des aides. « Des aides ? Pour quoi faire ? Je veux vivre du travail de mes mains ! » Mais mon interlocuteur, un homme un peu âgé, sans doute pas loin de la retraite, ne partageait pas mon point de vue. « Êtes-vous au courant du prix du lait, de la viande, et surtout de celui des agneaux ? Malheureusement aucun paysan, surtout ici en montagne, où le travail ne peut pas se faire avec des machines, ne peut vivre uniquement de ses ventes. Et connaissez-vous le prix d’un tracteur de montagne ? Trois fois le prix d’un normal ! Prenez les aides avec la conscience tranquille, et le plus possible ! », me conseilla-t-il. Il étudia un moment mes papiers. Voyant mon diplôme de maraîcher il fut intrigué et passa un coup de fil. Puis il m’expliqua que celui-ci correspondait au moins au BPA français et me donnait droit à une Dotation d’installation, la DJA, pour Jeunes Agriculteurs, une somme de 45 000 francs, car j’avais moins de 35 ans. « Ça doit être lié à quelques conditions. Je préfère rester maître chez moi ! », objectai-je. « Je pourrai vous donner des adresses de jeunes agriculteurs dans votre coin. Allez les voir et dites-leur que je vous envoie. Ils vont vous confirmer qu’ils ont toujours les mains libres. « La seule condition est de verser la TVA, la Taxe sur la Valeur Ajoutée de vos ventes, aux impôts. » Je voulais savoir de quoi il s’agissait, car la MWSt., son équivalent allemand, avait été introduit en Allemagne récemment. Et tout avait été plus cher ! « C’est simple : peu importe ce que vous achetez, vous payez une taxe dessus. En France c’est 16,8%. En achetant une débroussailleuse pour 1000 francs, vous avez payé 144 francs de taxes. Ils sont partis ! Si vous êtes assujetti à la TVA, vous récupérez cette somme. » Je ne voulais pas le croire. « L’état ne fait pas de cadeau ! Il ne fait que prendre ! », objectai-je. « Bien entendu, en contrepartie vous devez payer une taxe sur vos ventes. Mais sur les produits agricoles celle-ci est de 5,5%. Alors vous « gagnez » quand-même 90 francs ! », m’expliqua-t-il. « Faut que j’y réfléchisse ! Et pour tout ça il faut une sorte de comptabilité, car sans contrôle ça ne fonctionnerait pas ! » « Bientôt toutes les exploitations devront tenir une comptabilité ! », constata-t-il. « Les cinq premières années vous devrez faire faire ça en passant par un organisme agréé. Il y a le CEGERA, qui s’occupe uniquement du secteur agricole. Plus tard vous pourrez le faire vous-même ! » « Ils ne vont pas faire ça pour rien ! », me doutais-je. « D’après le nombre de « lignes » ça s’élève de 6000 à 10 000 francs par an. » « Une sacrée somme ! », répondis-je. « Les cinq premières années vous aurez une aide financière. Alors vous payerez peu. Et après cinq ans vous allez faire la compta vous-même ! » Ma tête commençait à bourdonner. Toutes ces abréviations que j’avais entendues aujourd’hui … Mais il n’avait pas fini : votre ferme se trouvant en zone de montagne, vous avez droit à l’ISM, l’Indemnité Spéciale Montagne. Celle-là dépend du nombre d’hectares et des cultures. Et vous avez des vaches ? Quand vous ne livrez pas le lait à une laiterie, vous avez droit à la Prime à la Vache Allaitante. Vous avez acheté l’exploitation en janvier. Je suis convaincu, que pour l’année en cours vous pouvez en bénéficier, car l’année agricole commence au 1er Avril ! »
Ainsi passa l’après-midi. Puis il me raconta qu’il était en train de « retaper » une grange dans le Riberot. Bien sûr au noir, car jamais on ne lui accorderait un permis de construire. Si un jour j’avais besoin de travail, plus exactement d’argent, je pourrai y travailler pour lui ! Mais pour l’instant j’avais assez de travail et le foin n’était pas encore fini non-plus… Avant de rentrer je me rendis dans un magasin pour acheter des oranges pour faire plaisir aux enfants. Je déposai le sac derrière la banquette du combi. Puis je me mis en route.
En quittant Foix vers l’ouest, la nationale serpentait sur plusieurs kilomètres sur le flanc de la montagne vers le Col del Bouich. Il n’y avait que peu de trafic et je prenais les virages un peu larges étant un peu pressé, les animaux m’attendaient à la maison. Mais je crois que c’était plutôt mon combi qui attira l’attention des défenseurs de la loi. Car deux de ces représentants s’ennuyaient plus haut au bord de la route en attendant leur client. « Merde, les flics ! » Cette phrase qui traverse le cerveau de chaque honnête citoyen traversa aussi le mien à la vitesse d’un éclair à la vue de ces voleurs de grands chemins. Déjà le plus jeune levait la main et se précipitait de mon côté pour me barrer la route. Je n’avais pas trop le choix et je me dirigeai vers la gauche pour m’arrêter. Le frein à main, plus une vitesse… « Bonjour ! Arrêtez le moteur et sortez du véhicule ! On peut voir vos papiers ? » Voyant que j’étais Allemand, leurs visages s’éclairèrent. « Est-ce que vous avez un titre de séjour ? », me demanda hargneusement le plus âgé. Je fouillai dans mon classeur et leur mis le papier si convoité sous le nez. Visiblement déçus, ils me le rendirent. « Est-ce que vous avez des marchandises ? » Si je ne leur répondais « rien », ils ne me croiraient pas. Alors je répondis : « Eh euh…un sac d’oranges ! » « Ouvrez la malle ! », ordonna le plus ancien. J’hésitais sachant ce qui nous attendait : les oranges, se sentant trop serrées dans la poche, s’étaient évadées, aidées par les multiples virages. A cause de mon hésitation l’instinct du vieux flic s’était éveillé et il s’approcha impatiemment. Et voilà, l’avalanche d’oranges s’échappa par-dessous le hayon ! Les fruits rebondirent légèrement sur le goudron, puis s’étalèrent en éventail sur la chaussée pentue. Le plus jeune flic, sans doute fan de foot eut le bon réflexe et stoppa net la course de deux balles, pendant que je plongeai après les autres afin de les sauver des roues pressantes d’une voiture qui approchait. Enfin j’eu ramassé tous les fruits et les mis à l’abri dans ma chemise transformée en tablier de fortune. Le gendarme le plus âgé avait saisi l’occasion et dirigea le véhicule approchant sur le bas-côté de la route pour une petite causette. Je libérai le jeune des oranges à ses pieds et fus autorisé à quitter les lieux.
*
Quand, aux alentours du village, tout le foin d’Elie fut rentré, il me montra une parcelle presque plate à proximité de l’église. Celle-là se trouvait au-dessus du village, pas loin de notre route, au lieu-dit Bonrepaux. Un nom approprié pour l’endroit où se trouvait le cimetière. « Voici ton foin ! Je te le donne ! Je ne peux pas y rentrer, mon tracteur est trop large. Mais toi avec ta motofaucheuse et le combi, tu y rentreras facilement. « Ne peut-on pas rentrer par l’autre côté, où se trouve ce hangar de fortune avec les machines ? » « Dans le passé c’était possible. Il faut traverser une parcelle qui appartient à la commune. Mais celui-là a fait main basse dessus ! », et il pointa vers une maison devant laquelle deux vieilles gens étaient assises à l’ombre. « Leur fils, celui qui travaille à la papèterie a mis le grappin dessus quand il a été maire du village. Plus personne n’a le droit d’y passer, même à pied ! Il croit pouvoir utiliser mes terres et celles des autres, parce que nous ne pouvons pas y accéder. Mais il s’est trompé ! C’est toi qui vas y faire le foin ! »
Puis nous montâmes en direction de notre ferme. A mi-chemin, après le pont en bois qui enjambait le ruisseau, il pointa sur un autre pré. « Celui-là je te le donne aussi et le pré derrière la haie. Mais la parcelle entre les deux appartient aussi à celui de la papèterie ! » « Il ne va pas me laisser passer non plus ! », répondis-je. « Je crois que si, il n’a rien contre toi. Si j’ai l’occasion je t’aiderai pour presser ou monter le foin. » « Ce sera la moindre des choses », pensai-je, « tu devrais aussi m’aider à faire le foin ! » Je ne comprenais pas bien. Il m’avait promis autant de foin qu’on en aurait fait pour lui. Et maintenant il me donnait que de l’herbe sur pied! Je voulais en savoir plus. « C’est la même chose. Tu n’as qu’à le faire ! Vaillant comme vous êtes, vous l’aurez bientôt fini ! » « Il se croit bien rusé ! » pensai-je.
Heureusement la vieille dame qui habitait au virage du passage étroit fut d’accord pour que j’enlève sa clôture, afin d’y passer avec le combi et la remorque. Elle était vraiment aimable, nous invita à boire une bière, les enfants un sirop et nous raconta ses soucis. Et son souci majeur était justement ce voisin. Elle lui avait fait faire des travaux dans sa maison et depuis elle était comme hantée ! Souvent, autour de minuit, elle entendait des bruits, comme si quelque part un moteur électrique était installé et vrombissait. Elle en avait parlé à ce voisin qui racontait au village que la vieille était folle et voyait des fantômes. Après quatre jours nous en avions fini avec ce foin et le montâmes avec la remorque. Nous le déchargeâmes à notre « station d’aval » et le montâmes vers la maison avec le chariot-treuil. Afin de ne pas avoir à dédouaner la caravane, nous en fîmes cadeau à Peter, « l’écolo de salon » qui, à l’époque, nous avait succédé chez le fermier bio en Allemagne. A l’endroit où s’était trouvé la caravane, nous construisîmes un toit en tôle ondulée, afin d’y stocker le foin avant de le monter.
La maman de Doris et son frère avaient annoncé leur visite. Les enfants étaient tout excités, car grand-mère avait toujours sa voiture bourrée de surprises et de friandises. En dehors des oursons Haribo, surtout des produits bio, introuvables en France. Nous étions en train de faucher le pré derrière le pont du ruisseau, quand nous entendîmes une voiture approcher. Les enfants l’avaient reconnue les premiers et se précipitèrent. Quelle joie de se revoir ! Nous nous assîmes dans l’herbe et échangeâmes sur les derniers évènements en sirotant une bière blanche allemande sortie de la malle insondable de la voiture d’Oma. Puis tous les autres montèrent à la maison, pendant que Reiner, le frère de Doris, m’aidait à faire le foin.
Plus tard Elie monta et pressa les balles. Cela facilitait le transport. Le propriétaire du pré voisin n’avait pas encore commencé le foin au village. On était au mois de juillet, et si nous ne nous dépêchions pas, il ne resterait que de la paille à la place du foin. Car l’herbe, une fois montée en graines, sèche vite et meurt. Le meilleur moment pour faucher est avant la montée en graine. Et bien sûr, quand le temps est favorable ! Je coupai un passage à travers le pré du voisin afin d’arriver dans notre pré. Elie étant horrifié refusa d’y passer avec son tracteur. « Il est capable de me foutre les gendarmes au cul si j’ose passer sur ses terres ! » Alors on porta tout le foin à la fourche au premier pré afin de le presser. Nous mîmes les balles faites avec l’herbe du passage debout et posions un sac en plastique dessus. Ainsi il voyait qu’on n’avait rien pris !
*
Enfin nous pouvions nous occuper des prés de la ferme ! Les fougères que j’avais coupées il y a quelques semaines afin de les utiliser comme litière avaient jauni à cause du soleil et s’émiettaient en ratissant. Alors je pris le briquet et mis le feu aux andains afin que le soleil puisse toucher le sol. Un peu plus et ça aurait tourné à la catastrophe, car le vent se leva et attisa les petites flammes en un brasier, en emportant des particules incandescentes haut dans les airs vers la forêt ! Et je n’avais même pas de pelle pour les éteindre en tapant dessus, seulement ma fourche de misère ! Le vent, une fois lassé de sa danse avec l’air scintillant, laissa ruisseler les braises sur le sol asséché de la forêt, créant de nouveaux foyers. Des fines colonnes bleuâtres perçaient la couche de feuilles de l’année précédente, prêtes à se propager. Je me précipitai de l’une vers l’autre afin de les éteindre avec un mouvement de rotation de mes bottes. Le rayonnement du feu, ma panique d’un feu de forêt, et ma course folle m’amenèrent au bord de l’épuisement. Et soudain le feu s’effondra, les andains étant consumés et le vent ne trouva que des cendres noires qu’il laissa retomber vers le sol, déçu !
Quand je fus assuré qu’aucun foyer caché ne somnolait dans les feuilles, je m’assis à l’ombre d’un bouleau, adossé contre son tronc lisse. L’air sentait la fumée. Et soudain j’aperçus notre vallée sous mes pieds avec une telle clarté ! Je n’en avais connue de semblable auparavant qu’en plongeant sous l’eau ! La forêt s’était parée de sa robe de début d’été, les vertes collines s’alignaient les unes derrière les autres, le ciel bleu englobait tout comme une demi-sphère. Depuis mon point de vue, tout ressemblait à un monde miniature. Et d’en bas, où j’apercevais le toit de notre maison légèrement courbée, des rires d’enfants et des aboiements arrivait jusqu’à moi. Je caressai la terre, laissai glisser ma main sur l’écorce de l’arbre, j’étais heureux ! Je remerciai le ciel et la terre de m’avoir engendré et de m’avoir permis d’être ici ! Et je savais : le travail était le prix qu’ils demandaient en retour. Car dans cet univers tout est un échange permanent : donner et recevoir !
Pour faciliter notre travail nous avions acquis à petits prix, parfois en travaillant, divers outils de fenaison. Le premier étant une faucheuse, entièrement en fonte, normalement tractée par deux bêtes. Mais nous n’en avions qu’une. Le mécanisme de fauche était actionné par les roues crantées. Cette machine faisait un tel poids qu’on avait du mal à la monter en haut de la côte. Il fallut nous atteler avec la jument ! Quand finalement nous fûmes arrivés en haut, la jument s’écroula par terre, couverte de mousse, et nous aussi. Nous nous aperçûmes que jamais nous ne pourrions faucher nos prés avec ! Nous rangeâmes l’engin dans un coin pour ne plus le toucher.
Une autre machine, pareillement actionnée par les roues, était une faneuse. Celle-là déjà, était plus légère ! Son ancien propriétaire l’avait transformée pour l’atteler derrière son tracteur. Nous montâmes deux tubes métalliques à la place du timon pourri et y conduisîmes Calina en reculant. Cela lui plaisait déjà mieux ! A travers le châssis, une sorte de vilebrequin était posé dans des roulements, actionné par la rotation des roues. Celui-ci faisait bouger plusieurs fourches à l’arrière. Celles-ci retournaient le foin en le jetant dans l’air. Les enfants baptisèrent l’engin « pattes de Frodo » parce qu’il travaillait de la même manière que le chien. Celui-ci aimait courir derrière la machine pour happer le foin tourbillonnant dans l’air. Le terrain étant trop en pente, je préférais ne pas monter sur le siège mais plutôt courir à côté et guider le cheval.
Dans un hameau, nous avions découvert un râteau-andaineur. Il mesurait dans les 2 mètres 50 et était équipé sur toute sa largeur de dents en demi-cercle qui, en avançant, glissaient sur le sol et ramassaient le foin en forme de grosses saucisses. Les enfants l’appelèrent la « machine à saucisses de foin ». Quand assez de foin s’était accumulé devant les dents, en appuyant sur un levier celles-ci se levaient en l’air par la rotation des roues, laissant derrière elles une « saucisse » de foin de la hauteur des hanches. Tout l’art consistait à déposer les bouts de « saucisses » de manière à ce qu’elles forment des rangées que nous pouvions charger sur le traîneau. Souvent nous préférions le travail manuel, car par un ratissage intelligent nous arrivions à raccourcir ou à sauter certaines étapes.
Le fauchage se faisait à la motofaucheuse. En altitude l’herbe poussait si clair, qu’elle ne pouvait pas bourrer la barre de coupe. Et au lieu de la retourner, il suffisait de procéder à un ratissage par étapes. A l’aide de deux troncs de frêne légèrement courbés et quelques planches je bricolais un traîneau assez long, muni d'une sorte de large échelle en bois à l’avant et à l’arrière, légèrement inclinée vers l’extérieur. Entre ces deux supports nous posions le foin, et, une fois que c’était plein, nous le serrions et le fixions à l’aide d’une corde. Pour faciliter le chargement, nous le ratissions d’abord en gros tas. Mais notre poulain prenait trop de plaisir à se rouler dans ces tas et à les éparpiller de nouveau. Nous n’avions pas d’autre choix que de l’enfermer momentanément. Notre Calina semblait fière de nous montrer de quoi elle était capable ! Elle se laissait tomber dans son harnais et traînait les charges vers la grange. Grâce à une fourche plus longue nous montions le foin au grenier.
Combien de fois le soir nous pensions « maintenant tout est plein » ! Et le lendemain le foin s’était tassé et nous désespérions presque. Nous nous sentions comme Sisyphe. Eh bien, pas tout à fait. Car nous le faisions volontiers et à un moment donné notre corvée pris fin. Le dernier foin était dedans !
*
Les journées étaient longues. Pas seulement parce qu’on était en été. C’était le travail qui réglait la longueur de la journée. Le coq nous réveillait le matin. Puis nous mangions du muesli avec du lait et du miel de Roger. Puis nous trayions les vaches. Chacun de nous s’était créé son domaine, même si souvent il devait donner un coup de main à l’autre. Le domaine de Doris était grosso modo les enfants, la cuisine, la maison et le jardin. Je m’occupais des travaux de la ferme : soigner les animaux, poser les clôtures, défricher et en même temps faire le bois de chauffage, continuer la rénovation de la maison et plein d’autre choses comme des chantiers à l’extérieur, afin de gagner un peu d’argent, ou aider quelqu’un au village. De ce fait j’étais parfois absent au moins la demi-journée.
Le soir il y avait la traite commune. Très souvent les vaches nous attendaient déjà au lieu de la traite, deux arbres auxquels nous les attachions. Il suffisait de leur poser une corde sur la nuque. Quand elles n’étaient pas là, ça dégénérait parfois en une partie de cache-cache dont souvent le chien sortait vainqueur. Malgré leurs cloches, elles se tenaient silencieuses. Quand c’était possible, je courais avec le chien à la recherche des vaches, répétais fort les ordres, les encerclais, afin qu’il apprenne. Souvent, arrivé près des vaches, celles-ci montaient de quelques mètres pour repartir dans l’autre direction. Mais en montant je ne courais pas bien longtemps. Je m’essoufflais rapidement. Le chien était avantagé à cause de ses quatre jambes ! Mais quand les vaches s’obstinaient il arrivait que nous nous trouvions tous deux côte à côte, allongés dans les fougères, nos respirations sifflant à qui mieux mieux.
Quand les animaux étaient soignés, c’était le tour des enfants. En général nous dînions ensemble avant qu’ils aillent au lit. Doris leur lisait des histoires ou chantait doucement des chansons qui se posaient, avec le ciel étoilé, comme une couverture de paix sur nos terres. Quand elle ne s’était pas endormie avec eux, elle s’asseyait ensuite à côté de moi contre le mur encore tiède de la maison, nos mains se rejoignaient et ensemble nous regardions la silhouette des montagnes encadrées par le ciel scintillant en nous réjouissant de notre journée accomplie. Doucement le murmure du ruisseau montait vers nous, de loin on entendait l’aboiement d’un chien, et un chevreuil bêla en face dans les bois, faisant sursauter le chien. Son poil se hérissa sous ma main et il gronda, à peine audible. Les grillons chantaient. Leur mélodie semblait venir de partout, nous donnant le sentiment d’être vraiment dans le Midi. Le chat se frottait en ronronnant contre nos jambes.
Parfois, les nuits de pleine lune, je marchais vers le versant en face et appuyé contre un arbre je regardais notre ferme planer dans la lumière de la lune. Dans ces moments je me sentais plus qu’heureux, indemnisé des peines de la journée, et j’étais prêt à en supporter d’autres. Le bonheur souvent n’est qu’un état éphémère. Pour le rendre plus durable il faut payer le prix, nommé labeur.
*
Deux fois par semaine une bétaillère avec des étalons remontait la vallée et s’arrêtait si besoin. C’étaient des animaux du haras de l’armée de Tarbes, qui avait une succursale à St. Girons. On pouvait aussi y mettre une jument en pension. Là elle était présentée une fois par jour à un étalon tant qu’elle était en chaleur. Mais ça coûtait assez cher. Quand nous descendîmes en ville, nous visitâmes le haras afin de voir le choix des étalons, connaître les prix et les jours où le camion montait dans notre vallée. L’édifice se trouvait en bordure de la ville. Déjà de loin on sentait l’odeur sucrée du cheval. L’intérieur était constitué d’une grande halle couverte de sciure, dont les ailes étaient équipées de nombreux boxes aux séparations élevées. D’un côté étaient logés les étalons, des animaux magnifiques et fiers, s’ébrouant excités ou hennissant dans des tonalités les plus variées. Un tableau au mur indiquait leur nom, race et dates. De l’autre côté se trouvaient les pensionnaires, les juments à saillir.
Dans la halle se trouvaient différentes barrières en bois, qui avaient l’air d’être solides, presque de la hauteur d’un cheval, dont deux étaient alignées face à face comme un couloir. Un propriétaire amena sa jument. Elle était très excitée. Il la conduisit, sur instructions, dans le couloir en la tenant court. Un employé en uniforme du haras, amena un étalon. Celui-ci sautillait d’excitation, s’ébrouait, et sans doute se réjouissait d’avance en approchant la jument, qui était entre les cloisons, par le côté. Il renifla le derrière de la jument et posa sa tête sur son dos. Plus vite qu’on ne pouvait le voir, la jument avait soulevé son derrière et rué en hennissant de colère. Indigné l’étalon se retira. Alors c’était pour rien ! « Mais attendons la prochaine fois ! », semblait-il penser. Soit la jument était pleine ou pas encore bien en chaleur, ce qui se produisait tous les 21 à 23 jours. Les chaleurs, la période pendant laquelle la jument peut être fertilisée, durent 5 à 7 jours. Avec plus de chances vers la fin de cette période.
La jument fut ramenée dans son box et une autre prit sa place. L’étalon recommença ses avances. Rien ne se passait. Alors le propriétaire guida sa jument devant l’une des barrières simples et se positionna derrière en tenant l’animal court. L’étalon s’approcha, tirant sa longe, son « machin » partiellement sorti. Et puis il cabra sa masse de presque une tonne et la posa sur le dos de la jument, pendant que son énorme pénis tacheté cherchait impatiemment son but. Un autre homme en uniforme s’approcha de côté, saisit la queue de la femelle et aida la flèche à trouver son point de mire. Un taureau est toujours pressé, l’étalon prend son temps. Une fois à l’intérieur il bougeait lentement et bien en rythme, comme s’il voulait atteindre le paroxysme le plus tard possible ! Puis il se relâcha et resta appuyé comme épuisé sur le dos de sa bien-aimée. Puis, doucement il se laissa glisser en arrière, son membre encore tressaillant dégaina en laissant s’échapper un reste de sperme et de glaire pendant que la jument restait immobile, les jambes écartées. Quel spectacle ! Lentement l’étalon suivit l’employé vers son box…
Lundi et jeudi étaient les jours de passage du camion dans notre vallée. Vers 15 heures, en fonction du nombre de saillies que les étalons devraient effectuer. Les étalons correspondants aux besoins des éleveurs se trouvaient dans le camion. Parfois c’était la grande bétaillère, souvent la petite, pouvant contenir deux mâles. Lorsque le véhicule s’arrêtait, ils s’impatientaient et commençaient à taper avec leurs sabots contre les parois renforcées. Quand la rampe descendait et la porte s’ouvrait, ils sortaient en reculant, leur membre déjà sorti en attente de ce qui allait arriver. Ils devaient faire attention à ne pas mettre un pied dessus ! Ici, n’ayant pas de barrières, l’homme du haras devait être très prudent afin de ne pas récolter une ruade si la jument n’était pas en chaleur, ni son étalon un sabot dans le pif. C’était pourquoi il fallait garder la longe longue et le mâle à distance, au moins au départ. Moi aussi, je devais être sacrément prudent, retenant notre jument et l’empêchant d’avancer afin de ne pas gêner l’étalon pour faire son devoir. Au-dessus de moi le cheval se cabrait et ses sabots de la taille d’une assiette s’approchaient tout près. Ça demandait beaucoup de concentration et de force. Mais secrètement je l’enviais, les badauds aussi. Le passage de la bétaillère du haras se transformait parfois en un peep-show en plein air, ici dans les fonds de vallée où la réception de la télé n’était pas possible.
*
Par Inter-rail, Claudia, une fille de Lindau vint nous rendre visite. Elle voulait nous aider pendant 15 jours et voir les Pyrénées. Elle avait deux chevaux à la maison et pouvait nous montrer pas mal de trucs. Ensemble nous regardâmes les pieds de Calina, qui, malgré le travail dans les prés avaient bien poussés et s’étaient fendus au bord. D’abord il fallut nettoyer l’intérieur des sabots avec le cure pied. Il faut faire ceci avant chaque travail ! Avec une massette et une lame bien tranchante nous raccourcîmes les parois en corrigeant légèrement l’angle d’appui du sabot. La sole étant en bon état, nous ne la touchâmes pas. Calina se laissait faire, elle donna même volontiers les postérieurs car nous l’avions exercé maintes fois. Au travail, quand elle mettait un pied à l’extérieur des chaînes de traction, il fallait souvent le libérer. Il suffisait de dire « donne le pied ! » et de le toucher légèrement et elle le levait. Puis, à l’aide du couteau courbé, nous coupâmes la fourchette (l’intérieur du sabot en forme de pointe de flèche) en plusieurs passages. Là, la corne était molle et se laissait enlever facilement. Une odeur de corne flottait dans l’air, me rappelant les visites chez le maréchal-ferrant étant petit. La corne était un peu effrangée, sans doute à cause des cailloux et nous la réduisîmes en plusieurs fois, afin de ne pas arriver trop en profondeur. La couleur de la corne indiquait jusqu’où on pouvait aller. A l’apparition des vaisseaux fins, il fallait arrêter. La jument se laissa faire. De temps en temps, surtout quand nous touchions les sabots postérieurs, les enfants lui tenaient un quignon de pain devant les lèvres de velours. Afin de ne pas abuser de sa patience, nous fîmes le parage en deux fois. Ainsi elle pouvait récupérer entre-temps (et notre dos aussi). En parant la fourchette l’odeur était la plus forte. Il y avait un peu d’humidité, mais le pied était sain. Le poulain devint un peu énervant au bout d’un certain temps et nous poussait afin de téter. Il était évident qu’on devrait le sevrer sous peu, car au plus tard à la Toussaint, à la grande foire aux chevaux, nous voulions le vendre. A la fin nous donnâmes quelques coups de râpe sur la surface du sabot et arrondîmes les bords de la paroi. Quand tout fut fini et que la jument se trouvait sur une surface plane nous fîmes un dernier tour. Les quatre sabots étaient pareils et dans le bon angle !
Pendant son temps libre, notre copine découvrait les différentes vallées en autostop, grimpait sur quelques montagnes avec Doris et les enfants et passait de bons moments. Sauf une fois. Mais j’appris cela plus tard, et pas d’elle. Un chauffeur essaya de la draguer. Quand dans son désespoir elle dit : « Je vais le dire à Wolfi ! », l’autre la laissa tranquille, s’excusa même et la conduisit jusqu’au village. Elle dût lui promettre de ne rien me dire. Je ne l’appris que plus tard par Doris.
Pendant que Claudia était encore là nous en profitâmes tous les quatre et partîmes tôt un matin nous baigner dans la Méditerranée. Les vaches et les chèvres faisaient si peu de lait qu’on pouvait sauter une traite ! Il faisait encore nuit quand nous partîmes. A l’aube nous étions à St. Girons. Les enfants excités n’arrivaient plus à dormir. En passant par Foix et Lavelanet nous arrivâmes à Quillan, d’où la route suivait une rivière verte à travers de gorges sauvages. En face, quasiment que dans des tunnels, se dessinait une ligne de chemin de fer. Ça nous rappelait fort la Perse. Et puis la mer s’étala devant nous, une étendue bleue sans limites, scintillant dans la lumière du soleil ! Les enfants partirent en courant dans l’eau, la faisant gicler. Alors nous les suivîmes. Le contraire absolu de notre vallée verte ! Plus tard, quand il commença à faire chaud, nous érigeâmes avec une couverture et les bâtons de berger qui se trouvaient toujours dans la voiture, un abri pour nous protéger du soleil. Je fus le premier à m’endormir. La farniente était plus fatigante que le travail ! Le cœur lourd, nous reprîmes la route tard l’après-midi avec la résolution de revenir bientôt. Mais c’était une résolution difficile à tenir…
Plus nous approchions de la ferme, plus les soucis prenaient le dessus. Pourvu que les animaux ne se soient pas échappés ! Quand nous montâmes la pente, il faisait déjà sombre. Nous ne les voyions pas, ni ne les entendions. Arrivés devant la maison nous les entendîmes dans l’étable. J’éclairai avec la torche. Mais qu’est-ce qui se passait ? Vaches et chèvres se promenaient dans tous les sens, une vache avait une botte de foin accrochée aux cornes, le sac de blé des poules était déchiré, le grain éparpillé… Quelques chèvres grimpaient sur les balles de foin empilées au fond de l’étable, s’en servant avec gourmandise. Puis Claudia, nous ayant entendu arriver, se joignit à nous. « Elles se trouvaient toutes devant la clôture et me regardaient avec leurs yeux suppliants. Alors je les ai fait rentrer ! », expliqua-t-elle. « C’est bien ! Mais tu aurais dû attacher les vaches et enfermer les chèvres dans leur enclos ! Quand tous sont enfermés ensemble ils peuvent se blesser facilement. Par chance elles étaient trop occupées de finir tout qui était comestible ! »
*
C’était semble-t-il « les portes ouvertes » chez nous. L’un des « occupants » de notre ancienne maison en Allemagne se pointa de façon inattendue. Il était en route pour le Maroc et voulait nous faire plaisir en nous rendant visite. Et aussi pour nous aider. « Bon sang, un marginal de la ville ! » pensai-je. « Qu’est-ce qu’on pourrait lui faire faire ? ». Bien, un peu de jardinage ne pouvait pas le tuer, surtout ayant quitté le lit très tard. Mais à l’extérieur il faisait chaud ! Alors qu’il sorte un peu de fumier. Là au moins il sera à l’ombre ! Mais non, après le stress de la ville il avait besoin de se remettre un peu… Car, en ville, ils y étaient tous revenus après avoir été mis à la porte définitivement avant la démolition de la maison, prévue de longue date. En ville la survie était plus facile qu’à la campagne ! Les rares fois où ils se levaient tôt, c’était quand ils partaient « prélever » devant chez Aldi ou d’autres magasins ce dont ils avaient besoin pour vivre. Dans ce cas, ça valait la peine de mettre le réveil, ou mieux encore d’y faire un saut après une nuit blanche ! « Là on trouve des choses meilleures que les légumes sales de votre jardin ! » Doris et moi étions d’accord : il fallait qu’il foute le camp ! Mais il avait d’autres idées dans la tête et commença à calculer : « Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? », voulu-t-il savoir. « Bientôt six mois ! », répondis-je. « humm…, ça fait environ vingt semaines. J’ai travaillé ici depuis une semaine. Alors j’ai droit à un vingtième de votre ferme ! Je suis devenu en quelque sorte copropriétaire ! » Nous en avions assez : « On t’avait dit que tu pouvais rester une semaine. Elle est finie. Maintenant ouste, prends la porte ! » En Allemagne il était squatteur, et maintenant il prétendait être propriétaire !
*
Où que nous allions, nous avions toujours un bâton avec nous. Les plus beaux étaient ceux des enfants, ornés d’anneaux ou de serpents gravés dans l’écorce. Les nôtres, surtout le mien, étant des bâtons de travail, étaient exposés à une certaine usure. Les tiges de noisetier s’y prêtaient bien à cause de leur croissance droite, mais aussi les frênes. Opinel et bâton sont l’équipement de base d’un berger. A ça s’ajoutait le « Caporal », ce tabac puant et émietté et les feuilles sans gomme. Je ne comprenais jamais pourquoi tant de « néos », comme on nous appelait, fumaient ce tabac. Déjà à cause de son nom ! Même pour faire un joint ce tabac était trop âpre ! Pourquoi empester cet air frais qui nous entoure ? Était-ce parce que la plupart entre nous avaient des poumons de citadins et avaient besoin de leur dose de pollution quotidienne ? Ou était-ce pour ressembler aux autochtones ? D’accord, moi aussi je fumais parfois. Ça pouvait être quelque chose de très convivial ! Surtout dans un bar, car en fumant soi-même on trouvait l’air environnant moins vicié. Le bâton était utile quand on marchait sur les pentes fortes. Aussi dit-on « le bâton est la prolongation du bras du berger ». Parfois il était le bras téléguidé, en le jetant loin pour faire tourner une bête. Et plus d’un se cassait quand les animaux suscitaient la colère du paysan… Les occasions ne manquaient pas! Un coup de pied inattendu contre le tibia, un coup contre le seau à moitié plein de lait, qui le faisait partir à travers la petite étable. Ou une vache qui posait son pied dans le seau et refusait de le ressortir ! Le plus courant était une caresse au visage avec la queue dégoulinante de purin. Mais on pouvait l’attacher à une jambe. Brigitte Bardot, si elle était passée à certains moments, aurait fait enlever nos animaux pour les mettre dans une ménagerie avec ses bébés phoques !
Petit à petit nous nous rendions compte qu’on pouvait « dresser » les animaux de deux manières : avec « carotte et bâton », une friandise (céréales, son, sel) ou le bâton. En plus il y avait la voix. Selon le timbre de la voix, un animal ressent la situation ! Les animaux doivent te reconnaître comme chef de troupeau. Ils doivent te respecter mais ne pas avoir peur de toi ! Un animal apeuré peut vite devenir dangereux, car il se comporte différemment de d’habitude. Quand ils ont du respect, un appel suffit souvent pour qu'ils arrêtent les provocations. Dans peu de cas il faut les « corriger », comme on dit ici, par un coup de bâton. Il faut aussi être ponctuel. Car un animal a son rythme : parfois il mange, d’autre fois il rumine. Par l’heure de la traite ou de l’alimentation on peut influencer ce rythme, mais ensuite on doit le garder. Il nous restait beaucoup plus à apprendre qu’aux vaches !