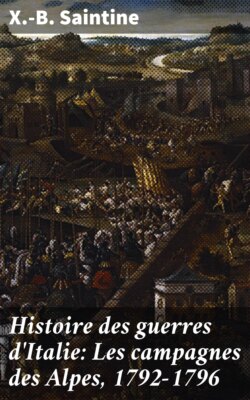Читать книгу Histoire des guerres d'Italie: Les campagnes des Alpes, 1792-1796 - X.-B. Saintine - Страница 4
INTRODUCTION.
ОглавлениеAVANT d’entreprendre le récit de ces glorieuses campagnes d’Italie dont les résultats furent si importans pour les destinées des peuples et des rois, il nous paraît indispensable de remonter jusqu’aux événemens qui secouèrent avec tant de violence le monde civilisé et qui ouvrirent la route à la France conquérante. Pour suivre plus facilement le plan que nous nous sommes tracé, nous nous proposons de faire succéder dans cette Introduction, au tableau général de nos luttes intestines et étrangères, un précis rapide des premières opérations militaires des armées des Alpes et d’Italie, jusqu’au moment où toutes deux, réunies sous un chef, cessèrent d’être inaperçues au milieu des autres armées, leurs rivales de gloire, et commencèrent enfin cette carrière de succès étonnans qui devaient faire pousser à l’Europe entière un long cri de terreur et d’admiration.
Ami sincère d’une liberté légale, mais étranger à tout esprit d’intrigue et de parti, à défaut des talens et de cet instinct sublime du grand historien qui embrasse d’un coup-d’œil de nombreux événemens pour en saisir les causes et les conséquences, nous apportons ici notre bonne foi. Si quelques assertions, si quelques faits méritent d’être démentis, nous aurons été abusé, sans chercher nous-même à abuser. Trop jeune pour avoir pu figurer comme acteur, ou même comme témoin, dans ces grandes querelles, nous n’y sommes intéressé que par notre titre de Français et par l’amour que nous portons à notre pays. Si les forces nous manquent pour accomplir la tache que nous avons entreprise, nous sommes fier du moins d’offrir comme garantie de notre impartialité, au milieu de cette époque de calcul et de corruption, une conscience qui ne s’est jamais vendue et qui n’est point à vendre.
1791.
Mirabeau venait de mourir, et sa mort, qui, selon l’expression d’un de nos jeunes écrivains, fut le dernier malheur du trône ébranlé par lui, sembla tout-à-coup enlever cette digue puissante qui séparait encore les deux factions opposées, leur permettre de s’envisager enfin de près et d’en venir aux mains. Il faut entendre ici par factions le parti de la cour aussi bien que le parti populaire, puisque tous deux voulaient l’anéantissement de la constitution.
Quoi qu’on ait dit de ce grand orateur et des vices qui dégradaient son caractère, Mirabeau était l’ame de la monarchie constitutionnelle, dont La Fayette était le bras droit. On n’a point une telle puissance de talens sans idées fixes, et, malgré ses fluctuations apparentes, son génie et sa raison ne tardaient jamais à rectifier les écarts où l’entraînait la passion. Cet Automédon du char révolutionnaire en pouvait seul retenir les coursiers fougueux; il tomba, et malheureusement ce fut dans le moment où l’Assemblée constituante, qui donna de si grandes preuves de sagesse et de modération, était près de se dissoudre.
Cependant, à l’intérieur, le parti royaliste s’appauvrissait par l’émigration; il semblait que la France, dans sa fermentation démocratique, cherchât à rejeter de son sein tout ce qui paraissait contraire à ses nouveaux principes. Bientôt le Roi lui-même, redoutant également pour son pouvoir les factions qui s’agitaient dans Paris et l’asile qu’on lui offrait chez l’étranger, résolut de se rendre à Montmédy, où le général de Bouillé, qui commandait les départemens de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle et de la Marne, lui promettait l’appui de son armée pour s’affranchir tout à la fois de la tutelle de l’Assemblée et de celle de la coalition. Si ce projet se fût effectué, peut-être la France était-elle perdue à jamais pour les Bourbons. Le code de nos lois nouvelles n’eût point été entaché d’un sang royal, et ce fut ce sang versé qui mit dans le berceau de la république le germe de sa destruction. Les Tarquins chassés de Rome n’y revinrent jamais; César assassiné eut un héritier dans son fils adoptif, Octave. En Angleterre, Charles II succéda à Charles Ier mort sur l’échafaud. Jacques II, en traversant le détroit, y engloutit la royauté des Stuarts.
A la nouvelle du départ de Louis XVI, le peuple sembla d’abord frappé de stupeur? la contenance ferme de l’Assemblée le rassura. Les républicains se montrèrent ouvertement pour la première fois, et se plurent à répéter cette phrase de la proclamation aux Français: L’ordre peut exister partout où il existe un centre d’unité.
Arrêté à Varennes, l’infortuné monarque, de retour dans sa capitale, y trouva un nouveau parti, moins fort encore, mais plus violent que les autres: citait celui qui voulait se passer de lui. L’Assemblée constituante usa de ménagemens, supposa aux agitateurs qui demandaient la déchéance du Roi, et pour quelque temps Louis sembla rentrer dans ses droits.
Mais l’émigration, qui croissait de plus en plus, le laissait dans un fatal isolement. Les officiers désertaient les armées et couraient hâter les préparatifs de guerre qui s’organisaient sur les frontières. Nul d’entre eux ne sut comprendre qu’ils aidaient aux projets des novateurs en se condamnant eux-mêmes à une proscription volontaire. C’était à Paris et non à Coblentz qu’il fallait se rassembler; ils voulaient servir le Roi, et ils l’abandonnaient; ils voulaient combattre, et ils s’éloignaient du champ de bataille. La présence des princes français était sufifsante pour intéresser à leur cause les cours étrangères. Était-ce de Bruxelles qu’ils espéraient contenir les émeutes populaires dirigées contre les Tuileries? S’ils tenaient plus à la conservation de la monarchie qu’à celle du monarque, leur conduite a été conséquente.
Pour la seconde fois, l’Autriche et la Prusse, excitées par la Russie, se liguèrent contre la France. Le roi de Sardaigne, Victor-Amédée, troisième du nom, prince d’une humeur chevaleresque et dont l’ardeur belliqueuse n’avait pu éclater encore qu’en projets et en préparatifs, était jaloux d’essayer sa magnifique armée, jusqu’alors objet de luxe et de vanité pour lui, mais qu’il ne pouvait entretenir qu’aux dépens des trésors amassés par la prudente économie de ses pères. Il était temps qu’elle lui rapportât en puissance et en gloire le prix. des richesses et des soins qu’il lui avait prodigués. Il pensait qu’à son exemple, l’Italie entière allait se lever; mais alarmée de l’attitude guerrière de l’Autriche, de l’ambition naissante d’Amédée, la sage Venise, craignant d’appauvrir sa marine et ses trésors pour favoriser les desseins d’ennemis futurs, restait immobile dans sa neutralité. Gênes l’imitait pour ne point perdre les avantages qu’elle retirait d e son commerce avec la France. Les mêmes raisons et l’amour qu’il portait à son peuple, enchaînaient le grand-duc de Toscane. Le roi de Naples, malgré les liens sacrés qui Punissaient à la famille royale de France, craignant qu’une escadre, sortie du port de Toulon, ne vînt le foudroyer dans sa capitale, attendait un signal de l’Angleterre pour se déclarer. Le Pape lui-même, séduit par les caresses et les protestations des fiers législateurs de la France, qui l’assuraient de leur fidélité aux doctrines de l’Église, et désirant mettre le trône de saint Pierre à l’abri des révolutions politiques, songeait à cimenter un pacte entre la religion et les idées nouvelles, pour en paralyser d’avance les effets, par rapport aux dogmes et au culte. Cette même année 1791, Spedalieri publia, dans la ville d’Assises, un traité des droits de l’homme. Il partait de ce principe que les sociétés ne s’étaient formées que par des conventions libres et purement humaines; Dieu n’était intervenu dans l’organisation sociale que comme premier moteur de toutes choses, comme principe général, et non comme agent immédiat; il n’y reconnaissait la royauté que comme une magistrature créée par le peuple, et dont le peuple peut priver celui qui n’en remplit point les devoirs. Il concluait, enfin, en déclarant que la religion chrétienne, protectrice des nations, terreur des tyrans, était la sauve-garde des droits de l’homme et la source de toute liberté. Bien que la publication de cet ouvrage, à une telle époque et dans de telles circonstances, ne fût sans doute point due à une inspiration généreuse, la cour de Rome l’accueillit avec une grande faveur, et son auteur fut nommé par Pie VI bénéficier de Saint-Pierre.
Privé de ses alliés naturels, ne se sentant plus d’appuis autour de lui, ému des plaintes de ses sujets, qui redoutaient les suites de la guerre, et appréhendant à son tour de n’agir que dans les intérêts de l’Autriche, Victor-Amédée, sans songer à rompre ses engagemens envers les souverains du Nord, sentit sa fougue se ralentir. Il augmenta encore ses troupes, fit de nouvelles promotions dans son armée, passa des revues, invoqua le souvenir du grand Frédéric, de la gloire duquel il était idolâtre, et que tous les rois alors prenaient pour modèle; mais ses forces restèrent stationnaires, et ses menaces seules franchirent les Alpes.
Les mouvemens hostiles de l’Autriche et de la Prusse, les préparatifs d’autres puissances durent fixer alors plus fortement l’attention de la France; mais ils l’irritèrent sans l’intimider; et cent mille hommes, tirés de la garde nationale, se disposèrent à marcher au devant de l’ennemi.
Alors aussi l’Assemblée constituante touchait au terme de ses travaux, et nul de ses membres ne pouvait être réélu aux nouvelles élections; elle-même en avait ordonné ainsi. L’Assemblée législative, qui lui succéda, ne tarda pas à mettre, dans ses rapports avec le Roi, plus d’aigreur et de méfiance et tout présagea encore un nouvel ordre de choses.
1792.
Déjà les princes français avaient fait répandre avec profusion dans le royaume une protestation violente contre l’acceptation de la constitution par Louis XVI. Les émigrés s’organisaient militairement à Bruxelles, à Worms, à Coblentz; la Russie, l’Espagne, la Hollande, la Sardaigne, s’engageaient à seconder la coalition, que devait commander le roi de Suède, Gustave III; mais la mort de Gustave, et des changemens de ministres ou d’intérêts, en détachèrent bientôt la Russie, la Suède et l’Espagne. L’Angleterre, renfermée dans sa neutralité hostile, observait de loin tous ces mouvemens de l’Europe, souriait à l’espérance de voir notre révolution devenir honteuse et sanglante, et entretenait elle-même nos passions et nos excès pour se venger du rôle actif que nous avions joué lors de l’affranchissement des États-Unis.
Dans ces circonstances impérieuses, l’Assemblée sentit la nécessité de prendre des mesures promptes et décisives; elle envoya vers le Roi une Réputation pour qu’il engageât les émigrés à renoncer à leurs entreprises criminelles contre la patrie, et les princes allemands à se rappeler les traités qui existaient entre eux et la France. M. de Vaublanc, orateur de la députation, termina ainsi son discours: «Dites-leur, enfin, que si les princes d’Allemagne continuent de favoriser des préparatifs dirigés contre les Français, les Français porteront chez eux, non pas le fer et la flamme, mais la liberté !»
Le Roi fit auprès des puissances étrangères les démarches exigées; bien plus, il proposa lui-même de commencer les hostilités, si ses justes demandes n’amenaient point les résultats qu’il en attendait. Narbonne, nouveau ministre de la guerre, auquel devait avant peu succéder Dumouriez, se rendit aux frontières pour les inspecter. Trois armées se formèrent sur-le-champ et furent confiées à la valeur et au patriotisme de Rochambeau, de Luckner et de La Fayette.
Un ultimatum présenté par l’Autriche étant repoussé avec indignation, la France prit l’initiative. Le maréchal de Rochambeau, placé à la tête des troupes rassemblées en Flandre, intima l’ordre au général Biron, qui commandait sous lui, de s’emparer de Quiévrain. Le 28 avril, Biron s’en rendit maître. Ce fut là , en Belgique, le premier fait d’armes de cette guerre qui devait se terminer à Waterloo.....
Le lendemain, nouveaux succès aux approches de Mons; mais, lorsque tout était tranquille dans l’armée, au milieu d’une nuit profonde, le camp retentit soudain de ces cris: Nous sommes trahis! sauve qui peut! Deux régimens de cavalerie se mutinent et veulent entraîner leur général avec eux. Le désordre gagne de rang en rang; les Autrichiens paraissent, et la déroute devient complète. A Marquain, même terreur panique de la part des soldats, qui fuient jusqu’à Lille, et ne s’arrêtent tout-à-coup que pour massacrer leurs généraux. Les aristocrates furent accusés d’avoir, dans l’intérêt de l’émigration, excité les troupes contre leurs chefs patriciens. Quoi qu’il en soit, le maréchal Luckner, qui, dans le même temps, commandait un corps d’armée dans la Basse-Alsace, ranima quelque peu, par la prise facile de Porentrui, l’esprit public qu’avait découragé la malheureuse expédition en Belgique.
A la première nouvelle de nos échecs, l’Assemblée nationale se déclara en permanence; et, craignant que les prêtres réfractaires, qui s’agitaient déjà dans plusieurs départemens, ne favorisassent les succès de la coalition par des révoltes à l’intérieur, elle les foudroya par un décret d’exil. D’antres mesures restaient à prendre pour supposer à une invasion, qui cependant n’était pas encore à redouter, grâce au tâtonnement et à la lenteur inconcevables de l’Autriche. La formation d’une armée de réserve tirée des départemens fut votée; vingt mille hommes de ces nouvelles levées devaient camper sous Paris.
Les constitutionnels élevèrent la voix contre la proscription des prêtres et contre la formation d’un camp qui menaçait l’indépendance de l’Assemblée et la sûreté du trône. On ne tint pas compte de leurs justes réclamations, et bientôt des compagnies d’artisans, armées de piques, prenant rang dans la garde nationale, tout fit présager que, les démocrates triomphant, le bon droit allait faire place à la force.
Dumouriez intriguait; le ministère fut dissous de nouveau; la révolution devenait de plus en plus menaçante; La Fayette, Lameth et Barnave essayaient en vain de calmer l’exaltation des clubs et de raffermir l’autorité du Roi. Ce prince comprit sa position, et, par son ordre, Mallet-Dupan, chargé d’un message secret, se rendit auprès des coalisés.
Si l’on en croit de nombreux rapports, qui presque tous sont empreints d’un caractère de franchise et de conviction, une faction désorganisatrice, étrangère à toutes les autres, avait alors son centre et ses moyens d’action à Paris. Son but était d’ensanglanter la régénération politique de la France, et de flétrir les patriotes en écrasant les royalistes. Cette faction... Marat la servait de sa plume et l’Angleterre de son or .
Enfin le 20 juin arrive: une foule effrénée, descendue des faubourgs, envahit la salle où siègent les législateurs de la nation, et, après les avoir contraints de répondre à son insolente pétition, se dirige en tumulte vers le château des Tuileries. Louis XVI ordonna que les portes lui fussent ouvertes, et, par sa tranquille fermeté, imposa aux factieux, qui se retirèrent satisfaits d’avoir vu le Roi, coiffé du bonnet rouge, boire avec eux et leur verser à boire. Le but des meneurs était atteint: la populace avait fraternisé avec la royauté ; le trône était avili.
Cependant cette journée excita une indignation universelle dans tous les cœurs honnêtes. La garde nationale voulut se réunir autour du Roi pour le défendre; le duc de la Rochefoucault-Liancourt lui proposa de l’emmener à Rouen, où il commandait, et répondit du dévouement de ses soldats. Outré de fureur contre le parti tout-puissant alors, et l’ame trop haute pour calculer le danger, La Fayette quitte son armée après avoir vu fuir devant lui les Autrichiens à Glisuelle, se présente seul à la barre de l’Assemblée, et, au nom de ses troupes et de la France constitutionnelle, demande le châtiment des fauteurs du 20 juin et l’anéantissement de la faction des jacobins. Il s’adresse ensuite à la garde nationale, qui jure de le seconder. Les clubs s’épouvantèrent devant son audace et sa popularité. Peut-être en était-ce fait d’eux; mais la cour elle-même refusa un appui qui devait l’entraîner dans une nouvelle alliance avec les partisans de la liberté. La même raison, de fausses idées de dignité et le ressentiment que gardait la cour contre les grands qui accueillirent avec faveur les idées de réforme, avaient déjà fait dédaigner les offres du duc de Liancourt. Le Roi, dominé par ses alentours, ne voyait plus de salut pour lui que dans les secours qu’il attendait de l’Autriche et de la Prusse. La Fayette rejoignit son armée après s’être déconsidéré auprès du parti populaire par des démarches infructueuses.
Bientôt, au sein de l’Assemblée nationale, Vergniaud et Brissot accusent Louis XVI de s’opposer de tous ses efforts à l’élan du peuple contre la coalition; de favoriser cette dernière par sa conduite artificieuse et par sa résistance calculée aux volontés générales. Brissot ajoute:
«On vous dit de craindre les rois de Hongrie
» et de Prusse, et moi je dis que la force
» principale de ces rois est à la cour, et que
» c’est là qu’il faut les vaincre d’abord. On
» vous dit de frapper sur des prêtres réfractaires
» partout le royaume; et moi je dis
» que frapper sur la cour des Tuileries, c’est
» frapper ces prêtres d’un seul coup. On vous
» dit de poursuivre tous les intrigans, tous
» les factieux, tous les conspirateurs; et moi
» je dis que tous disparaissent si vous frappez
» sur le cabinet des Tuileries; car ce cabinet
» est le point où tous les fils aboutissent, où
» se trament toutes les manœuvres, d’où partent
» toutes les impulsions! la nation est le
» jouet de ce cabinet. Voilà le secret de notre
» position, voilà la source du mal, voilà où il
» faut porter le remède.»
Ces terribles questions de culpabilité et de déchéance sont commentées par la multitude, et la poussent au dernier degré d’exaltation. Dans le même temps, un autre mouvement se manifeste parmi le peuple. Le roi de Prusse est à Coblentz; des compagnies de volontaires s’organisent de tous côtés, vont grossir le camp de Soissons; le canon d’alarme se fait entendre, et le président de l’Assemblée législative a solennellement prononcé ces mots: Citoyens, la patrie est en danger.
Si l’agitation croissait à Paris, où venaient d’affluer les fédérés de la Bretagne et de la Provence, les départemens du Midi étaient loin de l’état de calme et de tranquillité. A Pertuis et à Marseille, des projets de réaction avaient eu lieu, et le peuple s’en était vengé par des massacres. Le roi de Sardaigne garnissait de troupes les frontières du Piémont; les nombreux émigrés qui résidaient dans le comté de Nice se rendaient secrètement à Lyon pour aider au mouvement contre-révolutionnaire. Les patriotes exigèrent que l’on prit des mesures pour protéger la liberté menacée; mais une partie des autorités départementales était gagnée; ils n’obtinrent que des réponses évasives, et de nouveaux excès eurent lieu. Enfin, une ligue entre les départemens méridionaux se forma; elle établit son centre à Toulon, se promit des secours mutuels et jura de ne se dissoudre que lorsque la patrie serait triomphante de ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur.
C’est ainsi que les factions s’arrogeaient peu à peu le pouvoir, et se partageaient d’avance les débris du sceptre qui allait échapper à la main de Louis XVI. La cour, toujours dans l’indécision, toujours dans les demi-mesures, ne savait ni protéger ses partisans, ni désarmer ses ennemis, et plaçait toutes ses espérances dans l’intervention étrangère, qui devait mettre le comble à ses malheurs.
Vers la fin de juillet, la coalition s’ébranla pour envahir la France. Le prince de Hohenlohe, à la tête des Hessois et d’un corps nombreux d’émigrés, menaça Metz et Thionville, tandis que le général Clairfait, s’avançant sur Sedan et Mézières, espérait écraser l’armée de La Fayette, qui protégeait ces deux places, et marcher sur Paris en traversant Reims et Soissons. Chef des confédérés, ayant à soutenir la réputation de premier général de l’Europe, le duc régnant de Brunswick, à la tête de soixante-dix mille Prussiens, appuyé sur ses flancs par Hohenlohe et Clairfait, s’approchait de Longwy, après avoir franchi le Rhin à Coblentz, et longé la rive gauche de la Moselle. Il s’était fait précéder par cet impolitique manifeste qui menaçait du fer et de la flamme quiconque oserait se défendre. L’indignation générale en fit justice; mais cependant la municipalité provisoire, composée des plus fougueux jacobins, et qui voulait usurper tous les pouvoirs du corps législatif, résolut de combattre la terreur que ce manifeste pouvait faire naître, par une terreur encore plus grande. Le lion fut démuselé, la multitude s’empara violemment de la puissance, la catastrophe du 10 août arriva, et le Roi, déclaré déchu du trône, eut le Temple pour prison.
En vain l’Assemblée, après avoir donné au monarque un asile dans son sein, chercha à calmer la fureur de ces hordes d’assassins; envahie, menacée, elle courait elle-même les plus grands dangers. La terrible commune ordonnait, il fallut se soumettre. Le ministère fut destitué, une nouvelle Assemblée nationale, sous le nom de Convention, fut projetée, et des commissaires, munis de pleins pouvoirs, députés vers les armées, s’assurèrent de leur fidélité. La Fayette seul refusa de les reconnaître: oubliant peut-être trop alors la situation critique où se trouvait la France, et ne se souvenant que de ses sermens au Roi et à la constitution, il s’insurgea, jura de rétablir la puissance du trône et de l’Assemblée, sans songer qu’il allait sans doute, par la guerre civile, livrer la France aux fureurs de l’étranger. Éclairé bientôt sur sa véritable position, et se séparant de son armée, il résolut d’aller retrouver la liberté dans les champs américains, où il avait combattu près de Washington. Contre le droit des gens et de la guerre, les Autrichiens le firent prisonnier et le jetèrent dans un cachot. Dumouriez le remplaça.
Pendant ce temps, Custine, envoyé par Biron pour défendre l’approche de Landau, malgré le désordre inévitable qui régnait dans son armée et le mauvais état de la place, tint vigoureusement tête au prince de Hohenlohe, tandis que Luckner mit en déroute vingt-deux mille Autrichiens à Fontoy. Hohenlohe rejoignit par les frontières de la Lorraine le duc de Brunswick, qui, débordant en Champagne, venait de forcer Longwy de capituler après trois jours de siége.
A l’audition de ces nouvelles, la commune redouble ses fureurs pour redoubler ses forces. On désarme, on arrête les habitans suspects; les barrières de Paris sont fermées, les prisons se remplissent de personnes soupçonnées de dévouement à la cour ou à la constitution. L’Assemblée législative n’existait plus que pour sentir son impuissance. Dans ses faibles efforts pour ressaisir l’autorité, on voyait qu’incapable elle-même de donner à la France ce grand mouvement d’exaltation populaire qui seul pouvait la préserver des suites de l’invasion étrangère, elle craignait de compromettre le salut de la patrie en arrêtant l’impulsion formidable donnée au peuple par les démagogues.
Verdun venait d’ouvrir ses portes aux Prussiens. La consternation était dans Paris; mais Danton avait déclaré que le seul moyen de ranimer l’esprit public était de faire peur aux royalistes, et les massacres de septembre commencèrent. Il n’y avait plus de grâce à espérer de l’ennemi; il fallut vaincre ou mourir. Tous les vrais patriotes, fuyant l’anarchie et l’échafaud, coururent sous l’étendard national chercher du moins un trépas honorable. Dumouriez organisa à la hâte ces légions inexpérimentées, mais brûlantes d’enthousiasme, et Kellermann sauva la France à Valmy.
L’ennemi, qui s’attendait à n’éprouver aucune résistance, manquant de vivres et de munitions, se découragea tout-à-coup: des négociations s’entamèrent; la coalition n’exigeait plus que le rétablissement de ce trône constitutionnel dont ses menaces imprudentes avaient causé ou du moins hâté la chute. Mais la république venait d’être décrétée, le succès de Valmy avait centuplé les forces de nos armées, un cri général de vive la nation! retentissait dans toute la France. Les Prussiens opérèrent leur retraite à travers les Ardennes et le pays de Luxembourg; et, vers la fin d’octobre, ils étaient de retour à Coblentz.
Tandis que Kellermann s’illustrait par le combat de Valmy, important surtout par ses conséquences, la ville de Lille, après avoir soutenu pendant sept jours, avec une constance héroïque, un bombardement d’extermination, contraignait le duc de Saxe-Teschen à lever le siège. Custine avait repris l’offensive sur le Rhin, s’emparait de Trêves, de Spire, de Worms, de Mayence, et menaçait Francfort, coupable seulement d’avoir offert un asile hospitalier à l’émigration française. A Thionville, le brave commandant Wimpfen, n’opposant que l’ironie aux séductions du général autrichien, qui voulait le gagner par l’offre d’un million, répondait: «J’accepte, pourvu que Pacte » de donation soit passé par-devant notaire.»
Alors aussi débutait dans la carrière de la gloire cette armée du Midi, qui bientôt portera le nom d’armée d’Italie. Ses premières opérations semblaient présager ses destins futurs. Le roi de Sardaigne faisait toujours partie de la coalition; mais, par sa position centrale entre les possessions de la France et celles de l’Autriche, il redoutait également l’influence de l’une et de l’autre. Pressé entre ces deux colosses, chacun de leurs mouvemens le faisait trembler pour son existence; c’est pourquoi, malgré des intérêts de famille, ses promesses, son ardeur belliqueuse, la chance apparente du succès et l’extension territoriale qui, dit-on, lui était garantie aux dépens de la Provence, pour ses frais de guerre, il agissait avec lenteur, croyant agir avec mesure, se contentait d’armer ses frontières, et sans doute attendait l’événement pour se déclarer.
Tout-à-coup, le 16 du mois de septembre, le général Montesquiou, envoyé dans le Midi à la tête d’une faible armée, simple corps d’observation pour les Alpes et les Pyrénées, entre en Savoie, se porte vers l’Isère sur le fort Barraux, ordonne au général Anselme, alors commandant une division dans le département du Var, d’envahir le comté de Nice, tandis que l’amiral Truguet, avec une flotte de neuf vaisseaux de guerre, croisait dans les parages d’Antibes et de Monaco.
Les Piémontais exécutèrent d’abord de grands préparatifs de défense; mais ces corps brillans, si savamment exercés à la manœuvre par Amédée, n’avaient encore nulle expérience de la guerre; à la vue de nos soldats, ils prirent honteusement la fuite. Délivrées de leurs défenseurs, de toutes parts les députations des villes, parées de la cocarde aux trois couleurs, vinrent réclamer l’assistance protectrice du général, à qui quelques semaines suffirent pour se rendre maître de Chambéry et de toute la Savoie. La marche des Français fut un triomphe; le peuple, déjà séduit par des idées d’indépendance, y reçut Montesquiou comme un libérateur.
Ce fut ainsi que commença à s’effectuer cette terrible menace faite aux souverains de les vaincre, non par le fer et la flamme, mais par la liberté. La Savoie fut alors réunie à la France, sous la dénomination de département du Mont-Blanc.
Le général Anselme avait rivalisé d’audace et de célérité avec Montesquiou. Sans vivres et presque sans munitions, n’ayant sous ses ordres que huit mille hommes, presque tous volontaires ou gardes nationaux, deux escadrons de dragons pour toute cavalerie, il osa s’enfoncer dans le comté de Nice, défendu par vingt mille soldats, dont la moitié était de troupes réglées. Appelant la ruse au secours de sa faiblesse numérique, partout sur son passage il donna des ordres pour la nourriture et le logement de quarante mille hommes. De son côté, l’amiral Truguet, manœuvrant avec son escadre dans le golfe de Gênes, inquiétait l’ennemi sur ses derrières et portait l’épouvante dans la ville de Nice. Troublée, surprise à son tour d’une invasion qu’elle eût dû prévenir, la cour de Turin résolut de changer sa ligne de défense et de transporter son armée sur le revers des Alpes maritimes. Anselme, averti de ce mouvement de retraite, passe le Var à la tête d’une partie de ses troupes et s’empare sans peine de Nice, où quelques émigrés français osèrent seuls tenter une honorable résistance.
Bientôt les forts de Montalban et de Villefranche tombent en son pouvoir avec la même facilité, et le comté de Nice devient le département français des Alpes maritimes.
Les Piémontais, toujours poursuivis par leurs vainqueurs, s’étaient enfin retranchés à Saorgio, village situé à quelques lieues de Monaco; là ils résistèrent aux attaques d’Anselme, qui, craignant de compromettre ses succès antérieurs pour la conquête d’une position sans importance, donna ordre au général Brunet d’occuper Sospello avec deux mille hommes. Brunet y fit son entrée le 3 novembre et résolut d’y prendre ses quartiers d’hiver; mais Anselme, ne laissant pas se refroidir l’ardeur de ses troupes, conçut le projet de s’emparer d’Oneille, petite ville située sur les bords de la Méditerranée, à treize lieues de Nice, et qui vit naître André Doria. Jugeant que, par sa situation à la hauteur de Saorgio, elle n’était facilement attaquable que par mer, il fit embarquer ses troupes sur les vaisseaux de Truguet, et chargea cet amiral d’y opérer un débarquement. Le 23 novembre, l’escadre se présenta devant la ville; un canot parlementaire s’en détacha pour sommer les habitans de faire leur soumission et d’éviter les horreurs d’un bombardement. Rassemblés sur le rivage, ceux-ci laissèrent paisiblement s’approcher la députation; mais, lorsqu’elle allait mettre pied à terre, soudain accueillie par une décharge de mousqueterie à bout portant, elle s’enfuit à force de rames vers l’escadre en criant vengeance, et déplorant la perte de trois officiers et de quatre matelots.
Truguet, indigné, jura le châtiment des coupables; mais les habitans, prévoyant les suites de la lâche trahison de quelques-uns d’entre eux, se hâtèrent d’abandonner la ville et de se disperser dans les campagnes. Les soldats se vengèrent par le pillage et l’incendie, forçant ainsi les fugitifs d’assister à l’embrasement de leur cité. Effet désastreux de la justice militaire! Pour châtier quelques misérables, peut-être sans pain et sans asile, toute une population fut condamnée au désespoir et à la misère. Les troupes se rembarquèrent, et ce fut là leur dernier exploit dans cette campagne.
A Paris, depuis le 20 septembre, l’Assemblée législative était dissoute et remplacée par la Convention nationale. Le 21, la république avait été proclamée. Alors que tout semblait conspirer contre ce nouveau mode de gouvernement, quand les troupes étrangères occupaient encore la France, quand les partisans de la royauté constitutionnelle, sans grossir les rangs des amis de la cour et du clergé, s’irritaient comme eux à la vue des factions anarchiques qui ensanglantaient la patrie dans un moment où le volcan de la Vendée, qui ne devait s’éteindre que sous des torrens de sang français, menaçait d’une éruption générale le Poitou, l’Anjou, le Maine et la Bretagne, où la déchéance et le sort futur du Roi devaient faire prévoir une levée en masse de tous les souverains de l’Europe, la Convention se divisait en deux partis acharnés qui, sous la dénomination de la Gironde et de la Montagne, s’étaient juré une guerre d’extermination. La dislocation de la France semblait inévitable; tout raisonnement humain devait pronostiquer l’anéantissement prochain du nouvel ordre de choses. Il triompha cependant; le peuple soutint sa souveraineté récente par son énergie et par ses victoires. Il fut despote et tyran, car toute démocratie est despotique; mais il fut invincible, parce qu’il existe cette différence entre les États démocratiques et les rois absolus, c’est que le pouvoir de ceux-ci réside dans leurs agens; la force du peuple est en lui. Il s’irrite par les obstacles, grandit dans le péril, et ne se soumet que lorsqu’il n’a plus rien à vaincre. Le repos le tue, comme à une irritation violente succède un état de langueur et de faiblesse. C’est pourquoi l’on trouve toujours un dictateur à la queue de toutes les révolutions. Voyez César, Cromwel et Bonaparte.
La Convention s’occupait de voter des récompenses nationales pour les vainqueurs de Valmy, de Mayence, de Nice et de la Savoie, lançait des décrets de mort contre les émigrés pris les armes à la main, abolissait l’ordre militaire de Saint-Louis, et avait enfin trouvé dans son sein des voix généreuses qui s’étaient élevées contre les horribles provocations de Marat et les projets anti-républicains de Robespierre (Louvet accusait celui-ci d’aspirer à la dictature), lorsque le lendemain même de cette accusation, arriva la nouvelle de la fameuse bataille de Jemmapes, remportée par Dumouriez, et qui assurait à la France la conquête de la Belgique. Enorgueillie de ses victoires, la Convention marche alors d’un pas plus rapide et plus hardi à l’accomplissement de ses funestes desseins. Robespierre s’opposait à ce que Louis XVI fût jugé ; il en appelait contre lui à un acte de providence nationale, exigeant que les représentans le condamnassent à mort sans procès, en vertu de l’insurrection. D’autres membres, bravant courageusement les cris furieux des montagnards, invoquèrent en faveur du malheureux prince son inviolabilité. La majorité se décida entre ces deux partis, et l’appela à la barre de la Convention nationale pour y entendre son acte d’accusation.
1793.
Le meurtre du Roi entraîna la République dans une guerre générale. Sous chacune des couronnes de l’Europe elle trouva un ennemi. L’Autruche, l’Allemagne, l’Angleterre, la Hollande, Rome, Naples, le Portugal, l’Espagne, se jetèrent tumultueusement dans la lice pour nous anéantir. C’était peu pour toutes ces puissances d’opposer leurs armées à nos armées et leurs flottes à nos flottes, des agens dévoués à leurs intérêts, sous le masque faux d’un patriotisme exagéré , vinrent augmenter chez nous le désordre et l’anarchie, pousser au soulèvement les habitans passionnés de nos provinces. La guerre civile se joignit à la guerre étrangère. La Vendée devint formidable; soixante-dix mille Autrichiens, trente-huit mille Anglo-Bataves, étaient en Belgique et sur le Bas-Rhin; trente-quatre mille Impériaux, entre la Meuse et la Moselle; cent douze mille Prussiens et confédérés d’Allemagne campaient sur les bords du Rhin; quarante-cinq mille Austro-Sardes couronnaient la crête des Alpes, et les Pyrénées étaient franchies par cinquante mille Espagnols. Dans la Manche et dans la Méditerranée, des flottes ennemies déployaient l’appareil de la destruction devant nos côtes presque sans défense. Custine, écrasé par le nombre, dut abandonner ses conquêtes et se replier sur Mayence. Après mille projets extravagans, Dumouriez, battu à Nerwinde, se vendit aux Autrichiens et conçut le projet insensé de marcher lui-même sur Paris à la tête de son armée, pour y rétablir la constitution de 1791.
Les jacobins, exaspérés au récit de nos revers, ne les attribuaient qu’à la trahison et ne cherchaient les traîtres que parmi les girondins, qui refusaient de seconder leurs projets anarchiques et sanglans. Se souciant plus de la domination intérieure que de l’indépendance du territoire, moins impatiens de se délivrer de leurs ennemis à la frontière que de leurs rivaux à la Convention, ce fut d’abord sur ceux-ci qu’ils résolurent de frapper les premiers coups. La nuit du 10 mars fut fixée pour l’exécution de leur projet. Au signal donné, le tambour battit, le tocsin sonna, et deux bandes d’assassins furent poussées contre les ministres et vers l’enceinte où siégeaient les législateurs. Cette première tentative échoua, grâce à la fermeté de Beurnonville, ministre de la guerre, et de Kervelégan, député du Finistère, qui marcha au secours de la Convention à la tête d’un bataillon de fédérés de la Bretagne.
Vergniaud, le lendemain, dénonça à la tribune les auteurs de ces infâmes complots.
«Nous marchons de crimes en amnisties, et
» d’amnisties en crimes, s’écria-t-il. Un grand
» nombre de citoyens en est venu au point de
» confondre les insurrections séditieuses avec
» la grande insurrection de la liberté, de regarder
» les provocations des brigands comme
» les explosions d’ames énergiques, et le brigandage
» même comme une mesure de sûreté
» générale. On a vu se développer cet
» étrange système de liberté d’après lequel
» on vous dit: Vous êtes libres, mais pensez
» comme nous, ou nous vous dénonçons aux
» vengeances du peuple; vous êtes libres,
» mais courbez la tête devant l’idole que nous
» encensons, ou nous vous dénonçons aux
» vengeances du peuple; vous êtes libres,
» mais associez-vous à nous pour persécuter
» les hommes dont nous redoutons la probité
» et les lumières, ou nous vous dénonçons
» aux vengeances du peuple! Citoyens,
» il est à craindre que la révolution,
» comme Saturne, ne dévore successivement
» tous ses enfans, et n’engendre enfin le despotisme
» avec toutes les calamités qui l’accompagnent.»
Cependant, du sein de ces discussions orageuses et de ces innombrables dangers qui environnaient la république, sortit, avide de sang, ce fameux tribunal révolutionnaire qui devait décimer la France et la remplir d’épouvante et d’horreur.
Bientôt les désastres de nos armées s’accrurent. Dumouriez, abandonné par ses soldats, passait chez l’étranger. Valenciennes, Lille, Maubeuge, étaient investis par les troupes coalisées; les Espagnols assiégeaient Collioure et bombardaient Bellegarde; les Vendéens s’emparaient de Saumur, et le célèbre Paoli appelait les Corses à l’indépendance.
Dans le Piémont, quelques succès soutenaient encore la gloire de nos armes. Dès le commencement de 1793, Anselme, dénoncé à la Convention, comme auteur de nombreuses exactions commises dans le comté de Nice, avait été rappelé. L’armée du Midi fut séparée en deux armées distinctes, celle des Alpes et celle d’Italie; la première, toujours sous les ordres du général Montesquiou, la seconde, récemment confiée au général Biron, qui avait succédé à Anselme.
Le nouveau général, désirant célébrer sa bien-venue par un succès, fit quitter à son armée ses cantonnemens d’hiver et la poussa en avant. Il venait de s’emparer de Lantosca, après avoir éprouvé une vive résistance sur les hauteurs de La Scarena, lorsqu’il apprit que l’ennemi, retranché en avant de Sospello, petite ville à quelques lieues de Monaco, recevait des renforts et se disposait à l’attaquer lui-même. Il marche aussitôt pour prendre l’initiative, avec les généraux Brunet et Dagobert. Les Piémontais, supérieurs en nombre, se défendent d’abord avec vigueur; mais bientôt, après les avoir ébranlés par le feu bien nourri de leur artillerie, les Français les abordent à la baïonnette, les culbutent, et leur font quelques centaines de prisonniers.
L’amiral Truguet qui, quelques mois auparavant, s’était présenté devant la capitale de l’île de Sardaigne avec une flotte assez nombreuse, et y avait éprouvé un échec, reparut le troisième jour de février à la hauteur de Cagliari, où la résistance opiniâtre de la garnison rendit de nouveau ses efforts infructueux. En vain, le 17, il parvient à débarquer quatre mille hommes, divisés en deux colonnes, dont l’une se porte vers la citadelle, tandis que l’autre s’occupe d’élever des retranchemens sur le rivage. Cette expédition ne réussit pas mieux que la précédente. La colonne d’attaque fut battue. Assailli par une tempête violente qui disperse ses bâtimens et en jette plusieurs à la côte, Truguet, après avoir vu sombrer sous voile un vaisseau de quatre-vingts canons, se décide à lever l’ancre et rentre dans Toulon.
L’armée d’Italie avait reçu des renforts; elle comptait trente mille hommes sous les armes. Une division autrichienne et de nouvelles recrues étaient venues aussi accroître les forces de l’ennemi, dont les soldats prirent alors le nom d’Austro-Sardes. Biron établit son avant-garde entre Breglio et Sospello, se rendit maître, le 11 avril, des hauteurs de Lantosca, se porta jusqu’à l’entrée du Col de Tende, fit un grand nombre de prisonniers et s’empara de plusieurs pièces de canon; mais, quelque temps après, appelé au commandement de l’armée de la Vendée, il fut remplacé à celle d’Italie par le général Brunet.
Ainsi, ce brillant duc de Lauzun, neveu d’un maréchal de France, descendant d’une des plus illustres familles du royaume, Biron, à la tête des républicains, allait combattre le paysan Cathelineau, généralissime d’une armée où des gentilshommes servaient comme simples soldats. Singulier contraste, qui nous montre l’égalité établie au milieu de l’aristocratique Vendée. Malgré son dévouement à une cause qu’il crut celle de la liberté, Biron bientôt après périt sur l’échafaud. Là c’était lui qui, à son tour, devait succéder au général Brunet.
La Gironde succombait à Paris. Après des attaques réitérées contre ce parti modéré de la république, le 2 du mois de juin, une multitude exaspérée envahit les Tuileries, siége de la Convention. Les législateurs croient désarmer le peuple en se présentant devant lui; des canons sont pointés sur eux; ils rentrent dans le lieu de leurs séances, où Marat, maître de leur vie et de leur mort, décrète l’arrestation de trente-deux de ses collègues.
Quelques-uns de ces proscrits s’étaient retirés dans les départemens de l’Eure, du Calvados, de l’Orne, etc.; ils les soulevèrent. Une force armée s’organisa à Caen en leur faveur, prête à marcher sur Paris pour en expulser la faction des jacobins; mais elle fut vaincue à Pacy-sur-Eure par les troupes envoyées contre eux, et le sang des républicains coula sur l’échafaud, mêlé au sang des royalistes.
L’insurrection cependant faisait de rapides progrès dans le midi de la France. Les partisans des fédéralistes ou girondins, les patriotes honnêtes qui avaient d’abord embrassé avec chaleur la cause sainte de la liberté, à l’aspect du monstre sanglant qui usurpait son nom, se confondirent avec les royalistes dans leur haine pour l’anarchie. Marseille donne le signal et rejette la constitution nouvelle, présent funeste de la Convention. Arles, Lambesc, Tarascon mêlent leurs cris à ses cris de vengeance; Lyon et Toulon y répondent. Une armée se forme, et prend à son tour la route de la capitale; mais trop d’élémens opposés étaient entrés dans cette confédération; il manquait un but unique à toutes ces volontés divergentes; un chef habile à toutes ces masses inexpérimentées. Kellermann, qui avait remplacé Montesquiou dans le commandement de l’armée des Alpes, reçut l’ordre du comité de salut public d’interrompre ses attaques contre les Piémontais et d’éteindre à sa naissance ce vaste foyer de sédition. Il se contenta d’y envoyer deux mille hommes aux ordres du général Carteaux. Celui-ci s’occupa d’abord d’empêcher la jonction entre les Provençaux et les Lyonnais. Le 15 juillet, il rencontra les premiers à Orange et les battit. Nouveau combat, nouvelle victoire pour les conventionnels, le 9 août, près de la ville de Cadenet, sur les bords de la Durance. Enfin l’armée provençale en désordre, ne songeant plus qu’à défendre ses foyers, se retire sous les murs de Marseille, où Carteaux, avant-coureur des vengeances d’un gouvernement impitoyable, entra le 25 du mois d’août.
On sait quel fut le sort de la malheureuse ville de Lyon. Les habitans de Toulon, plus coupables, désespérant de se défendre, après de longues indécisions, livrèrent aux Anglais leur ville, l’une de nos plus importantes places maritimes, et dont le port contenait vingt-cinq vaisseaux de ligne et d’immenses magasins de munitions.
Lorsqu’à la fin du mois d’août l’amiral Hood entra dans Toulon, l’armée espagnole, victorieuse, s’emparait du Roussillon; les Piémontais avaient repris l’offensive et menaçaient Antibes et Chambéry; sur la ligne du nord, Mayence, Valenciennes, Condé, étaient tombés au pouvoir de l’ennemi; dans l’ouest, la Vendée devenait plus menaçante que jamais. La trahison de Toulon portait un coup terrible à la république, incapable alors d’agir avec de grandes forces devant cette place. Si la coalition avait su profiter de sa position avantageuse, les Napolitains, les Espagnols, les Sardes, les Anglais, réunissant une armée considérable dans cette ville, en sortaient pour marcher sur Lyon, s’unissaient par leur droite aux Piémontais, par leur gauche aux Espagnols, ranimaient l’insurrection de la Provence et du Dauphiné, et la république touchait à sa perte.
Parti de Nice avec quatre mille hommes, le général Lapoype se dirigea sur Toulon pour y seconder les efforts de Carteaux, qui commandait alors à huit mille guerriers, et qui bientôt après s’empara des gorges d’Ollioules. Cependant le siège traînait en longueur; les deux généraux, séparés l’un de l’autre par les montagnes du Faron, ne pouvaient communiquer ensemble, et leurs opérations manquaient, faute de régularité. Déjà le général Doppet avait succédé dans le commandement à Carteaux, désigné pour aller diriger les troupes qui se trouvaient alors dans le comté de Nice. Doppet eut à son tour Dugommier pour successeur. Ces changemens continuels entravaient la marche du siège. Des tentatives infructueuses commençaient à décourager le soldat, lorsqu’un jeune commandant d’artillerie, envoyé par le comité de salut public, proposa un plan d’attaque qui fut adopté et mis à exécution. Trois jours après, le 18 décembre, la ville fut prise. Ce jeune commandant se nommait Bonaparte.
Aux frontières de la Belgique et du côté de l’ouest, de grands événemens avaient eu lieu pendant la durée du siège de Toulon. Du 6 au 8 septembre, le général Houchard, ou plutôt Carnot, Jourdan et Leclerc, gagnèrent la bataille d’Hondtschoote sur les Hollandais et les Anglais que commandait le duc d’Yorck, et délivrèrent Dunkerque assiégé par ce prince. Houchard paya de sa tête son irrésolution pendant le combats.
Le 16 octobre, Jourdan triompha des Autrichiens à la sanglante affaire de Wattignies, et débloqua Maubeuge.
Dans la Vendée, Bonchamps et Lescure s’immortalisaient en expirant; mais leurs soldats, battus successivement à la Tremblaye, à Chollet et à Beaupréau, passaient la Loire en fuyant devant les bandes républicaines; et le brave général Hoche, placé récemment à la tête de l’armée du Rhin, allait écraser les Prussiens et les Autrichiens à Geisberg, délivrer Landau et terminer glorieusement l’année en reconquérant les fameuses lignes de Weissembourg.
Kellermann, avec une partie de l’armée des Alpes, avait été chargé d’investir la ville de Lyon; mais, profitant de son absence, les Austro-Sardes, à travers le comté de Nice, pénétrèrent dans le département du Mont-Blanc. Au bruit de cette invasion, Kellermann quitta aussitôt le siége qu’il ne dirigeait qu’avec répugnance, car quelle gloire pouvait-il attendre d’un triomphe remporté sur ses compatriotes!
L’ennemi, au nombre de vingt-cinq mille hommes, avait attaqué les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, où sept mille Français seulement étaient disséminés sur une ligne de quinze lieues. Après une noble résistance et des succès partiels, envahis de toutes parts et craignant d’être tournés, ils avaient enfin opéré leur retraite, et, pendant dix-huit jours, s’étaient retirés en bon ordre devant des troupes trois fois plus nombreuses qu’eux et qui cependant n’avaient pu les rompre. Quand Kellermann arriva, les Piémontais occupaient le Faussigny. Leur centre était à Beaufort en Savoie, leur droite à Salenches, sur la lisière du territoire de Genève, à six lieues de Chamouny, et leur gauche en Maurienne.
Le héros de Valmy fit un appel aux gardes nationales du département de l’Isère et du nouveau département français du Mont-Blanc; elles y répondirent avec enthousiasme et se rendirent au poste de l’honneur. En un mois, battu dans toutes les rencontres, déconcerté dans toutes ses tentatives, l’ennemi abandonna ses positions et, à son tour, opéra sa retraite. S’arrêtant enfin au village de Saint-Maurice, situé sur la frontière, au pied du petit Saint-Bernard, après l’avoir entouré de retranchemens, il résolut de tenter encore le hasard des combats.
Le général français l’y attaqua sans attendre un renfort qui arrivait à marches forcées pour le soutenir. Cependant, au milieu de l’action, lorsque la victoire flottait indécise entre les deux partis, l’apparition des soldats des Alpes décida du gain de la journée. Kellermann écrivit aux législateurs: «Le Mont-Blanc a été envahi
» par des forces supérieures; le Mont-Blanc
» est évacué aujourd’hui. La frontière de Nice
» à Genève est libre. La retraite des Piémontais
» de la Tarentaise nécessitera celle de la
» Maurienne. L’expulsion des Piémontais du
» territoire du Mont-Blanc leur a coûté deux
» mille hommes et une immense quantité d’argent.»
Cette affaire eut lieu le 4 octobre. Le 8, l’ennemi fut chassé de la Maurienne, comme l’avait prédit Kellermann, et forcé de se replier dans les défilés du Mont-Cenis. La réussite de cette expédition assura les succès de la République contre les soulèvemens des provinces du Midi.
Le 18 du même mois, les Piémontais, renforcés de nouveau par des régimens de Croates et d’Autrichiens, aux ordres du général Dewins, après avoir traversé la vallée de la Blure, s’étaient emparés du poste de Gilette, important par sa position, qui leur permettait de jeter un pont sur le Var, de faire une invasion sur le territoire de la République et de couper ses communications avec les troupes françaises occupant le comté de Nice. Dugommier, successeur de Brunet à l’armée d’Italie, et qui avait son quartier-général à Utelle, gros bourg situé à cinq lieues de Nice, sur les bords de la Vésubia, apprend ces nouvelles, et aussitôt il envoie un officier de confiance à la tête d’un bataillon, avec ordre de marcher sur Gilette. Celui-ci surprend l’ennemi dans un village qu’il était en train de piller, et l’épouvante par son arrivée imprévue. Dugommier, pendant la nuit, était parti d’Utelle avec trois cents hommes d’élite pour chasser quatre mille Autrichiens du poste qu’ils occupaient. Quelques détachemens semés sur son passage se réunirent à lui. Après une marche de sept lieues, il commandait à un millier de combattans, le jour venait de naitre, et il était en face de l’ennemi. Sans s’inquiéter du nombre, il l’attaque avec fureur, le culbute, le terrasse, s’empare de Gilette, des tentes, des magasins, de l’artillerie du général Dewins, assure le pays contre une nouvelle surprise, compte huit cents Austro-Sardes morts dans leurs retranchemens, et se hâte de repartir pour Utelle, emmenant avec lui sept cents prisonniers.
Bien lui prit de rejoindre son quartier-général; car, dans la nuit du 22 octobre, il y fut surpris à son tour par l’ennemi, qui avait rassemblé une grande partie de ses forces. Favorisé par l’obscurité et par un brouillard épais, celui-ci s’avance jusqu’aux avant-postes français, où les soldats, harassés par une marche longue et pénible, reposaient, rêvant peut-être à leur victoire de la veille. Il les égorge. Avertie par les cris des victimes, la grand’garde crie: Aux armes! et se replie sur le village. L’ennemi croit son triomphe assuré, établit ses bivouacs sur les montagnes qui bientôt resplendissent de feux, et attend le jour, plein de l’espérance d’achever sa victoire.
Parmi les postes avancés, un seul n’avait pu être occupé par les Austro-Sardes: c’était celui de la Madone, qui, placé sur un pic très-élevé, avait eu le temps de se mettre en état de défense. Dugommier fait éteindre les feux de ses soldats et leur ordonne d’attendre dans le silence le moment de réparer cet échec. Bientôt l’ennemi s’engage dans un étroit défilé, seule route qui pût lui donner accès jusqu’au camp français. Tout-à-coup, des ravins et des rochers, six cents braves s’élancent sur lui à la baïonnette; resserré dans un étroit passage où il ne peut se développer, le nombre lui devient inutile; la confusion se met dans ses rangs; il fuit, et trouve encore devant lui dans sa fuite le poste de la Madone, renforcé par deux compagnies de chasseurs et de grenadiers, qui l’empêche de se rallier, redouble son désordre et achève sa défaite.
Ce fut après cette affaire que le général Dugommier quitta l’armée d’Italie pour prendre la direction du siège de Toulon, laissant le commandement au général Dumerbion.
Combien doit sembler admirable la constance héroïque des soldats qui combattaient alors dans les Alpes, quand on songe aux privations et aux contrariétés sans nombre qui semblaient devoir jeter le découragement dans leur ame! A chaque instant on arrachait de leurs rangs les généraux auxquels ils étaient fiers d’obéir et qui avaient conquis leur amour en les conduisant à la victoire. Kellermann, qui venait sans doute de sauver la France pour la seconde fois, en arrêtant l’invasion rapide des Piémontais, était décrété d’arrestation; Brunet mourait sur l’échafaud; de nouveaux ordres de divisions, de mutations, venaient à chaque instant désorganiser les cadres de l’armée. Sans paie, manquant souvent des munitions de guerre et de bouche, en proie aux délations, à l’injustice, si difficile à supporter, appauvrie par l’absence des détachemens envoyés à Lyon et à Toulon, elle soutenait encore cependant, avec une intrépide résignation, l’âpreté du climat, la lâche tyrannie du gouvernement et les chances d’une défensive périlleuse, qui eût éteint son enthousiasme, si elle ne l’avait puisé dans un ardent amour pour la patrie et un respect aveugle pour ses lois.
Ancien capitaine de grenadiers, Dumerbion avait gagné successivement ses grades de colonel, de général de brigade et de général de division, au milieu des soldats qu’il commandait alors en chef. Il était âgé de soixante ans, bon, brave, instruit; mais tellement tourmenté par la goutte, qu’il restait quelquefois des mois entiers sans pouvoir sortir de son lit. Sous ses ordres figuraient les généraux Garnier, Macquart, Dallemagne et Masséna, qui n’attendaient qu’un champ plus vaste ouvert à leur bravoure pour conquérir une grande illustration. Lé dernier ne tarda pas à donner des preuves de son audace et de son-intrépidité.
Poursuivis par les Français, les Austro-Sardes s’étaient réfugiés au poste de Castel-Gineste, fortifié par l’art et par la nature, et de-là menaçaient de nouveau le quartier-général d’Utelle. A travers d’innombrables difficultés de terrain, Masséna, suivi de quelques compagnies d’élite, tourne l’ennemi, surprend ses premiers retranchemens et s’en empare. Entouré de périls sans cesse renaissans, il arrive au pied de la montagne, dont les hauteurs, couronnées d’artillerie, ne semblent lui présenter que l’appât d’une mort glorieuse, mais non d’un succès. Les Français se précipitent en avant; la résistance est d’abord égale à l’attaque; les Austro-Sardes cèdent enfin, abandonnent leur position première, couverte de morts et de blessés, et se réfugient sur la montagne de Brec, l’une des plus escarpées entre les Alpes maritimes. Masséna croit n’avoir fait encore que la moitié de son devoir, s’il ne parvient à les en débusquer. Cependant, afin de se présenter avec quelque avantage devant l’ennemi, il faut du canon, et il ne voit devant lui, pour arriver au sommet de la montagne, qu’un sentier à pic, étroit et raboteux, flanqué de rocs et de précipices. Par son ordre, une pièce de quatre est démontée; lui-même donne l’exemple; ses soldats. le secondent avec enthousiasme. Après six heures d’efforts inouis, la pièce, portée à bras, est remise sur son affût, et sa première explosion, répétée avec fracas par tous les échos des Alpes, épouvante les Piémontais, anéantis de terreur à la vue de cette petite armée en ordre de bataille et débouchant avec de l’artillerie par un sentier praticable seulement jusqu’alors pour les chèvres et les chamois.
Le plateau fut emporté à la baïonnette, l’ennemi se dispersa de rocher en rocher et laissa tout son matériel au pouvoir des Français.
Cette double action eut lieu le 24 novembre.
Ainsi préludait, par d’étonnans exploits, à des exploits plus grands, cette première armée d’Italie appelée à l’honneur de donner un jour la paix à l’Europe.
Pendant le cours de l’année 1793, des changemens de politique et d’autres événemens importans étaient survenus dans les différens États de la péninsule. Dès la fin du mois d’avril, la Corse avait cessé d’appartenir à la France. Promenant le vieux drapeau de Cyrnus au milieu des montagnes et des rochers, Paoli, dont le nom seul était une puissance, avait soulevé contre leur nouvelle métropole ces peuplades ardentes, ces paysans guerriers, ces farouches chasseurs d’hommes, qui habitent les hauteurs de l’île. En vain dans plusieurs combats décisifs, le général Lacombe Saint-Michel, à la tête des troupes et des partisans de la France, triompha des soldats de Paoli; ces intrépides montagnards, par ruse, par adresse, par force, attaquant, surprenant leurs vainqueurs dans des embuscades inévitables, du haut des rocs qu’eux seuls pouvaient gravir, les détruisaient en détail. Les Français montraient avec orgueil quelques champs de victoire, mais debout sur la cime du mont Calvi, dominant les défilés, les ravins, les bruyères, Paoli, de la pointe de son poignard, pouvait indiquer mille endroits différens teints du sang d’un ennemi.
Si l’indépendance de la Corse semblait indestructible au milieu de ses rochers, le parti français n’était pas moins solidement établi dans les plaines et dans les villes semées le long du rivage. Déjà même Lacombe forçait à la soumission des forteresses occupées par les insurgés, lorsque l’Angleterre, qui venait de se déclarer ouvertement contre la France, envoya au secours de Paoli une forte escadre, qui parut tout-à-coup devant l’île. Foudroyé sur les côtes par la flotte britannique, pressé dans l’intérieur par les bandes nombreuses du pays renforcées de plusieurs régimens anglais, le général Lacombe dut songer à la retraite pour sauver son armée d’un anéantissement complet.
Le 1er mai il abandonna l’île; la Corse se crut libre, elle n’avait fait que changer de maître.
La présence des Anglais dans la Méditerranée n’influait pas seulement sur les destinées de la Corse; elle avait triomphé des irrésolutions et fait tomber le masque des ennemis de la république. Se sentant appuyé par eux, le roi de Naples s’était enfin engagé à fournir des soldats et des vaisseaux à la coalition. A son exemple, le grand-maître de Malte avait rompu toute relation avec la France. Épouvanté des excès des révolutionnaires, le souverain pontife appelait sur eux les vengeances du ciel et bénissait les armes des confédérés. Le sang de Louis XVI s’élevait entre nous et l’Europe. Gênes, Venise et la Toscane persistaient seules dans leur neutralité, malgré les insolentes menaces de l’Angleterre. Le grand-duc cependant, sans prendre parti dans la ligue générale, s’était enfin déterminé, pour lui complaire, à renvoyer de ses États le ministre de la république et à rappeler près de lui l’ambassadeur qu’il avait à paris.
Nous avons vu les résultats de cette levée en masse de tous les souverains; des désastres et des triomphes alternatifs n’avaient pu fixer encore l’indécision de la fortune; la lutte se prolongeait douteuse, mais terrible. L’année qui va suivre renfermait dans son sein les destinées de la France nouvelle.
1794.
Déjà la révolution, qui avait tout détruit, commençait à se détruire elle-même. L’échafaud, après s’être inondé tour à tour du sang des prêtres, des émigrés, des constitutionnels, des républicains modérés, se couvrait de celui des terroristes et des montagnards. Selon l’expression de Camille-Desmoulins, le comité de salut public mettait la Convention en coupe réglée. La fatale charrette contenait souvent ensemble l’accusateur et l’accusé, l’un condamné par un décret, l’autre pour avoir proposé le décret. Étrange contradiction, bien digne de ce gouvernement sans but et sans base, hydre sanglante dont toutes les têtes devaient tomber, qui ne connaissait de liberté que la toute-puissance du crime, et d’égalité que sous le niveau de la mort. Une seule pensée cependant présidait à tant de meurtres et de réactions; mais la main qui faisait mouvoir le fer de la guillotine était hors de France. L’Angleterre, qui ne soulevait, qui n’armait la Vendée que pour l’abandonner ensuite au glaive des républicains, qui excitait ceux-ci à s’entre-détruire, espérait voir enfin la France, son éternelle rivale, épuisée de sang, tomber à sa merci, lui livrer ses colonies et ses flottes. Mais elle calcula mal les suites du coup qu’elle voulait porter; la France, menacée sur tous les points, irritée de ses blessures, sentant le sol s’agiter sous elle, se lève plus grande et plus forte que jamais. Elle enfante, au milieu de ses convulsions, quatorze armées formidables; onze cent mille hommes combattent sous ses drapeaux. Dugommier, Pérignon, Lefebvre, Hoche, Moreau, Jourdan, Pichegru, Mocey, Macdonald, Kellermann, Championnet, Kléber, dirigent ses soldats; sous eux s’élèvent Masséna, Desaix, Augereau, Marceau, Laharpe et Victor. Pendant le cours de 1794, la victoire sembla s’enrôler elle-même sous nos étendards et marcher avec nos bataillons. Pichegru, vainqueur à Courtray et à Hooglède, Jourdan à Fleurus, s’emparent des Pays-Bas, rejettent les Autrichiens au-delà du Rhin, entrent en Hollande, soulèvent en leur faveur tous les Bataves au cri de liberté. Le Quesnoy, Valenciennes, Condé, sont repris. En Espagne, Fontarabie, Saint-Sébastien, Tolosa, tombent au pouvoir des Français, et le brave Dugommier meurt au sein d’un triomphe. On compta peu de jours dans cette campagne mémorable qui ne fussent marqués du sceau de la victoire. Au commencement du mois de juillet, Pichegru entra dans Ostende, en chassa les Anglais; Moncey écrasa les Espagnols au combat d’Arquinzun; dans la Belgique, Schérer expulsait l’ennemi du Mont-Paliselle, Lefebvre le culbutait de poste en poste à Corbaix, au mont Saint-Jean, à Waterloo; Mons se rendait aux Français; les Autrichiens, chassés de Seneff, évacuaient Saint-Amand, Marchiennes et Cateau-Cambrésis. L’affaire sanglante de Sombref nous ouvrait les portes de Nivelle; l’armée du Nord pénétrait dans Bruxelles, et y opérait sa jonction avec celle de Sambre-et-Meuse; les armées du Rhin et de la Moselle terrassaient les Prussiens à Platzberg et à Tripstadt. Le 15, Kléber s’emparait de Louvain, Pichegru de Malines; le 16, Schérer reconquérait Landrecies, et Jourdan plantait le drapeau tricolore sur les remparts pe Namur. La capitulation de Nieuport, la conquête d’Anvers et de Liége, les succès de Moncey en Espagne et la soumission de l’île de Cassandria, en Hollande, terminèrent dignement ce mois glorieux.
On peut juger par cet aperçu du mouvement offensif et rapide qui s’était déclaré dans toutes nos armées.
Nos forces au pied des Alpes et dans le comté de Nice s’étaient augmentées de tous les détachemens qu’on en avait tirés précédemment pour les sièges de Lyon et de Toulon, et qui étaient devenus disponibles depuis la réduction de ces deux places.
Arrêtée, dans ses diverses tentatives en Savoie et dans le comté de Nice, par Kellermann et Dugommier, l’armée austro-sarde, au commencement de la campagne de 1794, avait repris ses anciennes positions, et depuis les hauteurs du petit Saint-Bernard jusqu’au fleuve du Tanaro, ses soldats, échelonnés sur les Alpes, protégeaient les plaines du Piémont, A Turin, tout s’agitait pour augmenter encore les cadres de cette armée et la mettre en état de repousser les Français au-delà du Var.
La prise d’Oneille était, depuis long-temps, le but vers lequel se dirigeait l’attention de nos généraux. De son port partaient tous les bâtimens corsaires qui interceptaient la communication entre Gênes et Nice, et mettaient obstacle aux approvisionnerions de la Provence; c’était la seule place qui permit à la cour de Turin de correspondre encore avec la Sardaigne et les Anglais. L’amiral Truguet l’avait attaquée avec succès par mer en 1792; mais depuis la déclaration de guerre de l’Espagne et l’état de faiblesse où languissait notre marine, presque anéantie dans la Méditerranée par la trahison de Toulon, les flottes de la coalition dominaient seules dans ces parages. L’expédition contre Oneille ne pouvait donc s’entreprendre que par terre, et il était impossible d’y parvenir sans entrer sur le territoire de la république génoise, jusqu’alors restée neutre entre les parties belligérantes.
Ce jeune commandant d’artillerie qui s’était distingué devant Toulon, Bonaparte, était, depuis le mois de mars, sous les ordres de Dumerbion avec le titre de général d’artillerie. Après avoir examiné attentivement les positions qu’occupait l’armée, s’être convaincu de l’impossibilité d’attaquer de vive force les Piémontais dans les camps inexpugnables des Fourches et de Raus, fortifiés encore par eux, et où le général Brunet avait inutilement sacrifié précédemment l’élite de son armée, il conçut le projet de contraindre l’ennemi à les abandonner de lui-même. Il s’agissait de le tourner sur sa gauche, et de se rendre maître de la chaîne supérieure des Alpes en s’emparant du Col de Tende. Renvoyé à un conseil où siégeaient Robespierre jeune et Ricord, représentans du peuple, les généraux Dumerbion, Masséna et Rusca, son plan fut adopté.
La même difficulté d’exécution subsistait toujours par rapport à Gênes; on fit demander le droit de passage au doge, qui refusa. Ne pouvant l’obtenir, on s’en passa. On se rappela que, six mois auparavant, deux mille Piémontais, partis d’Oneille pour se rendre à Toulon, avaient traversé en armes les possessions de cette république; on se rappela encore que, le 15 octobre 1793, la frégate française la Modeste était amarrée dans le port de Gênes, sous la protection génoise, lorsque des vaisseaux sortis des ports de la Grande-Bretagne et placés auprès d’elle, lui intimèrent l’ordre d’arborer le pavillon blanc. Sur le refus du capitaine, les Anglais attaquèrent la frégate, massacrèrent une partie de l’équipage, qui, peu préparé à une telle violation des lois de la guerre, n’avait point eu le temps de se mettre en défense. La Convention irritée, mais alors dans une situation qui ne lui permettait pas de rompre ouvertement avec le doge, dévora son injure; mais c’en était plus qu’il ne fallait pour légitimer à ses yeux le plan proposé et sa mise en œuvre.
Le 6 avril, tandis que le général Dumerbion, pour distraire l’attention de l’ennemi, faisait emporter d’assaut le camp de Fougasse et tous les postes avoisinant Bréglio, une division de quatorze mille hommes se dirige sur le château de Vintimille, s’en emparé ; Masséna, à la tête d’une brigade, marche aussitôt sur le mont Tanardo; le général Macquart franchit la Taggia et se porte vers Monte-Grande. Précédé d’une proclamation pacifique, alors Bonaparte traverse le territoire génois, rencontre les Autrichiens à Sainte-Agathe, les met en fuite, et le lendemain fait son entrée dans Oneille, où il ne trouve personne pour assister à son triomphe; car, terrifies au seul nom des Français, et se rappelant sans doute les excès commis précédemment dans leur ville par l’amiral Truguet, les habitans n’avaient livré que leurs murs aux vainqueurs. Ils y furent bientôt rappelés par la conduite modérée que tinrent, dans cette occasion, les soldats républicains.
De son côté, Masséna s’était emparé de Loano. Le général Mercy-Angenteau, avec deux mille cinq cents Autrichiens, tenta en vain de l’arrêter sur les bords du Tanaro, à Ponte-di-Nave; il succomba sous les efforts de la valeur française. Le même jour, 17 avril, Orméa tomba en notre pouvoir. Garessio capitula le lendemain.
Au bruit de ces victoires si rapides, les Austro-Sardes, comme on l’avait prévu, se hâtèrent d’abandonner les revers des Alpes, où ils n’étaient plus en sûreté. Les généraux Macquart et Masséna, poursuivant leurs succès, investirent Saorgio, place importante par sa position sur la route de Nice à Turin; et, malgré de formidables retranchemens, quoique pourvu d’abondantes munitions de guerre et de bouche, Saorgio ouvrit ses portes devant les Français, le 29 avril. Le roi de Sardaigne en fit juger et mettre à mort le commandant, dont la molle résistance avait compromis le salut du Piémont.
Trois mille prisonniers, deux places fortes, soixante pièces de canon, de vastes magasins de munitions de toute espèce, étaient les trophées de ces brillantes affaires. Bientôt le Col de Tende fut occupé par les soldats de l’armée d’Italie, qui, maîtres de la chaîne supérieure des monts jusque la vallée de Barcelonnette, purent enfin communiquer avec les premiers postes de l’armée des Alpes.
Celle-ci n’était pas restée oisive pendant ce temps. Secondant le mouvement qui avait lieu sur sa droite, le général Alexandre Dumas, investi du commandement depuis le départ de Kellermann, fit attaquer, par le général Bagdelone, le Mont-Valaisan et le petit Saint-Bernard, situés entre la vallée d’Aoste et la Savoie. L’Europe fut effrayée de tant d’audace! Au sein de l’hiver le plus rigoureux, dans des régions où il exerce son pouvoir avec le plus de fureur, nos soldats osent tenter d’enlever des positions jusque-là regardées comme imprenables, même quand la saison peut favoriser les assaillans. Armés du sabre et du fusil, ils vont à travers les glaces et les précipices se heurter contre des remparts indestructibles, hérissés d’artillerie et défendus par des ennemis supérieurs en nombre. Le délire semblait avoir enfanté un tel projet, mais l’impossibilité probable de son exécution en assura elle-même la réussite. Le général Bagdelone, à la tête d’une division résolue à trouver la gloire ou la mort au but de sa course, après avoir foulé pendant deux jours entiers des neiges amoncelées où les pas des chasseurs des Alpes n’eussent point même osé s’imprimer, attaque brusquement le Mont-Valaisan, dont la triple redoute protégeait les hauteurs du Saint-Bernard. Les Piémontais, surpris, terrifiés par cette invasion à laquelle ils étaient loin de s’attendre, au milieu du désordre, opposèrent en vain à l’impétuosité française le feu terrible de leurs batteries; les retranchemens furent emportés, et la fuite seule put protéger les Austro-Sardes contre leurs vainqueurs. Les républicains se servirent alors des canons ennemis pour foudroyer la chapelle de Saint-Bernard où s’étaient concentrées les forces royales. Celles-ci, écrasées par leur propre artillerie, abandonnèrent à la hâte ce poste désastreux, et, poursuivies avec acharnement par quelques détachemens français qui parvinrent avec elles jusqu’à la base de ces rochers, elles se virent contraintes d’évacuer encore le petit village de la Thuile où elles s’étaient réfugiées. Toute la vallée d’Aoste en fut remplie de terreur; déjà l’on tremblait pour la capitale de cette province, lorsque le duc de Mont-Ferrat, fils du roi, jeune prince d’une haute espérance, accourut, secondé par des troupes de ligne et les milices nombreuses du pays, et contraignit cette poignée de braves de se mettre à l’abri, sous la protection de sa conquête récente.
Mais des obstacles plus grands peut - être restaient encore à surmonter pour assurer aux Français la tranquille possession de la Savoie. A une égale distance de Turin et de Chambéry, s’élève formidable le gigantesque Mont-Cenis, dont le point culminant domine la vallée du Pô. Là, une double barrière de rochers s’étend d’un côté jusqu’à des montagnes escarpées, et de l’autre se lie à un ravin dont la pente rapide, coupée par de nombreux précipices, descend à Lanslebourg, ville frontière de la Savoie, où des troupes françaises étaient rassemblées. Des redoutes, des tranchées, des batteries, garnissaient ces formidables éminences; la garde en était confiée aux soldats les plus habiles et les plus aguerris de l’armée austro-sarde. Déjà, au mois de février, le général Sarret avait entrepris de s’en rendre maître; mais, vaincus par les frimas, lui et ses braves dormaient sous les avalanches.
Aussitôt que le printemps eut facilité la fonte d’une partie des neiges qui obstruaient les sentiers et couvraient les montagnes, le général Alexandre Dumas tenta de nouveau cette opération périlleuse. Pour en protéger l’exécution, une division de trois mille hommes, partie de Briançon, franchit le pic de la Croix, s’empara des forts de Mirabouc, de Maupertuis, passa le Mont-Genèvre, descendit dans les vallées de Bardonnèche et de Césane, prit Oulx , Fenestrelles, força le Col de l’Argentière et le passage des Barricades qui assura le point de jonction entre l’armée des Alpes et celle d’Italie.
Alors, sans douter de leur triomphe, pleins de confiance dans le génie de la République et dans l’expérience de leurs chefs, les soldats français s’enfoncent audacieusement dans ces étroits défilés où le souvenir du désastre de Sarret ne les fait point trembler. Séparés en trois colonnes, dont Dumas lui-même, Bagdelone, le vainqueur du Saint-Bernard, et le brave capitaine D’Herbin ont pris le commandement, à la chute du jour, au moment où la lune, apparaissant tout-à-coup sur un pic neigeux, comme un disque d’argent placé sur un obélisque, éclairait les sommités des Alpes et projetait au loin leurs grandes ombres, ils s’élancent avec fureur contre les trois redoutes principales. Les Piémontais résistent avec courage et se montrent dignes de pareils adversaires. Partout, dans les tranchées, dans les batteries, sur les roches déjà teintes de sang, nos soldats frappent ou meurent. Une lutte horrible s’établit dans les bas défilés où règne encore l’obscurité la plus profonde; ce n’est qu’aux cris de vive la République! que les Français peuvent se reconnaître entre eux: ces cris mêlés aux cris furieux des Piémontais, au fracas épouvantable et continu de l’artillerie ennemie, s’engouffrant dans les gorges caverneuses, répétés par les échos des montagnes, semblent avoir étendu le lieu du carnage sur toute la chaîne des Alpes. En vain nos guerriers, foulant aux pieds les corps de leurs compagnons déjà tombés, cherchent à leur donner encore une part dans le triomphe en s’en servant comme d’échelons sanglans pour tenter l’escalade; en vain Dumas, retrouvant au milieu des glaces toute la chaleur de son sang africain (car une mère esclave lui donna le jour), non content de commander en général, exécute lui-même ses propres ordres et se bat en soldat; la pointe de son épée ne peut atteindre que des rocs et s’y brise. Accablé de son impuissance, des pleurs de rage sillonnent sa figure basanée. Tout-à-coup du haut de la redoute principale un cri de victoire s’élève! Bagdelone à travers les précipices, secondé des plus valeureux d’entre les siens, avait tourné la redoutable position et s’en était emparé en l’attaquant sur les derrières. En vain les Piémontais crurent encore la résistance possible. Indécis de terreur entre un nouveau combat contre de tels ennemis, ou une fuite nocturne au milieu des rocs, des neiges et des sentiers impraticables, l’épouvante paralysait leur courage. Dominés bientôt à leur tour par les Français, forcés dans leurs autres retranchemens par D’Herbin et par Dumas, ils effectuèrent enfin leur retraite en désordre, et le drapeau républicain domina les hauteurs des Alpes depuis le Mont-Blanc jusqu’aux sources du Tanaro.
Tout le matériel des troupes royales était tombé au pouvoir des vainqueurs; huit cents prisonniers rehaussaient déjà l’éclat de leur triomphe; le nombre sans doute allait s’en accroître de nouveau; car, cernés sur le sommet d’une montagne, quelques guerriers encore armés ne pouvaient racheter leur vie que par une prompte soumission. Hélas! ces derniers combattans ennemis étaient des Français. Chassés de leur injuste patrie et réfugiés en Savoie, ils y jouissaient en paix de l’asile généreux accordé au malheur, lorsque Montesquiou s’empara de ce pays. Entraînés par le désir d’aider au succès de leur cause, de garantir de l’invasion les nouveaux foyers hospitaliers qui les avaient reçus, ils prirent rang parmi ceux qu’ils croyaient ne s’être levés qu’en leur faveur. Ainsi, comme Alexandre, durant le cours de ses conquêtes dans la Perse, était sûr de trouver des Grecs partout où se faisait sentir une forte résistance; tels les Français devaient deviner la présence de leurs compatriotes dans les lieux où leurs adversaires semblaient lutter avec eux de courage et de persévérance. Perdant tout espoir d’échapper aux soldats républicains, ces malheureux émigrés, sachant trop qu’épargnés par ceux-ci leur vie n’en était pas moins proscrite dans leur pays, résolurent du moins d’être libres dans le choix de leur mort et le genre de leur supplice. Épargnant sans doute un crime de plus aux mille tyrans qui pesaient sur la France, ils atteignirent les cimes les plus escarpées du rocher qu’ils occupaient, mesurèrent la profondeur des précipices ouverts sous leurs pas, brisèrent leurs armes, s’élancèrent, et bientôt un dernier cri de vive le Roi! se fit entendre jusque dans le fond des abîmes. Surpris de cette clameur étrange pour eux, les vainqueurs allaient y répondre par un cri de vive la nation! un sentiment de respect et de pitié enchaîna leurs voix; une émotion douloureuse resserra leurs cœurs, et par un mouvement unanime, spontané, les baïonnettes et les drapeaux républicains s’abaissèrent silencieusement en signe d’hommage, et saluèrent ceux qui savaient mourir.
La faiblesse numérique de nos soldats les força de ralentir leur offensive. Après un grand nombre de marches, de contre-marches et d’attaques partielles où ils atteignirent presque toujours le but qu’ils s’étaient proposé, une affaire plus décisive eut lieu.
Vers le mois de septembre, une division autrichienne, aux ordres du général Wallis, menaça d’occuper Savone, ville appartenant à la république génoise. Une division anglaise devait, pour la seconder, débarquer à Vado, où, depuis la prise d’Oneille, se réfugiaient tous les corsaires, jaloux d’interrompre les moyens de commerce de Gênes à Marseille. Le but de cette double expédition était d’épouvanter le doge et de le contraindre à se déclarer contre la France.
Victor-Amédée voulait se hâter d’agir; l’Allemagne n’avait encore fourni qu’une faible partie des forces qu’elle s’était engagée à faire passer dans le Piémont, par le traité de Valenciennes. Le roi craignait que les Français en poursuivant leurs avantages, franchissant les Apennins, n’envahissent enfin le Piémont par la route de Dégo et de Cairo. Les Autrichiens, rassemblés dans les environs d’Alexandrie, reçurent l’ordre d’occuper les places de Carcare, Millesimo, Cossaria et Cairo, tandis que les Français semblaient se concentrer vers Loano et Finale.
Dumerbion prévit les conséquences de ces mouvemens, et se hâta d’y mettre obstacle en attaquant les Austro-Sardes dans leur camp fortifié de Dégo. Dans la nuit du 20 septembre, il avait réussi dans son entreprise, les avait chassés de leurs positions, et campait lui-même sur les hauteurs de Cairo dont il venait de s’emparer.
Le lendemain, dès l’aurore, il put apercevoir devant lui l’armée des coalises, partagée en deux grandes divisions, dont l’une, formant l’avant-garde, garnissait les hauteurs de Colletto et se prolongeait jusqu’aux vallées de Carpezzo. Une nombreuse artillerie couronnait toutes les positions environnées de forts retranchemens; le corps d’armée manœuvrait déjà avec ordre et s’étendait majestueusement depuis les hauteurs de Bosco jusqu’à celles de Brovida. Aux extrémités des deux ailes, les monts de Cerretto et de Vallaro, occupés par des bataillons de Croates et de chasseurs, protégeaient les flancs des Austro-Sardes: ils acceptaient la bataille.
En l’absence de Dewins, le général autrichien Wallis avait le commandement. Sous les ordres de Dumerbion, les généraux Masséna et Laharpe dirigeaient les soldats de la République, divisés en trois colonnes. La première, secondée par cinq cents cavaliers, les seuls que pût compter l’armée française, attaqua l’importante position de Colletto, tandis que les deux autres se portaient vers le mont Vallaro et les sommités qui dominent la route de Cairo. L’artillerie redoutable des Autrichiens paralysa long-temps les efforts des Français, tour à tour assaillans et assaillis. Des cris de victoire retentissaient alternativement dans les deux armées, dignes l’une de l’autre par leur valeureuse ténacité. Enfin, après un jour de combat, après vingt assauts furieux, quoique ébranlés, écrasés par les batteries autrichiennes auxquelles ils ne pouvaient riposter, les Français s’emparèrent des retranchemens de Colletto, et dès-lors la chance sembla tourner en leur faveur. Cependant les confédérés combattaient encore, et la nuit seule put mettre fin à cette lutte acharnée. Le général Wallis profita de l’obscurité pour se retirer sur Acqui, ville du Piémont, située sur la rive septentrionale de la Bormida.
Privé de sa cavalerie, qui alors cherchait sur les bords du Rhône à se refaire de ses fatigues et de ses privations, le général Dumerbion n’osa brusquer une entrée en Italie qui eût attiré sur sa faible armée toutes les forces autrichiennes et piémontaises. Il laissa l’ennemi s’éloigner, fit lui-même un mouvement rétrograde et se retira du côté de Vado, d’où les Anglais étaient partis et où il se fortifia. De cette position, aidé du général Bonaparte, il fit armer les côtes, élever les redoutes pour protéger les bâtimens républicains, pour interrompre les communications entre les flottes de la Grande-Bretagne et l’armée des confédérés, pour maintenir les relations commerciales de Marseille avec Gênes, et retenir cette dernière dans les liens de sa neutralité. L’affaire de Cairo, importante par ses résultats, termina la campagne de 1794.
Cependant, jetés sur la crête supérieure des Alpes, dans une étendue de soixante lieues, nos soldats éprouvaient déjà les atteintes d’un ennemi plus difficile à vaincre pour eux que les Autrichiens. L’hiver les environnait de ses montagnes de glace, interceptait leurs relations avec l’intérieur et les différens corps. Fatigués de leur inaction, affaiblis par le manque de subsistances, pâles de faim et de misère, en proie à de nombreuses maladies causées par la crudité des eaux et la vivacité de l’air dans ces hautes régions, ils voyaient à leurs pieds, dans des plaines fertiles, l’armée piémontaise au sein de l’abondance et du repos, se renforcer de jour en jour, et soupiraient, mais vainement encore, après ce temps où la victoire leur ouvrirait les portes de la belle Italie.
De grands changemens étaient survenus en France pendant le cours de cette année. Le règne de la terreur avait cessé ; la tête de Robespierre était tombée sur l’échafaud au bruit universel des applaudissemens de tous les partis. L’ordre renaissait, lentement il est vrai, car trop de secousses violentes avaient ébranlé l’État, trop d’hommes avaient été déplacés, trop d’intérêts irrités; mais malgré les efforts de l’anarchie expirante, malgré les excès des factions qui combattaient encore pour le désordre, tout tendait à reprendre une allure légale. Les succès de nos armées, l’espérance d’un avenir de gloire et de bonheur, remplissaient les cœurs d’allégresse. Nous avons vu, nous allons voir encore la nation en armes combattre pour ses droits et pour son indépendance; mais du moins désormais elle espérait obtenir le prix du combat. Si les factions devaient encore la tourmenter, si le despotisme même devait peser sur elle, il était du destin de la liberté de leur survivre et de faire oublier leur passage.
Nous touchons enfin à l’instant où, après quelques revers, après une campagne plus glorieuse que brillante, l’armée d’Italie va prendre une attitude formidable, anéantir devant elle les cinq grandes armées de Dewins, de Beaulieu, de Wurmser, d’Alvinzi et du prince Charles, conquérir le Piémont, la Toscane, la Lombardie, épouvanter Naples et Rome, créer des républiques nouvelles, renouveler la constitution génoise, rayer la vieille Venise du rang des nations, et dicter la paix à l’Autriche au sein même des États héréditaires.
C’est l’armée d’Italie qui soumit les derniers ennemis de la révolution; ses triomphes amenèrent le grand jour où toute l’Europe continentale reconnut publiquement cette ère nouvelle; l’armée d’Italie semblait devoir nous en assurer à jamais les nobles résultats, et c’est de son sein cependant que sortit le destructeur éphémère de notre liberté ; homme extraordinaire qui semble être venu pour nous rassurer sur notre avenir et nous apprendre qu’en France, aujourd’hui, le génie le plus prodigieux et la puissance la plus vaste ne sont pas encore suffisans pour y fonder le despotisme. Le vœu de Louis XVI s’exaucera; tant de maux n’auront pas pesé vainement sur notre belle patrie. Le repos et le bonheur de la France dépendent désormais de la durée de ses nouvelles institutions.
Il est un arbre qui d’abord ébranle la terre où il s’implante; ses racines croissent dans le sang; les orages s’amoncellent autour de sa tige faible encore, la courbent et ne peuvent la briser, car il brave la foudre et il croit sous la tempête. Plus tard, parvenu à sa hauteur, il étend ses rameaux protecteurs sur les enfans de ceux qui l’ont vu naître; son feuillage se couronne de fleurs et de fruits; son influence magique dissipe les génies malfaisans de l’air; les peuples dorment en paix sous son ombrage, et les rois consolident leur trône en l’adossant à son tronc immobile. Lorsque autour de lui s’établissent les danses et les jeux, si un esprit chagrin et rêveur traverse la foule joyeuse et lui dit: «L’arbre que vous environnez d’hommages, plus fatal que le mancenillier, recèle un poison destructeur; il est assis sur des cadavres, et vous dansez sur les tombeaux de vos pères;» la foule écoute à peine, sourit et continue ses jeux et ses danses. Les générations vivantes s’inquiètent peu de ce que leur bonheur a coûté aux générations éteintes. A l’homme chagrin succède un homme pervers: «Renversez cet arbre, dit-il, il vous cache des trésors et vous intercepte les rayons du soleil.» Peuple, gardez-vous de le croire; sans cet arbre le soleil vous dévorerait; gardez-vous d’y porter la hache, le sang en jaillirait; il vous écraserait sous ses débris: cet arbre, c’est celui de la liberté.