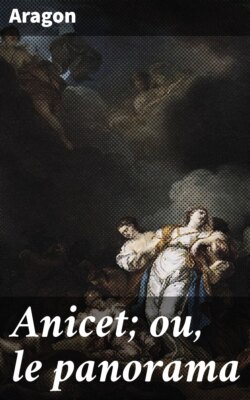Читать книгу Anicet; ou, le panorama - Aragon - Страница 3
CHAPITRE PREMIER ARTHUR
ОглавлениеAnicet n'avait retenu de ses études secondaires que la règle des trois unités, la relativité du temps et de l'espace; là se bornaient ses connaissances de l'art et de la vie. Il s'y tenait dur comme fer et y conformait sa conduite. Il en résulta quelques bizarreries qui n'alarmèrent guère sa famille jusqu'au jour qu'il se porta sur la voie publique à des extrémités peu décentes: on comprit alors qu'il était poète, révélation qui tout d'abord l'étonna mais qu'il accepta bonnement, par modestie, dans la persuasion de ne pouvoir lui-même en trancher aussi bien qu'autrui. Ses parents, sans doute, se rangèrent à l'avis universel puisqu'ils firent ce que tous les parents de poètes font: ils l'appelèrent fils ingrat et lui enjoignirent de voyager. Il n'eut garde de leur résister puisqu'il savait que ni les chemins de fer ni les paquebots ne modifieraient son noumène.
Un soir, dans une auberge d'un pays quelconque (Anicet ne se fiait pas à la géographie, basée comme toutes les sciences sur des données sensibles et non sur les intangibles réalités), il remarqua tandis qu'il dînait que son voisin de table d'hôte ne touchait à aucun des mets et semblait cependant passer par toutes les jubilations gastronomiques du gourmet. Anicet saisit immédiatement que ce convive étrange était un esprit libre qui se refusait à recourir aux formes a priori de la sensibilité et n'éprouvait pas le besoin de porter les aliments à ses lèvres pour en concevoir les qualités. «Je vois. Monsieur, lui dit-il, que vous ne tombez pas dans la crédulité où se tiennent généralement les hommes, et que, par mépris de leur sotte représentation de l'étendue, vous vous abstenez des simulacres par lesquels ils s'imaginent changer leurs rapports avec le monde. De même que certains peuples croient à la vertu des signes écrits, de même le commun attribue superstitieusement à ses gestes le pouvoir de bouleverser la nature. Je me gausse autant que vous-même d'une semblable prétention, laquelle dénote la légèreté d'esprit de nos contemporains (mot dénué de sens que j'emprunte, comme vous le pensez bien, à leur propre langage) et la facilité qu'éprouvent les apparences à les abuser de leur jeu. On me nomme Anicet, je suis poète et fais semblant de voyager pour complaire à ma famille. Je ne saurais vous dissimuler combien je brûle d'apprendre à côté de qui je suis assis. La distinction qui paraît sur votre visage et l'excellence des principes dont vous avez fait montre en cette occasion m'incitent à n'avoir pas de plus vif désir.» Anicet se tut, fort content de soi-même, de l'aménité qu'il avait mise en ses propos, de sa période et de la délicatesse des sentiments qu'il y avait exprimés, enfin des quelques archaïsmes par lesquels il avait si finement nargué l'idée de temps et la chronologie puérile et honnête des lourdauds qui présentement se pourléchaient de l'illusion d'un rapprochement de leur palais et d'une tarte à la crème.
L'inconnu ne se fit pas prier et commença le récit suivant: «Je m'appelle Arthur et je suis né dans les Ardennes, à ce qu'on m'a dit, mais rien ne me permet de l'affirmer, d'autant moins que je n'admets nullement, comme vous l'avez deviné, la dislocation de l'univers en lieux distincts et séparés. Je me contenterais de dire: je suis né, si même cette proposition n'avait le tort de présenter le fait qu'elle exprime comme une action passée au lieu de le présenter comme un état indépendant de la durée. Le verbe a été ainsi créé que tous ses modes sont fonctions du temps, et je m'assure que la seule syntaxe sacre l'homme esclave de ce concept, car il conçoit suivant elle, et son cerveau n'est au fond qu'une grammaire. Peut-être le participe naissant, rendrait-il approximativement ma pensée, mais vous voyez bien, Monsieur,» et ici Arthur frappa la table du poing, «que nous n'en finirons plus si nous voulons approprier nos discours à la réalité des choses, et que le maître d'auberge nous chassera de cette salle avant la fin de mon histoire, si nous ne consentons chemin faisant à des concessions purement formelles aux catégories que nous abominons comme de faux dieux, et dont nous nous servirons, si vous le voulez bien, à défaut de les servir.
«Je m'appelle Arthur et je suis né dans les Ardennes. De très bonne heure, on me donna un précepteur lequel devait m'enseigner le latin mais qui préféra m'entretenir de philosophie. Mal lui en prit, car très rapidement je remarquai que mon professeur démentait par sa conduite les principes mêmes qu'il avait démontrés. Il agissait comme si Dieu pour construire la terre avait préalablement calculé la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. Je fus outré de cette malhonnêteté. Aux reproches un peu véhéments que je lui fis, le philosophe improbe répondit par la délation. Mon père, homme simple et qui ignorait tout de l'impératif catégorique, me fustigea devant mes sœurs. Je décidai de quitter la maison car déjà je possédais ce sens aigu de la pudeur qui devait me dominer par la suite. Je voyageai d'abord par les routes, mendiant mon pain ou le dérobant de préférence. C'est pendant cette période de ma vie que j'appris à concevoir les eaux, les forêts, les fermes, les figurants des paysages indépendamment de leurs liens sensibles, à me libérer du mensonge de la perspective, à imaginer sur un plan ce que d'autres considèrent sur plusieurs comme les enfants qui épèlent, à ne plus me laisser berner de l'illusion des heures et embrasser simultanément la succession des siècles et des minutes. Un beau soir, un peu fatigué de ces panoramas champêtres, je me glissai dans un train et fis, caché sous une banquette pour ne pas payer mon billet, le chemin de C... à Paris. Cette position ne m'incommoda pas, dans la connaissance où j'étais qu'un préjugé seul amène les voyageurs à en préférer une autre. J'utilisai le trajet à m'accoutumer à regarder le monde du ras du sol, ce qui me permit de me faire une idée des représentations qu'en ont les animaux de basse taille. Puis je m'avisai qu'à l'inverse de mon passe-temps habituel rien n'était plus aisé que de reporter sur plusieurs plans ce que l'on voit sur un seul: il suffit de fixer obliquement ce qu'on veut dissocier au lieu de le regarder de champ. J'appliquai immédiatement ce procédé pour éloigner de ma figure les bottes du voyageur assis au-dessus de moi. Dans l'enthousiasme de ces exercices, je scandai mentalement, au bruit rythmé du train sur le ballast, des poèmes qui faisaient bon marché du principe d'identité lui-même.»
Anicet se permit de l'interrompre: «Vous êtes donc aussi poète, Monsieur?»
—À mes moments perdus, reprit le narrateur. J'arrivai à destination dans la plus heureuse disposition d'esprit. Songez à ce qu'est Paris pour un garçon de seize ans qui sait s'émerveiller de tout et de mille manières. Dès la gare, je me sentis transporté: ce mouvement, les maisons chargées de la perspective, cette façon orientale d'écrire CAFÉ au fronton des palais, les fêtes lumineuses du soir, et les murs couverts d'hyperboles, tout concourait à ma joie. Il y avait peu d'apparence que je me lassasse jamais d'un décor, varié sans cesse par les quelques méthodes de contemplation que je possédais, quand une aventure vint me donner les loisirs et la retraite nécessaires pour en élaborer d'autres.
Un matin que je croisais un convoi funéraire, je me représentai le mort, comme je m'étais assoupli à le faire, indépendamment de la durée. Simultanément je le perçus dans les poses les plus prétentieuses, les plus insignifiantes et les plus naturelles, accomplissant toutes les bassesses et toutes les sottises d'une vie sans intérêt, avec ses petits vices et ses petites vertus, si peu responsable que je ricanai assez haut de voir des passants se découvrir devant la boîte cirée qui renfermait ses restes. À cette époque, l'issue malheureuse d'une guerre encore récente, les dissensions politiques et le joug toujours sévère du romantisme portaient les esprits parisiens à des violences peu coutumières aux habitants de la ville la plus polie du monde. Un quidam m'arrêta et m'ordonna d'un ton emphatique de mettre chapeau bas devant je ne sais quelle image de notre humilité. Je caressai mon olibrius de quelques épithètes et n'en fis rien. Comme cet individu cherchait à m'y contraindre, je lui donnai une leçon pratique de philosophie. Cela se termina au poste de police et je fus jeté dans une pièce obscure où l'on m'oublia trois jours. Pour être plus libre que mes geôliers, il suffisait de m'abstraire du temps ou de l'étendue, mais je préférai mettre à profit cette réclusion pour des évasions nouvelles. Les mathématiciens ont inventé d'autres espaces que le nôtre, à n dimensions, disent-ils. Mais embarrassés par l'habitude de penser suivant trois dimensions, ils ne parviennent pas à se représenter leurs propres imaginations. Grâce à ses gymnastiques préalables, ce fut au contraire un amusement pour mon esprit que d'envisager le monde en donnant à n les valeurs les plus diverses; j'étais en train de concevoir l'étendue à un tiers de dimension quand on se souvint de ma présence pour me faire comparaître devant le commissaire. Comme mes réponses subissaient un léger trouble du fait de cet exercice, ce fonctionnaire, qui avait une idée puérile de la relativité des concepts, ne comprit rien à mes discours et, dans la persuasion de parler à un fou, me fit relâcher.
Paris devint pour moi un beau jeu de constructions. J'inventai une sorte d'Agence Cook bouffonne qui cherchait vainement à se reconnaître un guide en main dans ce dédale d'époques et de lieux où je me mouvais avec aisance. L'asphalte se remit à bouillir sous les pieds des promeneurs; des maisons s'effondrèrent; il y en eut qui grimpèrent sur leurs voisines. Les citadins portaient plusieurs costumes qu'on voyait à la fois, comme sur les planches des Histoires de l'Habillement. L'Obélisque fit pousser le Sahara Place de la Concorde, tandis que des galères voguaient sur les toits du Ministère de la Marine: c'étaient celles des écussons aux armes municipales. Des machines tournèrent à Grenelle; il y eut des Expositions où l'on distribua des médailles d'or aux millésimes différents sur l'avers et sur le revers; elles coïncidèrent avec des arrivées de Souverains et des délégations extraordinaires. On habita sans inquiétude dans des immeubles en flammes, dans des aquariums gigantesques. Une forêt surgit soudain près de l'Opéra, sous les arbres de fer de laquelle on vendait des étoffes bayadères. Je changeai de quartier les Abattoirs et le canal Saint-Martin; le bouleversement n'épargna pas les Musées, et tous les livres de la Bibliothèque Nationale submergèrent un jour la foule des badauds.
Vous parlerai-je des mille métiers que j'adoptai, tour à tour camelot et chantant comme des poèmes les titres des journaux que je vendais, homme-réclame par amour des chapeaux hauts de forme, porteur de bagages, débardeur à la Villette? L'étrangeté de ma vie m'attira des curiosités, des fréquentations, des amitiés. Je connus dans certains milieux une vogue égale à celle d'un prestidigitateur ou d'un danseur de cordes. Enfin quelques oisifs de la rive gauche me trouvèrent du génie. Je fus admis dans des cercles choisis, des académiciens m'hébergèrent, des femmes du monde voulurent me connaître. Le contact journalier de mes semblables avait fortement développé chez moi ce sentiment de la pudeur dont je vous ai déjà parlé et qui m'était inné. Je me dérobai aux sollicitations du monde pour éviter de me mettre à nu devant tous. C'est à cette époque que je connus Hortense. Elle ignorait tout de la vie, mais non de l'amour. Image de la passivité, elle supporta mes fantaisies sans les comprendre. Elle admit toutes les expériences, se plia à tous les caprices et me laissa pénétrer jusqu'au dégoût les secrets de la féminité. Devant elle je pouvais dépouiller tout masque, penser haut, dévoiler l'intime de moi-même, sans crainte qu'elle y entendît rien. Elle me fut un manuel précieux que j'abandonnai au bout de trois semaines: j'avais appris à connaître la vision féminine du monde, aussi distante de celle des hommes que l'est celle des souris valseuses du Japon, lesquelles n'imaginent que deux dimensions à l'espace.
Parmi les amis que m'avaient valus quelques dons naturels il en fut un qui s'attacha plus particulièrement à moi. Quand L*** parvenait à pénétrer ma pensée, je le battais jusqu'au sang. Il me suivait comme un chien. Ma pudeur était incommodée à l'excès de cette présence perpétuelle et mon seul recours était de m'évader dans un univers que je bâtissais et dans lequel L*** cherchait à m'atteindre avec des efforts si grotesques que parfois je riais de lui jusqu'à ce qu'il en pleurât. Cette honte qui me prenait quand on me devinait s'exagéra vers ce temps au point qu'une simple question, comme: quelle heure est-il?, si par hasard je l'allais moi-même prononcer, me faisait monter le rouge aux joues et me rendait la vie intolérable. Je devins agressif, méfiant, insolent. Je giflais à tous propos les indiscrets. Il y eut des scandales, dans des réunions, des banquets. Le comble fut qu'une aventure de cet ordre se trouva contée ironiquement dans un journal avec mon nom en toutes lettres. Je ne pus plus supporter le regard des gens dans la rue: je décidai de m'expatrier.
L*** m'accompagna à Londres où le brouillard nous permit quelques distractions nouvelles. Joli songe doré des bords de la Tamise, on se fatigue à la fin de comparer tes réverbères à des points d'orgue. La diversion survint heureusement sous les espèces d'une fille de comptoir dans une de ces maisons de picles et de picalilies qui parfument tout un quartier au vinaigre rose, encens d'un culte inconnu. Elle avait l'aspect de ces poupées anglaises, héroïnes des récits de Golliwog, et qui s'appellent inlassablement Peg, Meg ou Sarah Jane, les cheveux peints très noirs sur le crâne ovoïde, les pommettes carminées, les yeux faits au pinceau, pas de nez, le corps formé de pièces de bois apparentes articulées par des chevilles, les membres cylindriques. Dès quelle fut ma maîtresse je m'aperçus de mon erreur: rien de plus harmonieux que cette enfant potelée, rien de plus souple que ses gestes. Habitué à Hortense, je me laissai aller à penser haut devant Gertrud, à transposer la vie, à me montrer au naturel. Bien vite il fallut convenir qu'elle me pénétrait, que rien ne lui échappait de ce que je lui abandonnais et qu'il n'y avait pas de jeu si compliqué qu'elle n'en sût saisir la règle et la marche. Après m'être un instant révolté d'une perspicacité qui ne venait point sur commande, je ne pus me retenir d'un mouvement d'admiration pour cette Gertie si voisine de moi que je pensais déjà l'atteindre et me confondre avec elle. Elle apportait à me suivre une intelligence, une lucidité qui me déconcertaient. Elle me devançait dans ces courses spirituelles, devinait la direction que j'allais prendre, me surprenait par les bonds quelle exécutait de système en système et m'enseignait à son tour mille divertissements nouveaux. Parfois nous nous poursuivions à travers les espaces de notre invention, nous nous fuyions, nous cachions l'un à l'autre, et finalement nous rencontrions au détour d'un univers. Tout aboutissait à l'amour. Il devenait le but suprême de la vie: pas un geste, pas un rire qui n'y menât. Que je me sentais loin au-dessus de l'émotion goûtée aux premiers jours de Paris, maintenant que j'allais contempler avec Gertie de la coupole de St Paul Church cette autre métropole que les mêmes techniques accommodaient à mon gré, mais pour mener à une joie plus noble et plus complète, du sein de laquelle je regardais avec pitié ces pauvres astronomies passées et les enthousiasmes de mes seize ans! Suprême abolition des catégories, l'amour rendait tout aisé, tout docile, nous n'avions plus de limites à nous-mêmes au moment qu'il s'accomplissait. Nous admettions sans protestation qu'il fût notre maître, mais nous le lui rendions bien. Il se pliait à nos caprices, car nous savions le secret de l'éterniser, de le recommencer, de le suspendre. Nous le connûmes sous toutes ses formes, nous en inventâmes, et nous portâmes dans l'amour nos méthodes d'exaltation. Nous nous y adonnâmes aux confusions de plans, de lieux, d'instants et de durée. Tout prenait un sens érotique et tout devenait autel pour la religion de l'amour. Une factice rivalité d'imagination nous poussa aux fantaisies les plus folles. Nous nous aimâmes dans toutes les contrées, sous tous les toits, dans toutes les compagnies, sous tous les costumes, sous tous les noms. Ce fut un merveilleux voyage de noces. «Gertie, si nous allions aux lacs italiens?» Nous cherchions à nous décevoir, mais la déception même tournait à la volupté. Au temps précis où l'un de nous perdait le contrôle de soi-même, le second parfois se sauvait dans un autre monde. Le jeu consistait à forcer l'évadé au gîte. Que me fallait-il de plus? Par moments j'éprouvais le besoin d'être seul et Gertie intervenait, me tourmentait jusqu'à ce qu'un mensonge m'eût débarrassé d'elle. Par moments je me lassais d'être un lutteur à armes égales devant un autre lutteur. Par moments, cela me gênait de dire: nous toujours, jamais: je. Par moments il y avait un abîme entre nos lèvres réunies. Par moments je me sentais hostile, dur, avec la mâle envie de frapper cette fille trop clairvoyante dont les roueries m'agaçaient, dont les moqueries me blessaient, dont les provocations n'excitaient pas seulement mon désir mais aussi la haine noire de ma pudeur offensée. Bref le dialogue m'excédait, et le prétexte qui s'offrit (L*** voulait revenir sur le continent), fut accueilli comme un soulagement. Un jour, au lieu de prendre la voie lactée, je pris le vapeur à Douvres.
Quelques discussions avec L*** qui dégénérèrent en querelles, un voyage pendant lequel je pensai mourir, la certitude trouvée au cours de ma liaison dernière que l'art n'est pas la fin de cette vie, un scandale qui se fit vers la même époque autour de mon nom, la publicité qu'on lui donna et la calomnie qui s'en empara, enfin mille causes plus offensantes les unes que les autres m'engagèrent à changer d'existence. Je résolus de donner un but différent à mes jours et de tourner mon activité vers le commerce et l'acquisition des richesses. Après avoir liquidé ce qui restait de mon passé, je me munis d'un lot de verroteries et je partis en Afrique orientale, dans l'intention de pratiquer la traite des nègres.
L'aisance que j'apportais à m'adapter à n'importe quelle manière de concevoir, l'absence de tous les liens qui enchaînent les Européens en exil, me mirent rapidement en lumière aux yeux des indigènes, peu accoutumés de voir un blanc se soucier d'eux avec autant de clairvoyance, et à ceux des colons qui durent bientôt en passer par moi pour toute tractation avec les gens du pays. Il n'y eut plus un échange, une affaire que je n'y fusse intéressé ou que je n'y intervinsse. Je m'enrichis impudemment aux dépens de tout le monde, et tout le monde en retour m'en exprima sa gratitude. Je devenais une sorte de potentat économique, aussi indispensable à la vie que le soleil aux cultures. Je me grisais de ces succès rapides, mes seules préoccupations désormais. Toute la poésie pour moi se bornait aux colonnes de chiffres sous les rubriques DOIT et AVOIR de mes registres. Je m'enivrais de nombres, je me saoulais de mesures. Tout ce qui concernait les évaluations de la durée, de l'espace, des quantités, me paraissait subitement la plus merveilleuse création humaine. L'assurance qu'aucune réalité ne les légitimait me poussait à l'admiration de ces unités que l'homme a méticuleusement choisies de façon arbitraire pour servir de point d'appui à ses emprises sur la nature. Rien de plus pur, de plus exempt d'éléments étrangers que les idées mathématiques. Ce sont des vues de l'esprit, qui n'existent que si quelqu'un les imagine et qui n'ont ni fondement ni existence en dehors de celui qui les conçoit. Les plus beaux poèmes furent éclipsés à mes yeux par les épures, par les machines. La pendule, étonnante réalisation d'hypothèse, qui continue, quand son propriétaire n'est plus là, à calculer une quantité qui n'a de réalité qu'en présence de lui, me bouleversait plus qu elle ne faisait les peuplades auxquelles j'en montrais une pour la première fois. J'étudiais les sciences exactes comme j'eusse cherché à pénétrer les secrets du lyrisme. Un grand orgueil me naissait, que seul peut-être j'en sentisse la beauté. J'essayais parfois de la divulguer parmi quelques-uns de ces sorciers de tribus, hommes éminents et sages, mieux ouverts à la spéculation que ces Messieurs de Paris. Ils ne parvenaient point à me comprendre, hochaient la tête, et l'un d'eux disait: «Voici une datte, une deuxième datte, une troisième datte. Il y en a trois. Je les vois, donc le nombre trois n'est pas seulement une vue de l'esprit mais aussi des yeux.» Ainsi raisonnent faussement les plus experts des hommes, sans saisir que les dattes existent mais non le rapport qu'eux seuls établissent entre elles. Les rares relations épistolaires que je conservais avec l'Europe m'apprirent qu'on y déplorait ma disparition et mon silence, que la gloire m'y attendait pour peu que je consentisse à y revenir. Cette nouvelle ne m'émut pas; je préférais à ces lauriers vulgaires la situation de despote et de sage que je m'étais faite dans ces pays africains. Tout le monde reconnaissait ma supériorité intellectuelle, matériellement je n'avais plus rien à désirer. Quelques prodigalités me sacrèrent dieu, j'eus un nom dans les dialectes de la région, je devins légendaire. Je fus de tous les débats religieux; la casuistique dépendit de moi; je traitai des dogmes solaires, du culte des idoles; on me mit à contribution pour expliquer les phénomènes naturels, les cataclysmes, les signes célestes.
C'est ainsi qu'un jour on m'amena en grande pompe dans un village où j'avais affaire, une fille, folle, me dit-on, que la population considérait comme sacrée. Un Européen qui s'était fixé aux environs et qui pratiquait la médecine dans ces parages, m'expliqua: «Cette jeune négresse, sans doute sourde, mais non pas muette, est affligée depuis sa naissance d'une maladie nerveuse assez complexe. Elle n'a jamais pu apprendre à communiquer avec ses semblables ni par la voix ni par la mimique. Ses gestes, incordonnés, ne semblent pas appropriés à une fin. Elle ne peut se mouvoir, même pour l'accomplissement de ses fonctions naturelles qu'il faut bien que des servantes préviennent pour elle. Par bonheur elle ne résiste jamais à une impulsion quelconque qu'un étranger donne à l'un de ses membres. Elle semble demeurée dans l'état du nouveau-né, et ces gens naïfs la respectent comme un prodige.» Dès quelle se trouva devant moi, je fus frappé de la grande beauté de cette fille. Elle possédait visiblement la virginité la plus rare, celle que jamais un désir d'homme n'effleura, tant la crainte et la vénération tenait chacun éloigné d'elle. Je remarquais tout d'abord cette apparente incoordination des mouvements, signalée par l'officier de santé; on eût dit, quand elle cherchait à saisir un objet, que ses regards, séparément commandés, partaient d'un être différent de celui qui tendait la main. Il n'y avait aucun rapport entre l'étendue de son geste et la distance à franchir; parfois un objet qui passait devant elle la tentait plusieurs minutes après sa disparition et elle faisait mine de l'atteindre vers l'emplacement depuis longtemps vide ou dans toute autre direction. Aucun doute pour moi ne subsista quand j'eus pensé au mot: synchronisme qui désigne admirablement cela qui faisait défaut à ses actes: cette fille n'était ainsi isolée de ses semblables que parce quelle n'avait pas l'idée de temps, et vraisemblablement pas celle de l'espace. Gertrud quand elle s'abstrayait des modes de la sensibilité avait de ces attitudes, inexplicables pour un tiers, mais que je ne pouvais méconnaître. L'idée me vint qu'en appelant à mon aide mes anciens talents, je parviendrais à m'entendre avec la folle-par-philosophie. Cela ne manqua pas, et, après quelques jours d'éducation, j'arrivai à communiquer avec elle à l'aide de monosyllabes, de gestes qui semblaient incoordonnés aux assistants, de contacts. Ma réputation de sorcier déjà établie fut confirmée du coup et l'on me confia la vierge noire qui manifestait de mon caractère magique en correspondant avec moi. Je l'emmenai dans une habitation où je m'appliquai à parfaire son instruction. Elle me fit tout d'abord comprendre que, parvenue à l'âge nubile, elle entendait prendre un amant, ce qui lui semblait un mal nécessaire, et que, puisque je l'avais conquise comme nul autre, il était normal que ce fût moi. Je n'eus garde de lui refuser ce service, et, l'amour aidant, ma tâche se trouva simplifiée. Je lui donnai bien des noms par la suite, mais si je veux encore aujourd'hui penser à mon Africaine, je l'appelle de celui qu'elle préférait, quoiqu'il ne soit pas sur le calendrier, Viagère, que je ne puis, après bien des années et à un âge moins ardent, prononcer sans une certaine émotion. Viagère, trop intelligente, s'était mentalement développée avec une précocité rare alors qu'elle n'avait pas encore acquis de ceux qui étaient chargés de sa petite enfance la science de considérer l'univers suivant les modes généralement adoptés. Aussi vivait-elle au milieu des siens comme une étrangère, laquelle ne comprend pas la langue que l'on parle autour d'elle. Mais son esprit, déjà formé quand j'en commençai l'éducation, exempt de toute idée préconçue, apprit aisément les divers systèmes que je lui proposai, sut les appliquer rapidement, non point comme Gertrud qui était embarrassée par la vision commune du monde, mais d'un point de vue général, large, philosophique, auquel je n'avais atteint qu'au prix d'incessants efforts. Elle put se mettre en liaison avec les hommes et ne retint de leurs discours qu'une admiration sans borne à mon égard, et le juste sentiment de ma supériorité sur eux. Tout ce qu elle savait lui venait de moi, je l'avais façonnée à mon image: elle n'eut qu'une religion, m'aimer. Mais cet amour fut d'autre sorte que celui rencontré à Paris ou à Londres. Le calme y régnait, et non cette inquiétude de connaître qui me talonnait aux bras d'Hortense, ni cette pudeur d'être connu qui me faisait quitter ceux de Gertie. Je n'avais pas besoin de sonder son âme, œuvre de mon génie, et le mot pudeur perdait pour moi tout sens devant elle, puisqu'elle était un reflet de moi-même. Je songeais avec orgueil de combien j'avais dépassé, en modelant cet être, les faibles imaginations des hommes: s'éprendre d'une statue au point de l'animer n'était pas un exploit pareil à celui de dissiper les ténèbres qui entouraient Viagère et d'appeler cette larve à la vie. L'existence avec elle n'avait pas l'amour pour but, elle était l'amour même. Rien ne me choquait chez ma maîtresse puisque tout en elle venait de moi. Pas un instant je ne pouvais cesser de l'aimer ni elle de m'adorer, par simple instinct de conservation. Ce n'est que dans le récit que j'emploie, en parlant de nous deux, le pronom personnel à la première personne du pluriel. Nous n'étions qu'une seule personne, une seule volonté, un seul amour. Aussi la volupté ne s'épuisait-elle jamais pour nous, et grâce à la science que j'avais de me soustraire aux lois physiques inventées par les hommes, je trouvais sans cesse en moi les ressources qui la perpétuait. Toutes les variations que j'avais fait subir à mes amies passées devenaient superflues, où l'acte se suffisait, sans que nos fantaisies demandassent d'autres décors. Néanmoins du nœud de cette étreinte sans fin qui nous unissait nous associions le monde à nos ébats. Mais au lieu de nous explorer nous-mêmes à l'occasion d'un spectacle donné, ainsi que je l'avais fait au cours de mes aventures antérieures, nous ne portions nul intérêt à nos réactions affectives, mais nous souciions de la seule ambiance où nous nous trouvions. Ainsi nous n'étions curieux que d'autrui et pas de nous-mêmes, parce que nous échangions à tout instant le meilleur de notre énergie, et que chacun donnait à l'autre l'image de son propre don. Sans jamais interrompre le commerce de nos corps, nos esprits s'appliquèrent à connaître la substance réelle des choses et la conception que l'univers avait de nous. C'est dans la poursuite de ces expériences que nous apprîmes que le lion ne mange les hommes que parce qu'il les prend pour des plantes qui courent; que nous sûmes des grandes fourmis rouges quelles croient à l'immortalité de l'âme; que nous discutâmes avec des sensitives des théories qui assimilent la lumière à des vibrations, à des émanations; que les serpents nous enseignèrent la véritable explication de l'hypnotisme, basée sur la grande vitesse de la lumière, l'impossibilité pour l'homme d'évaluer des fractions infinitésimales de la durée et de l'espace, et la confusion de temps et de lieu que le regard fait naître en lui par sa soudaineté et qui, artificiellement, abolit les formes de sa sensibilité. Nous transposions le plaisir de nos sens à chacune de ces découvertes, de telle sorte que par un doux mensonge nous feignions de le croire purement intellectuel et intimement attaché à la satisfaction du travail accompli. Ainsi notre joie avait mille visages sans que la source en fût modifiée. Cela dura toute une éternité.
Mais c'est en France que je suis mort, voici plus de vingt ans. Dans le mépris où je me tiens de la façon humaine de regarder la vie, je n'hésite pas à n'en point tenir compte et à dîner anachroniquement ce soir à vos côtés. Il n'y a rien d'étonnant, Monsieur, à ce que mes traits vous aient incité à entamer la conversation, car ce sont ceux d'un homme, lequel a délaissé la poésie où il excella, paraît-il, au-dessus de tout autre, qui a connu l'amour comme personne ici-bas, mais qui sait aujourd'hui se suffire, qui a dédaigné une gloire offerte, délaissé une popularité dont il se passe fort bien, abandonné des richesses dont il ignore le compte, qui est revenu de la vie dont il peut sortir à son gré et de la mort qu'il connaît trop bien pour y croire et qui, tout solde fait de tant de qualités naturelles et de connaissances amassées, n'a gardé que l'affabilité bavarde d'un vieillard, petit fonctionnaire retraité de province qui s'entretient à l'issue d'un repas de table d'hôte, en buvant le café trop chaud à petites lampées, avec un Monsieur Anicet, poète, et qui fait semblant de voyager pour complaire à sa famille.»