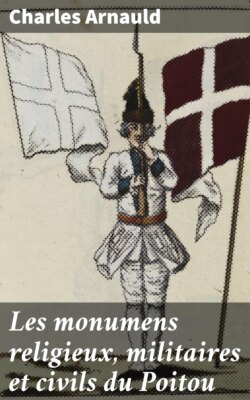Читать книгу Les monumens religieux, militaires et civils du Poitou - Charles Arnauld - Страница 3
Introduction.
ОглавлениеLES beaux-arts ont suivi les destinées des peuples, et ils ont eu, comme toutes les choses de ce monde, et leurs jours de pompes, et leurs jours d’adversités. La terre des Deux-Sèvres prit part à toutes ces vicissitudes; aussi, parmi les monumens que nous possédons encore, les uns sont debout, et les autres s’en vont où d’autres sont allés, dans les ruines et l’oubli!
Tout près de La Mothe-Saint-Héray, dans la commune de Bougon, nous avons des tumulus aux pierres amoncelées, où furent ensevelis des colliers, des vases et des haches; car aux habitans de la Gaule il fallait, dans la mort comme dans la vie, des alimens, des parures et des armes. Les dolmens, les tumulus élevés sur le sol des Deux-Sèvres furent longtemps ignorés; que leur a-t-il donc manqué ? les landes de la Bretagne, le désert peut-être, ou les flots de la mer océanique?
Après ces œuvres gigantesques et sans art, le génie de Rome plana sur nos contrées: point de temple ni d’arène pour ce pays sauvage; seulement des routes qui le traversent, des colonnes et des chiffres pour indiquer l’espace, et des stations pour reposer sa tête. Les voies romaines, construites pour l’éternité, ne sont point effacées; on les retrouve encore dans les lieux où les soldats, partis du Capitole, s’arrêtèrent tant de fois. Bien souvent, fatigués d’une course trop longue, ils y déposèrent pour toujours leurs casques et leurs épées, maintenant on les retrouve aux rayons du soleil, exposées par le soc de la charrue et par les hommes, qui cheminent et moissonnent à toute heure.
Les barbares passent et repassent; tout s’en va; mais enfin le système féodal s’organise. Quelques hommes, fatigués de voir le sol qui les a vus naître ravagé par les barbares du Midi, de l’Orient et du Nord, se groupent, se réunissent, et, pour se défendre contre les incursions des farouches Normands, ils élèvent des palissades, des tours et des donjons. C’en est fait maintenant, l’impulsion est donnée, la France va commencer, et bientôt les arts, à leur retour, embelliront ces vieilles forteresses où les comtes et les barons ont fixé leurs demeures. De ces vieux châteaux le souvenir doit nous être sacré. A l’ombre de leurs tours massives le courage revint au monde, les troubadours préludèrent a leurs chants; et la France héroïque, avec ses fiers paladins, ses croyances et sa foi, fut porter sa vaillance aux luttes du désert.
Le donjon de Niort, qu’il ait été construit par Henri ou Richard d’Angleterre, appartient à ces temps où les forteresses sont imposantes, où les tours sont arrondies, où les châteaux se montrent avec orgueil, car ils ont dans leur marche rapide suivi les progrès de l’architecture religieuse. La forteresse qu’on voyait parmi nous avait une immense place d’armes, une église, des ponts-levis, et des tours où les soldats veillaient pour sa défense. A la révolution, la place d’armes, inutile, encombrée, devint un jardin botanique, un riant parterre. Mais tout lasse, tout finit, tout s’efface; un jour, le jardin fut détruit, les arbres, réunis avec tant de soin, disparurent avec les ombrages, les frais gazons, les bassins délicieux.
Encore sur les bords de la Sèvre, mais plus haut, l’on trouve une autre forteresse dont l’histoire mystérieuse et voilée est presque sans passé, sans souvenir. Le château Salbard, si connu par les amis des vieux temps, est pour tous un long rêve où l’imagination volontaire et sans bornes peut errer en liberté de songe en songe; car ses voûtes qui s’écroulent, ses échos tant de fois éveillés par les oiseaux de la nuit, ses tourelles qui s’affaissent, n’ont rien appris du malheureux captif qui vint pour un moment y reposer ses douleurs et ses chaînes.
C’est à la période romane, pendant laquelle la vie circulait avec tant d’énergie, que nous devons la plupart des édifices religieux qui couvrent notre sol, du moins leur origine remonte à cette époque. C’est ainsi qu’à Champdeniers nous avons une église dont les chapiteaux sont garnis de moulures qui glissent et se cachent pour se montrer encore. C’est ainsi qu’à Parthenay l’on rencontre Notre-Dame-de-la-Coudre, où des femmes pieuses prièrent et s’inclinèrent tant de fois; il en reste aujourd’hui des chapiteaux épars, de longues robes, des boucliers, des épées qui se plongent et détruisent; là sont aussi des arcades, des jambes, des éperons; puis enfin dans le jardin qui l’approche, un cheval, des guerriers mutilés; Charlemagne, saint Guillaume peut-être.
Il faut distinguer ensuite Saint-Pierre d’Airvault; à la vue de ses colonnes, de ses chapiteaux, de sa vieille poussière soulevée, agitée par les pas de tant de siècles, à la vue du clocher qui tinta si souvent, l’imagination est profondément saisie, et l’âme, attentive et surprise, écoute avec un saint respect le bruit léger qui semble s’agiter le long de ses murailles; ce murmure, c’est le dernier bruit des générations passées qui venaient avec tant de recueillement s’agenouiller sur des dalles vieillies, c’est le dernier souffle de ces âmes pieuses dont la vie toute entière se livrait à la pensée de Dieu.
Il faut citer aussi Saint-Jouin-des-Marnes, car c’est dans les cloîtres bénédictins que vivaient et se formaient les maîtres-maçons, les tailleurs d’images, qui produisaient des chefs-d’œuvre, et qui, pour prix de leur gloire, voyaient leurs noms disparaître et s’effacer comme l’ombre qui passe sous les voûtes antiques, leur ouvrage et leur dernier asile.
N’oublions pas Saint-Hilaire de Melle; là, des entrelacs, des rinceaux serpentent sur ses murs, où l’on voit de délicieux oiseaux, un énorme cheval, un puissant cavalier, mais détruits: là, des chasseurs, des monstres, des marguerites, des pommes de pin, des diamans, des moulures qui se brisent autour des colonnes; là, une longue procession, des livres, des bâtons pastoraux.
Dans les environs de Melle il faut remarquer, au modeste hameau de Vérine, des restes bien précieux, mais bien tristes; des murs renversés, des chapiteaux battus par les vents, un clocher découvert, une tourelle où grimpent et s’élancent des rameaux qui voudraient la défendre; puis à lenteur, des fossés, des remparts et des tours, emblêmes de cette vieille France où s’agitaient jadis tant d’héroïsme et tant de foi. Ce sont ensuite les églises de Parthenay-le-Vieux, de Saint-Généroux, de Javarzay, qui se distinguent par leur antiquité, par des voûtes élevées, par une coupole dont l’exemple est si rare.
Après, la main des hommes se repose; elle est lasse, elle a tant remué ; elle a prodigué partout tant de force et de vie: aussi le treizième siècle, qui créa dans le nord de la France de magnifiques épopées, le treizième siècle, dont les chefs-d’œuvre ont surpassé peut-être les merveilles et de Rome et d’Athènes, nous a laissé de vagues souvenirs: c’est à Parthenay, la porte Saint-Jacques, peut-être, avec ses tours elliptiques, ses mâchicoulis, ses créneaux.
Au siècle suivant, dans nos contrées tant de fois ravagées par les guerres de l’Angleterre, peu de monumens s’élèvent; durant ces tristes jours, la pensée de l’homme songeait seulement à guérir ses blessures, à réparer le toit de ses pères. Cependant on peut citer à Niort le chœur de Saint-André, ses fenêtres ogivales. Il ne faut pas oublier non plus Notre-Dame de Bressuire, dont une partie fut sans doute construite à cette époque; il faut parler aussi de sa tour élancée, dont le clocher répéta jadis un long cri d’alarme quand Duguesclin s’approcha de ses murs.
Vers ces temps, Pierre de Frottier, pour braver en paix et le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne, fait élever, dans les environs de Melle, le château de Melzéard. Quand Richement promit d’accepter l’épée de connétable, Frottier, proscrit et chassé, se retira dans ce formidable asile qu’il avait préparé.
Puis après sur la lisière de la Gâtine s’élève, au commencement du quinzième siècle, une curieuse forteresse. Celle-ci du moins n’est pas sombre et triste comme un donjon du douzième siècle; c’est un beau pavillon, des tours poétiques, d’élégans mâchicoulis où l’affreux badigeon ne vint jamais déposer ses couleurs; les pierres, rembrunies par la main du temps, sont splendides et pures comme les pieds de ces remparts qui se plongent et se baignent dans l’eau qui les entoure. A Cherveux, les pas des écuyers ont retenti souvent. Plus d’une fois sans doute de galans pages y parlèrent, y rêvèrent de gentilles damoiselles, de riches fourrures, de robes de brocart; car de belles marraines avaient promis pour eux d’être fidèles à Dieu, fidèles à l’amour.
Cette époque doit nous être chère, car ce fut alors que s’éleva Notre-Dame de Niort et sa flèche admirable; ce fut alors qu’on prépara pour elle de curieuses dentelles, des festons, des bouquets.
Dans la sauvage Gâtine, au milieu de ses champs solitaires où les pas de l’homme s’impriment pour s’effacer; au milieu des landes, des ajoncs et des bruyères qui croissent et périssent ensemble, l’on érige ensuite l’une des plus curieuses compositions de l’architecture religieuse. Saint-Marc-la-Lande n’est plus une église; les voûtes sont enfoncées, les prêtres dispersés, et la voix des fidèles n’y retentit jamais; pourtant quelle délicieuse façade; partout des broderies, des festons; là, des plis et des replis qui veulent enlacer les colonnes et craignent de les quitter.
Nous touchons à une période qui, sur la terre des Deux-Sèvres, a laissé des châteaux remarquables, une élégante église. Au commencement du seizième siècle, Gabrielle de Bourbon, voulant imiter la Sainte-Chapelle de Paris, fit construire l’église du château de Thouars. Ce curieux monument renferme quatre églises qui s’élèvent les unes sur les autres. La plus basse recevait la dépouille de ces puissans comtes qui trônaient comme des rois. La quatrième, ou chapelle ducale, est le chef-d’œuvre de cet élégant édifice, qui nous montre l’architecture ogivale dans toute sa perfection, dans toute sa grâce; la principale porte, dont le travail est achevé, conserve encore des feuilles de vigne, des raisins, de jolies statues.
Maintenant nous sommes à la renaissance, à cette admirable époque qui fut si féconde. Alors de tous côtés se construisent, sur le sol de la France, de gracieuses compositions; car les grands seigneurs dédaignent les donjons, les détruisent ou les laissent. Aussi d’Estissac, qui voulait imiter tant d’orgueil, fit construire le château de Coulonges, où l’on peut remarquer encore des sculptures charmantes, un escalier rempli d’élégance, de jolies voûtes qui commencent à fléchir et qu’on tremble de ne plus revoir. Le château de Javarzay, plus heureux que Coulonges, a conservé, dans leur intégrité, ses machicoulis, ses tourelles.
Dans les environs de Thouars se trouve ensuite Oiron, dont le magnifique château, bâti sous François Ier, rappelle toutes les splendeurs de sa somptueuse époque. Ce superbe édifice fut destiné, sous Louis XIV, à de royales amours. C’est alors que le grand roi voulut prodiguer à la terre du Poitou ses pompes et ses largesses; dans son faste et sa puissance, il semblait dire: Tout pour la fille des Rochechouart, pour la belle Athénaïs. Alors de splendides plafonds chargés d’or et d’azur, des statues, des noms entrelacés, des tableaux, une galerie dont les fresques poétiques rappelaient en même temps les dieux de la Grèce, ses fables et ses vers.
Auprès du pompeux édifice s’élève une église élégante et parée, trop mondaine peut-être; sous ses voûtes sont des pavés tumulaires, des tombes fastueuses, de riches bas-reliefs; car c’est là qu’ils reposent, les Gouffier, les d’Oiron; car c’est là qu’il repose, le fameux Bonnivet, le célèbre amiral qui sut si bien mourir.
L’Hôtel-de-Ville de Niort, par ses tourelles et ses machicoulis, rappelle la vieille forme de ces hôtels, où délibéraient jadis des hommes tout armés. Les fenêtres semblent aujourd’hui modernes, plus de traverses, plus de croix, de vitres coloriées pour briller au soleil. A l’un des angles du monument s’élève un modeste beffroi; il est lourd, il est massif; qu’importe; c’est le vivant témoin des libertés passées.
Encore, sur les bords de la Sèvre, à la place d’un donjon féodal, un édifice construit au commencement du dix-septième siècle. Le château de La Mothe-Saint-Héray est flanqué de tourelles, entouré de fossés où viennent dormir des ondes toujours limpides: partout l’isolement, le silence et le vide; partout des peintures qui pâlissent, des portraits mutilés, des plafonds qui murmurent seulement au bruit des voyageurs qui passent pour ne plus revenir.
C’est à Saint-Loup qu’on trouve la jolie construction du cardinal de Sourdis. Ce favori des femmes, dans son imagination brûlante, voulut imiter le palais de l’Amour; il le voulut par des peintures qui semblaient dire: Malgré ma mitre, malgré ma crosse, j’ai le droit de tout dire, j’ai le droit de tout faire.
Puis, sur la route de Saint-Maixent à Parthenay, le château de la Meilleraye s’éleva dans le sein d’une vieille forêt. Alors, c’est Hortense Mancini, la plus belle des femmes; c’est un peintre célèbre qui rêve aux grâcieuses images qu’a tracées son pinceau; c’est la statue de Mazarin, fastueuse et blanche. Maintenant des murs qui s’écroulent, des serpens qui s’y glissent, des pierres qui s’amoncèlent; et le soir, de funèbres oiseaux qui viennent sur le salon des grâces jeter, à la vue des pavillons déserts, un long cri de douleur et de mort.
Le château de Mursay n’offre rien de remarquable; mais les souvenirs s’y foulent et s’y pressent. En effet, Françoise d’Aubigné, toute petite, y fut apportée par madame de Villette, et plus tard, à son retour d’Amérique, après avoir, pauvre teigneuse, mangé le pain de la misère, elle revint à l’ombre des grands arbres, des sauvages coteaux. Alors, madame de Villette est au comble de la joie; c’est Françoise qui dirige tout, qui préside à tout; cependant, triste jeune fille, il lui fallut bientôt, pour la dernière fois, se reposer sur le pan de rochers qui lui semble si cher; assise dans la grotte creusée dans la colline qui descend sur les bords de la prairie, elle regarde son grand chêne, les flots qui roulent si paisibles; elle écoute le murmure lointain de la chaussée des Loups, regarde, écoute encore, s’éloigne et disparaît.
Maintenant nous allons visiter, sur les bords du Thouet, le château commencé, en 1635, par Marie de la Tour-d’Auvergne, épouse de Henri de la Trémouille, duc de Thouars. A la pensée de Richelieu, la fière duchesse dont l’orgueil et la jalousie étaient immenses, prodigua sans regrets les domaines de ses pères et l’amitié du peuple; il fut pressuré ; toujours du travail, toujours des corvées nouvelles: aussi pour dérober le pompeux édifice à la guerre mortelle que lui livrèrent les hommes de la révolution, le district fut obligé d’y transporter le lieu de ses séances et l’orageux séjour de la liberté nouvelle.
A présent il faut arriver à la fin du dix-septième siècle, et nous arrêter à l’abbaye de Celles, où Louis XI fit bâtir une église. C’est là qu’il vint autrefois, fanatique pélerin, s’agenouiller et prier. Après lui les hommes, qui, dans nos contrées, amoncelèrent tant de ruines, vinrent aussi, mais pour voir les voûtes s’écrouler, leur poussière voler au vent. Plus tard un célèbre architecte, un fils de l’Italie, François Le-Duc, surnommé Toscane, répara l’église qui se distingue par de vastes chapelles, des piliers élancés, des voûtes élégantes dont les nombreuses nervures, qui se coupent et se croisent, sont remplies çà et là par des guirlandes, des fleurs et des fruits.
Déjà le terme approche, encore une église, celle de Saint-Maixent et tout sera fini. Là, où elle repose, bien des pierres ont été préparées, élevées, renversées; car la noble abbaye fut souvent exposée aux plus rudes attaques; abandonnée, trahie par l’un de ses abbés, elle passa tour-à-tour du plus fort au plus riche. Longtemps son front voilé tomba de chûte en chûte, de douleurs en douleurs; longtemps foulée aux pieds, elle resta pantelante et détruite; mais enfin les hommes du travail et de la puissance, les religieux de la congrégation de Saint-Maur, debout sur ses débris, les ranimèrent au souffle de leur inspiration. Alors un riche crucifix, de remarquables peintures, de curieuses boiseries, un jubé solitaire où les nuages d’encens fument et tourbillonnent.
L’église de Saint-Maixent semble appartenir à des temps plus anciens; mais par ses pierres taillées avec tant de soin, par ses détails si polis, élégante et coquette, peut-être, elle semble dire: Je suis jeune, bien jeune encore; voyez ces contours, examinez ces parures, elles sont fraîches, elles sont blanches, elles sont si jolies; ne me vieillissez pas.
Tels sont les monumens qui restent dans le département des Deux-Sèvres, et dont je vais tâcher de raconter avec détail les vicissitudes de gloire et de deuil.