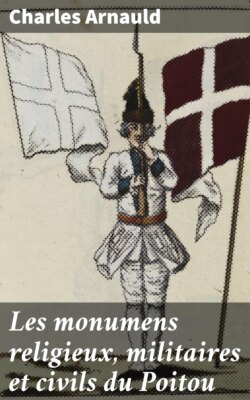Читать книгу Les monumens religieux, militaires et civils du Poitou - Charles Arnauld - Страница 5
Epoque Romaine.
ОглавлениеAPRÈS l’invasion des Romains, après ce duel terrible dans lequel périrent vainement tant de guerriers et tant d’héroïsme, les fils de la Gaule virent s’élever de tous côtés les impérissables chemins qui devaient imprimer sur le sol de la conquête la terreur et la civilisation. La circonscription territoriale dont je m’occupe dans ce moment, avait eu part, comme toutes les autres, aux largesses des vainqueurs; elle était traversée par la route de Saintes à Poitiers et par celles de Poitiers à Nantes, et de Nantes à Angers. Il en existait aussi quelques autres moins importantes qui servaient à parcourir la Gâtine et à gagner les bords de l’Océan.
La grande voie romaine de Saintes à Poitiers entrait par Aulnay dans l’ancien pays des Pictons; de là elle se dirigeait vers Brioux, aujourd’hui chef-lieu de canton dans l’arrondissement de Melle. Brioux était un lieu de repos, et plus d’une fois les légions romaines y laissèrent des malades et des morts. Avant la révolution, l’archéologue pouvait visiter avec intérêt la cour de l’ancien prieuré, où on lisait sur une large pierre:
QUINTUS-JULIUS
Q. F. TER CETRUS
DOMO ARE MILES
LEG. XVIII. VOL.
H. S. E.
De temps en temps on découvre à Brioux des objets qui rappellent le passage du peuple-roi; tantôt c’est un tombeau cloisonné en briques romaines et à plusieurs compartimens, qui renferme des cadavres tous séparés les uns des autres; tantôt ce sont des épées, des médailles, des vases et des boucles, qui prouvent qu’on rendait aux morts de grands honneurs, et qu’on leur laissait leurs vêtemens et leurs armes. Ces formidables épées, jadis si brillantes aux rayons du soleil, sont maintenant sombres et ternes: rongées par le temps et la rouille de tant de siècles, elles se brisent dans la main de celui qui les touche. Ce qui doit surtout exciter vivement les regrets, c’est la perte d’une magnifique armure: ses curieuses ciselures, la rendaient digne d’attention; mais, au bout de quelques jours, sa forme élégante, ses précieux dessins brisés et vendus, ont disparu dans le creuset d’un avide fondeur. Au temps des Romains, Brioux portait le nom de Mansion ou Station; c’était une importante localité où passèrent bien longtemps beaucoup d’hommes et de chevaux; longtemps elle servit d’asile aux soldats qui parcouraient l’empire; c’est là qu’ils s’arrêtaient, c’est là qu’ils se reposaient; les courriers y trouvaient aussi non seulement le repos de quelques heures, mais encore des relais, pour continuer leur route. Les mansions étaient toujours placées dans des lieux assez considérables: aussi, dans le pays que l’on nomme à présent département des Deux-Sèvres, nous en trouvons seulement trois: Brioux, Rom et une autre sous le nom de Ségora; mais aujourd’hui l’on ignore où elle était placée.
Outre les mansions toujours établies à des distances égales, il y avait des mutations représentées par nos postes et nos relais; c’est là que les chefs de l’empire trouvaient à leur disposition tous les moyens de traverser avec une incroyable rapidité le pays des vaincus. Ces lieux de change et de mutation, si utiles à ceux qui voulaient parcourir l’empire, furent établis, selon quelques historiens, par Auguste. Quelques autres prétendent qu’ils commencèrent seulement sous l’empire d’Adrien et de Trajan.
L’espace compris entre les mansions était toujours disposé de manière à ce qu’on pût le traverser en un jour; aussi, dans les anciens auteurs, le mot mansio signifie quelquefois journée. Quand les envoyés des empereurs parcouraient les provinces, ils s’arrêtaient souvent dans les mansions; car c’est là qu’ils trouvaient des chars, des chevaux, des bêtes de somme, en un mot toutes les choses indispensables à ceux qui voyagent.
En sortant de Brioux, par la grande route qui conduit à Melle, il faut tourner à droite, dans un chemin qui porte le nom de Chemin-Chaussé ; c’est là que commence pour nous la voie romaine de Saintes à Poitiers; après des traces incertaines, on rencontre, vis-à-vis le château de Melzéard, une ligne droite formée par plusieurs pierres qui sont alignées et debout, pour soutenir l’antique chaussée; elles sont au nombre de 15. Après une petite interruption, elles recommencent pour disparaître et reparaître de temps en temps. Vis-à-vis Pezay-le-Tort, j’ai pu examiner la route et la creuser: la couche la plus profonde, que j’aie pénétrée, est composée de pierres mises au hasard et sans mortier; la seconde est une couche de ciment, de 33 centimètres d’épaisseur environ, garnie d’un peu de sable. Ainsi la chaussée de ce grand chemin était formée de cailloux, de ciment et d’un summum dorsum en sable. Cette voie qui suit presque toujours le point le plus élevé de la plaine, n’a laissé que de bien faibles traces de Puyberland à Sainte-Soline; mais en sortant de ce dernier village, on rencontre en même temps, à droite et à gauche, les larges pierres qui servaient à soutenir la chaussée; j’ai donc pu mesurer sa largeur. J’ai trouvé qu’elle avait seulement 6 mètres environ; c’était d’ailleurs la largeur ordinaire. A commencer de Sainte-Soline, la voie romaine se nomme indistinctement Chemin-Chaussé, ou Chemin des Romains. Un peu plus loin, les traces de la voie sont assez bien conservées: on voit des deux côtés les pierres qui formaient la bordure; aujourd’hui elles sont dans les champs, ce qui semble prouver que ces anciennes routes ont été souvent détruites par le soc de la charrue.
Près du bourg de Rom, dans lequel passait la voie romaine, se voyait jadis un vaste cimetière rempli de tombeaux, pareils par la forme à ceux de Civeaux; comme eux ils étaient destinés à des chrétiens morts depuis longtemps. Ce qui le prouve d’une manière évidente, c’est que l’on voyait sur un grand nombre de ces tombeaux des croix à traverses fort larges: quelques-unes de ces tombes étaient faites en dos d’âne; la plupart étaient plates. L’une portait les empreintes d’une cognée de charpentier, avec une doloire à côté, sans aucune inscription: sur une autre on avait gravé une équerre, un marteau, un compas et une règle. Toutes les tombes chargées d’inscriptions n’étaient pas anciennes; il est probable que les premières avaient disparu; des mains paresseuses ou avares les avaient effacées pour recouvrir, sans tribut, les restes de leurs parens, pour y graver quelques lignes de regrets et d’adieu.
Un archiprêtre de Rom ayant fait défricher une partie de ce cimetière pour le livrer à la culture, plusieurs tombeaux furent enlevés à la terre qui les renfermait depuis si longtemps. Le dépôt mortuaire de Rom était bien vaste, car les rues et les jardins du bourg étaient autrefois remplis de tombeaux; aujourd’hui encore, dans les environs de l’église, on en trouve sous les murailles des vergers et des maisons. On a donc eu tort de tant parler des tombeaux de Ciseaux, comme si ce bourg eut été le seul endroit du Poitou qui renfermât un grand nombre de ces sarcophages, dont la découverte exerça souvent sur la foule tant de surprise et d’étonnement.
En arrivant à Rom, la voie romaine se doublait, sans doute: l’une de ses branches se dirigeait vers Poitiers, en passant dans nos contrées, par les villages de la Chaussée, de la Forêt; l’autre allait à Couhé. De Rom il partait un autre chemin qui se dirigeait vers les hauteurs de la Mothe-Saint-Héray; il laissait Vançais sur la gauche, et passait par Bagnaux, Exoudun, Exireuil. Avant d’arriver à Vançais, j’ai trouvé des traces très fréquentes de cette voie romaine; après ce village, on en trouve encore dans plusieurs endroits. La bordure des deux côtés de la chaussée est assez bien conservée: j’ai mesuré sa largeur; elle varie de 3 à 4 mètres; aussi doit-on la regarder seulement comme une voie secondaire: à Rom elle se nomme Chemin-Chaussé ; à Bagnaux, Grand-Chemin de Rom. De la Mothe-Saint-Héray elle allait à Saint-Georges de Boismé, à la Boucherie, à la Fontaine, commune de Saint-Pardoux, à Lingrimière, à la Caillerie et à l’Absie; elle passait dans la forêt de Chantemerle et à Saint-Pierre-du-Chemin. Cette voie romaine, qui traversait toute la Gâtine, porte dans le pays le nom de Chemin-Ferré ; elle n’abandonne jamais les hauteurs, et tâche toujours d’éviter les ruisseaux. On a reconnu qu’elle était formée par un cailloutage, des pierres et du ciment: un rang de pierres debout soutenait la chaussée; c’est de là que viennent, il n’en faut pas douter, les noms de Chemin-Haussé, de Chemin-Chaussé. Du côté de l’Absie, la bordure était formée par des blocs de terre cuite ressemblant à des tuiles par la couleur et la consistance. Aujourd’hui encore, sur la place de l’Absie, partout où l’on cherche, partout où l’on creuse, l’on trouve des restes qui rappellent que les Romains y passèrent, que les Romains y restèrent; car là sont des blocs de ciment, des briques et plusieurs autres débris.
L’autre chemin qui traversait la portion du Poitou, qui se trouve dans les Deux-Sèvres, était un fragment de la grande voie romaine qui conduisait de Poitiers à Nantes; elle passait à Airvault, qui formait, peut-être, la mansion connue sous le nom de Ségora, et que les antiquaires ont placée tantôt à Airvault, tantôt à Bressuire, et même à Secondigny. En sortant d’Airvault, la voie de Poitiers à Nantes traversait le Thouet sur un pont qui n’existe plus; après l’avoir franchi, la grande route gagnait Bressuire par la direction la plus directe. Au temps du savant bénédictin dom Fonteneau., les traces de ce chemin subsistaient presque partout. Entre Bressuire, Châtillon et Mortagne, il n’en était pas ainsi: la route était dans un état déplorable et presque détruite; cependant, au quinzième siècle, on s’en servait encore: à cette époque elle fut parcourue par le frère de Louis XI, lors de son voyage de Poitiers à Nantes.
L’Itinéraire d’Antonin et la Table théodosienne sont muets sur la voie romaine de Poitiers à Angers; néanmoins son existence est certaine, elle est prouvée par les débris qui subsistent encore et par des chartres qui la nomment le Grand-Chemin de la Chaussée. Cette voie passait au village des Marnes, non loin de la célèbre abbaye de Saint-Jouin; elle allait ensuite au moulin de Montguinier situé dans la paroisse où l’on voit aujourd’hui la vieille église de Saint-Généroux. Après avoir traversé tous ces lieux, dont les noms sont si connus dans l’Histoire du Poitou, elle arrivait aux endroits nommés la Roche-de-Luzay et Monceau Après être parvenue au gué de Thouarcé qu’elle franchissait sur un pont aujourd’hui détruit, elle passait du côté de Coulonges-en-Thouarçais, puis se dirigeait sur Angers.
Un aveu du 6 mars 1568 parle en ces termes de cette voie romaine et de son pont: «Item, Mathurin et Guillaume les Audouars, tiennent de moi
«sous Ledit hommage, une pièce de terre plantée en bois, assavoir, au
«Monceau, contenant six boisselées environ, tenant d’une part au chemin
«appelé le Grand-Chemin de la Chaussée, par lequel on va dudit lieu du
«Monceau au pont de Volubine (à présent Vaulebine).»
Il existait ensuite une autre voie de traverse, ou grand chemin de communication, qui venait du côté de Saint-Maixent et conduisait vers Fontenay: on en trouve des traces assez fréquentes dans le village de Breloux, où souvent l’on a rencontré des restes légués par la puissance romaine; tantôt ce sont des briques, des monceaux de ciment, tantôt des restes de colonne. De Breloux la voie romaine suivait sa première direction, et passait par Saint-Maxire, Villiers-en-Plaine et Saint-Pompain.
Il y avait un autre chemin, qui partait de celui-ci, entre Fontenay et Saint-Pompain; il passait par les communes de Coulon et de Magné, traversait un bras de la Sèvre au gué de Menevaut, et se dirigeait vers le pont près d’Epannes et vers Usseau. M. Lary, à qui nous devons la découverte de cette nouvelle voie qui conduisait à Saintes, a rencontré dans plusieurs endroits des vestiges qui prouvent son existence d’une manière incontestable. C’est ainsi qu’au-dessus de Coulon, près de la métairie appelée Maupasset, il a découvert, sous le sol d’une vaste prairie, une chaussée d’environ 10 mètres de largeur.
Les voies romaines étaient construites avec le plus grand soin: après avoir creusé le sol à 1 mètre 40 centimètres, on mettait de larges pierres pour servir de base aux futures constructions. Cette première couche s’appelait, chez les Romains, statumen; la deuxième couche renfermait des cailloux, de la chaux et des briques qu’on mêlait ensemble; la troisième était un mélange, non moins solide, de gravier, de cailloux, de chaux ou de terre grasse; enfin, la dernière, ou summum dorsum, était composée de larges dalles; mais, quand ce n’était que des pierres brisées et de la chaux mêlées ensemble, elle portait le nom de pavimentum.
Sur les bords de ces vastes chemins qui parcouraient l’empire, on voyait, de mille en mille pas, des bornes milliaires pour indiquer les lieux parcourus et les noms de ceux qui les avaient élevées. Ces routes militaires, dont les rayons s’étendaient si loin, sortaient toutes de Rome pour rentrer dans Rome et au milieu du forum, leur commune origine. C’est là que s’élevait la plus célèbre des colonnes milliaires: elle était splendide, couverte d’or; elle reflétait les rayons du soleil; aussi la nommait-on milliarum aureum.