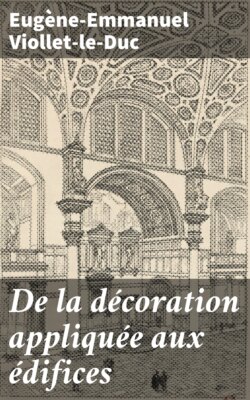Читать книгу De la décoration appliquée aux édifices - Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc - Страница 4
II
ОглавлениеSans remonter jusqu’au déluge, passons en Égypte, dans cette contrée unique au monde par sa constitution géodésique comme par les aptitudes particulières du peuple qui remplissait la vallée du Nil et avait atteint un haut degré de civilisation, alors que sur le sol gaulois nous passions probablement le temps à déjeuner et diner de nos semblables.
L’art égyptien est, pourrait-on dire, tout d’une pièce, et pendant que dans les autres contrées asiatiques, africaines ou européennes, on peut toujours trouver, si anciennes que soient les œuvres d’art laissées sur leur sol par les antiques civilisations, des liens, des traces d’influences, des origines communes, la terre d’Egypte semble n’avoir rien emprunté, rien vu, rien admis en dehors de ses limites; avoir tout créé, depuis l’architecture jusqu’aux derniers produits de l’industrie. Peut-être est-ce parce que sa population est arrivée, la première sur le globe, à la civilisation. Et cependant on peut affirmer, en même temps, que l’art de l’Égypte a peu rayonné et que si les influences asiatiques se démêlent dans tous les arts de l’antiquité sur le sol européen, celles de l’Égypte ne s’étendent guère au-delà de son voisinage immédiat.
Séparer, dans cet art égyptien, la sculpture et la peinture de l’architecture, c’est se livrer à une sorte de dissection qui a pour effet de détruire l’organisme, tant ces arts sont intimement unis, ne peuvent vivre l’un sans l’autre. Et cependant le procédé employé est des plus simples. La construction proprement dite est déduite des lois élémentaires de la statique: murs extérieurs élevés dans un plan vertical, ou légèrement inclinés vers l’intérieur pour concentrer les pesanteurs, piles ou colonnes isolées portant des plates-bandes et des plafonds en pierre. Mais ces piles ou colonnes, outre qu’elles affectent des formes empruntées à la flore, se couvrent, comme les murailles, de nombreux dessins en creux, c’est-à-dire intaillés aux dépens de la pierre et légèrement modelés, ou d’hiéroglyphes, c’est-à-dire d’inscriptions; le tout couvert d’un très léger enduit qui cache les joints et défectuosités du calcaire et qui est peint de couleurs brillantes.
Ainsi, la sculpture relief n’apparaît jamais sur ces nus de l’architecture et ne saurait en modifier les lignes d’une extrême pureté. Ce n’est qu’assez tard qu’elle se montre sur les chapiteaux et sur les dés qui les surmontent.
La sculpture n’est donc traitée chez les Égyptiens que comme une façon de tapisserie couvrant tous les nus, aussi bien ceux des murs que ceux des piles et colonnes, et elle appelle à son aide la peinture pour faire ressortir les moindres détails des intailles. Le bas-relief égyptien n’existe pas, car on ne peut donner le nom de bas-reliefs à ces dessins intaillés et à peine modelés; et cependant l’art de la statuaire avait atteint, en Égypte, un admirable développement dès les premières dynasties, mais il se liait intimement à l’architecture par la façon dont il était traité. Car si les intailles qui tapissent les parements des édifices représentent parfois des scènes très mouvementées, la statuaire proprement dite affecte invariablement des poses calmes et une certaine rigidité symétrique qui cependant n’exclut ni les délicatesses du modelé, ni la recherche de la nature. Ainsi contribue-t-elle à la composition architectonique. D’ailleurs–sauf lorsqu’il s’agit de représentations de divinités placées dans certains sanctuaires–la statuaire, toujours colossale, ne décore que les dehors des édifices, les cours, les portiques, les pylônes (figure I, page2). Les intérieurs ne sont décorés que par cette manière de tapisserie intaillée; et cela était parfaitement entendu, au point de vue de l’art.
En effet, par suite du mode de construction adopté, il n’était pas possible d’obtenir des salles spacieuses dans les deux sens. Si ces salles pouvaient avoir une longueur indéfinie, leur largeur était forcément subordonnée à la portée des matériaux formant plafond. Dès lors, la reculée n’existait que dans un seul sens. Si donc–ainsi qu’ils l’ont fait pour des portiques extérieurs–les artistes égyptiens avaient accolé des figures colossales à des piliers, celles-ci n’eussent pu être vues que de profil. Mais indépendamment de cette raison, l’esthétique des Égyptiens était trop délicate pour admettre dans des intérieurs des images colossales dont il eût été impossible d’apprécier l’ensemble, et qui n’eussent pas été à l’échelle de la décoration. Celle-ci, dans ces intérieurs, outre qu’elle n’est qu’une tapisserie, n’est pas grande d’échelle et compose une sorte de réseau coloré ne détruisant en rien les formes architectoniques.
Pour se rendre compte de l’effet que voulaient évidemment obtenir les artistes égyptiens, il faut, par la pensée, restaurer ces intérieurs de leurs grands édifices, tels que ceux de Karnac par exemple. La lumière du jour n’arrivait dans ces intérieurs que par de rares ouvertures ou seulement par les baies des portes. Mais telle est l’intensité, l’éclat des rayons solaires dans cette contrée, que le. moindre filet dérobé à ces rayons produit des reflets qui ont une puissance supérieure à la lumière diffuse des intérieurs, dans nos climats. Les décorations intaillées et colorées sur les parements prenaient ainsi un éclat dont il est difficile d’apprécier la valeur et la chaude tonalité, lorsqu’on n’a pas eu l’occasion de s’en rendre compte sur place. Et, certainement, ce mode de décoration était celui qui convenait le mieux, les conditions admises, c’est-à-dire le climat et la destination. Ces intérieurs, maintenus frais par l’épaisseur des murs et plafonds de pierre et par l’absence des rayons solaires directs, n’eussent pu recevoir une décoration encombrante et dont les saillies auraient produit quelques points lumineux et des ombres larges en perdant des surfaces considérables. Par suite du procédé admis, tout parement recevait suffisamment de lumière reflétée, pour laisser voir les formes générales et deviner les dessins délicats qui les couvraient.
Ajoutons que ces intailles peintes sont habituellement colorées chaudement sur des fonds blancs, et qu’ainsi elles pouvaient être vues jusque dans les parties les plus sombres.
Le système de décoration appliqué dans les intérieurs par les artistes égyptiens est donc bien compris et admirablement adapté aux conditions imposées par l’architecture (figure2, page3). Il n’était pas moins favorable aux grands effets à l’extérieur, et c’est en cela qu’on ne saurait trop admirer l’instinct merveilleux de ce peuple dans les choses d’art. Il n’est pas d’architecture qui ait adopté une décoration plus propre à profiter de l’intensité de la lumière solaire.
On sait que dans les climats où cette lumière est très vive et où la pureté de l’air est extrême, l’œil se rend difficilement compte des plans. Les demi-teintes se perdent et se confondent, soit avec les parties éclairées, soit avec celles laissées dans l’ombre. Celles-ci même sont tellement reflétées qu’elles prennent une transparence extraordinaire. Il convient donc, en pareil cas, d’adopter des partis très larges et d’éviter ces demi-teintes, destinées à être dévorées par la lumière. Aussi l’artiste égyptien procède-t-il par surfaces nettement accusées, et, s’il élève des colonnes dont les fûts cylindro-coniques donneraient des ombres molles, il a le soin de les entailler de filets et d’ornements vivement découpés qui accrochent des lumières brillantes et produisent des ombres nettes (figure3, page5).
Quant aux parements, les Égyptiens se gardent de les revêtir de décorations bas-relief ou ronde bosse. Ils les laissent unis, calmes, en les ornant seulement de ces intailles peintes qui produisent l’effet d’un riche tapis. Si parfois cependant la statuaire prend là une place, elle est colossale, portant de grandes ombres, et elle participe de l’architecture par le style hiératique qu’elle affecte (figure1).
Telle est la franchise d’allure de cet art égyptien, telle est la parfaite concordance de sa structure avec la décoration qu’elle revêt, telle est sa complète appropriation aux conditions imposées par le climat, que tout autre art importé sur les bords du Nil y fait piètre figure. Les quelques monuments grecs et romains élevés dans cette contrée semblent des tentatives puériles, sont écrasés, paraissent n’être que des conceptions maladives.
Mais, par cela même, cet art ne saurait être exporté; il tient au sol d’une façon si intime, il exprime avec tant de franchise une civilisation absolument étrangère à toutes celles que l’antiquité et les temps modernes ont vues naître ailleurs, que si on l’admire, comme une des plus merveilleuses manifestations du génie humain, on ne saurait le déplacer, pas plus qu’on ne peut déplacer le mont Blanc. Il n’en est pas moins un grand enseignement, et c’est pourquoi j’ai tout d’abord essayé de faire apprécier les principes qu’il a su appliquer avec une si surprenante clarté.
Il est un point sur lequel je crois devoir insister, savoir: la concordance de la décoration dans les édifices de l’antique Égypte avec le système de construction. Celle-ci, comme le montre la figure I, est élevée par assises de grès, de calcaire, parfois de granit ou syénite. Les colonnes ou piles monostyles sont rares. Mais cette structure est revêtue d’un enduit extrêmement mince sur lequel la peinture est appliquée; de telle sorte que l’appareil est invisible et que ces monuments paraissent être taillés dans un bloc homogène. Le climat de l’Égypte se prêtait à l’emploi de ce procédé, puisque ces enduits peints existent encore sur beaucoup de ces édifices. L’artiste égyptien décorant une maçonnerie n’avait donc pas à se préoccuper de cet appareil, et traçait son ornementation à travers les lits et joints de pierre des parements, puisque cet enduit léger devait couvrir le tout.
Cette manière de procéder était la conséquence de deux traditions: l’une qui rattachait ces constructions aux méthodes primitivement adoptées dans la vallée basse du Nil, et qui consistaient dans l’emploi du limon et de la brique crue mêlée aux roseaux, structure que l’on revêtait d’un enduit dans lequel il était facile de graver en creux l’ornementation; l’autre qui dérivait de la demeure taillée dans le roc, méthode employée dans le haut Nil.
Ainsi donc le constructeur élevait son bâtiment dans la forme voulue et en laissant tous les parements lisses, puis venait le dessinateur, intailleur-sculpteur, qui traçait sur ces surfaces les sujets, hiéroglyphes et ornements, comme il l’eût fait sur un tableau, et qui, ciselant tous les contours à angle vif, trouvait dans la partie enfoncée la saillie nécessaire au léger modelé des sujets.
Le stucateur et le peintre couvraient l’ouvrage ainsi préparé. C’est seulement à l’époque des dernières dynasties que les chapiteaux des colonnes reçurent des formes sculpturales empruntées à la flore du Nil, c’est-à-dire au lotus (figures4et5). Mais alors l’art égyptien entrait dans la période de décadence et perdait le grand caractère qu’il avait acquis sous les premières dynasties.