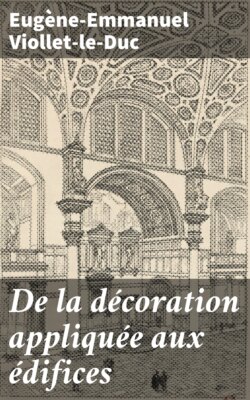Читать книгу De la décoration appliquée aux édifices - Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc - Страница 5
III
ОглавлениеPostérieurement à l’art primitif de l’Egypte se développait en Asie, sur les bords de l’Euphrate et du Tigre, un art qui, au point de vue où nous sommes placés, mérite une étude attentive. Nous voulons parler de l’art assyrien.
Bien que les Assyriens aient été en contact fréquent avec l’Égypte, que leur territoire ait été conquis en partie par ceux-ci, et qu’à leur tour ils aient envahi la vallée du Nil, il n’y a entre ces deux peuples non plus qu’entre leurs arts nul point de ressemblance.
Autant les matériaux propres à bâtir sont abondants sur les rives du Nil, autant ils sont rares sur les bords du Tigre et de l’Euphrate. Cette vaste contrée est un terrain d’alluvion composé d’un limon argileux très propre à faire de la brique crue ou cuite. Le climat, plus brûlant encore que celui de l’Égypte, présente une pureté égale; et à quelques semaines de pluies incessantes succèdent des mois pendant lesquels le ciel, dépourvu de nuages, présente un éclat sans pareil. Les Assyriens adoptèrent, dès une haute antiquité, un mode de construction parfaitement approprié à ces conditions climatériques.
Composant de ce limon, extrait des canaux d’irrigation qui réunissaient les deux fleuves, des masses énormes de briques, ils élevèrent, à l’aide de ces pains d’argile comprimée et séchée au soleil, des constructions colossales, des murs d’une épaisseur fabuleuse, et n’ayant pas, comme les Égyptiens, des pierres de grande dimension en abondance, ne pouvant par conséquent poser des plates-bandes d’un seul morceau sur ces murs, ils adoptèrent la voûte.
Ce mode de structure fut-il introduit sur le sol assyrien ou y prit-il naissance? Je ne chercherai pas ici à élucider cette question, fort difficile à résoudre d’ailleurs. Il doit nous suffire, pour l’objet que nous traitons, de constater le fait.
Ce qui est certain, c’est que l’emploi de ce système de construction était merveilleusement approprié au climat, en ce qu’il mettait les intérieurs dans les meilleures conditions d’habitation; fraîches en été, sèches pendant l’époque des pluies.
Mais dans ces intérieurs, ni piliers isolés, ni colonnes qu’il eût été impossible d’élever avec des briques crues ou même cuites. Ces intérieurs se composent uniquement de salles voûtées en berceau dans le sens de leur moindre largeur–et elles ne sont jamais très larges–afin de ne pas exercer de poussée sur les murs. D’ailleurs l’épaisseur de ceux-ci et le peu de hauteur relative de ces salles faisaient que ces poussées ne pouvaient avoir aucune action. Ces voûtes étaient couvertes par des terrasses sur lesquelles on venait prendre le frais pendant les nuits qui succédaient aux journées brûlantes de l’été. Des jardins même y étaient plantés et arrosés par des pompes. Les fameux jardins suspendus de Sémiramis ne sont autre chose qu’une plantation faite sur les voûtes d’un palais. Ils entretenaient la fraîcheur sur ces plates-formes exposées au soleil et fournissaient d’agréables promenades sans sortir de l’habitation.
Quelle était, en dehors de ces données générales, la décoration de ces demeures, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur? Il va sans dire que, comme en Égypte et dans tous les climats très chauds, on recherchait dans les intérieurs l’obscurité qui seule mettait les habitants à l’abri de la chaleur et des insectes; que par conséquent les ouvertures étaient très rares, et que le plus souvent la clarté du jour ne pénétrait que par les portes ou par de petits orifices percés dans les voûtes.
La sculpture ne pouvait prendre un rôle important dans des habitations ainsi construites. Quant à la peinture, ces murs de brique crue et cuite étant revêtus d’enduits, elle trouvait là de larges places pour se développer à l’aise.
Les Assyriens non seulement savaient cuire la brique, mais aussi la revêtir d’émaux colorés, et ils trouvaient ainsi des moyens décoratifs d’une grande puissance, inaltérables et dont l’exécution était facile. Cependant ils ne négligèrent pas pour cela la sculpture.
Allant chercher au loin des pierres, ils n’employèrent celles-ci (sauf exception) que pour en former les maçonneries basses, que pour revêtir les soubassements des intérieurs, les jambages des portes, et alors ils les couvrirent de sculpture. Ainsi, indépendamment de la solidité de l’ouvrage, ils évitaient les frottements qui eussent pu dégrader des matières fragiles et posées en petites parties, telles que sont les terres cuites émaillées.
Ces sculptures ne sont point intaillées comme celles de l’Égypte, mais bas-reliefs peu saillants, pour ne point offrir des aspérités gênantes, puisqu’elles étaient généralement posées sur le sol, en manière de stylobates, autour des pièces ou le long des entrées principales. Les voûtes si l’on en juge par celles qui restent entières et par les représentations de monuments sur les bas-reliefs, étaient plein cintre en brique crue enduite, avec têtes en brique cuite émaillée. Les murs, à l’intérieur comme à l’extérieur, étaient partiellement recouverts de briques émaillées en manière de frises, de stylobates, ou autour des portes (figure6).
Les bas-reliefs représentent parfois des coupoles ou demi-coupoles surmontant les terrasses des palais.
Il est évident que ces procédés de structure ne permettaient aucune décoration saillante sculptée à l’extérieur non plus qu’à l’intérieur. Les murs unis étaient seulement décorés, au moyen de ces faïences, de quelques lignes verticales figurant des portions de cylindres, comme des troncs d’arbre jointifs; le tout terminé par un bandeau et une balustrade découpée ou crénelée en brique. Toutefois on recouvrait ces murs de tons unis bleus, rouges, pourpres, jaunes, et les découvertes faites par V. Place à Ninive confirment à cet égard le dire d’Hérodote.
Ce système décoratif diffère autant de celui adopté par les Égyptiens que la construction elle-même.
Ce ne sont plus, comme en Égypte, des tapisseries semant sur les parements des dessins multicolores innombrables et produisant une harmonie par la multiplicité même des tons juxtaposés, tout en respectant rigoureusement les grandes lignes et les grandes surfaces. Chez les Assyriens, ce sont de larges parements couverts d’un enduit monochrome, avec quelques parties seulement diversement colorées par les émaux.
Au total, ces deux peuples avaient adopté un mode décoratif absolument approprié à leur structure, et nous verrons que ces traditions assyriennes se retrouvent encore dans la décoration monumentale des Persans, tant les choses changent peu en Orient.
L’aspect extérieur de ces constructions assyriennes était, comme ensemble, d’une grande simplicité, ainsi qu’on en peut juger par ce croquis (figure7), qui représente une portion du flanc sud du palais de Khorsabad. Les entrées seules étaient décorées de sculptures colossales (chérubins)à leur partie inférieure, et les archivoltes, de briques émaillées sur leur face. Des mâts, terminés par des boucliers dorés ou des palmiers de bois bas-reliefs, recouverts de feuilles d’or, surmontaient les piédroits et se détachaient sur le nu de la muraille.
Le parti décoratif qui consiste à faire valoir, par le contraste de grandes surfaces unies, certains points principaux sur lesquels alors la sculpture et la peinture sont prodiguées, appartient à ces contrées de l’Orient et a été adopté, plus tard, par les architectes dits arabes. Il est contraire au système égyptien aussi bien qu’au mode hindou, et il est évidemment provoqué par la nature de la structure, faite de pisé, de moellon enduit, ou de brique crue ou cuite; moyens qui ne permettaient pas l’emploi de la sculpture. Celle-ci était donc réservée pour certains détails que l’on tenait à faire ressortir, et notamment, comme il vient d’être dit, pour les soubassements.
C’est, pour nous, habitués aux arts européens, grecs et latins, une chose étrange de voir, posées sur le sol (figure6, page8), des frises sculptées ou des peintures émaillées, que nous mettons ordinairement sous les corniches. Ce mode paraît avoir été généralement adopté en Assyrie et dans la Perse, puisque les ruines de Persépolis nous montrent des processions sculptées sur les soubassements extérieurs des palais.
Résumons donc les procédés décoratifs de ces deux peuples: les Égyptiens et les Assyriens.
L’Égyptien adopte une structure de pierre dont les formes, les principes, sont très simples, mais il couvre cette surface d’un réseau décoratif intaillé et coloré, que l’on ne saurait mieux comparer qu’à une tapisserie ou une étoffe multicolore, laquelle ne modifie en rien ces formes, ne dérange en aucune façon la pureté des profils.
Chez l’Assyrien la pierre est rare, l’argile abondante; l’Assyrien construit en terre, ne se sert de la pierre que pour les soubassements; il sculpte alors cette matière rare, tandis qu’il revêt partiellement d’émaux sa construction de terre crue ou cuite, se contentant de couvrir le reste des parements d’un enduit qu’il peint, le plus souvent, de tons unis. Dans l’un comme dans l’autre cas, la décoration est parfaitement logique et appropriée au mode de structure et elle produit par cela même un effet puissant.