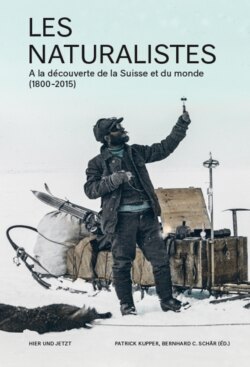Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 25
BERNHARD C. SCHÄR ÉVOLUTION, SEXE ET RACE On the Origin of Species de Darwin dans la traduction de Clémence Royer
ОглавлениеToute politique devrait se baser sur le principe suivant: «Les hommes sont inégaux par nature».1 C’est ce qu’écrivait Clémence Royer en 1862 dans la préface de sa traduction de l’ouvrage de Charles Darwin On the Origin of Species (en français: De l’origine des espèces). Dans cet ouvrage paru en 1859 et qui fera date, le naturaliste anglais expose pour la première fois sa théorie de l’histoire de la nature. Selon lui, les animaux et les plantes n’ont pas été créés par Dieu, mais par la «sélection naturelle». Dans la concurrence à laquelle ils se livrent pour les ressources naturelles limitées, seules les espèces les mieux adaptées à leur environnement survivent. De ce fait, elles se développent et se transforment constamment.2
C’est à la Bibliothèque municipale de Lausanne que la philosophe française Clémence Royer (1830-1902) a traduit le livre de Darwin, y ajoutant non seulement de nombreux commentaires sous forme de notes en bas de page, mais aussi une préface de 60 pages. Celle-ci allait susciter presque autant de remous dans le monde francophone que la théorie de Darwin elle-même. La raison en était que la traductrice se hasardait à «beaucoup d’hypothèses», 3 comme elle l’explique dans sa préface, «beaucoup plus que M. Darwin»:
«La loi d’élection naturelle appliquée à l’humanité, fait voir avec surprise, avec douleur, combien jusqu’ici ont été fausses nos lois politiques et civiles, de même que notre morale religieuse.»4
La morale de «notre ère chrétienne», poursuit-elle, se distingue par une «exagération de cette pitié, de cette charité, de cette fraternité» à l’égard des plus faibles, des malades et des pauvres. Ceux-ci «pèsent de tout leur poids sur les bras valides» et «prennent à eux seuls plus de place au soleil que trois individus bien constitués!»5
«Que résulte-t-il de cette protection exclusive et inintelligente accordée aux faibles, aux infirmes, aux incurables, aux méchants eux-mêmes, à tous les disgraciés de la nature? C’est que les maux dont ils sont atteints tendent à se perpétuer et à se multiplier indéfiniment; c’est que le mal augmente au lieu de diminuer, et qu’il tend à s’accroître aux dépens du bien.»6
En 1862, bien avant que le terme d’eugénisme ne soit inventé, 7 Clémence Royer est l’une des premières intellectuelles à formuler de telles conclusions sur la théorie de Darwin. Bien qu’elle ne l’écrive pas explicitement, ses remarques suggèrent que dans cette «lutte pour l’existence», on ferait peut-être mieux de laisser mourir les faibles, les malades et les personnes à charge ou de les empêcher de se reproduire.
Ill. 1: La Bibliothèque de Lausanne vers 1900.
Ill. 2: Page de titre de la première traduction du livre de Darwin. Pour la deuxième édition française de 1866, Clémence Royer remplacera, à la demande de Darwin, le terme de «progrès» par celui de «transformation» dans le sous-titre. La troisième édition, parue en 1869, sera publiée sans l’autorisation de Darwin.
L’attitude de Clémence Royer reflétait, d’une part, l’une des caractéristiques fondamentales de la pensée scientifique de son temps. A une époque où, en Europe, les femmes n’avaient pas le droit d’exercer des charges politiques et n’étaient pas non plus admises dans les universités, Clémence Royer constituait cependant une exception. C’était l’une des rares femmes du monde francophone à se mesurer intellectuellement sur un pied d’égalité avec les plus grands théoriciens de son temps. Dans ces débats, elle défendait un point de vue clairement féministe8 qui se distingue des nombreuses théories de ses contemporaines (et à plus forte raison de celles des hommes de science de son époque), mais aussi des théories féministes des générations suivantes. Tandis que sa compatriote, Simone de Beauvoir, presque un siècle plus tard, proclamera que l’on ne naît pas femme, mais qu’on le devient à cause de la société, 9 Clémence Royer soutient que les êtres humains sont nés soit hommes, soit femmes, et sont «inégaux par nature». Ce qu’il y a d’original dans son argumentation, c’est que cette inégalité naturelle serait la raison pour laquelle les femmes (tout au moins celles de la «race blanche», comme nous le verrons) doivent bénéficier des mêmes droits et chances que les hommes. Elle développera cette opinion dans une théorie de l’évolution féministe. Ses collègues masculins ignoreront en tout cas largement ses positions, ce qui vaudra à Clémence Royer de tomber rapidement dans l’oubli après sa mort.10 Au XXe siècle, sa mémoire sera régulièrement évoquée, tout d’abord dans les revues féministes.11 A partir des années 1980, l’histoire des femmes et des genres finiront par s’établir, et une première biographie scientifique de Clémence Royer paraîtra bientôt, celle de la philosophe Geneviève Fraisse, suivie en 2002 par celle de l’historienne des sciences américaine Joy Harvey.12
L’objectif principal des deux biographes était de reconstituer la contribution de la naturaliste à la formation de la théorie féministe et à la biologie, et de lui rendre hommage. Dans le présent article, nous mettrons en avant un autre aspect de la pensée de Clémence Royer, qui n’a, certes, pas été ignoré dans la littérature, mais qui a été traité accessoirement, à savoir le racisme. C’était l’un des principaux piliers de son féminisme, mais aussi de sa réception de Darwin, qui en était imprégnée.13 En même temps, nous donnerons un aperçu du rôle de la Suisse comme plaque tournante entre les communautés scientifiques française, allemande et anglaise. Des théories du XIXe siècle qui jouèrent un rôle crucial et ont eu jusqu’à ce jour de l’influence sur nos sociétés, ont transité par la Suisse. Il s’agit de la théorie de l’évolution, des races et des sexes.