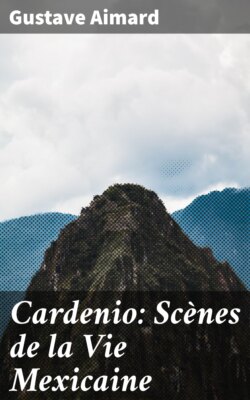Читать книгу Cardenio: Scènes de la Vie Mexicaine - Gustave Aimard - Страница 7
IV
ОглавлениеLe Cœur-Bouillant entre en scène.
Le défrichement dont était propriétaire don Melchior de Bartas était, ainsi que nous l'avons dit, situé à deux lieues tout au plus de l'immense territoire, ou plutôt du vaste désert, propriété exclusive des Indiens comanches et apaches qui le parcouraient dans tous les sens, et y chassaient, et s'y battaient en toute liberté, sans craindre d'être inquiétés par d'autres blancs que les quelques chasseurs, Canadiens ou Américains du Nord, qui y tendaient leurs trappes, et avec lesquels parfois ils avaient maille à partir.
Le domaine du Mexicain était très vaste. Il s'étendait sur les bords du Río Nueces, sur une étendue de plusieurs lieues.
Cette plantation était coupée par plusieurs forêts, des chaparrales ou maquis mêlés à de verdoyantes prairies couvertes d'une herbe drue haute de six à huit pieds, arrosées par de nombreux cours d'eau, et dans lesquelles paissaient en liberté, sous la surveillance de quelques peones et vaqueros, une quantité innombrable de chevaux et de taureaux presque sauvages.
Çà et là s'élevaient, abrités par la pente des collines ou des chaos de rochers, quelques ranchos et jacales servant d'habitation aux serviteurs du planteur; puis on apercevait de grands défrichements de cafés, de cannes à sucre, de sandías ou melons d'eau, de patates douces, de longs bois de cotonniers, et au milieu de cette nature exubérante, de cette admirable végétation, on voyait incessamment bondir et se jouer, comme à plaisir, des assathas ou longues-cornes, des daims, des bigornes, des antilopes, puis aussi des bisons, des coyotes ou loups rouges des prairies, des jaguars, des panthères et même des ours; des myriades d'oiseaux aux plumes diaprées de mille couleurs voltigeaient et chantaient sur toutes les branches des arbres, au milieu des opossums, des écureuils gris et des singes de toute sorte et de toute espèce, qui sautaient et gambadaient gaiement en se poursuivant, du pied au sommet des arbres.
Sur les bords fangeux des marais et des rivières on voyait, vautrés dans la vase et étendus au soleil, de hideux caïmans, qui semblaient contempler, d'un air mélancolique, les magnifiques cygnes noirs qui se laissaient nonchalamment aller au courant de l'eau, tandis qu'au plus haut des airs les gypaètes, les urubus et les condors formaient d'immenses cercles, en poussant des cris saccadés et discordants.
Ce défrichement, plus grand qu'un de nos départements de France, était la propriété d'un homme qui, cependant, dans ce pays où les fortunes sont si considérables, ne passait pas pour riche.
La surveillance de tout ce territoire était confiée, ainsi que nous l'avons dit, malgré son jeune âge, à Cardenio, qui avait sous ses ordres deux majordomes, véritables jinetes, hombres de caballo s'il en fut, dont la vie se passait à cheval, qui mangeaient, buvaient et dormaient sur la selle; qu'il était presque impossible de voir à pied, et qui étaient presque aussi sauvages que les hommes et les animaux qu'ils étaient chargés de surveiller.
L'habitation principale, le domaine de la famille de Bartas, s'élevait à l'angle formé par le confluent du Río Nueces et d'une rivière dédaignée ou plutôt ignorée par les géographes, et à laquelle les habitants de ces contrées, à cause de la couleur de ses eaux, avaient donné le nom de Río Bermejo.
Cette habitation était grande, construite à la mode du pays, c'est-à-dire en double clayonnage en roseaux tressés très fin, recouvert à l'intérieur de toiles fortement tendues, de façon à laisser la libre circulation de l'air, tout en empêchant la vue et arrêtant les insectes, dont les myriades innombrables bourdonnaient sans cesse alentour.
Une partie des appartements, ceux dans lesquels on habitait pendant le jour, c'est-à-dire au moment de la plus grande chaleur, étaient construits en sous-sol; il fallait descendre vingt-cinq marches pour y parvenir. Les chambres à coucher se trouvaient, au contraire, à l'entresol. Le toit se terminait en terrasse à l'italienne; à droite et à gauche de l'habitation principale, et en formant pour ainsi dire, les ailes rentrantes, se trouvaient d'autres corps de bâtiment, construis à peu près sur le même modèle, mais plus simples et sans ornements. Ces bâtiments servaient, ceux de droite de logement aux serviteurs attachés plus particulièrement au service de la famille et de magasins pour les provisions d'hiver; ceux de gauche contenaient une raffinerie, des ateliers, des étables pour les vaches laitières et des corrales pour les chevaux et les mules, ainsi que des hangars renfermant les chariots et les wagons.
A l'angle même du confluent s'élevait une tour de vingt-cinq mètres de circonférence sur quarante de haut; cette tour était construite en troncs d'arbres équarris, empilés les uns sur les autres, retenus entre eux par des crampons de fer. Elle avait deux étages souterrains, dont le plus bas communiquait par un couloir à la rivière; trois étages au-dessus du sol, éclairés par des meurtrières et garnis de pierriers et d'espingoles de la force de huit balles à la livre. Sur la plate-forme crénelée, une caronade de quatre, montée sur affût à pivot, était en batterie.
Cette tour était la forteresse de l'habitation, et servait de refuge aux colons en cas d'attaque des Indiens; ses appartements étaient meublés; elle renfermait toutes les munitions de guerre et des vivres pour un mois.
A droite et à gauche de la tour, et appuyés contre elle, s'élevaient, sur le bord même de la rivière, des retranchements en troncs d'arbres, hauts de douze pieds, fortement retenus entre eux par des crampons de fer et assurés par un double revêtement en terre. Ces retranchements enclavaient complètement l'habitation et enfermaient même le jardin ou huerta, dans une circonférence de plus de huit mille mètres.
A trois portées de fusil de l'habitation, il n'y avait ni un arbre ni un buisson qui pût servir d'abri ou d'embuscade à l'ennemi.
Chaque nuit des sentinelles étaient placées aux retranchements, et un factionnaire veillait au sommet de la tour, prêt à sonner la cloche d'alarme à la première apparence de danger.
Telle était la propriété nommée on ne sait pourquoi, l'Étang-aux-Coyotes, et appartenant à don Melchior de Bartas.
Le jour où commence cette histoire, vers sept heures et demie du soir, au moment où l'orage commençait à se déchaîner avec sa plus grande fureur, trois personnes étaient réunies dans une chambre à coucher de cette habitation.
Ces trois personnes étaient: don Melchior de Bartas, sa femme et, étendue tout habillée sur un lit, une jeune enfant de treize ans, leur fille.
Don Melchior avait, à cette époque, un peu moins de soixante ans; c'était un homme encore vert, de haute talle, à la physionomie altière, aux traits ascétiques, pâles et émaciés par la souffrance morale plutôt que par l'âge et les privations; ses cheveux, et sa barbe qu'il portait entière, et tombant en éventail sur sa poitrine, étaient d'une blancheur de neige.
Il se promenait de long en large, avec agitation, dans la pièce; parfois il s'arrêtait, jetait un regard douloureux sur sa fille, puis il poussait un soupir, baissait la tête et reprenait sa marche saccadée.
Doña Juana de Bartas, beaucoup plus jeune que son mari, car elle atteignait à peine la quarantaine, conservait encore les restes d'une beauté qui quinze ans auparavant, avait dû être sans rivale. Assise au chevet de sa fille, dont elle tenait une des mains dans les siennes, son regard fixé sur le visage de la malade semblait épier chacune de ses souffrances; des larmes coulaient sur ses joues pâlies, sans qu'elle songeât à les essuyer.
Flora de Bartas avait treize ans à peine. En France ou dans n'importe lequel de nos pays du Nord, ce n'eût été qu'une enfant; dans ces contrées équatoriales, où la sève est si puissante, la nature si précoce, c'était une jeune fille.
Elle était grande, admirablement faite; chacune de ses formes était dessinée avec une perfection exquise; jamais le Titien, les Carrache, le divin Anzio lui-même, n'ont rêvé pour leurs madones un modèle aussi parfait. C'était la femme tout entière, avec ses lignes un peu heurtées, sévères et légères à la fois, droites, et cependant brisées, s'harmoniant pourtant pour compléter un tout presque idéal, diaphane pour ainsi dire, et d'une perfection telle que Dieu seul pouvait le concevoir et l'exécuter. On aurait dit un de ses anges oubliés sur la terre et qui se souviennent encore des ailes qu'ils ont laissées au ciel. Ses yeux alanguis par la douleur, demi-clos, se fixaient avec une expression d'affection rêveuse sur ceux de sa mère. Sa bouche, entr'ouverte, gardait les traces d'un dernier sourire.
Un silence de mort régnait dans cette salle.
Tout à coup le tintement lointain d'une cloche résonna deux fois.
—Qu'est-ce cela? murmura don Melchior en tressaillant.
Doña Juana ne fit pas un mouvement, ne leva pas les yeux; tout son être était concentré sur sa fille; hors d'elle, elle ne voyait, n'entendait rien.
Une porte s'entr'ouvrit doucement; une tête brune aux traits énergiques et profondément accentués, passa dans l'entrebâillement.
—Qu'y a-t-il, don Ramón? demanda le planteur.
—Venez, répondit à demi-voix l'homme auquel on avait donné ce nom, et qui était un des majordomes de l'habitation.
Don Melchior posa un baiser sur le front moite de Flora.
—Merci, père, répondit doucement l'enfant d'une voix suave et harmonieuse comme le chant du centzontle, le rossignol mexicain, tandis qu'un charmant sourire s'épanouissait sur ses lèvres pâlies.
Don Melchior quitta la chambre et referma sans bruit la porte derrière lui.
Don Ramón l'attendait dans une grande pièce à côté, servant de salon ou, comme disent les Américains, de parlour.
Don Ramón avait trente-deux ou trente-trois ans à peine; il était né dans la famille de Bartas, pour laquelle il professait un dévouement à toute épreuve. Bien que sa taille fût à peine au-dessus de la moyenne, ses formes trapues, la grosseur de ses membres, sur lesquels saillaient des muscles d'acier, la largeur presque difforme de ses épaules, dénotaient une vigueur extraordinaire; il avait les jambes arquées, comme tous les hommes dont la vie se passe à cheval; il portait suspendu au côté gauche un machette, dont la lame était passée nue dans un anneau de fer; le manche de corne d'un long couteau sortait de l'extrémité supérieure de sa botte droite.
—Qu'y a-t-il, don Ramón? Pourquoi ce double coup de cloche? demanda le planteur.
—Il y a, mi amo, répondit le majordome, que des étrangers demandent l'hospitalité à l'habitation; ils attendent votre réponse à la barrière.
—Pourquoi ne les a-t-on pas introduits aussitôt? Par un temps comme celui-ci, l'hospitalité me serait demandée par mon ennemi le plus cruel, que je ne me reconnaîtrais par le droit de la lui refuser.
—C'est que, mi amo... répondit le majordome avec embarras.
—C'est que... quoi? fît le planteur avec une nuance d'impatience.
—Eh bien, mi amo, ces voyageurs sont des Indiens.
—Qu'importe que ce soient des Indiens? Ne sont-ils pas des hommes? Doivent-ils plus que d'autres rester exposés aux fureurs de l'ouragan?
—C'est vrai, mi amo, vous avez raison; mais l'homme qui vous demande l'hospitalité est un de vos ennemis les plus acharnés, un chef apache; quatre guerriers l'accompagnent; en un mot, c'est le Cœur-Bouillant.
—Le Cœur-Bouillant! murmura le planteur d'une voix profonde.
Puis il reprit au bout d'un instant:
—Que vient-il faire ici? Qu'importe, après tout? Les lois de l'hospitalité ne sauraient être méconnues. Amenez ici le Cœur-Bouillant; faites conduire les quatre guerriers dans le logement des hôtes; que tout ce qu'ils demanderont leur soit donné. N'oubliez pas surtout d'user envers ces hommes, qui sont vos hôtes, de la plus grande courtoisie! Allez! J'attendrai dans cette pièce. Dites à Pedrillo d'apporter les rafraîchissements nécessaires.