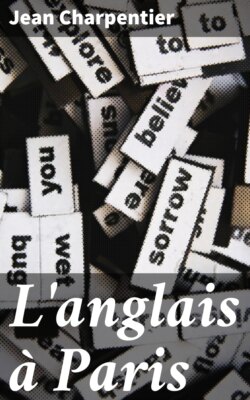Читать книгу L'anglais à Paris - Jean de Charpentier - Страница 8
ОглавлениеDES VINS ET DES BIÈRES
L’Angleterre ne produit pas de vin, mais avec ses guinées, qu’elle ne ménage jamais pour se procurer le meilleur de toutes choses, elle enlève aux pays vignobles les vins de leurs premiers crûs. C’est à Londres que se boivent le château-margaux, le château-la-rose, le château-laffite, le chambertin, le sauterne des meilleures années. L’aï, le pomard, le côte-rôtie, l’hermitage, prennent le même chemin, au grand discomfort des gourmets français qui ne sont pas millionnaires.
Ce que boivent habituellement les Portugais, nous l’ignorons, mais ce ne peut être, à coup sûr, leur vin de Porto, port-wine, qui circule sur toutes les tables anglaises et en telle abondance qu’on se demande comment le petit royaume de Portugal peut produire une si énorme quantité de ce vin délicieux, mais capiteux au plus haut degré. Quand parfois les Portugais veulent boire du vin de leur crû, ils doivent, dit-on, l’acheter aux Anglais. C’est le traité de Méthuen qui a joué aux Portugais ce mauvais tour, en les obligeant à livrer à l’Angleterre tout ce qu’ils ont de meilleur. Le sherry, «Xérès,» est au Porto ce qu’un frère cadet est à son aîné, en Angleterre où fleurit le droit d’aînesse: on vide une bouteille de port avec un lord, un personnage important dont on reçoit la visite; on entame une bouteille de sherry pour un ami, un égal, un homme qui n’a que deux cent cinquante mille livres de rentes. Rien que cela! dites-vous; je me croirais fort riche si j’avais deux cent cinquante mille livres de rentes. Et moi aussi parbleu! si je devais vivre à Paris. Mais à Londres cela ne fait que dix mille livres sterling de revenu; or, dix mille livres sterling, dans ce pays, classent un homme parmi les moins riches entre les riches. Au-dessous de dix mille guinées, guineas, on est pauvre; à partir de cinq cent mille francs jusqu’à sept millions de rentes, on est riche: ce qui vous explique comment notre bordeaux, claret, et notre bourgogne, burgundy, passent le détroit de la Manche pour aller égayer le spleen britannique. C’est à tort que le spleen, ce mal étrange, national et aristocratique, est attribué au ciel sombre, au climat brumeux, aux noires vapeurs du charbon de terre que vomissent en épais tourbillons des millions de cheminées. Sa vraie cause, sa cause unique, c’est l’excès de la richesse. Quels désirs, quelles espérances, quelles illusions, peut avoir l’homme de trenteans qui, depuis son enfance, n’a eu qu’à dire: «Je veux cela» pour l’avoir à l’instant? Luxe de table, chevaux, châteaux, voyages, bayadères de l’Inde, almées de Constantinople, houris du demi-monde qui habite le quartier Bréda, l’archimillionnaire anglais a tout essayé, tout goûté, tout épuisé jusqu’à la lie, et cela, à l’âge où les autres hommes commencent à jouir du fruit de leurs travaux et de leurs talents. Aussi la vie pour lui, qui n’en est qu’à moitié chemin, n’a plus ni lointain, ni mystère, ni promesses; il la sent lourde, froide, sombre, insupportable: il a le spleen.
Spleen! dégoût de la vie et de tout ce que la vie offre à l’homme pour se faire oublier, quand tu résistes au généreux nectar mûri sous les pampres de France, au champagne surtout, ta dernière ressource est d’aller dormir à l’ombre des cyprès!
Voici pourtant comment un poëte anglais a jugé les vins de France; mais ses vers, il faut le dire, ne sont chantés que par les Anglais, qui n’ont que de la bière à boire et qui ne sont pas assez riches pour avoir un cuisinier français:
Let not the pert cook from Gallia dress our food,
Nor her burning spirits foul our generous blood,
Shook our strong nerve, provoke our mind to strife,
And rob us of half our length of life.
Ne laissons pas le cuisinier gaulois apprêter notre dîner,
Ni les vins brûlants de la Gaule corrompre notre généreux sang;
Ils amollissent les nerfs, excitent les esprits aux révoltes
Et accourcissent de moitié le fil de la vie de l’homme.
Si tous les compatriotes de l’auteur avaient, pour nous, l’obligeance de suivre ces conseils, nous payerions moitié moins cher nos bordeaux et nos bourgognes.
En retour des bons vins qu’elle prend à la France, à grand renfort de guinées, que nous donne l’Angleterre? Des bières variées, various beers, qui ne sont pas sans mérite, mais d’un mérite de troisième classe sur la table d’un gourmet.
Il y en a de toutes les couleurs: bières blanches, brunes, noires, et pour tous les goûts, sans doute afin qu’on n’en dispute pas, comme le recommande le proverbe.
Le tonique houblon et l’orge germée et grillée, appelée malt, sont les deux substances dont sont faites les bières connues sous le nom de porter et de stout.
Elles doivent à l’orge, brûlée comme du café, leur couleur noire et leur odeur forte. La force musculaire des ouvriers anglais peut être justement attribuée aux qualités hygiéniques d’une boisson faite de substances fortifiantes, telles que le houblon et l’orge. Les autres peuples, dit l’Anglais, mangent leur pain; nous buvons le nôtre. Que, par reconnaissance, les Anglais donnent donc à leurs bières les noms glorieux de splendides, brillantes, pyramidales, célèbres et sans pareilles; cela se conçoit. Mais qu’ils leur décernent la gloire d’avoir gagné la bataille de Waterloo, voilà ce que nient à la fois les Français et les Prussiens de Blücher. «A Waterloo, le vin rouge de fureur et bouillant d’audace s’est élancé comme un fleuve débordé sur la bière, mer puissante qui l’a absorbé et englouti dans son sein.»
Telle est la légende britannique de ce mémorable désastre.
Les noms de porter et de stout donnés à ces bières viennent de la grande consommation qu’en font les portefaix, porters, et les ouvriers généralement robustes, stout workmen. — Le stout n’est qu’un double porter, dont l’usage modéré est un excellent réparateur pour les estomacs faibles.
Un brasseur de Dublin, M. Guinness, a été créé baronet pour l’excellence de ses stouts, qui sont aux autres ce que le moët est aux champagnes ordinaires. Le porter et le stout de MM. Ind et Coope, qui sont de bonne qualité, se trouvent aujourd’hui dans tous les cafés de Paris.
Outre ces bières fortes, il s’est introduit chez nous, depuis trois ou quatre ans, des bières légères, mais horriblement capiteuses, appelées pale ales, bières blanches. Un bouchon fortement enfoncé et attaché pour plus de sûreté avec un fil de fer, retient prisonnière, dans de petites bouteilles au col rentré dans les épaules et très-épaisses, cette effervescente boisson. A peine délivrée de ses entraves, elle s’élance en un jet d’écume pétillante qui remplit aux trois quarts le long verre où elle ne séjourne qu’un moment. Sa couleur ambrée, son amertume acidulée, l’éveil soudain qu’elle donne à l’estomac et à la tête, vous font dire tout d’abord: Voilà une bière délicieuse! Ce qui est vrai pour un verre ou deux; mais gare au troisième et encore plus au quatrième! Il en sortirait une gaieté délirante, qui, comme toutes les gaietés de ce genre, fait payer tribut à la tête et à la lucidité de l’esprit. Le houblon, base du pale ale, est un tonique excellent; mais, pris à haute dose, il devient par trop exhilarant.
Méfiez-vous donc de la compagnie prolongée de ces blondes étrangères, agréables, mais un peu perfides, car elles viennent d’Albion. Partout leurs noms, écrits en noir sur papier jaune, attirent les regards du Parisien sans défiance: Bass’ pale ale, ind and Coope’s pale ale; c’est-à-dire: bière blanche brassée par M. Bass, qui, en ce genre, est le plus grand nom de l’Angleterre, et par MM. Ind et Coope, dont les produits sont moins célèbres.
Il y a aussi le scotch ale, bière blanche écossaise, qui se vend à Paris, mais qui est tellement forte que les têtes écossaises, dures comme le granit, peuvent seules l’ingurgiter sans mollir. On évalue à douze cents millions de francs la consommation annuelle de la bière dans les trois parties du royaume-uni: Angleterre, Écosse et Irlande. Aussi les principaux brasseurs, Guinness, Bass, Barclay, Henri Meuxi et Goding, ont-ils des fortunes colossales de deux à trois millions de revenu. Les douze grands brasseurs anglais sont appelés les douze Césars de la tonne.
Dans quelques tavernes anglaises de Paris on trouve le rum anglais, rhum de la Jamaïque, le gin et le whisky. Ce rum, beaucoup plus fort que le nôtre, est moins agréable. Le gin, eau de genièvre, avec de l’eau chaude et du sucre, fait un grog excellent. Le gin pur, tel que le boit le peuple anglais, est, à lui seul, aussi fatal à ce peuple que son aristocratie, et que les sept plaies d’Égypte le furent aux sujets de Pharaon. Pour boire du gin, le mari délaisse sa femme, la mère délaisse ses enfants, et quelquefois les vend; vols, meurtres et incendies se commettent pour satisfaire la passion du gin. Le samedi soir, des foules hâves et déguenillées encombrent les gin-palaces, les palais du gin, tavernes richement décorées, où le gain de la semaine va emplir les tiroirs du publican, «tavernier.» Mais le logement de la famille est vide de meubles, de pain, d’union et de bonheur. Rentrés à minuit auprès du foyer éteint, les malheureux se livrent à des querelles et des luttes féroces. Nos anciennes barrières de Paris n’ont jamais offert de si navrants spectacles.
Un homme d’État moraliste et statisticien dit que la quantité de gin bue annuellement par le peuple anglais suffirait pour mettre à flot un vaisseau de ligne.
Le whisky, liqueur obtenue par la distillation des grains, est la consolation nationale et privée des Écossais et des Irlandais. Maux politiques et domestiques sont noyés, oubliés dans les flots de ce spiritueux limpide et blanc comme l’eau de source. Le whisky de M. Kinahan, distillateur de Dublin, est fameux par sa qualité et aussi par la distinction aristocratique dont l’a honoré un grand personnage. Un lord-lieutenant ou vice-roi d’Irlande (le feu duc de Richemond, je crois), appréciant l’excellence des produits de M. Kinahan, nomma ce distillateur whisky purveyor by appointment to the Lord Lieutenant, «fournisseur breveté de whisky du lord-lieutenant.» L’industriel mit, selon l’usage, cette distinction en belles lettres d’or sur un écusson dont il orna la porte de son magasin. Mais il demanda en outre, et obtint le rare privilége de mettre sur ses étiquettes et le cachet de ses bouteilles les armes de la maison de Richemond, surmontées d’une couronne ducale, ayant pour support deux L.L. qui signifient lord-lieutenant. Ce whisky anobli, élevé à la dignité ducale, ne pouvait manquer de faire fortune parmi la noblesse d’abord, puis parmi le peuple, imitateur passionné et insensé de la noblesse.
Public house. Cabaret où l’on débite de la bière et des spiritueux. Quelques-uns sont décorés avec un grand luxe, et derrière leurs bars, «comptoirs de zinc poli,» sont de belles filles parées comme pour une noce, qui servent gravement les consommateurs en habits noirs ou en guenilles. Ces Hébés s’appellent bar-maids, «filles ou vierges du comptoir.» Elles excellent à faire le grog, mélange d’eau de vie ou de rhum, d’eau chaude et de sucre.
L’usquebaugh, scubac, est une liqueur spiritueuse et safranée, en usage chez les Écossais.
Dans les oyster-rooms, «restaurants où l’on ne sert que des huîtres,» des crabes, des homards, des crevettes et du saumon salé, on trouve le soda water, «eau de seltz,» et le ginger beer, bière faite avec de la poudre de gingembre, de l’acide citrique et du sucre. C’est un breuvage rafraîchissant et fort agréable.
Privés du don de la vigne, les Anglais tâchent de s’en consoler par toutes sortes de succédanés. Ils font du vin avec des oranges, des baies de sureau, des groseilles à maquereau, des primevères; mais tous ces breuvages ne valent pas notre vin de Suresne.