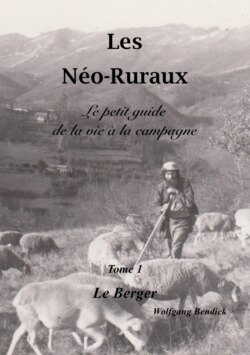Читать книгу Les Néo-Ruraux Tome 1: Le Berger - Wolfgang Bendick - Страница 7
EXPRESSO À PARIS
ОглавлениеLudwig était d’accord pour m’accompagner pendant un mois dans les Pyrénées et m’aider à rénover la maison. Nous avions décidé de partir le mardi. Mais nous nous rendîmes compte qu’il s’agissait du mardi gras. Nous trouvions trop risqué de partir ce jour-là, avec tous ces conducteurs éméchés qui se trouveraient alors sur la route. Nous décalâmes donc le départ d'un jour. Et c’était mieux ainsi, comme en témoignaient les nombreuses épaves de voitures sur le trajet !
Avec les affaires du déménagement dans le combi et la remorque, il n’était pas recommandé de traverser la Suisse, même si c’était le chemin le plus court. En longeant le Lac de Constance, nous arrivâmes dans la Forêt Noire. Le brouillard s’étendait dans les vallées et ne nous permettait pas d’avancer bien vite, en particulier parce que nous devions faire un grand détour pour éviter Schaffhausen, l’enclave suisse. Nous avions chargé au maximum notre combi à plateau Volkswagen, avec tout ce dont nous n’avions actuellement pas besoin chez nous. De plus, nous avions attaché une échelle en bois longue de six mètres sur la bâche, un cadeau de mon père, car mes parents avaient déménagé dans une maison de plain-pied. Derrière, dans la remorque, se trouvaient la motofaucheuse et le vieux treuil pour foin équipé de trois cent mètres de câble, recouverts d’autres appareils, le tout soigneusement arrimé par des cordes.
Nous traversâmes un petit village. « Regarde, là ! », s’écria Ludwig. « La boulangerie ? », rétorquai-je d’un air interrogateur. « J’ai passé la nuit du nouvel an précisément dans cette vitrine, ou plutôt sur son rebord ! » « Ce n’était pas vraiment le meilleur endroit ! » répondis-je. « Si, parce que de la grille qui se trouvait au sol juste devant, émanait de l’air chaud, sans doute parce qu’elle se trouvait au-dessus des fourneaux. » « Je peux m’imaginer quelque chose de mieux ! Tu revenais d’une fête, ou alors pourquoi... ? » « Non ! La fête battait son plein à la maison, et j’ai eu envie de boire un expresso à Paris, vite fait. Tu te souviens, nous y étions tous allés à l’époque, avec ton premier combi VW... Et du coup je me suis posté au bord de la route et j’ai tendu le pouce. À deux heures du matin j’étais ici. Et puis plus rien ! Lorsque la boulangerie a ouvert, j’ai acheté un petit pain chaud et je me suis posté de l’autre côté de la route ! »
À Huningue, nous sommes passés au-dessus du Rhin et voulûmes passer la frontière. Il y avait un gros chantier. Apparemment le poste de frontière était en train d’être modernisé pour la circulation des poids lourds. À force de panneaux de déviation et du brouillard, nous avions sûrement dû rater la douane et vîmes soudain le premier panneau d’une localité française au bord de la route. « Appuie sur le champignon et continue ! », suggéra Ludwig. « Évidemment ! Ça nous a évité des ennuis ! », acquiesçai-je.
Au bout de deux jours, nous arrivâmes au camping où nous attendait notre caravane. « Achetez, achetez ! », ainsi nous accueillit le propriétaire, « Le franc français a chuté, le mark allemand a pris de la valeur ! » Avait-il oublié que nous avions déjà acheté il y a deux semaines ? Nous nous procurâmes quelques bouteilles de vin rouge, du fromage et des baguettes et célébrâmes notre arrivée en France. Tôt le lendemain matin, nous nous rendîmes dans le village près duquel se trouvait notre ferme. J’étais impatient de pouvoir poser les pieds sur nos propres terres ! D’abord nous nous arrêtâmes à la maison où nous avions déposé nos affaires. Mais le cadenas n’était plus là et on pouvait entrer sans clé. Malgré la semi-obscurité, je remarquai que quelqu'un avait tout inspecté. J’espérais que personne ne s’était servi ! Nous voulions refermer la porte lorsqu'un jeune un peu rondouillard apparut devant nous. Il avait une tête ronde et les cheveux ébouriffés et fumait une cigarette avec ce tabac gris et puant, le ‘Caporal’, que tous les bergers semblaient fumer ici ! Il nous sourit et grommela des mots incompréhensibles. Personne ne savait donc parler français ici ? Si ! Lorsqu’il s’aperçut que nous ne comprenions pas, il répéta, de façon un peu plus claire : « Un sacré bazar, ce que vous avez là-dedans ! » Qu’entendait-il par ‘bazar’, peut-être les affaires que nous avions déposées ici ? Il avait donc été là-dedans ! Et l’ancien propriétaire de notre ferme à qui appartenait cette maison visiblement aussi, car c’est lui qui en avait la clé. Il valait mieux ne plus rien laisser ici et monter sans attendre tout ce que nous avions apporté avec nous jusqu’à la maison.
Nous avons laissé le type sur place et nous nous sommes mis en route. Le chemin ne s’était pas amélioré et Ludwig dût monter sur la barre de la remorque pour mettre du poids sur l’essieu arrière afin de parvenir à monter. Au croisement qui servait également à faire demi-tour, se trouvait évidemment déjà Fernand, le voisin, en bleu de travail. Il approchait les 80 ans. Est-ce qu’il se postait toujours ici ou bien avait-il déjà entendu nos roues patiner de loin lorsque nous montions la côte ? Il me salua comme une vieille connaissance. Ensemble, nous allâmes jusqu’au roncier à travers duquel nous traçâmes un sentier avec nos pieds pour accéder à la maison. Nous remarquâmes qu’une piste carrossable menait jusqu’ici, et même encore un peu plus loin. Je ne l’avais pas remarquée auparavant, certainement à cause de toutes les broussailles ! Il y avait même un endroit un peu plus large où nous pûmes ranger la remorque.
D’abord nous allâmes chercher une faux et un croissant de notre chargement pour couper les ronces les plus épaisses. À notre étonnement, nous trouvâmes sous les ronces un chemin creusé et pioché dans la pente, comme une rampe, qui menait au pré se trouvant sous la maison. Vers midi nous avions fauché un passage à travers les ronces sèches vieilles de plusieurs années. Nous étions sacrément crevés ! Mais au moins on y voyait plus clair maintenant ! Il y avait une bande d’accès d’environ 1,50 mètre de large pour accéder au pré. Le voisin qui ne nous avait pas lâchés d’une semelle pendant un bon moment, m’avait expliqué que l’ancien propriétaire y était une fois monté avec un petit tracteur tout-terrain, mais avait failli se renverser. Cette rampe nous semblait parfaite pour notre système de treuil-chariot.
Nous nous mîmes à monter vers la maison. « La baraque n’a pas l’air en aussi piteux état que tu me l’avais dit. Je m’étais imaginé une ruine, et ça c’est plutôt un château fort ! », me dit Ludwig. D’ici, le bâtiment avait l’air imposant avec sa face avant d’environ 25 mètres de long. « Attends d’être dedans ! », répondis-je. Plus nous nous approchions, plus on voyait que la dégradation était déjà bien avancée. Mais depuis notre première visite, rien n’avait changé. Nous dûmes enfoncer la porte avec force pour accéder à la cave. Cela était certainement lié au fait que les poutres qui formaient l’encadrement s’étaient légèrement affaissées au contact de l’humidité. En enlevant deux centimètres du bas de la porte à la tronçonneuse, on pourrait de nouveau l’ouvrir et la fermer correctement. En tout cas il faudrait en mettre une avec des vitres car au rez-de-chaussée, les fenêtres étaient minuscules. Un souffle froid nous frôla, légèrement rance, mais qui sentait surtout la suie. Après avoir jeté un coup d'œil à l’intérieur, nous nous assîmes contre le mur de pierres réchauffé par le soleil et cassâmes la croûte.
Au lieu de faire une sieste, nous redescendîmes et détachâmes notre chargement. En premier, nous descendîmes la motofaucheuse de la remorque et l’allumâmes. Nous nous servîmes ensuite du pied de biche pour pousser le cadre en V du treuil avec tout l’équipement en bas de la remorque et l’attachâmes derrière la motofaucheuse avec des cordes. L’idée était de tracter le treuil en haut de la côte grâce à la faucheuse. Mais celui-ci était certainement aussi lourd que la motofaucheuse ! Les roues de la faucheuse tournaient dans le vide, sautaient sur place et commençaient doucement à s’enfoncer dans la terre. Nous disposions sur la remorque d’un essieu supplémentaire de récupération pour le chariot. Je l’avais gardé parce que j’étais persuadé qu’il servirait un jour. Et ce jour était arrivé ! Nous le fixâmes sous le cadre du treuil. Ainsi, seul l’arrière de ce dernier traînait encore sur le sol. Alors que j’appuyais de toutes mes forces sur les longerons de la motofaucheuse, Ludwig faisait levier avec une grande branche pour faire avancer l’arrière du treuil. C’est comme ça que nous entamâmes la montée de la côte, 10 centimètres par 10 centimètres. La première partie, la plus raide, était la plus difficile. Une fois celle-ci franchie et la maison en vue, nous nous écroulâmes d’abord dans l’herbe. Nous y restâmes allongés un moment, en haletant.
Ensuite, nous nous mîmes à remonter la côte, étape par étape. Le moteur sentait l’huile chaude, nous dégoulinions de sueur et étions à bout de souffle. Mais il nous fallait monter ces pièces, sinon il nous serait impossible de transporter quoi que ce soit car il n’y avait aucun accès pour un véhicule. Heureusement ! Car sinon le bien aurait coûté le double et il aurait été vendu à de riches Allemands travaillant chez Airbus à Toulouse, comme résidence secondaire. Deux heures plus tard, nous avions réussi ! Le treuil se trouvait dans la cour, nous éteignîmes le moteur et nous affalâmes par terre. Nous étions à bout. Aucun de nous n’avait jamais réalisé une telle épreuve de force auparavant ! Notre tête vrombissait, notre cœur battait comme un compacteur dans notre poitrine, l’air sifflait en entrant et sortant de notre gorge endolorie. Notre bouche était pâteuse et nous y ressentions un goût amer. Nous étions trempés de sueur. Nous restâmes allongés là sans dire un mot, épuisés, pendant dix bonnes minutes. Mais le corps est un bon esclave ! Après un quart d’heure, il se soumit de nouveau, fidèle, à notre volonté et se redressa.
D’ici nous pouvions enfin bien voir le futur tracé du câble. Nous ancrâmes le châssis du treuil avec une barre en métal que nous enfonçâmes aussi profondément que possible dans le sol légèrement humide à l’aide de la masse. A deux, nous montâmes le support de la motofaucheuse. Il s’agissait d’une construction en poutres de bois sur laquelle on pouvait poser la faucheuse en entier afin que celle-ci ne se mette pas à rouler toute seule. A la place de la barre de coupe, nous avions fixé une platine à laquelle était soudé un tube dans lequel se trouvait un embout de prise de force logé dans des roulements à billes. Nous avions construit ça avec un mécanicien à la Baywa, un concessionnaire de machines agricoles. Il s’agissait de pièces de ferraille que nous avions découpées et adaptées les unes aux autres. Nous avons relié cet embout au treuil au moyen d’un cardan de tracteur. Ça pouvait enfin commencer ! J’avais mis le treuil en roue libre et nous avons traîné le bout du câble en acier long de 300 mètres dans le vallon. Le câble devait faire un coude à deux endroits à cause de la forme du terrain. Là, nous enfonçâmes des piquets dans la terre à coups de masse, jusqu’à ce qu’ils ne dépassent plus que de dix centimètres hors du sol. La corde de 8 millimètres d’épaisseur passait autour de ces piquets, et descendait jusqu’à la route dans le vallon, où se trouvaient les véhicules.
*
A deux nous libérâmes le chariot en forme de cercueil du véhicule et l'accrochâmes au câble. J’espérais que les pneus résisteraient aux ronces qui poussaient au bord du chemin ! Nous chargeâmes le chariot de petites affaires afin de ne pas le faire monter à vide. A trois endroits différents du timon se trouvaient des anneaux où on pouvait accrocher la corde de traction. Cela devait aider à le diriger. Peut-être qu’ainsi la charrette pourrait, du moins en montée, avancer sans que personne ne la dirige par la barre ? J’avais prévu deux klaxons à poires de caoutchouc pour qu'on puisse communiquer. J’avais dévissé les balles en caoutchouc parce qu'il était plus facile de se faire comprendre en soufflant directement dedans. Nous nous mîmes d’accord : Trois coups brefs, émis en haut – Attention, ça va bientôt démarrer ! 1 long coup, d’en bas – tout baigne ! Plusieurs coups brefs – attendre encore un peu. 1 coup long, en haut – ça va partir !
Je montai vite à pied et après avoir échangé les signaux, je mis le moteur en marche. Maintenant il était impossible de communiquer. De plus, je n’y voyais rien sur les 15 premiers mètres. Par précaution, j’avais ajouté une rallonge au timon du chariot côté vallon, afin que le « conducteur », au cas où celui-ci glisserait, ne tombe pas devant le chariot. Doucement, j’abaissai le levier d’embrayage du treuil qui était équipé d’un poids réglable. Celui-ci poussait le cylindre du tambour, qui contenait le câble avec son côté en forme de cône, dans le côté également conique de la roue motrice qui se trouvait en mouvement continu. Le câble de traction se tendit progressivement. Le fil s’enroulait autour du tambour dans un bruit grinçant. Le poids agissait maintenant sur le levier, de sorte que la transmission et le tambour restent couplés et je pouvais, au moyen d’un gros bâton, diriger un peu la corde pour que celle-ci s’enroule de façon homogène. Petit à petit je pouvais voir Ludwig en bas, au premier virage, et aussi le chariot. Est-ce que ça allait marcher ? Est-ce que le câble allait tenir, même si quelque chose se mettait à coincer ? L’avenir allait nous le dire !
Maintenant nous avions un contact visuel et c’était plus facile. Contre toute attente, tout se passa pour le mieux ! Bientôt la première cargaison se trouvait devant la maison. La corde remplissait sacrément le tambour, presque trop. Comme celle-ci était trop longue de 30 mètres, nous la raccourcîmes. Les piquets devaient être aussi enfoncés plus profondément dans la terre, parce que les essieux du chariot les touchaient. Grâce à cet essai, nous pûmes également voir à quels endroits il fallait légèrement niveler le terrain pour que le chargement ne puisse pas se renverser. Mais nous repoussâmes cela au lendemain. Nous étions crevés et rêvions d’une douche avec l’arrosoir, d’un repas et de sommeil !
Le lendemain, nous montâmes le reste du déménagement de la voiture jusqu’à la maison. Parmi les affaires qui étaient stockées au village, nous n’allâmes chercher que celles dont nous aurions besoin pour continuer les travaux à la maison. Le jour suivant, nous coupâmes encore d’autres ronces en face de notre « station en aval » et y garâmes notre caravane. Ainsi on évitait les longs déplacements. Nous rendîmes visite aux anciens propriétaires. Ceux-ci nous invitèrent à dîner. Mais nous devions venir plus tôt parce qu’ils voulaient nous présenter à un propriétaire de scierie de la vallée qui possédait également un commerce de matériaux de construction. Son affaire qui se trouvait deux villages en-dessous de nous était, comme beaucoup d’autres, déjà fermée depuis un moment. La nouvelle affaire, plus moderne, se trouvait à coté de St-Girons. Le commerçant nous promit des prix bas si nous prenions tout chez lui. Pour tester ses paroles, je commandai tout de suite quelques poutres pour la semaine suivante et achetai une palette de ciment que nous répartîmes, à cause de son poids, entre la remorque et le Combi. Grâce à la facture, je pouvais ensuite comparer les prix auprès des autres commerçants. Et surprise, ceux-ci étaient réellement bon marché !
Une partie des terres avec le tracé du câble :
Environ 50 mètres derrière notre « station aval », un ruisseau coulait depuis nos terres. Quelqu'un y avait fait un barrage au moyen d’un tronc d’arbre disposé en travers. C’est là que nous puisions notre eau. Et c’est là que Jean-Paul, le garçon rondouillard du village aux cheveux ébouriffés venait faire boire ses vaches deux fois par jour. Sinon celles-ci restaient dans une petite grange en face de chez Fernand, le voisin en bleu de travail qui se plaignit auprès de nous que l’urine des bêtes dégoulinait sur le chemin et lui rendait la vie difficile. Chaque matin et chaque soir le même rituel. Jean-Paul donnait du foin aux bêtes et sortait le fumier devant la porte. Puis elles devaient d’abord finir de manger. Pendant ce temps, il nous espionnait. Nous ne le voyions pas, mais nous le sentions, surtout son tabac infâme. Puis, soudain, il se trouvait là, comme un diable sorti d'une boîte, quand on s’y attendait le moins ! Il se montrait toujours au moment où il pensait qu’on l’avait découvert.
Il nous montra ses bêtes avec fierté. Deux vaches brunes rondes, en fin de lactation si on en croyait l’état de leurs pis. Il nous expliqua qu’elles lui avaient servi à engraisser quatre veaux dans l’année écoulée et nous proposa du lait. Nous ne pouvions pas en trouver de plus frais ! Il chercha un tabouret dans un coin de l’étroite grange dont la porte était la seule ouverture. Des toiles d’araignées enveloppaient les poutres, une fourche à fumier était apposée dans un coin, une pelle, un bâton. À un gros clou étaient suspendues, comme une grosse barbe, des ficelles de bottes de foin ouvertes, à côté se trouvait un manteau poussiéreux. Au sol était posée une gamelle dans laquelle il versait du lait pour ses chiens. Il s’assit entre les vaches, leur parla dans le dialecte local et se mit à traire la première, mamelle par mamelle, à la main, puis la deuxième, dans une cruche en plastique avec une anse sur le côté qu’il tenait de l’autre main. Comme il n’avait pas de récipient, nous allâmes chercher une bouteille de vin vide dans notre caravane. Il y versa le lait, au-dessus de la gamelle des chiens, dans laquelle coulaient le lait et la mousse qui débordaient. En grognant légèrement, les chiens se mirent à laper le lait sucré.
Nous préparâmes notre muesli avec le lait. Il avait une odeur légèrement âpre. C’est pourquoi nous préférâmes d’abord le faire bouillir. Et il avait une couleur légèrement verte. Était-ce notre bouteille qui avait déteint ? Ou bien est-ce que ça venait de la nourriture des bêtes ? Lors de la traite suivante, nous l’observâmes plus minutieusement. Nous comprîmes alors pourquoi son lait avait un goût inhabituel : les mamelles et les pis étaient recouverts de fumier, certainement parce que les emplacements étaient prévus pour des vaches de taille plus petite. A cause de ça les bêtes étaient couchées, pour un tiers, dans la rigole à fumier. Après la traite, les pis, du moins les mamelles, étaient bien propres !
Lorsqu’il ne nous trouvait pas à la caravane, il montait à la maison, nous enfumait et nous regardait travailler. Que faisait-il lorsque nous n’étions pas là ? Bien sûr, il rôdait ! Un jour nous trouvions une trace de pas dans le ciment frais, un autre jour, un mégot dans la grange. Mais il ne manquait jamais rien. Pour se débarrasser de lui, il suffisait de lui mettre une pelle dans la main. Alors il se souvenait soudain qu’il devait encore aller à l’étable pour faire boire les vaches ! Il abreuvait les vaches l’une après l’autre parce que sinon celles-ci se battaient pour avoir le droit de boire en premier. Pendant que la première buvait de grandes gorgées, s’arrêtant parfois pour savourer, il retenait l’autre par la corde, jusqu’à ce que l’eau se remplisse de nouveau derrière le barrage. Alors, sur ordre de son maître, le chien poussait la vache sur le côté et l’autre pouvait s’approcher de l’abreuvoir.
Entre-temps nous avions réfléchi par où commencer pour la rénovation de la maison. Nous pouvions temporairement oublier les terres, nous étions au mois de mars et la nature était encore en sommeil. Mais dans tous les cas la maison devait être habitable dans un mois. Doris avait dit qu’elle n’emménagerait qu'une fois qu’il y aurait une douche et des toilettes. Pour cela il nous fallait de l’eau. Au-dessus de la maison, une source jaillissait de la terre. Pas très fort, mais suffisamment si on construisait un bassin de rétention. Il y avait assez d’argile sur place, comme nous pouvions le constater au bord du canal creusé par l’eau. Nous avions suffisamment de tuyau d’arrosage avec nous. Nous formâmes alors un bassin dans l’argile dans lequel nous posâmes, environ 10 cm au-dessus du sol, le tuyau d’arrosage dont le bout était entouré d’une moustiquaire. Dans ces 10 cm, les particules qui flottaient dans l’eau pouvaient se déposer. Puis nous rehaussâmes le barrage. Sous le rebord supérieur de celui-ci, nous enterrâmes un morceau de gros tuyau qui servirait de trop-plein, afin que l’eau qui débordait ne puisse pas emporter la digue. Nous enfonçâmes un bouchon dans la partie basse du tuyau d’arrosage. Plus tard nous le remplaçâmes par un robinet. Le bassin se remplissait doucement. Nous redescendîmes à la maison, le début était fait !
*
À la maison il fallait tout refaire à neuf. Afin d’avancer rapidement, il valait mieux commencer par le haut. La face avant du toit, le côté sud, semblait avoir été couverte récemment (nous apprîmes plus tard que cela remontait à avant la guerre, c’est-à-dire à 40 ans plus tôt). On pouvait le voir à la couleur unie et sombre des ardoises, et à leur forme. Mais le côté arrière était en piteux état. Seules les bordures du toit étaient en ardoises noires, le reste en ardoises grises qui se réduisaient en poudre. Ce côté devrait être rénové dans les années à venir !
Lors de la première visite j’avais déjà constaté des gouttières au grenier et par prévoyance je m’étais procuré des chutes de découpe, pour la plupart des bandes étroites, chez un zingueur. Car, s’agissant du côté talus, la réparation me semblait facile. Nous posâmes un matelas au-dessus du bord du toit, là où il formait un angle léger et ensuite nous y posâmes l’échelle. En partant de celle-ci, on pouvait faire glisser sur ses deux côtés ces lames de tôle, sans briser les ardoises. Parfois je pliais les angles supérieurs des lames pour les empêcher de glisser vers le bas. Ce faisant je constatais qu’un toit en ardoise était toujours fait de trois couches. Les trous des clous de la première rangée sont recouverts par la troisième rangée. Par chance nous trouvâmes plusieurs grandes ardoises posées contre le mur arrière, qui servirent à remplacer les quelques ardoises manquantes, surtout à la faitière. Nous les posâmes sur une arrête solide et avec une serpe, sorte de couteau, qui servait à couper des branches, nous leur donnâmes la taille voulue. Nous perçâmes les trous avec un marteau et un clou en acier. C’était plus facile que ce que nous avions imaginé ! Mais il fallait prévoir la façon dont l’ardoise se casserait. Ce qui, au moment de la coupe ou du perçage, se trouve en haut, devient le dessous au moment de la pose. Toutes ces opérations sont plus faciles à faire avec un marteau spécial pour les ardoises. Nous en achetâmes un plus tard au marché. Il faut cependant faire attention lors de l’achat, car il y a des marteaux pour droitiers et pour gauchers. Ce n’est pas une blague !
Les vieilles ardoises sont très fragiles. Quand elles sont mouillées, elles supportent encore moins de poids. On devrait alors travailler uniquement sur des toits secs, pour éviter de casser plus qu’on ne répare ! Les toits humides sont aussi très glissants à cause des algues et mousses qui y prolifèrent ! Par précaution nous fixâmes un petit coussin sous l’extrémité haute de l’échelle. Afin de ne pas abimer le toit, nous tournions l’échelle autour d’elle-même pour arriver à l’emplacement suivant. Ainsi l’échelle se trouvait sur un endroit déjà réparé et on pouvait réparer la bande où l’échelle se trouvait auparavant et la suivante de l’autre côté. Pour les travaux côté sud nous avions équipé le haut d’une échelle légère en aluminium de deux crochets rectangulaires. Nous la posâmes du côté nord, c’est-à-dire du côté talus par-dessus la faitière, parce que c’était plus facile. Les ardoises du côté nord dépassaient de la faitière de cinq centimètres à cause du vent et du mauvais temps. Pour ne pas abîmer ces ardoises, nous fixâmes un bout de bois enveloppé d’un bout de couverture sous l’échelle, non loin des crochets. Heureusement seules quelques ardoises avaient bougé à cause du vent et furent vite remises en place. Dans cette situation, l’utilisation d'un peu de mastic-colle peut faire des miracles ! Perché là-haut j’étais content d’avoir une ceinture de sécurité, dont la corde était fixée côté talus ! Le mieux aurait été un harnais avec auto blocage, pensai-je. Mais seul un Reinhold Messner pouvait se payer quelque chose d’aussi cher…
Étrangement, la face nord des toits se trouvait dans un plus mauvais état que la face sud. Sans doute était-ce dû à l’ensoleillement, qui faisait sécher un côté plus vite. Aussi sur la partie colline s’accumulaient des feuilles humides, le toit touchait la terre par endroits et le bois pourrissait par dessous.
L’après-midi nous nous attaquâmes au découpage des troncs de frêne secs que notre prédécesseur avait fait rentrer par les fenêtres dans les diverses pièces afin de nourrir ses brebis avec leurs feuilles sèches. Comme un voile bleu, les gaz d’échappement sucrés de la tronçonneuse planaient dans les cônes de la lumière rentrant par les fenêtres, et les murs noircis entendaient, surpris, le son de l’ère nouvelle ! Nous empilâmes les bûches à côté de l’énorme cheminée, qui prenait le côté ouest de la pièce. Enfin nous pûmes circuler librement dans la maison ! Dehors il commençait à faire nuit. Ludwig alluma un premier feu avec ce bois hyper sec, pendant que je descendais vers la caravane chercher des provisions et les duvets. Nous passâmes une soirée extraordinaire au coin du feu. J’avais toujours rêvé de posséder une maison avec cheminée ouverte. Maintenant nous l’avions !
Le lendemain matin nous descendîmes les bouteilles vides du grenier, qui s’y trouvaient par centaines. Souvent c’étaient des bouteilles épaisses, c’est-à-dire très vieilles avec des capuchons mécaniques, avec des sceaux ou des écritures dans le verre. À l’époque ces bouteilles devaient avoir une grande valeur, sinon on ne les aurait pas gardées ! « On pourra les vendre aux puces… » songea Ludwig. « Qu’on s’en débarrasse ! » criai-je. Mais comment, car il n’existait pas de collecte de déchets ici ? Je pensai alors qu’on avait prévu de construire une fosse septique. Celle-ci devrait être construite en face de la porte d’entrée, en bordure du jardin. Alors on y creusa un trou de 2x2 mètres, d’environ 30 centimètres de profondeur. Nous y jetâmes toute la verrerie, mîmes des lunettes de soleil sur le nez et cassâmes tout à grand coup de masse, pour la rendre moins encombrante. Plus tard nous y coulâmes la dalle de la fosse.
Les grandes caisses en bois au grenier, dans lesquelles on conservait les jambons et la charcuterie sous une couche de cendres, étaient en grande partie bouffées par les vers. Il y avait des cendres partout. Nous balayâmes tout et épandîmes les cendres dans le pré en contrebas de la maison, là où nous avions projeté de faire le potager. À un endroit, au-dessus de la pièce dont le mur arrière était tombé, quelqu’un avait posé un nouveau parquet au grenier. Seulement, entre-temps les vers l’avaient attaqué. Mais il pouvait encore porter notre poids. Nous le laissâmes donc, il y avait plus urgent !
Avec pied de biche et barre à mine, nous nous mîmes à arracher les vieilles planches du grenier. Nous commençâmes côté vallée. Lorsqu’il y eut assez d’espace, nous clouâmes quelques vieilles planches en forme de caniveau qui descendaient à travers la fenêtre de la cuisine à l’étage inférieur jusqu’au jardin. Nous nous en servîmes pour expédier tous les déchets vers le bas. Au jardin nous triâmes tout. Nous mîmes les meilleures planches de côté, pour nous en servir de coffrage, les autres partaient sur un tas afin d’être brûlées à l’occasion, peut-être à la Saint Jean. Lentement, comme une grande toile d’araignée, l’ossature du grenier apparaissait.
À l’aide d’une hache j’incisai diverses poutres, afin de voir comment elles étaient à l’intérieur. Je fus surpris ! Ma première impression à l’achat était qu’il fallait changer quasiment tout. Maintenant je constatai que c’était uniquement l’extérieur, l’aubier, qui était envahi par les vers et tombait en poussière. Le reste, le cœur, dur comme du fer, résistait même à la hache ! Même les vers à bois avaient jeté l’éponge ! Le cœur était si dur que nous n’arrivions pas à en extraire les vieux clous, encore moins à en planter de nouveaux ! Les vieux, encore forgés à la main, perdaient les têtes, les nouveaux se tordaient. Sans doute l’épaisse couche de suie, qui couvrait tout le bois, avait-elle contribué à la conservation des poutres. Car nous constatâmes que le conduit de la cheminée au grenier était plus récent. Avant, les fumées s’évacuaient simplement vers le haut à travers les fentes entre les planches et les ardoises. On n’avait utilisé quasiment que du bois dur, certes, parfois peu épais, peut-être pour éviter de le scier. Mais en séchant tout s’était transformé en une construction rigide et solide. Les poutres étaient façonnées grossièrement à l’aide d’une hache et d’un autre outil, qui ressemblait plutôt à une bêche de jardin. Nous en avions trouvé un dans la cave. Par endroits l’écorce se trouvait encore sur le bois. Tous les matériaux de construction semblaient venir du voisinage tout proche.
Je dus péniblement couper à la tronçonneuse les quelques pièces que je voulais changer. Et pour y poser les nouvelles pièces, il fallut pré-percer les trous pour les clous avec la perceuse à manivelle. Un léger brouillard de fines particules de suie planait dans l’air, nous procurant un gout amer dans la bouche et nous bouchant les narines. La lumière oblique du soleil bas projetait des points lumineux dans l’intérieur obscur de la maison, invitant les particules de poussière à des danses folles. Le soir, nous étions contents de nos progrès, même si nous n’avions pas encore entamé la reconstruction.
*
Samedi nous descendîmes au marché à St. Girons. Nous savions que dans le passé c’était le lieu de rencontre de tous les « néos », tous les « immigrants », que ce soient des Français des villes, des néoruraux Allemands ou des hippies internationaux. Ceux-ci étaient bien reconnaissables à leurs cheveux longs et parfois à leurs habits colorés, même si parfois leurs vêtements ressemblaient beaucoup à ceux des autochtones, surtout ceux qui élevaient des bêtes. L’Allemand était la langue la plus entendue. De plus, on reconnaissait souvent les Allemands à leur tignasse blonde. Quelques-uns des néo-immigrants tenaient un stand de marché sur lequel étaient étalés des plants de légumes, des pains faits par eux-mêmes, ou des fringues indiennes et des accessoires pour fumer. Ces stands servaient aussi comme lieu de rencontre aux compatriotes, car souvent on y voyait un attroupement de jeunes gens assis par terre ou des enfants qui s’amusaient à courir en riant ou qui mendiaient auprès des passants. Un autre groupe avait amené ses instruments de musique et jouait sur le trottoir devant l’Hôtel de l’Union, au rez-de-chaussée duquel se trouvait un café-bar derrière de hautes vitres. Autour des petites tables étaient assis des êtres d’apparence exotique. Tout le monde fumait, tout le monde buvait. Le serveur avait du mal à arriver aux tables et à vider son plateau plus que plein. Des tables étaient même posées sur le trottoir pour abreuver la foule assoiffée, et aussi sur le parking adjacent.
Nous aussi, nous y rencontrâmes des connaissances. D’une certaine manière tout le monde semblait se connaître ou connaître quelqu’un qui connaissait quelqu’un qu’on connaissait aussi… Tous les marchés du monde se ressemblent : ce sont des lieux pour des gens qui ont quelque chose à vendre et ceux qui ont besoin de quelque chose. Ici le marché était en plus un lieu de rendez-vous pour les gens qui sinon vivaient éparpillés dans la multitude des vallées environnantes et ne se voyaient pas, aussi bien les autochtones que les néos. Et ici on apprenait toutes les nouvelles, avant que ça ne paraisse dans les journaux et aussi celles que ceux-ci ne publieraient jamais…
Assis sur une terrasse derrière une bière nous regardâmes passer le courant humain. De temps en temps quelqu’un émergeait de la foule, venait vers nous et on se saluait à la manière française avec un « bisou », la bise soufflée sur chaque joue, ou on s’embrassait à la manière hippie. Quelques policiers déambulaient dans la foule, ce qui incitait plus d’un fumeur de joint à être un peu plus discret. D’autres ne se laissaient pas intimider et continuaient d’émietter et de rouler leur œuvre à trois feuilles. Ici régnait une sorte de trêve. A un stand de réfugiés vietnamiens nous achetâmes quelques nems que nous mangeâmes assis sur le mur de la rivière. Nous regardâmes en contrebas un groupe de gens habillés en couleurs faire passer un chilom assis sur le gravier de la berge. Mélangées au bruissement de l’eau, les fumées montaient vers nous jusqu’à notre nez. Sur le chemin du retour nous nous arrêtions ici et là, devant un bistro pour déguster une autre bière. On y rencontrait surtout des autochtones, qui comme nous prenaient encore un ‘coup pour la route’. Ici on parlait patois, le dialecte.
Nous avions acquis un trépied auprès d’un ferrailleur, sous lequel, non loin du treuil, à l’écart de la maison nous allumâmes un feu avec du bois de démolition. Dans un chaudron nous fîmes chauffer de l’eau. Nous nous servîmes d’un arrosoir comme douche pour nous débarrasser de la couche noire de la semaine précédente. Ce qui avait pénétré plus en profondeur, nous le fîmes sortir en toussant et crachant pendant les jours suivants.
*
Ponctuel, notre fidèle cowboy nous livrait sa bouteille de lait à la caravane tous les matins, ou la montait au chantier et restait pendant un moment dans nos pattes. Parfois c’était sa mère ou son père qui limitait nos mouvements ou nous empêchait plus directement de travailler. « Ne font-ils rien d’autre toute la journée que de rester plantés là et de bavarder? » Ludwig prononça cette question qui me taraudait aussi. « Les Allemands, ne font-ils rien d’autre toute la journée que de bosser ? », devaient se demander ceux-ci en patois. Mais ces visites avaient l’avantage de nous mettre au courant de tout ce qui se passait au village et dans le monde. De plus Elie, le père de Jean-Paul, nous montrait petit à petit les parcelles qui avaient appartenu à la ferme. En les comparant avec le cadastre je découvris lesquelles avaient disparu. Parce qu’un autre voisin portait le même nom que notre ancien propriétaire, à savoir Dubuc. Pour distinguer ces deux personnes, on avait appelé chacun d’entre eux avec le nom de sa maison, lui « Le Graviaret », le nôtre « Le Pourtérès ». Ce qui signifiait qu’il venait du Portet d’Aspet, deux villages plus haut en bas du col qui portait le même nom et qu’il s’était marié avec une fille d’ici.
La pièce où se trouvait la cheminée était séparée d’une autre chambre, plus petite, par une cloison en volige. Au fond de celle-ci se trouvait un lit. En dessous du lit le plancher était pourri. Lors de ma première visite de la cave j’avais découvert sous le lit, à travers le plancher pourri, un carton contenant des photos et des lettres. Je repris ce carton et je découvris des actes de cadastre qui remontaient jusqu’à l’année 1823. Dans ces derniers on mentionnait déjà quelqu’un surnommé « Le Pourtérès ». Je rangeai tous ces papiers dans une caisse afin de pouvoir les regarder plus tard, confortablement. Est-ce que dans quelques générations on parlera de « L’Allemand » en mentionnant cette ferme ?
*
En tout cas, en ce moment précis nous étions sûrement le centre de toutes les discussions au village. Quand nous traversions le village, on nous saluait, on nous regardait avec curiosité, on essayait de nous arrêter pour nous parler. Jean-Paul devait certainement profiter pleinement de sa fonction d’observateur. Le plus souvent nous descendions au village après le travail et le dîner afin de boire une bière au bistrot qui faisait parfois office de restaurant. Là se trouvait le seul téléphone public du village. L’auberge formait une équerre avec la rivière qui était retenue à cet endroit par une digue. Cinquante mètres en aval se trouvait une scierie presque en ruine, qui tournait parfois encore. Mais l’antique lame à ruban était actionnée maintenant par un moteur électrique. La famille de l’hôtelier habitait le premier étage de l’auberge étroite et dans une maison à côté de la scierie, où elle louait aussi des chambres d’hôte.
Il n’y avait pas de cabine téléphonique, à proprement parler, mais l’appareil était accroché à côté des toilettes, une pièce minuscule, dans laquelle se trouvaient des « toilettes à la turque », avec un trou dont l’évacuation allait directo dans la rivière. La plupart du temps on ne se faisait pas déranger ici, parce que - à part les femmes - chacun réglait ses besoins à la manière française, directement dans la rivière. Ça revenait au même. Avec comme seule différence que le clapotis se faisait entendre immédiatement. Dans l’étroite antichambre des toilettes, quasiment dans la salle d’attente pour clients féminins, était accroché le téléphone. Le compteur, cependant, se trouvait au bar et devait être consulté avant et après chaque utilisation. C’est d’ici que nous effectuions les conversations avec nos bien-aimées. Le plus souvent très brèves, car en téléphonie, même dans le midi, il y avait la devise : « Time is money ! », le temps c'est de l’argent.
Le bistrot, une pièce étroite et oblongue, avec le bar au fond à droite, n’ouvrait en général que le soir. Souvent quelqu’un partait à la recherche du barman pour lui annoncer qu’il y avait de la clientèle. La famille des hôteliers avait quatre fils âgés de 15 à 20 ans. Le plus souvent c’était l’un des quatre qui venait pour ouvrir. À côté du bar se trouvait une pièce avec une cheminée qui leur servait de salon. De cette pièce on arrivait dans la cuisine.
Le soir c’était le rendez-vous des assoiffés de la vallée. Certains jours ça grouillait de chasseurs. Et ici tout le monde était chasseur. Souvent on trouvait les mêmes visages sauvages au bord des routes ou dans la forêt, fortement armés dans un vieil uniforme de l’armée, parfois avec blason allemand. Ces hommes avaient en commun leur amour pour les armes, pour la course dans les bois et leur soif énorme. On appelait « apéritif » ce cérémonial non limité dans le temps qui remplaçait très souvent le repas et qui pouvait s’étirer jusqu’à l’aube. Il n’existait quasiment pas d’heure de fermeture. Parfois quelqu’un tournait la clef et ça devenait une réunion privée. Et si par hasard, une patrouille passait dans la vallée, les gendarmes entraient, buvaient un verre et discutaient avec les gens. Parce que pour un policier tout ce qu’il entend peut être utile, surtout quand les langues sont déliées par l’alcool…
Il arrivait que nous aussi nous nous retrouvions dans ce cercle humide et joyeux, même si nous n’étions initialement descendus que pour téléphoner. Tout autour de nous on parlait chasse, chiens, proie et calibres divers, dans un charabia incompréhensible pour nous. Avant même de passer une commande, un verre se trouvait déjà devant nous, généralement cette liqueur d’anis que nous buvions sans y ajouter d’eau. Ça faisait monter d’un degré la gaieté des gens présents qui s’efforçaient tous de nous apprendre à boire à la française. Le barman avait le boulot le plus difficile : à part boire il devait mémoriser tout qui avait été bu. Pour simplifier les choses chaque boisson coûtait le même prix et en plus on buvait en « tournées ». Chacun se bousculait pour payer la prochaine ronde ! On ré-remplissait les verres avant que ceux-ci ne soient vides. Alors, moins on avait soif, plus le verre se remplissait et plus sa contenance s’épaississait, parce qu’il ne restait plus de place pour l’eau. Heureusement on ne nous faisait que rarement payer une tournée. J’avais vite calculé le prix d’une tournée et immédiatement converti celui-ci en sacs de ciment. Un verre coûtait 3 francs. 5 verres correspondaient à un sac de ciment de 50 kilos ou le salaire d’une heure de travail…
Nous, Teutons incultes qui ne connaissions rien à part la bière, ne faisions pas bonne image. Même si tout le monde se livrait à la liqueur d’anis, il semblait y avoir une subtile différence : il y avait le choix entre « Pastis », « Pernod » et « Ricard ». Pour nous, tous avaient le même goût. Mais pas pour un Français ! Le serveur devait bien mémoriser quoi resservir à qui. Et ça se faisait avec des bouteilles portant un versoir-doseur au goulot, une espèce de goitre avec un bec. Enfin, tant que le verre était encore à moitié plein, le dosage s’avérait plus facile. Si le barman avait saisi la mauvaise bouteille par erreur et un des porte-verres se mettait à râler, le barman bouchait le trou du verseur et faisait revenir la dose dans la bouteille par un mouvement de rotation.
*
Pendant une de ces soirées interminables nous apprîmes que l’un des chasseurs présents, qui occupait le poste de maire du village, possédait un vieux camion GMC, un de ces anciens véhicules de guerre américains, abandonné par les Alliés. Celui-ci avait trois ponts moteurs et était capable de porter 4 à 6 tonnes, en fonction de la pente. Il nous proposa de monter du sable et du gravier jusqu’à la bifurcation avant notre « station aval ». Avec notre combi et la remorque nous ne pouvions porter qu’une tonne à la fois. Le lendemain vers midi nous entendîmes au loin le vrombissement du camion. En reculant il peina à grimper l’étroit chemin délavé, qui lui avait été indiqué par un autre chasseur que nous avions aperçu l’autre soir au bistrot. Ce dernier avait à peu près mon âge. Bien qu’étant du village, il avait travaillé à Dunkerque, tout à fait dans le nord. Maintenant il avait eu la chance d’avoir trouvé du travail à St-Girons et était revenu. Nous n’étions donc pas les seuls « néos » au village. Ils bennèrent le sable dans le virage. Bien sûr qu’ils voulaient voir le chantier. Je me demandais si le transport n’avait pas été qu’un prétexte. Nous montâmes tous la côte et inspectâmes notre ruine. Yvon, le conducteur, étant lui-même maçon, pouvait me donner quelques conseils précieux. De toute manière la « table ronde » de ce soir aurait de l’information en direct !
Nous chargeâmes la remorque à la pelle et la tractâmes avec le combi jusqu’à notre « station en aval » où nous transvasâmes le sable dans notre chariot en forme de cercueil. Environ 300 à 350 kilos par voyage. Parfois un peu moins, et par-dessus nous posâmes des longues sections de bois dans des supports escamotables pour transporter des poutres ou des fagots de parquet pour le plancher. Avec le sable lourd au fond nous risquions moins de tout renverser. Nous stockâmes séparément le gravier et le sable à droite du bâtiment, contre le mur de la grange, où nous installâmes aussi la bétonnière, qui était actionnée par ma vieille mobylette. J’avais trouvé la bétonnière chez un ferrailleur en Allemagne et elle pouvait contenir trois brouettes. Le moteur électrique étant cassé, elle n’avait pas coûté cher. Et parce qu’à la maison il n’y avait pas de courant, j’avais soudé une deuxième couronne sur la roue arrière de ma ‘Zündapp’, et sur la bétonnière un support pour la mobylette. Une longue chaîne faisait la transmission. J’alourdis la poignée d’accélération avec une pince à étau et c’était parti ! Maintenant nous avions besoin de plus d’eau. La source étant limitée, nous coupâmes un fût en plastique en deux et fîmes rentrer le tuyau. Pendant que nous faisions le mélange le fût avait le temps de se remplir à nouveau.
Nous avions prévu deux chantiers : par beau temps un à l’extérieur et un autre à l’intérieur en cas de pluie. Tous les matériaux avaient été transportés en haut. Le mur de devant la maison penchait légèrement vers l’extérieur. On le voyait bien dans le grenier aux entraits, ces poutres qui traversent la maison, liant les deux sablières qui sont posées sur les murs. Ceux-ci servaient à rattraper la poussée latérale des chevrons par manque de fermes dans la construction. Mais ceux-ci s’étaient défaits de leur fixation. Comme on pouvait le voir à la couleur du bois, quelqu’un avait à deux reprises essayé de corriger ce défaut en ajoutant un nouvel entrait. Mais ceux-ci avaient lâché à leur tour. Nous essayâmes à notre tour d’empêcher ce mouvement des murs avec un vieux câble que nous entourions autour des sablières à l’aide des serre-câbles et d’un ridoir. Plus tard, quand nous aménageâmes le grenier nous coulâmes du béton armé sur le mur transversal et autour du câble pour consolider le toit une fois de plus et pour toujours…
Mais une question restait ouverte – est-ce que c’était uniquement la poussée du toit qui écartait les murs ou est-ce que ça venait aussi des fondations et du poids des murs ? La façade de la maison, 25 mètres de long, construite uniquement avec des pierres brutes et avec des blocs en ardoise, faisait six mètres de haut. Sur quelle base cette dernière avait-elle été construite ? Les interstices étaient remplis d’un mélange d’argile et de petits cailloux. Mais à la base, là où le mur touchait le sol, ces joints étaient partis, probablement à cause de l’eau qui s’écoulait du toit, offrant un abri à de multiples animaux. Quand le soleil chauffait le mur, ça se mettait à grouiller de partout. Nous y observâmes des souris, des lézards et aussi des serpents. Jean-Paul y avait même vu des vipères ! Il semblait bien connaître notre maison. Sans doute avait-il cuvé pas mal de cuites dans le vieux lit. Dans sa grange aux vaches il avait caché une bouteille de gnôle, de la ‘prune’, dont il nous avait déjà offert une gorgée. Même sa mère donnait l’impression d’aimer la boisson.
Nous commençâmes par creuser le plus profond possible le long du mur afin de couler des sortes de fondations devant. Nous posâmes d’anciennes planches de parquet de chant en haut de cette tranchée et les calâmes avec des pierres. Puis nous coulâmes du béton derrière ce coffrage, en ajoutant une barre d’acier torsadé avant de remplir complètement. Puis nous compactâmes ce béton avec la masse, jusqu’à ce qu’un lait de ciment remontât en surface. Pour faire ce chantier il nous fallait beaucoup de matériel, et matériel veut dire beaucoup de main d’œuvre. Bouger le gravier trois fois avec la pelle : d’abord du tas dans la remorque, de là dans le chariot et puis dans la bétonnière. Et de là avec la brouette dans le coffrage. Après quelques beaux jours ensoleillés c’était fini. Mais il faudrait bientôt poser une gouttière !...
Ensuite nous élevâmes les murs de la fosse septique, mais avec des parpaings. Puis nous creusâmes une rigole en-dessous du seuil de la porte d’entrée, par laquelle nous fîmes passer tous les tuyaux d’évacuation et d’adduction. Avec en plus un tuyau que nous laissâmes vide. Au cas où… Traverser les murs du rez-de-chaussée semblait impossible, car ceux-ci avaient une épaisseur de 80 centimètres à leur base. Pourquoi chercher compliqué, quand c’est possible de faire simple ! Qu’est-ce qu’ils ont trimé à l’époque, les paysans d’ici pour ériger cette maison ! Est-ce qu’ils ont calculé l’épaisseur des murs d’après la quantité de pierres dans les champs pour s’en débarrasser ? En tout cas, l’endroit où se trouvait la maison avait servi de carrière. Et selon l’épaisseur variable de la couche de suie du feu ouvert sur les murs intérieurs nous constations que toutes les parties n’avaient pas le même âge, il y en avait qui avaient été ajoutées plus tard. La maison était faite de plusieurs parties, au moins deux, comme on pouvait le constater à une jointure sur l’avant. Comparé à l’effort que les vieux avaient fourni pour construire cette quasi-forteresse, notre boulot ressemblait plutôt à du cosmétique.
*
Plus de deux semaines s’étaient écoulées. Des jeunes gens avec un gamin de deux ans qui avaient acheté une maison sur l’autre versant de la vallée l’an passé, étaient venus et nous avaient invité pour déjeuner le dimanche. Comme le samedi précédent, nous avions fait un plongeon dans la civilisation et visité le marché dans la ville qui se trouvait à 25 kilomètres. Comme auparavant nous nous étions arrêtés devant de multiples bistrots sur le chemin du retour. Dans chaque bled il y en avait au moins un, géré par de vieux hôteliers qui, bizarrement, étaient tous au courant d’où nous venions et où nous habitions. En dehors des week-ends, ces auberges n’ouvraient que le soir et ce uniquement quand il y avait de la clientèle.
A cause de tous ces « obstacles » en bordure de route, nous ne rejoignîmes le village que vers le soir. Les lumières claires du café nous souhaitaient la bienvenue et parce que nous voulions téléphoner, nous nous arrêtâmes. Courageusement nous plongeâmes dans le brouhaha des voix et l’épaisse fumée. Rapidement l’atmosphère hilare nous submergea et bientôt nous nous retrouvâmes parmi les picoleurs autour du petit zinc en nous accrochant à un verre de Pastis. « Ils sont bien lunés ! », remarqua Ludwig, « Tu crois qu’ils ont fumé quelque chose ? » « Regarde un peu mieux ! », répondis-je. « Ce ne sont pas des babacools, mais dans le meilleur cas des alcooliques ! » « J’ai pas mal envie de rouler un joint et de le faire tourner. Je parie, qu’ils prendront une taffe ! Vu la manière dont ils attaquent, ils ont bien un penchant pour les drogues ! » « Oublie-ça ! », répondis-je un peu agacé, « Ça nous amènera que des ennuis ! » « Eh bien, ce n’était que - comment dit-on - une supposition rhétorique ! », ajouta-t-il pour calmer le jeu.
Ma vessie me força à quitter la ronde joyeuse pendant un instant. Je me trouvai, titubant, sur le mur de la berge à côté de la chiotte et me vidai en un grand arc dans la rivière. Celle-ci était plus facile à atteindre que le petit trou du WC à la turque ! Il me sembla être resté là-haut une éternité. Plusieurs fois je vérifiai si je n’avais pas encore fini. Je ne savais pas qu’une vessie avait une telle capacité ! L’idée me traversa l’esprit que l’estomac avait peut-être aussi participé au stockage. Car à part quelques pâtisseries sucrées au marché nous n’avions rien mangé de la journée. « Pouh ! Mais tant mieux », réfléchis-je, « ainsi au moins, rien ne peut me sortir de la bouche ! »
Je dus soudain m’appuyer contre le mur. Je descendis du rempart de la berge et me rendis vers le bar en tâtonnant le crépi rugueux. En rentrant, un brouhaha babylonien me submergea. Quelqu’un m’avait aperçu et me tendait mon verre de Pastis bien tassé. « Tchin ! » « Tchin ! » Je le pris en me demandant combien de tournées j’avais raté. Automatiquement, peut-être aussi un peu conscient de mon devoir je le guidai vers ma bouche. « Cul sec ! », s’exclama celui qui me l’avait donné en vidant son verre en un seul coup. Je l’imitai. Je dus frissonner. « Affreux, ce goût exagéré d’anis ! » disait une pensée dans ma tête et je dus faire des efforts pour garder tout en moi. Car ce n’étaient pas de petits verres de gnôle, dans lesquels nous buvions, mais un genre de verres à eau avec en bleu inscrit dessus Pastis ou Ricard. Mon copain faisait triste mine. Deux chasseurs ont cru de leur devoir de lui montrer ce que signifiait « cul sec ! », en allemand quelque chose comme « ex ! » Le jeune barman qui tenait aussi un verre dans sa main mais qui, d’après son apparence, n’avait que peu bu, me faisait signe de le rejoindre derrière le bar. Il se baissa et ramassa quelque chose au sol, qu’il avait glissé sous son pied. Il me fit signe de le suivre et s’éloigna à travers la porte dans la pièce adjacente. « Surveille un peu ton pote ! », me dit-il. « Il a sorti une boulette de haschisch de sa poche et voulait rouler un joint sur le bar ! Mais le morceau est tombé par terre. Heureusement les autres n’ont rien vu ! J’ai tout de suite mis le pied dessus et l’ai ainsi expédié derrière le zinc. » Je le remerciai, pris le morceau et le fis disparaître dans ma poche.
Nous rejoignîmes le bistro. La pièce était pleine à craquer. Les gens aussi. Des petits groupes s’étaient formés, assis autour des quelques tables, les autres étaient debout, leur verre dans la main. Le serveur faisait le tour avec deux ou trois bouteilles dans les mains et remplissait. « Comment peut-il savoir qui a bu quoi et combien, et combien de tournées chacun a offert ? », s’étonnait mon cerveau imbibé d’anis. Ludwig était rouge vif, se cramponnait au bar et bredouillait des choses incompréhensibles même pour lui. Mais apparemment tout le monde bredouillait ou criait quelque chose, que personne n’était encore capable de comprendre. Et en plus le Pastis ballotait fortement les tympans. « Il faut déguerpir ! », criai-je en direction de Ludwig et le traînai vers la porte. « Un dernier pour la route ! », nous cria quelqu’un et nous colla un nouveau verre dans la main. J’avançais à la force des bras à travers le bruit et les amis accrochés à leurs verres jusqu’au barman. « Payer ! », criais-je, « combien ? » « Rien, tout est réglé ! », répondit celui-ci. Je ne voulais pas le croire et sortis un billet de cent francs de la poche. Il le repoussa vers moi. « Tout est déjà réglé ! », confirma-t-il. Je posai mon verre dans l’évier derrière le bar afin que plus personne ne puisse le remplir et vacillai à l’extérieur avec Ludwig. Je me sentais comme un capitaine qui quitte en premier son navire qui coule, balloté par les vagues.
Cette fois-ci je ne remontai pas le mur de la berge. Nous appuyâmes nos fronts contre l’écorce rugueuse du seul arbre qui poussait dans la cour et partageâmes avec lui le jus d’anis de nos vessies. Puis nous escaladâmes avec un dernier effort la cabine du combi où je cherchai un moment infructueusement le trou du contact. « Il se peut que sur ce modèle-ci ils l’aient changé de place et je ne m’en étais pas encore rendu compte ! », me consolai-je. Finalement je le trouvai bien là où il aurait dû se trouver et la caisse finit par démarrer. Lentement elle vacilla à travers les quelques voitures garées et bifurqua toute seule à gauche, avant de monter le chemin délavé en grinçant. Il n’y avait pas beaucoup de virages sur le chemin, mais néanmoins Ludwig tomba malade et malgré la vitre ouverte se couvrit lui-même et le tableau de bord d’une couche d’anis liquide. En allant vers la caravane je fus moi aussi pris comme par une vague de compassion et ensemble, l’un à côté de l’autre, nous nous mîmes à genoux sur le bord du talus pour faire une offrande à Pan, le dieu de la forêt. Un peu soulagé nous rampâmes ensuite vers l’abreuvoir des vaches pour enlever la couche de colle de nos visages. « BRRR ! PLUS JAMAIS CA ! »
Plus tard, nous parvînmes à dormir, bien que la caravane s’inclinât dans tous les sens dans une folle danse. Jusqu’au moment où une pression suraiguë dans nos vessies nous chassait des duvets. Le soleil commençait à dépasser la montagne, les oiseaux chantaient, le ruisseau murmurait et nos têtes buissonnaient. « Quelle matinée ! », m’exclamai-je. « Quelle soirée ! » Ludwig sondait sans doute encore dans les restes de sa mémoire. « Regarde, une espèce de porc a gerbé dans la bagnole ! », cria-t-il soudain. « ‘Une espèce de’ est un peu inexact. Tu te souviens comment nous sommes montés ici hier soir ? » « Non. En tout cas pas à pied, vu l’état dans lequel je me trouve ! » « Moi, n’étant plus capable de marcher, j’ai pris le volant », répliquai-je. « Et regarde, ce que le serveur a ramassé ! », dis-je en lui rendant sa boulette de shit. « Alors cette espèce de porc risque bien d’être moi-même ! », conclut-il et se mit à nettoyer la cabine.
Un peu plus tard nous mîmes de l’eau à chauffer sur le trépied et prîmes une douche chaude avec l’arrosoir. Ensuite nous entassâmes nos fringues puant l’acide d’anis dans le chaudron et frottâmes jusqu’à ce que la planche à laver brillât. Nous tendîmes une corde et étendîmes tout au soleil pour sécher. Entre-temps il était déjà presque midi. « Temps d’aller chez les voisins d’en face, qui nous ont invité pour le déjeuner ! », constatai-je. « Manger ? Boire ? Je te prie de ne plus jamais prononcer ces mots ! », répliqua-t-il. « Le simple fait d’entendre leur son me donne mal au cœur ! Vas-y seul ! Je préfère m’allonger sur la colline au soleil et récupérer un peu de sommeil ! » Alors je descendis seul les quelques centaines de mètres dans la vallée, pendant qu’il grimpait la côte à la recherche d’un endroit un peu plat…
En bas je me retrouvais devant un ruisseau tourbillonnant sans trouver de pont pour le traverser. Enfin je trouvai un endroit où quelques gros blocs dépassaient le courant, me permettant de traverser. Les berges du ruisseau étaient bordées de noisetiers qui venaient juste d’ouvrir leurs tresses pleines de pollen jaune. Les rives, par endroits creusées par l’eau, mettaient à nu une couche de terre peu épaisse, parsemée par de petits rochers, le lit était fait d’ardoise lisse et noire. Sur l’autre côté s’étendaient quelques prés étroits, séparés en petites parcelles par des haies de noisetiers, puis le terrain devenait plus raide et se couvrait progressivement de chênes maigres. A un endroit je passai devant la carcasse cabossée d’une 2 CV complètement désossée. Plus haut je rejoignis la route après avoir grimpé le talus escarpé. Ayant bien étudié le chemin à prendre depuis notre côté, je découvris bientôt le sentier qui me conduisait vers la maison des amis. En plus leur 2 CV était garée en bas.
S’en suivit un accueil chaleureux. Des odeurs délicieuses s’échappaient de leur cuisine pendant que Frédéric m’offrit un Pastis. Ma barbe se mit à se hérisser ! Je n’avais pas le courage d’affronter ça ! Frédéric rangea alors la bouteille. « Moi aussi, je préfère une bière ! », dit-il et chercha deux canettes de Guinness. C’était déjà mieux ! J’appris que sa sœur était mariée avec un Irlandais. Cela expliquait son amour pour ce breuvage noir ! J’acceptai avec joie et nous levâmes les verres. J’appris que sa femme Joana était Polonaise. Lui-même avait le look hippie avec sa longue barbe. Mais c’était trompeur ! Il avait cette dégaine parce qu’il était motard ! Il louchait d’un œil, ce qui me perturbait au début. Je ne savais jamais avec quel œil il me dévisageait. Mais tous deux semblaient être ok. Ils voulaient que je rentre dans la maison. Mais je leur répondis que je préférais rester dehors pour profiter de la vue. Frédéric bourra sa pipe. « A l’intérieur je n’ai pas le droit de fumer à cause du petit ! » « La prochaine fois j’amènerai ma pipe ! », répondis-je. « Je fumais le même tabac à l’époque ! »
Juste en face s’étalait notre ferme ; comme sur un plan de cadastre coloré. Je reconnaissais les prés, les parcelles déjà reprises par la forêt, et, en plein milieu la maison, cachée en partie par un versant. Plus haut s’étalait la bande encore grise de la forêt de hêtres, surmontée par le dos blanc et brillant du Moussaou, notre montagne locale, qui s’élevait à plus de 1700 mètres. Et des deux côtés s’étendaient d’autres chaînes montagneuses luisantes touchant dans le lointain le ciel bleu clair. Je regardais un bon moment. « Idyllique » était un mot trop faible pour décrire un tel panorama ! Je me sentais heureux d’avoir échoué dans une telle région ! Puis je baissais un peu mon regard, pour le faire passer sur les terres, nos terres ! En tournant la tête plus vers la droite j’aperçus l’autre partie de notre vallée qui bifurquait sous mes pieds et s’orientait plein sud. En bas, au fond, des prés limités par des haies, des maisons solitaires, plus en recul un petit hameau. Après celui-ci, le terrain devenant plus pentu était couvert par la forêt et s’étirait vers une entaille dans laquelle j’aperçus un sommet brillant, blanc, sous la lumière du soleil. « Le Maubermé, 2880 mètres de haut ! », expliqua Frédéric ayant suivi mon regard d’un œil. « D’ici vous avez une vue comme d’une tour de guet ! », les mots s’échappèrent de ma bouche. « Je crois qu’au moyen-âge se trouvait une tour ici, parce que de cet endroit on peut scruter toutes les vallées et remarquer tout de suite si quelqu’un approche ! Sans aucun doute on communiquait alors avec des fumées ou des feux », expliqua Frédéric.
Leurs terres, ils n’avaient que deux hectares, étaient très pentues. Quelques lopins de pré, le reste, sans doute à cause de la terre peu profonde, en grande partie couvert des chênes. A quelques endroits s’élevaient d’énormes châtaigniers, sûrement âgés de plusieurs siècles. Ceux-ci étaient plantés aux croisements des limites des parcelles afin de rendre impossible des querelles de voisinage pour les temps à venir. Pas loin derrière leur maison se trouvait le « plan », un pré presque plat qui appartenait à un voisin, qui utilisait aussi leurs autres terres.
Puis le déjeuner fut prêt. Leur gamin avait fini son dodo et dans sa chaise haute il prit place parmi nous autour de la table. Entre-temps j’en avais appris un peu sur le rythme français : on prend son temps avant de commencer, on mange un plat après l’autre et il y a toujours des surprises qui arrivent. Tout ça accompagné par les vins correspondants (qui pour moi avaient tous le même goût, surtout après une soirée comme hier !). Quand tout ce cérémoniel fut finalement terminé, le soleil avait bien avancé et ses rayons ne caressaient que nos terres en face, le reste de la vallée étant empli d’ombre.
Pendant qu’on mangeait, j’apprenais que Frédéric et Joana avaient fait un stage chez nos anciens propriétaires, car ils rêvaient aussi de s’installer à la campagne. Ainsi ils avaient déjà été au courant depuis un bon moment que notre ferme était à vendre. Mais les propriétaires refusaient de la leur vendre. Alors ils avaient décidé spontanément d’acquérir cette petite propriété, parce que la vallée leur plaisait. Malheureusement leurs terres étaient exploitées par un berger qui ne voulait pas les céder. Étant obligés de rembourser leur crédit pour la ferme ils continuaient à vivre ailleurs. Frédéric travaillait comme prof dans un lycée professionnel, Joana comme secrétaire pour une association.
Je leur demandai comment la 2 CV était arrivée dans la forêt en dessous. Ils éclatèrent de rire. « C’était la nôtre ! Ça a été juste ! Ecoute ! », dit Joana et commença : « C’était en automne dernier. Arlo, le petit, venait juste de faire un an. On a été tous les trois en Andorre, plus exactement au Pas de la Case, un peu avant, où on peut tout acheter détaxé. On avait fait plein de courses, pour amortir le trajet, car aller-retour il y a près de six heures de route ! De l’huile d’olive, du vin, du tabac, de l’alcool et quelques sacs de sucre, pour faire de la confiture. Il faisait déjà nuit, le temps de revenir ici. Frédéric avait garé sa « Dedeuche » comme d’hab en bordure de la petite route. Le garçon dormait encore dans son siège et on s’est mis à décharger. Nous avons tout entassé au bord de la route. Nous avons seulement laissé le sucre dans le coffre, il pouvait attendre le lendemain ! Le gamin s’est réveillé et Frédéric l’a sorti de son siège. Il l’a posé à terre. A ce moment il nous a semblé que quelque chose avait bougé derrière nous. C’était la voiture ! Nous avons essayé de la retenir, mais elle était déjà trop loin sur le talus et commençait à dégringoler le pré. Et puis il y a eu quelques craquements horribles quand elle est entrée dans la forêt. Et puis - rien ! Elle était foutue ! Heureusement on avait sorti le gamin ! Nous avons réalisé quelle chance nous avons eu ! Alarmés par le vacarme les bergers sont sortis de leur maison. Ils nous observaient sûrement déjà depuis un moment. « Il n’y restera pas grand-chose ! », commenta l’un d’entre eux, « peut-être la roue de secours ! »
« Bien, nous avons monté le garçon à la maison où je l’ai fait manger pendant que Frédéric montait les courses en plusieurs aller-retours. Et figure-toi, le lendemain c’étaient les « poulets », les « flics », qui nous ont sorti du lit ! Apparemment le voisin les avait appelés ! Nous avons dû tous les trois les accompagner au poste. Le côté de la route a été barré avec un ruban, et aussi la carcasse de la Deuch dans la forêt. Plusieurs gendarmes s’affairaient autour. On nous poussait dans l’Estafette et c’était parti vers Castillon pour un interrogatoire ! Nous ne comprenions plus rien ! Ils voulaient savoir si nous prenions des drogues. ‘Bien sûr, Guinness !’, répondit Frédéric. ‘Qu’est-ce que c’est ?’, demandèrent-ils. Nous leur avons expliqué. Là ils se sont fâchés. Ils nous ont demandé directement si nous dealions des drogues. Nous avons répondu par la négative en riant. De ce côté-là, on avait la conscience tranquille ! ‘Qu’est-ce que c’est que cette poudre blanche éparpillée dans toute la forêt et dans la voiture ?’ C’est là que nous avons compris leur comportement et nous nous sommes mis à rire encore plus fort ! Ils avaient pris le sucre pour de l’héroïne ou de la coke ! Vers midi ils ont eu le résultat de l’analyse du laboratoire : du sucre ! Grincheux ils nous ont dit qu’on pouvait s’en aller. ‘Aller ? Faire 15 kilomètres avec le gamin ?’ Frédéric commençait à s’énerver. ‘Vous nous avez emmenés ici, vous allez nous ramener là-bas !’ Et c’est ce qu'ils ont fait finalement. Quand après trois jours les barrières étaient encore là, nous sommes quand-même descendus. Le sucre avait disparu, jusqu’à la dernière graine ! Quel travail ! Mais ils ne nous l’ont jamais rendu. Ils continuaient à espérer que le laboratoire s’était trompé ! » Nous nous roulions presque par terre de rire, en nous imaginant la scène !
Un troupeau relativement grand passait en contre-bas, accompagné par deux hommes un peu âgés et deux chiens. Les chiens nous aboyaient dessus depuis une distance avant de finir par suivre les brebis qui s’éloignaient. « Marcel, le berger et son domestique Philippe ! », expliqua Frédéric. Le soleil illuminait encore tout juste les plus hauts sommets et pour moi c’était l’heure de partir. Je leur dis « A bientôt ! » et commençai à redescendre la pente.
*
Malgré le crépuscule je trouvai le petit pont qui passait par-dessus le ruisseau. Il était situé un peu plus en amont de l’endroit où j’étais passé à l’aller. Bientôt je me trouvais en haut sur le chemin en terre, puis devant la caravane. Pas de lumière ! Un sentiment désagréable m’envahit. Je montai vite à la maison, pour aller à la rencontre de Ludwig. Mais là aussi : Personne ! « Peut-être qu’il est allé au troquet du village ! », me consolai-je en ramassant le linge sec. A cause de la fraîcheur du soir l’air était déjà un peu humide. Je descendis le linge vers la caravane et allumai une bougie. Entre-temps dehors il faisait nuit noire. De temps en temps j’entendais une chouette hululer. Puis une autre, plus loin, lui répondit. Cela me rappelait l’album « Umma Gumma » des Pink Floyd. Je scrutais la caravane. Là il y avait son duvet, son sac à dos, et même ses chaussures de montagne se trouvaient là ! « Il ne peut pas être bien loin ! », me dis-je et me mis à dormir. J’avais bien du sommeil à récupérer !
Mais le seul qui arriva était Jean-Paul avec sa bouteille de lait vert. « Où est Ludwig ? », demanda-t-il. Savait-il quelque chose qu’il ne me disait pas ? « En route, il ne va pas tarder à arriver ! », répondis-je malgré mon pressentiment qui me disait qu’il ne viendrait plus ! Car il aurait dû être là, où qu’il ait été ou à quel point il avait picolé ! Est-ce qu’il lui était arrivé quelque chose ? Avait-il eu un accident ? Était-il tombé dans un trou ? Ou était-il rentré à la maison ? Mais je rejetais de suite cette dernière pensée. Car toutes ses affaires étaient là, même sa carte d’identité ! Et puis Rudi, notre copain autrichien voulait venir le récupérer dans dix jours. En plus, il m’avait promis de m’aider quatre semaines au chantier ! « Il peut déjà être loin ! », songea Jean-Paul. « Comment ça ? », voulus-je savoir. « Comme ça … peut-être même qu'il est mort… » Je cessai de parler de lui et attendis que l’adolescent s’en aille. « Un jour quelqu’un le trouvera ! », dit-il en s’allumant une clope. Puis il me fit un clin d’œil avant de descendre vers le village.
*
Aujourd’hui le travail ne voulait pas avancer. Je ne cessais de penser à Ludwig. Je me remémorais toutes les aventures que nous avions vécues ensemble. Non, c’était impossible qu’il ait foutu le camp comme ça, après toutes ces galères communes (voir mon livre : ‘Contes d’Hiver’) ! Je redescendis encore vers la caravane et fouillais partout à la recherche d’un mot ou d’un signe. Rien ! Je remontai vers la maison, mais bifurquai à droite en montant la colline. Je suivis chaque passage d’animaux, chaque trace qui aurait pu être de lui, étant préparé au pire ! Mais toujours rien ! J’arrivai à l’endroit où les terres en friche faisaient place à la forêt de hêtres et l’appelai. Mais le bruissement du ruisseau était la seule réponse que le vent me renvoyait, par vagues. En suivant ce bruissement je me trouvais bientôt devant un petit cours d’eau qui descendait impatiemment dans un ravin raide. Je le suivis en longeant son bord et me trouvai tout à coup devant des crevasses profondes, cachées par des feuilles, qui pénétraient dans la roche à travers la couche d’humus de la forêt. Elles avaient été faites par la main de l’homme. Ici, il y a longtemps, on avait fait des ardoises pour les toits.
En glissant sur la couche profonde de feuilles vers le bas du talus je me trouvai en face de galeries étroites qui pénétraient dans la montagne. Je pris la première. Mes pieds patinaient sur des dalles cachées sous les feuilles pourries. Le filon devait rentrer dans la roche de façon oblique. Au-dessus de ma tête s’inclinaient des plaques de schiste épaisses, fendues légèrement par l’humidité et le gel et déjà écartées de la roche solide, comme une épée de Damoclès, menaçant de tomber au moindre choc. L’haleine froide de la montagne m’enveloppait. Plus j’avançais dans l’obscurité humide, plus les mousses sur les rochers cédaient leur place aux algues, au fond il ne restait que la roche noire, nue. Les tailleurs de pierre avaient avancé jusque-là, jusqu’au jour où ils avaient subitement arrêté leur travail. Pourquoi ? Sur le sol le vent avait entassé des feuilles mortes, qui m’arrivaient jusqu’aux genoux. Je les écartai avec les pieds. Rien, à part les quelques blocs tombés du haut. En quittant les lieux j’aperçus un scintillement jaunâtre dans la roche. Je m’approchai. Ça ressemblait à de la poussière d’or. Avions-nous une mine d’or sur nos terres ? Bien sûr que non ! C’était sans doute de la pyrite, un amalgame sulfurique, aussi appelée l’or des fous. Car dans le cas contraire, les tailleurs de pierre auraient arrêté l’exploitation d’ardoise bien avant et un cratère géant se trouverait à la place de nos prairies !
Il y avait plusieurs crevasses. Je devais toutes les inspecter ! Peut-être que Ludwig, en essayant d’explorer le terrain, avait glissé dans l’une d’entre elles et… Je repoussais toutes ces pensées noires et essayai de m’imaginer comment on avait travaillé à l’intérieur de ces puits. Sans doute que, munis de barres à mine, on avait détaché des gros blocs de la roche-mère, puis on les avait fendus en des plus petits avec des burins, en suite encore et encore, jusqu’à obtenir l’épaisseur voulue. Puis on les avait triés par taille et encore plus tard taillé leurs bords avec une sorte de hache large. En descendant je découvris des quais, des murettes surélevées, le plus souvent construites par la roche stérile ou des déchets, qui avaient sans doute servi à charger les dalles sur le dos des ânes pour le transport. Tout ceci avait depuis été recouvert d’une couche de mousse.
Au-dessus de moi un long tronc d’arbre recouvert de mousse traversait une large crevasse. Je voulais voir à quoi il avait servi, car je sentais que des mains d’hommes l’avaient posé là. Je montai. C’était une rigole. Le tronc avait dû être creusé il y a fort longtemps pour y faire traverser un canal d’irrigation. Ces rigoles déviaient des deux côtés des cours d’eau comme des arêtes de poisson, puis traversaient les pentes et les prés à des fins d’irrigation. Parfois elles faisaient plusieurs kilomètres de long. De tels canaux arrivaient aussi devant notre maison. A cause d’un manque d’entretien ils avaient fini par être remplis de terre. Ils suivaient les flancs des montagnes comme des courbes de niveau sur une carte.
Un vieil essieu de charrette gisait un peu plus en contrebas dans le lit du ruisseau. Les arceaux tordus des roues cassées mêlés aux rayons brisés étaient couverts d’une couche épaisse de rouille et de mousse. Que s’était-il passé ici ? Un transport de bois avait-il dégringolé la pente ? Je descendis à travers la forêt dont les arbres n’avaient toujours pas de feuilles, en suivant le cours d’eau. Bientôt un autre ruisseau rejoignit le premier et il me sembla entrer sur des terres encore utilisées. Les fortes pentes s’adoucissaient un peu et des bandes de prairies longeaient le ruisseau, bordées par des peupliers d’environ vingt ans. Le sentier se transforma en un chemin creux, dans lequel le ruisseau, à cause d’un glissement de terrain, avait pris son cours. En pataugeant, je suivis le chemin boueux et aperçus soudain derrière les arbres la décoration en colombage de notre caravane. Quelque chose bougeait à côté.
Mais pas Ludwig. C’était Jean-Paul qui faisait boire ses vaches. « Où est Ludwig ? » fut sa première question. Je haussai les épaules. « Peut-être qu’il a été mordu par une vipère ? » dis-je. « Pour les vipères il fait encore trop froid ! », répondit-il. « Peut-être a-t-il fait une mauvaise chute ? », songeai-je. « Ou - peut-être que tu l’as tué ? », prononça-t-il lentement. Je me mis à rire, sans trouver ça drôle. « Laisse tes mauvaises blagues ! », lui rétorquai-je. « Je connais plein d’histoires de gens qui ont disparu et plus tard on a trouvé que quelqu’un les avait tués ! » Il me scrutait d’en bas avec ses yeux de porcelet comme pour me tester. Il cria « pico ! » à son chien. Celui-ci fit un bond et mordit la jambe de la vache qui était en train de boire. Avant même que celle-ci ne puisse lui donner un coup de pied, il s’était déjà écarté d’un mètre. Lentement elle fit demi-tour et se mit à suivre l’autre en direction de l’étable. Jean-Paul lui aussi se tourna et se mit à suivre les bêtes, laissant derrière lui un nuage de fumée gris-bleu. « L’avoir tué ! Quel idiot ! » Mais soudain je réalisais que les gens du village se racontaient peut-être cette histoire ! Une telle histoire ne peut avoir pris racine uniquement sur son fumier ! A mes soucis du copain disparu s’ajoutaient maintenant des soucis de soupçons de meurtre !
*
Je ne mangeai rien, et après un coup d’œil dans la maison je pris le combi pour aller voir les anciens propriétaires de la ferme. Arrivé là, on me proposa une bière, pendant qu’ils se servaient un Pastis. Désormais les gens connaissaient ma préférence pour le jus de houblon à cette colle d’anis ! Nous levâmes nos verres et je leur racontai l’histoire de la disparition de Ludwig. « Une morsure de serpent est peu probable. Mais qu’il soit tombé dans un trou, c’est possible. Pas à la ferme, mais plus loin, là où le sol est calcaire il y a des « dolines », sorte de cratères, souvent couverts par des feuilles. La fermière avait une idée : elle connaissait bien l’adjudant-chef de la brigade, et celui-ci avait un chien pisteur. Nous décidâmes de nous retrouver le lendemain matin au village voisin, Auret. Devant la gendarmerie. D’une certaine manière cela allait contre mes convictions. Ma devise était : « Ne va pas à l’empereur, quand on te n’a pas appelé ! » Mais dans ce cas spécifique une exception était permise !
La caserne des gendarmes était un bâtiment de trois étages, sur le devant duquel se trouvait un insigne lumineux bleu-blanc-rouge portant le mot GENDARMERIE. André m’attendait déjà. « Au rez-de-chaussée se trouvent les cellules. Jean-Paul, de ton village, les connaît bien. Il y a plusieurs fois passé la nuit ! », mais il ne me dit pas pourquoi. Nous montâmes les escaliers en forme de pyramide jusqu’au premier étage. Au-dessus devaient se trouver les logements de fonction des gendarmes. A travers la porte ouverte nous accédâmes à un long couloir et frappâmes à la porte de service. On nous fit entrer et André raconta ce qui s’était passé.
Mais les gendarmes n’étaient que peu intéressés par mon collègue disparu. Ils me trouvaient beaucoup plus intéressant. « Votre passeport d’abord ! Et la carte de séjour. Vous n’en avez pas ? Mais vous devriez en avoir une ! » « Mais nous sommes en Europe, je n’en ai pas besoin ! », répondis-je. Ils m’expliquèrent que si je restais plus de trois mois en France j’en aurais besoin. « Je suis ici depuis trois semaines ! », répondis-je. « Pouvez-vous prouver ça, avez-vous un tampon dans votre passeport avec la date d’entrée ? » Bien sûr que non. Nous avions franchi la frontière comme ça. Mais je préférai ne pas leur dire. Le problème semblait se compliquer plutôt que de se résoudre ! J’avais pressenti ça ! « Ne va pas chez les flics, sauf si tu portes des menottes ! »… Entre-temps André papotait avec un autre gendarme. Ils semblaient se raconter des blagues cochonnes, car leur rire bruyant remplissait le bureau enfumé. Après un bon moment ils se trouvèrent à court de brimades et me dirent que c’était tout et que je pouvais m’en aller. « Et n’oubliez pas de demander la carte de séjour ! Ça prendra quelques mois ! » « Et mon pote ? Et le chien pisteur ? » « Pour le chien il faut voir la brigade de Castillon, et pour le copain… Des hippies il y en a plein dans le coin. Quand il y en a un qui se perd, il y en a deux qui apparaissent ! »
Alors je descendis à Castillon en suivant le fermier. La gendarmerie du chef-lieu du canton était aussi moche que celle d’Auret et construite d’après le même modèle. Ici le fermier me quitta. Il attendait un marchand de bestiaux qui voulait lui prendre les derniers animaux restants. Pour moi la même procédure qu’auparavant recommença, en commençant par la saisie des données personnelles. Il s’avérait que le chien pisteur était un chien d’avalanches. On approchait midi. Du clocher de l’église carillonnaient les cloches. Ceci motiva les gendarmes à terminer mon interrogatoire. Je me retrouvais dans la rue, soulagé mais pas avancé d’un pouce ! J’étais heureux d’être encore libre ! Heureusement qu’ils n’avaient pas encore eu vent des rumeurs qui circulaient au village ! Ou savaient-ils déjà, mais ne voulaient-ils pas avoir du travail supplémentaire ?
Alors je rentrai à la maison pour reprendre moi-même la recherche de Ludwig. Et voilà, qui vint à ma rencontre alors je montais la colline ? Les flics d’Auret ! J’avais l’impression d’être arrivé trop en avance ! Sans doute ceux de Castillon m’avaient retenu si longtemps afin que leurs collègues puissent fouiner chez moi sans être dérangés. Eh bien, je n’avais rien à cacher, mais je détestais les limiers. Ils me saluèrent énergiquement et voulaient savoir ce qu’on voulait faire ici plus tard. « Bien sûr de l’agriculture ! » « En communauté ? » « Plutôt en famille ! », répondis-je. Ils m’informèrent encore sur le nombre de véhicules qu’on avait le droit d’importer : « 1 voiture, 1 remorque. Le reste doit être dédouané ! »
*
La bouteille de lait était posée devant la caravane. Jean-Paul restait invisible. Avait-il vu les gendarmes ? Sans doute oui. Rien ne lui échappait, à lui et à sa grand-mère qui vivait au virage en sortant du village. Ça allait les faire jaser ! Je m’efforçais de manger un muesli et puis je repris la recherche du disparu. Vers le soir, en approchant la maison, je vis déjà Jean-Paul de loin, en train de fouiner. « Un jour quelqu’un le trouvera… ! », dit-il avec ambiguïté. Au lieu de répondre je préférai faire un mélange de mortier et monter les trois dernières rangées de parpaings de la fosse septique. Aujourd’hui je n’avais pas encore travaillé à la maison !
Quand la nuit fut tombée, je descendis au village. Le bar était peu fréquenté. On me demanda si Ludwig avait réapparu. J’étais sûr que Jean-Paul les avait tenus au courant de tout ! En plus, tout le monde avait vu passer les flics ! Quelqu’un mentionna qu’une personne du village avait vu dimanche après-midi un stoppeur au bord de la route, mais elle n’était pas sûre que ce soit Ludwig. Cela ne m’aida pas beaucoup. Après avoir bu deux bières, je remontai vers la caravane et passai une nuit inquiète. Le lendemain matin je pris un autre itinéraire, cette fois au-dessus de la maison, là où la forêt avait reconquis la plus grande partie des terres arables. Je découvris quelques granges en ruine, un hameau abandonné, tout un système de chemins. Je regardais dans tous les bâtiments. A l’intérieur se trouvait parfois encore du foin fané, mais noirci côté ouest à cause du mauvais temps pendant les décennies écoulées. Le fumier avait rétréci en une couche de tourbe. L’intérieur ressemblait à un village-musée. Mais je ne trouvai aucune trace de mon copain !
Vers midi je descendis à la maison. Il faut agir ! Il faut mettre les choses au clair ! Je devrais appeler quelqu’un de sa famille ! Mais qui ? Son père ? J’avais parfois travaillé avec lui et on se tutoyait. Ou mieux, plutôt sa copine ? Tant qu’on ne l’avait pas trouvé, il demeurait encore un espoir qu’il soit en vie. Et enfin Jésus même n’avait ressuscité qu’au troisième jour ! Je descendis au village. Le bistrot était ouvert. La patronne rinçait les verres de la veille. Je lui demandai de mettre le compteur à zéro et me rendis aux toilettes. Je composai le numéro de sa copine.
Après de longues sonneries, quelqu'un décrocha. C’était elle. Je ne savais absolument pas comment lui apprendre la disparition de Ludwig. Je décidai de le faire à la française: « Comment ça va ? Bien ? Chez vous aussi il fait beau ? » Mais bientôt je ne savais plus quoi dire. « Mais pourquoi tu m’appelles, en fait ? », voulut-elle savoir. « As-tu des nouvelles de Ludwig ? », demandais-je pour préparer le terrain. « Pourquoi des nouvelles ? Il est dans le salon sur le canapé et fait la grasse matinée ! » Je n’en croyais pas mes oreilles ! Un soulagement énorme m’envahit. Il était vivant ! Mais ensuite je fus désarçonné... « Mais depuis quand ? » demandai-je. « Tu poses de drôle de questions ! Depuis qu’il a fini le repas, bien sûr ! » « Depuis quand est-il de retour je veux savoir ?! » « Depuis lundi après-midi, environ… » « Mais ce n’est pas possible ! Ici on le cherche partout ! » « Comme ça, au moins tu ne t’ennuies pas ! », fut sa réponse. « Passe le moi ! » Après un moment j’entendis sa voix à l’autre bout du fil. « Ah, c’est toi, salut ! Quoi de neuf en France ? » « La dernière nouvelle est, qu’ici, depuis trois jours on te cherche partout ! » « Pourquoi ça ? Je vais bien ! » « Pourquoi as-tu disparu si soudainement ? » « Euh, j’ai monté la côte et il y avait Madame Ail (c’est ainsi que nous avions surnommé la mère de Jean-Paul) et nous avons parlé un peu, sans trop se comprendre. Quand je suis arrivé sur la crête, j’avais envie de boire un expresso. Alors je suis descendu de l’autre côté vers la vallée. J’étais bientôt sur la route et j’ai tendu le pouce en l’air. Et le premier qui s’est arrêté se rendait comme par hasard à Paris. Il te connaissait même, il t’a vu dans le troquet une fois. C’était super ! A huit heures du soir j’étais à Paris. Je sirotais quelques expressos et puis j’ai sauté dans le métro, sans ticket, bien sûr, et j’ai quitté le bled. Et je me suis de nouveau posté au bord de la route. Figure-toi que la France est le pays idéal pour les auto-stoppeurs ! Le lendemain midi j’étais de retour à la maison, juste à temps pour déjeuner ! » « Tu aurais au moins pu dire un mot ! » « Tu n’étais pas là ! » « Ou écrire trois lignes ! » « Je ne vais pas descendre de la montagne pour une bagatelle pareille ! » « Je craignais que quelque chose te soit arrivé. Jean-Paul a raconté que je t’avais tué ! » « Que quelque chose me soit arrivé ?! Moi tué ?! Ça me fait hennir de rire ! Les mauvaises herbes ça ne s’élimine pas si facilement que ça ! En plus, je suis venu de mon plein gré, alors je peux repartir quand bon me semble ! » Face à une telle logique, il ne me restait plus qu’à raccrocher. Soulagé, mais en colère !
Je racontai la conversation à la patronne. Elle allait faire le nécessaire pour que la nouvelle se sache ! Quand le lendemain matin Jean-Paul m’apporta son lait verdâtre et me répéta, en me faisant un clin d’œil avec ses yeux de porcelet : « Un jour on le trouvera ! » Je lui répondis que j’avais parlé avec Ludwig au téléphone et qu’il était rentré chez lui. « C’est pas vrai, toutes ses affaires sont encore ici ! » insista-t-il. Avec de telles têtes de mule il me faudrait anticiper ! Je descendis voir les gendarmes pour leur faire savoir que mon pote était rentré chez lui. Cela ne les étonnait guère. « Vous autres hippies, vous venez et repartez quand ça vous chante. Si nous devions nous occuper de chaque disparation, on aurait du travail ! Déjà que ceux qui restent nous donnent assez de fil à retordre ! »
*
De retour à la maison, je pus enfin reprendre mon travail. Je serais encore seul ici pendant une semaine, puis un autre copain de mon village et le frère de Doris viendraient m’aider pour deux semaines de plus. Mon but, en ce laps de temps, était de poser le plancher des deux étages, installer les escaliers et une salle de bain provisoire. Avec un peu d’organisation ça pouvait être possible ! Je me procurais tout le matériel nécessaire, mais laissai tout dans le véhicule, afin de le monter une fois que mes amis seraient là. J’avais essayé de monter un chargement avec Jean-Paul au timon du chariot. Mais ça ne se passa pas comme prévu et il termina dans le ruisseau. Après coup, je m’étais demandé s’il ne l’avait pas fait exprès, car ce n’était pas si difficile que ça ! En attendant je continuai avec les matériaux qui étaient déjà sur place. Je montai les cloisons de la salle de bain, je crépis la fosse septique. Une fois sèche, je pourrais y appliquer la couche de goudron et puis couler la dalle au-dessus.
J’installai et branchai les lavabos. Les tuyaux en PVC s’avéraient être une solution idéale car ils étaient faciles à couper et à poser. Au lieu d’utiliser un taraud, il suffisait de passer du papier de verre et puis de la colle. Mais il n’y avait pas assez de pression pour que l’eau monte jusqu’à la cuisine. Je me procurai alors une bobine de tuyau Polyuréthane en 25 mm et un embout avec crépine. Il me restait un fût en plastique avec couvercle. Celui-ci ferait l’affaire comme captage et réservoir de la source plus haut, d’où venait le ruisseau que nous avions déjà capté provisoirement. D’abord je perçai un trou de 10 mm dans la paroi avec la perceuse à manivelle, à environ 10 cm du fond. J’agrandis ce trou avec une râpe afin que le tuyau de 25 peinât à y rentrer. Ainsi au moins c’était étanche ! Je fixai la crépine dans cet embout. Plus bas, à peine au-dessus du fond, je fis un autre trou, cette fois de 32 mm, dans lequel j’enfonçai un bout de PVC que je fermai avec un bouchon. Celui-ci servirait plus tard pour purger le dépôt de temps en temps. En partant du milieu vers le haut je perçai des trous de 5mm dans la paroi, par lesquels la source pourrait s’infiltrer dans le fût. En haut, juste en-dessous du bord, un autre trou de 32, dans lequel j’introduisis le trop plein. Je creusai la source le plus profond possible et y posai le tonneau. Je dus le remplir d’eau pour l’alourdir afin d’éviter qu’il ne flotte. Maintenant je pouvais remplir l’avant et le tour avec de l’argile afin que l’eau ne puisse pas s’écouler vers le devant, et à l’arrière je mis du gravier. L’eau pouvait alors s’infiltrer à travers celui-ci et les trous dans le fût. A ma satisfaction le niveau dans le tonneau montait doucement. Je tassai bien l’argile humide autour du fût. Bien sûr, la première eau était trouble. Je la laissai s’écouler par la purge, et bientôt l’eau qui suivit fut limpide. Il ne restait plus qu’à mettre le couvercle ! Il n’y avait pas une grande réserve, mais plus tard on pourrait y ajouter d’autres fûts de stockage. J’étais content de ma réalisation !
Plus tard j’allais construire un bac énorme à côté de la maison, assez pour stocker une grande réserve afin de faire tourner la turbine aux heures de pointe pour produire de l’électricité. En même temps ce bassin pourrait servir de piscine. J’imaginais déjà les enfants barboter et j’entendais leurs rires !
*
Reiner et Rolf étaient arrivés. Nous pouvions enfin monter tout le matériel. L’intérieur de la maison ressemblait à un trou noir avec deux grandes toiles d’araignée suspendues dans le vide, les ossatures des deux planchers. Nous commençâmes avec la pose de quelques piliers et poutres de soutien et les vissâmes avant de couper à la tronçonneuse les passages pour les escaliers. Entre-temps j’avais reçu les marches. Dans la scierie j’avais découvert une pile de madriers secs de 32 mm que le menuisier du village voisin avait délignés et rabotés. Puis nous sortîmes l’échelle longue, qui montait de la cave jusqu’au grenier. Dans cet espace nous posâmes les deux limons, les montants latéraux du premier escalier. Il fallut tout percer à la main avant de pouvoir fixer les limons avec des grands clous en haut aux poutres du plancher, et en bas sur une poutre hérissée de clous et coulée dans une chape de béton. A des endroits stratégiques nous utilisâmes des tire-fond. Maintenant, ayant la hauteur et la pente exacte, nous pouvions calculer l’écart entre les marches, qui devait être autour de 20 cm, ainsi que leur nombre. Conditionné par une poutre porteuse transversale qu’on ne devait pas toucher, l’escalier était relativement raide. C’est pourquoi nous ne posâmes pas de contremarches. A l’aide d’un niveau à eau, nous traçâmes alors des lignes parallèles à l’intérieur des limons dont l’écart correspondait à la hauteur des marches. En dessous des lignes nous vissâmes des morceaux de liteaux équarris préalablement enduits de colle sur une face. Avant que la colle ne prenne, nous y posâmes les marches en les fixant avec des vis. Maintenant il fallait laisser le temps à la colle de prendre.
Jusqu’alors, tous les travaux avaient été de la démolition, aujourd’hui nous avions commencé la reconstruction ! La baraque commençait doucement à ressembler à une habitation ! Le soir venu, nous arrosâmes ça avec une bonne bière, que les amis avaient apporté d’Allemagne. Le lendemain nous commençâmes la pose du parquet. Il s’agissait de planches de pin de deux mètres de long, équipées de rainures et languettes des quatre côtés, ficelées en bottes de cinq. Jusque-là je ne connaissais que les planches de parquet allemandes. On se procurait ces planches un peu plus longues que nécessaire puis on les raccourcissait à la bonne longueur. Dans ce cas il n’y avait pas de jonctions. Nous commençâmes la pose. Bientôt nous nous rendîmes compte que la rainure ne passait pas au milieu, mais un peu décalé. Certaines planches dépassaient un peu par rapport aux autres. Il fallut les arracher. Mais alors, quel côté était face et lequel était pile ? Nous nous mîmes d’accord pour la face dont la rainure était la plus épaisse. Cela semblait être bon ! Nous posâmes la première rangée, les ajustâmes avant de commencer à les clouer. Une autre surprise ! Les clous se tordaient et refusaient de pénétrer dans les poutres ! Notre but était de clouer de façon ‘dissimulée’, dans l’angle de la languette. Mais ça s’avérait impossible. Les languettes se fendaient.
Il ne nous restait alors qu’une option : clouer à travers la face ! Afin que les clous soient moins visibles, nous achetâmes des clous avec une tête minuscule, appelée ‘tête d’homme’. Un nom peu flatteur… Mais même en clouant de cette manière, il y avait des clous qui se tordaient et il fallut les sortir au pied de biche. A leur place nous plantâmes des clous en acier, que nous dûmes commander en ville. Après avoir posé la première rangée il nous restait la chute de la dernière planche. Que faire avec celle-ci ? Puis nous vint l’illumination : c’était le début de la rangée suivante ! Ainsi on évitait aussi que toutes les jonctions se trouvent au même endroit ! Génial, le parquet sans perte ! Par endroits nous étions obligés de mettre des cales, car la plupart des anciennes poutres n’étaient pas planes. Nous le fîmes en utilisant les liteaux qui avaient servi à séparer les diverses couches des bottes de parquet sur la palette. Une chute de parquet servait comme protection de la rainure quand nous frappions les lames avec une massette, pour les approcher les unes contre les autres. Parfois les planches étaient légèrement tordues. Nous avions acheté le troisième choix, car moins cher. Apparemment c’étaient des planches avec des défauts légers et beaucoup de nœuds. Quand une planche s’avérait trop tordue, il fallait d’abord clouer un côté, puis l’alourdir afin de la bloquer, puis essayer de la forcer avec des coups de massette contre la précédente. Vite un autre clou en travers, afin qu’elle ne puisse plus bouger ! Le premier choix coûtait plus que le double et nous ne voulions pas poser une piste de danse ! Il fallait faire attention que les jonctions ne soient pas trop près les unes des autres.
Bientôt la maison sentit la forêt, la résine et le bois. Notre savoir-faire s’améliorait avec chaque rangée posée et nous travaillions main dans la main. Le soir venu, nous avions créé une surface de trois mètres de large devant le foyer. Un feu de cheminée s’imposait ! Pendant que je le préparais, les autres descendirent à la caravane chercher les duvets et les provisions. Bientôt nous étions allongés autour du feu et nous nous mîmes à l’aise. Nous regardions les flammes chaudes, scrutions le bois se transformer d’abord en charbon puis en braise, duquel s’échappait ci et là, comme d’un briquet, un petit jet de gaz brûlant. Bientôt nous succombions tous à sa magie hypnotique. Nous prenions conscience que depuis que l’humanité existe, le feu se trouve au centre de toute vie commune ! Il nous apparut comme le symbole de la force vitale qui nous traversait. Des souvenirs nous submergèrent, d’autres feux et d’autres lieux qui nous avaient unis. A partir de maintenant nous allions dormir dans la maison.
*
Ça faisait maintenant plus d’une semaine que les amis étaient là. Entre-temps nous avions commencé le plancher du grenier. Le mauvais temps avait apporté le froid et tout devenait un peu désagréable. Mais le travail nous réchauffait. C’était le soir. Nous étions dans la caravane en train de faire la cuisine. La pluie martelait le toit. Dehors l’eau s’était accumulée dans les traces des roues. Seules les chouettes étaient actives. De partout résonnaient leurs appels et réponses lugubres. J’ouvris la porte de la caravane afin de sortir pour me soulager, parce que la bière allemande provoquait une envie accrue. A ce moment j’aperçus une silhouette s’approcher à travers l’obscurité. En bondissant en zigzag elle essayait d’éviter les flaques d’eau sur le chemin. Qui est-ce que ça pouvait être ? J’allumai la torche. Puis je reconnus le sauteur. C’était Rudi, notre ami autrichien ! On ne s’attendait pas à le voir ! « Hello ! », cria-t-il, « Dommage ! Je voulais vous surprendre ! Mais Ludwig m’a déjà vu et vous a annoncé mon arrivée ! » « Ludwig – ton arrivée ? » Je ne comprenais rien. De nouveau une chouette cria. « Là, tu l’entends ? Il appelle de nouveau ! Il doit être quelque part sur la pente ! » « Rentre d’abord au sec ! », lui dis-je. Nous nous saluâmes. On se serra un peu et je posai une autre assiette sur la petite table. Quelqu’un lui donna une bouteille de bière et je remplis les assiettes. « Qu’est-ce qu’il fait Ludwig, pourquoi il ne rentre pas ? », voulait-il savoir. « Il y a dix jours que Ludwig n’est plus là. Il est rentré par autostop sans dire un mot ! », et je lui racontai l’histoire en trois mots. « Et moi, j’ai fait 1300 kilomètres pour le chercher ! Nous avions prévu de voyager encore une semaine à travers la France comme Astérix et ‘Le Tour de Gaule’ ! » « Je croyais qu’il t’avait averti ! », répondis-je. On se mit à table en échangeant des nouvelles. « Vous savez quoi ? », dit-il après un moment, « d’après ma carte, l’Espagne n’est pas loin. Demain nous y irons tous ! Par ce temps de cochon vous ne pouvez pas travailler ! » Après manger il alla chercher sa ‘mallette à échantillons’ dans la voiture et sa machine à rouler et se mit à fabriquer un pétard. Il me le tendit pour l’allumer. « Non merci ! », je refusai, « pour le chantier j’ai besoin d’une tête lucide ! Pour l’instant je reste abstinent ! » Il l’alluma lui-même. La fumée commençait à rendre l’air de la caravane plus épais. L’ambiance monta de quelques degrés. Il alla chercher son magnétophone à cassettes et y introduisit les « Dubliners ». Plus tard nous lui laissâmes la caravane et montâmes vers la maison.
Le lendemain matin nous visitâmes le chantier et les terres. Il fut bientôt midi. Puis nous partîmes tous les quatre dans sa Simca rouge à travers le col, vers l’Espagne. La pluie s’était remise à tomber et au col on se retrouva en plein dans les nuages. Dommage, car de là, on avait une vue magnifique sur notre ferme ! Rudi descendit presque en tâtonnant la route étroite et sinueuse. Nous ne voyions que vaguement les arbres pleins de lichen et le sous-bois couvert de buis. Lentement la visibilité s’améliora. Bien sûr, les douaniers espagnols eurent quelques questions à nous poser. Au deuxième village espagnol Rudi s’arrêta. « Je vous invite tous à manger ! », dit-il en nous dirigeant vers un restaurant. Mais il était déjà trois heures passé, un peu tard, même pour l’Espagne ! On nous conseilla d’attendre le dîner. Mais c’était trop tard pour nous. Nous déambulâmes alors à travers les ruelles peu fréquentées. Des échoppes de souvenirs alternaient avec des boutiques de mode et des magasins pour alcool et cigarettes. Face à la bruine omniprésente, nous nous réfugiâmes dans un bar, commandâmes quatre verres de rouge en grignotant des cacahuètes. Soudain les verres et les bouteilles dans les étagères se mirent à danser. Tout le monde se précipita dehors. Nous restâmes, en pensant qu’un train était passé derrière le bâtiment. Quelqu’un revint, nous prit par les manches et nous traîna à l’extérieur. Il baragouina quelque chose comme « terremoto », « seismo ». Là on avait compris ! Tout le monde parlait avec excitation. Quand, après un moment, tout redevint calme, les premiers rentrèrent dans le bar. Nous les rejoignîmes et le barman paya une tournée pour la survie. Par un temps pareil même l’habituel « midi ensoleillé » paraissait gris. L’estomac vide, nous rentrâmes en France.
*
Lentement les gouttes se transformèrent en flocons. En approchant du col, la couche de neige sur la route s’épaissit de plus en plus. Les branches alourdies par la neige se courbaient au-dessus la chaussée. La voiture chassait dans les virages et l’avance devint pénible. Nous n’étions qu’à 100 mètres du col quand la voiture s’arrêta. Mais très brièvement, puis elle commença à reculer en glissant. Nous parvînmes tous les trois à sauter dehors et commençâmes à pousser, pendant que Rudi appuyait en vain sur les freins. « Qu’est-ce que tu as sur les jantes, ce sont des concombres, pas des pneus ! », s’étonna Rolf. « J’ai mis exprès les vieux pneus d’été, en les croyant suffisamment efficaces ici dans le Midi », se défendit Rudi. Alors c’était ça ! Et c’était à nous maintenant de pousser la bagnole jusqu’au col ! Et nous réussîmes !
Arrivé en haut, Rudi sortit son appareil photo de la boîte à gants et déclama de façon théâtrale : « Des instants pareil méritent d’être capturés pour la postérité ! » Et paf, il reçut une boule de neige en pleine figure ! Nous le laissâmes descendre seul. C’était trop risqué, de rentrer dans sa luge ! Comme des dunes blanches les montagnes s’étalaient à nos pieds. Malheureusement les plus hautes se cachaient dans les nuages. Et sur l’une de ces dunes se trouvait notre ferme. Mais toutes ces dunes avaient la même apparence… « Je vous invite tous à manger ! », dit Rudi. « C’est la deuxième fois que tu nous invites, nous ne pouvons pas accepter ça ! », se moqua Reiner. Nous nous mîmes à la recherche d’un panneau « Restaurant ». Dans le premier bled que la route traversait en serpentant, rien ! Mais dans le deuxième nous trouvâmes un panneau « Auberge de l’Izard ». Il n’y avait que le bar d’ouvert. Apparemment c’était l’heure de l’apéro. Demander ne coûte rien ! La patronne nous observa en se demandant si ça ne vaudrait pas mieux de nous dire que le cuistot était de repos. Mais son sens des affaires fut plus fort et elle ouvrit la porte de la salle. Elle alluma les néons et nous guida dans une pièce oblongue sentant un peu le moisi, où deux rangées de tables couvertes de nappes cirées nous attendaient. Elle nous plaça à proximité de la cheminée ouverte, qui n’était pas allumée. Puis elle posa une bouteille de gaz équipée d’un dispositif de chauffage à nos côtés et demanda qu’est-ce que nous voulions boire. Bien sûr tout le monde réclama un Pastis, sauf moi, qui optai pour une bière. Rudi, parlant bien le Français, était déjà en pourparlers pour le repas.
« La bonne dame demande si on se contenterait de quelque chose de simple, car pour l’instant ils ne sont pas bien préparés à accueillir du monde ! », expliqua Rudi. « N’importe quoi, à condition que ce soit comestible ! » Pendant ce temps son mari s’affairait dans la grande cheminée et bientôt surgirent les premières flammes. Des trophées de chasse nous dévisageaient du haut des murs. Une énorme tête de cerf, plusieurs bois crochus, sans doute des chamois, et la tête bien garnie de défenses d’un sanglier mâle. « 140 kilos ! », expliqua l’hôtelier, voyant nos regards posés sur celui-ci. Commença une conversation pendant que lentement les flammes grignotaient le gros bois qui commençait à rayonner un peu de chaleur vers nous. Rudi semblait s’y connaître un peu en chasse et nous apprîmes que l’auberge portait le nom des chamois des Pyrénées, de plus petite taille que leurs cousins des Alpes, que l’on appelait ici isards.
Les amis réclamèrent un autre Pastis. Entre-temps l’aubergiste avait posé une terrine énorme pleine de soupe dégageant des vapeurs alléchantes sur la table, saisit quatre assiettes profondes dans une étagère murale et les posa bien remplies devant nous. Que ça faisait du bien ! Après les premières cuillères une vague de chaleur agréable nous envahit jusque dans notre moelle dorsale. Bien sûr que nous ne refusâmes pas un deuxième remplissage ! Nous laissâmes quand même un petit reste, non par politesse, mais en pensant que les hôteliers aussi devaient manger… Suivit bientôt une terrine avec du pâté, un plateau avec d’énormes tranches de jambon et de saucisson, agrémenté de minuscules concombres très acides, appelé cornichons. Ils s’excusèrent de ne pas avoir de salade. Avec ça ils apportèrent un panier contenant du pain blanc découpé, une carafe de vin rouge et une cruche d’eau. Bien entendu, par un temps pareil nous ne touchâmes point à l’eau ! Soudain nous nous rendîmes compte que depuis le petit déjeuner, à part les quelques cacahuètes espagnoles, nous n’avions rien mangé et nous nous jetâmes sur le « casse-croûte ». Parfois, à travers la porte, l’aubergiste nous jetait un coup d’œil et semblait se réjouir de notre appétit. Ne sachant pas si après ce casse-croûte il y aurait autre chose, nous nous servîmes jusqu’à ce que les plateaux soient vidés. Nous nous sentions à nouveau comme des êtres humains !
L’aubergiste rentra, portant quelques bûches dans les bras, qu’il posa sur la braise. Des étincelles tourbillonnaient et disparaissaient dans la hotte avec les flammes. Avant de sortir il ramassa les assiettes. « Ça semble être la fin ! », dit Rolf. « Moi pour ma part, j’en ai assez ! » Nous étions d’accord avec lui. Puis l’hôtelier revint et posa des assiettes apparemment préchauffées devant nous. « Il semble y avoir une suite ! », constata l’un d’entre nous. Et c’était bien ça ! Une bassine énorme pleine de pommes de terre bouillies fumantes fut hissée sur la table et une autre terrine pleine à ras bord d’une sauce sombre de laquelle émergeaient quelques morceaux de viande. Le parfum qui en émanait nous fit instantanément oublier que nous avions déjà mangé à notre faim. Et même moi qui étais végétarien, j’étais prêt à faire une autre exception. Et quand l’aubergiste nous annonça que ce ragoût venait d’un sanglier qu’il avait tué lui-même avant-hier dans la montagne, nous nous sentîmes comme les irréductibles Gaulois dans leur village au banquet final.
La carafe se vidait ainsi que les terrines. La patronne nous regarda plusieurs fois. Était-elle vraiment si soucieuse de notre bien-être ou craignait-elle que nous finissions tous ses stocks ? Quand enfin nous étirâmes nos jambes et nous mîmes à l’aise, arriva une planche avec une demi-tomme d’un fromage un peu mou plein de petits trous. Quand on nous annonça solennellement que c’était un fromage du village appelé « Pic de la Calabasse » d’après la montagne la plus haute du coin, nous surmontâmes une fois de plus notre sensation de satiété et chacun en coupa un gros morceau. Sa consistance ressemblait un peu au « Räskas » de la Forêt de Bregenz, mais son goût était encore pire. Rudi demanda un peu d’ail pour garnir le morceau avec des tranches fines et saupoudrer le tout avec un peu de poivre et de sel. C’était un régal ! Rudi demanda une bonne bouteille de rouge. Après un moment l’aubergiste revint avec quelques bouteilles poussiéreuses et nous les mit sous les nez. Qu’est-ce nous connaissions en vin ? Sauf peut-être Rudi, qui sortit ses lunettes de manière compliquée et scrutait les étiquettes. En dégustant le fromage et le vin nous nous remémorions toutes les régions où nous avions déjà savourés les deux : Girlan, la vallée de Sarn, chez Hiesel, la vallée de Leckner… « Toutes sont des intersections cosmiques, Lourein aussi ! », nous expliqua Rudi.
Plus tard la patronne remplaça le plateau de fromage presque vide par une galette en pâte feuilletée truffée de pruneaux, encore bien chaude, au parfum de beurre et d’eau de vie, la spécialité locale appelée « croustade ». A ceux qui en avaient envie, on servit un café épais. Puis le patron réapparut avec, cette fois, une seule bouteille dans une main et cinq verres dans l’autre. Il s’assit à notre table. Il déposa un verre devant chacun d’entre nous et le remplit à ras du liquide transparent de la bouteille. Nous trinquâmes et portâmes les verres à la bouche. Nos têtes virèrent au rouge et nous n’arrivions plus à respirer. Nous tous, sauf Rudi, reposâmes nos verres sur la table. Celui-là démontra à l’aubergiste qu’un natif de Vorarlberg peut bien rivaliser avec un Ariégeois ! Puis il nous offrit son tabac. Sur le paquet était écrit « Bergerac ». Est-ce que c’était le tabac de la bourgeoisie, le « Caporal » étant réservé aux bergers ? Mais ses feuilles n’étaient pas gommées non plus !
« Qu’est-ce que vous faites ici à cette époque de l’année ? », voulait-il savoir, « Ce n’est pas un temps pour faire du tourisme ! » « Nous avons achetés une ferme dans le coin et voulons nous installer ici ! », expliquai-je. « Alors une communauté », constata-t-il, « On a déjà eu ça dans la commune ! » Je m’aperçus qu’il y avait un malentendu et lui expliquai. « Non, ce sont des amis qui donnent un coup de main pour retaper la maison. Ma famille viendra plus tard ! » Bien sûr, qu’il avait déjà entendu parler de nous. Tous semblaient parler que de nous ! Jean-Paul aussi avait déjà raconté ses histoires au bar. « Il faut être fou pour venir s’installer ici ! », conclut-il. Je le prenais plutôt comme une reconnaissance. En tout cas il connaissait Maryse, l’ancienne propriétaire de chez nous ainsi que notre ferme. Il y avait souvent été en cherchant des champignons. « Très pentu et très sauvage. Mais un bon coin pour les cèpes et les morilles ! » Au bout d’un certain temps la bouteille fut vide, ce que nous prîmes comme un signal de départ. Mais ce n’était pas si facile que ça ! Car soudain nous ressentîmes les séquelles d’un repas français ! Rudi régla l’addition en laissant un bon pourboire. Parce que nous avions bu vraiment plus que bien et bien plus qu’il n’en fallait !
En rassemblant tous nos efforts, et en y ajoutant des blagues et conseils au chauffeur, nous réussîmes à monter la voiture sur la colline. La neige avait cessé de tomber et les pneus lisses trouvèrent enfin quelque chose à mordre sur la surface caillouteuse. Arrivé au bout de la route nous eûmes de la peine à quitter les sièges. Les trois autres dormirent dans la caravane pendant que je montai la côte en rampant, mon duvet se trouvant dans la maison. Heureusement j’avais une des couvertures en laine de chameaux dont Rudi faisait commerce. Celles-ci, à cause de petits défauts de tissage, ne coûtaient pas cher et il avait équipé tous ses amis avec. Le lendemain il reprit la route. Sans Ludwig. Celui-ci devait dormir chez lui, sur le canapé. Mais Rudi n’avait pas du tout regretté sa venue dans ce petit village Gaulois…
*
Les parquets étaient posés, les escaliers montés, les anciennes fenêtres arrachées et de nouveaux cadres posés. Ceux-ci avaient aussi pour fonction de soutenir les linteaux fatigués. Rolf et Reiner étaient repartis. J’étais de nouveau seul. A part Jean-Paul ou sa mère qui faisaient paître leurs brebis sur nos terres. Je leur avais permis. En contrepartie ils allaient labourer notre champ avec leur attelage de vaches, car avec leur tracteur énorme, un vieux AVTO rouge et russe, ils ne pouvaient guère monter ici. Ils l’auraient renversé. A environ trois cents mètres de la maison j’avais découvert une source et je me demandais comment je pouvais l’amener à la maison. Car l’idée de produire du courant avec une turbine me trottait dans la tête.
Un soir, alors que je rentrais affamé avec plein de matériel de la ville, le restaurant était illuminé et les tables mises. Je m’arrêtai et demandai si je pouvais y manger. La patronne marmonna quelque chose concernant une soirée privée. Quand je remis le moteur en marche, l’un des participants approcha et me dit que je pouvais rester dîner avec eux. C’était le repas annuel des chasseurs et je serais le bienvenu, car ils chassaient aussi sur nos terres. « Peut-être un jour tu deviendras chasseur toi-même ! », ajouta-t-il en riant. Me voilà assis avec une cinquantaine de personnes, pour la plupart des inconnus, autour de tables rangées en U. Je reconnaissais Yvon, le maire, Jean-Marc, qui l’avait dirigé quand il avait monté du sable avec son camion, et quelques autres que j’avais vu au bistrot. Il y avait une bonne ambiance, le repas, du sanglier dans tous ses états, était extra. Plus tard on superposa les tables les unes sur les autres contre les murs, rangea les chaises en cercle autour de la salle pour les personnes âgées. Et tous ceux qui en étaient encore capable dansèrent aux rythmes d’un accordéon joué par un homme un peu âgé. Je l’avais déjà croisé à plusieurs reprises, car il était le facteur de notre vallée. Il transpirait plus que les danseurs et se rafraîchissait à la bière. J’avais compris pourquoi il promenait toujours une caisse de bière sur la banquette arrière de son Ami 6 ! Il souffrait d’excès de transpiration !
*
Le lendemain je passais un mélange de 2/3 d’huile de lin et 1/3 d’essence de térébenthine sur les planchers, car le jour suivant j’avais prévu de rentrer en Allemagne. Lors de notre retour, tout serait bien imprégné. Avec une bande de bâche en plastique j’avais matérialisé un passage sur le parquet pour ne pas le salir et je commençai par bien enduire le bois neuf à l’endroit le plus éloigné. J’entendis une voix de femme parler. C’était la mère de Jean-Paul qui se parlait à elle-même. « Bou diou ! Il y a déjà des escaliers dans la maison, et les planchers ! » J’entendis ses pas monter les marches. « Il ne me manquait plus qu’elle ! », songeai-je en continuant de passer la brosse. Ses pas approchaient. « Ah, te voilà ! Que c’est propre ici ! Tout neuf ! Mais aujourd’hui c’est les Rameaux, on n’a pas le droit de travailler ! », cria-t-elle, puis elle se trouvait déjà derrière moi pour me faire la bise. Je posai la brosse et me levai. Je n’en croyais pas mes yeux ! Elle avait traversé le parquet blanc et propre avec ses sabots pleins de merde ! Je poussai un cri : « C’est propre ? – Tu devrais dire ‘c’était propre’ ! La bâche, je l’ai mise exprès pour qu’on y marche dessus ! » « Je l’avais bien vue, mais je n’osais pas la salir ! » Je l’accompagnai en bas en disant : « A partir de maintenant, accès interdit au chantier ! En plus, le vernis c’est très toxique. Pendant 14 jours on ne doit pas y rentrer ! » Je disais ça pour être sûr qu’elle ne vienne pas y fouiner pendant mon absence. Elle recommença : « Aujourd’hui c’est les Rameaux, on ne doit pas travailler ! » « Et qu’est-ce que tu fais ? », lui demandai-je. « Je ne fais que garder les « oueilles », les moutons ! » Je me mis à préparer un seau et une serpillère pour enlever la crasse. Elle prit le seau, posa ses sabots à côté et se prépara à monter. Elle était pieds nus. Et ses pieds avaient la même couleur que ses sabots. « Je m’en occupe ! », dis-je en prenant le seau. « Comme je disais, le vernis est très toxique ; c’est trop dangereux pour toi, les pieds nus ! »
Le soir j’avais terminé. La maison sentait comme une forêt dans les Landes. Je passais une chaîne derrière le cadre et à travers un nœud dans la porte et y accrochais un gros cadenas. La nuit je dormis dans la caravane. Le lendemain matin je partis pour l’Allemagne.