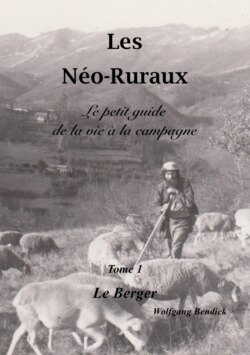Читать книгу Les Néo-Ruraux Tome 1: Le Berger - Wolfgang Bendick - Страница 8
PRINTEMPS
ОглавлениеNous fêtâmes Pâques dans notre vieille maison en bois. Les voisins, sachant que nous allions bientôt partir, nous demandèrent des objets. Le fût en chêne énorme, transformé en cabane, fut roulé trois maisons plus loin, afin de servir aux enfants du voisin. Nos chaises et la table, taillés dans des troncs d’arbre semblaient être devenus en vogue et trouvèrent un acquéreur. Nous arrivâmes à vendre facilement le four à bois à trois portes, que nous avions trouvé à la casse et le camion VW bâché, ayant le contrôle technique depuis peu, trouva un nouveau propriétaire. Martin avait préparé une surprise : Chez un ferrailleur il avait déniché une petite turbine, plus exactement une roue Pelton. C’était un caisson en tôle avec à l’intérieur une roue en fer, dont la circonférence était garnie de petites pelles en forme de double-cuillères. A travers un ou plusieurs gicleurs un jet d’eau sous haute pression était dirigé vers les pelles et faisait tourner la roue. Au moyen d’une courroie on pouvait faire tourner un générateur ou la dynamo d’une voiture. C’était exactement ce dont nous avions besoin !
Cela faisait un objet de plus à déménager. Nous rehaussâmes les ridelles de la remorque avec le cadre de notre lit et nous nous mîmes à charger. Tout ce qui ne rentrait plus dans la remorque, nous l’entreposions sur la galerie du toit, gardant l’intérieur du combi vide afin de dormir dedans, comptant trois jours pour le trajet. J’inspectai une dernière fois toutes les pièces de la maison pour être sûr que tout était vide. Cette fois-ci tout était vraiment vide, contrairement au moment où nous avions emménagé. Tout avait l’air triste. Je réalisais que chaque chambre sentait différemment et je voyais, comme des images extraites d’un film, des souvenirs du temps passé dans cette maison défiler devant mon œil interne. Quelques larmes me montèrent aux yeux… Je traversais une dernière fois l’étable. Ça sentait encore un peu nos chèvres. Est-ce qu’elles allaient être bien ? Un dernier tour autour de la maison. « Adieu ! Il faut partir ! Merci, mon lieu si familier de nous avoir hébergés pendant quelque temps ! Bénédiction à ceux qui vont vivre ici après nous ! ». Mon regard s’arrêta sur l’épigraphe que j’avais peinte au-dessus de la porte. Quand nous habitions encore dans la « maison des fleurs », les gens me demandaient parfois si je pourrais leur peindre quelque chose sur leur maison. Quelqu’un me donna un pochoir afin de lui faire une inscription. Je l’avais aussi utilisé pour nous :
Cette maison est la mienne, mais elle n’est pas à moi.
Elle n’appartiendra pas non plus à celui qui viendra après moi.
Celui qui y habitait avant est sorti les pieds devant -
Alors dis-moi, à qui appartient cette maison ?
Presque tous les voisins, avec lesquels il avait fallu beaucoup de temps pour tisser des liens, étaient au bord du chemin et nous faisaient signe. Pour la première fois je me sentais appartenir à cet endroit ! Mais tant pis ! Une page de notre livre de la vie était en train d’être tournée. Nous montâmes à bord, la première vitesse, et c’était parti ! Nous nous arrêtâmes brièvement chez Martin. Il prit une photo de notre « roulotte de gitans », comme il appelait note attelage.
D’abord nous avançâmes au pas, pris dans les éternels bouchons le long du Lac de Constance. Puis à travers la Forêt Noire avec ses virages, vers la frontière française. Là, on nous demanda de nous garer sur le côté. « Les papiers, s’il vous plaît ! » « Quels papiers ? Ce n’est que de la camelote ! Pourquoi devrions-nous encore avoir des documents ? » « Dans de cas il faudra les faire ! En tout cas les bureaux sont déjà fermés pour aujourd’hui. Demain à partir de 9 heures ils seront ouverts ! »
*
Nous passâmes la nuit sur un parking en chantier entre des poids lourds qui, comme nous, attendaient l’ouverture des bureaux de la douane. Pendant que Doris faisait manger les enfants, je rentrai dans un des bureaux. On me donna un imprimé. Je devais faire une liste de tous nos biens et leur valeur en trois exemplaires ! Et il se pouvait que nous devions encore payer des droits de douane ! J’étais content de ne pas devoir tout décharger. Je m’assis sur un banc et commençai à tout noter de mémoire. Quand la première liste fut pleine, j’en demandai une autre. Le fonctionnaire était horrifié de ma précision. Non, ce n’était pas ce qu’il avait voulu dire. Que dans les grandes lignes, que les objets les plus grands ! Ils nous établirent également une attestation d’entrée sur le territoire qui était nécessaire afin de demander une carte de séjour plus tard à la préfecture du futur domicile. A midi tout était enfin rempli et tamponné. Nous pûmes alors reprendre la route. L’autoroute était encore en construction. En dehors de celle allant de Paris à Marseille en passant par Lyon à travers la vallée du Rhône, il n’y en avait pas d’autre. Quand nous fîmes une pause, une voiture civile s’arrêta avec à son bord des non-civils, qui nous collèrent leur carte sous le nez. Bien sûr, un chargement pareil ne passait pas inaperçu ! Ils voulaient savoir ce que nous transportions. « Des biens de déménagement ! », répondis-je en leur présentant mes listes tamponnées par leurs collègues. Ils ne semblaient pas avoir compté avec ça. La liste dans la main ils firent le tour des véhicules et semblaient satisfaits. Et nous aussi, quand ils eurent enfin disparu !
Notre but était d’éviter les autoroutes, car lors du premier voyage nous avions constaté qu’aux péages il y avait un mécanisme qui comptait automatiquement les essieux. Avec trois essieux on rentrait dans la catégorie camion ou semi-remorque. A notre grand désarroi, avant Lyon tous les panneaux du trafic des grands axes nous ramenèrent sur l’autoroute. N’ayant pas d’autre choix nous la prîmes. Par chance, elle était gratuite, sans doute pour soulager la ville du trafic longue distance. Mais nous ne l’apprîmes que plus tard ! Nous étions soulagés quand la Méditerranée fut enfin en vue. Après avoir trouvé un endroit pour garer les véhicules, nous retroussâmes les pantalons et courûmes dans l’eau. Les amandiers ornés de leurs fleurs rosées et les genêts jaunes nous indiquaient que nous étions enfin dans le Midi !
*
Une fois arrivés sur place, nous montâmes à la maison. Tout se trouvait dans le même état où je l’avais laissé dix jours plus tôt. Les crottes de mouton devant la maison nous prouvaient que quelqu’un avait été là-haut. Le petit champ aussi était labouré. Nous constatâmes que la couche de terre était peu profonde. Elie n’avait quasiment retourné que la couche d’herbe. En dessous on voyait le schiste gris-noir. Les enfants couraient dans tous les sens et découvrirent bientôt le tas de sable. La mère de Martin leur avait fait cadeau d’un set d’ustensiles de bac à sable à notre départ. Ainsi ils attaquèrent le tas. Je leur demandai de ne pas trop éparpiller le sable, car avant d’arriver ici nous l’avions déjà manipulé trois fois ! Mais comme ça on pouvait garder les enfants à l’œil. Nous nous assîmes devant le mur au soleil printanier. Nous repoussâmes le déchargement au lendemain. Les 1300 kilomètres nous avaient bien épuisés. Seuls les enfants débordaient d’énergie après leur longue captivité dans le combi ! Nous étions le 16 avril 1980.
La première nuit nous dormîmes tous dans la caravane. Puis j’expliquai à Doris comment allumer la motofaucheuse et actionner le treuil. Nous montâmes nos dernières affaires. Lentement tout prenait forme et les pièces devenaient chaleureuses. Surtout, quand la cuisinière fut branchée. Au tout début le tuyau du chauffe-eau qui se trouvait dans la cave traversait le plancher de la cuisine et puis traversait, avec le tuyau de la cuisinière, le mur vers l’extérieur. Mais bientôt je montai une cheminée à l’extérieur de la maison. Ceci était plus sûr et permettait un meilleur tirage. A l’endroit où le tuyau avait traversé le mur, j’enlevais d’autres pierres et créais une autre ouverture.
Le grenier fut habillé avec du lambris, afin de le rendre plus confortable. Ici les fenêtres étaient utilisables. Mais il manquait les carreaux. J’enlevai la croix et posai une grande vitre à la place des quatre petites. Afin de fermer les fenêtres de l’étage en dessous, nous assemblâmes des cadres au moyen de liteaux et de clous et les habillâmes avec des bâches en plastique. Malgré la latitude méridionale, les nuits pouvaient être très fraîches, et surtout les jours de pluie et de vent !
*
La maison était enfin agréable à habiter. Puis nous nous mîmes à sortir le fumier de l’étable pour faire place aux premiers animaux. A la pioche et au crochet fourchu, nous attaquâmes la couche de fumier qui se trouvait à hauteur de genou. Nous le jetâmes en bas du talus, où Doris le reprit afin de l’éparpiller sur le futur jardin. En dessous nous mîmes à nu une surface presque plane taillée dans la roche, avec des rigoles et une évacuation en-dessous du mur. Bien sûr que tout avait souffert du temps passé et du purin ! Avec quelques bétonnières d’un bon mélange, nous remîmes tout à neuf. Nous trouvâmes même quelques colliers de vaches en bois dans le fumier. D’abord nous ne savions pas ce que c’était. Jean-Paul nous expliqua le système, car il avait le même dans son étable en bas. Les ancêtres avaient tressé, avec des lianes de chèvrefeuille – cette plante qui grimpe aux arbres et dont les fleurs blanches le printemps venu diffusent un parfum envoûtant (nous, nous les avions fumées lorsque nous étions enfants) – des maillons et les avaient unis en une chaîne. Le dernier maillon était fixé de sorte à pouvoir coulisser sur un piquet devant le râtelier, le premier passait autour d’une pièce étroite en bois de frêne formée en U, qui était attachée autour du cou de l’animal. Ceci permettait à l’animal de se coucher ou de se lever tout en l’empêchant d’embêter les voisins. Afin de détacher la bête il fallait serrer les bas de l’attache, ce qui permettait de débloquer la « clef » en bois par un quart de tour et de l’enlever. Ainsi on enlevait l’attache par-dessus la nuque et l’animal était libre. Génial ! Les anciens l’appelaient « estacadetch ». Rares étaient ceux qui savaient encore les fabriquer. La partie en forme U était découpée dans du bois de frêne vert. Ils leur donnaient leur forme au-dessus de la vapeur. Pour la « clef », la partie transversale, ils employaient du frêne sec. Les finitions de toutes les parties étaient faites à l’Opinel, le couteau de berger. Les deux extrémités de la clef étaient exactement ajustées aux ouvertures de la pièce en U. Une fois le bois du collier séché, la clef restait liée au collier et ne pouvait pas se perdre.
Avant de retourner le jardin nous voulions planter les pommes de terre au champ. Pendant un moment, nous essayâmes en vain d’émietter la couche de racines sur le champ labouré à l’aide des bêches. Bientôt nous abandonnâmes. Chaque sillon ressemblait à une bande de feutre épaisse, tellement solide à cause des racines ! Mais les patates devaient être plantées, l’hiver allait être long ! Alors l’un de nous souleva le tapis en feutre pendant que l’autre y glissait la patate en-dessous. Nous n’attendions pas grand-chose. Nous fûmes d’autant plus surpris lorsque, peu de temps après, les premiers germes sortirent du sol ! Nous suivîmes leurs rangs afin d’enlever l’herbe qui repoussait à la bêche, ou la recouvrîmes simplement avec du fumier. Les pommes de terre aiment l’engrais ! Peu importe qu’il vienne du bas ou du haut !
*
Maintenant nous pouvions enfin nous occuper de l’achat des animaux. Nous avions décidé d’acheter des vaches et des chèvres, des espèces que nous pensions connaître suffisamment. Bien sûr aussi de la volaille, pour nous et plus tard pour vendre. Nous parlâmes de nos projets à Jean-Paul, entre autres pour lui faire comprendre qu’ils devaient enlever leurs bêtes afin que l’herbe puisse repousser. Il nous raconta qu'il avait eu un troupeau de chèvres, mais il les avait vendues récemment. Des bonnes et belles bêtes de race Pyrénéenne. Peut-être le marchand les avait encore et nous les vendrait ? « N’aie pas peur, quand tu le verras. Il est énorme, il pèse dans les 200 kilos. A cause de son poids on l’appelle Bourguiba, comme le président tunisien. » Le soir nous nous rendîmes chez lui. Il était assis avec d’autres gens dans son salon, autour d’une grande table, qui prenait presque toute la pièce. Le tableau était scié dans un seul tronc d’arbre de bois exotique et faisait bien 12 cm d’épaisseur. Comment avait-on transporté une telle pièce de l’Afrique jusqu’ici ? Ils étaient tous en train de prendre l’apéritif, et à peine entrés, on nous donna un verre.
D’après le signalement de Jean-Paul, je reconnus tout de suite le patron de la maison. Il régnait une ambiance de fête. Apparemment ils n’en étaient pas à leur premier verre ni même à la première bouteille. J’admirais la table. « Je parie que tu n’arriveras pas à la soulever ! », cria Bourguiba. « Je parie que si ! », répondis-je en me positionnant le dos contre l’avant de la table. Je pliai un peu les genoux, pris le plateau dans les mains et le soulevai avec de grands efforts. Les verres se mirent à danser. Bourguiba sembla impressionné et me remplit de nouveau le verre. Puis il demanda à sa copine de me montrer les animaux. Nous les regardâmes. Une longue robe noire, plutôt claire au niveau du thorax et des jambes, parait les animaux. De longues cornes courbées ornaient les têtes. De toute façon, qu’est-ce qu’on y connaissait en chèvres et leurs races ? Jean-Paul affirmait qu’elles étaient pleines. Il ne les avait jamais traites, mais leur avait laissé les petits. De retour dans la maison une vague d’hilarité nous emporta. Bourguiba était en train d’expliquer comment ils faisaient au lit. Plus exactement par terre, car aucun lit ne supporterait ça ! Etant trop lourd, sa copine devait lui monter dessus. C’était la raison pour laquelle il s’était séparé de sa femme, parce qu’elle ne réussissait plus à le monter ! Tous éclatèrent de rire. Chacun essayait sans doute de s’imaginer la scène. Pour s’habiller c’était pareil. En tout cas il n’arrivait plus à se baisser suffisamment pour rentrer le bas de son pantalon dans ses bottes. Il se leva, saisit un balai et avec le manche il inséra son pantalon dans sa botte. Leur rire s’étendit à travers le petit village. Ces descriptions détaillées semblaient plaire à sa copine.
Il m’assura que c’étaient les meilleures bêtes du monde. Il ne vendait que les meilleurs animaux. Sinon il était prêt à les reprendre ! Mais nous connaissions l’espèce des marchands de bétail encore moins que les chèvres. En Allemagne, pendant une tempête de neige, l’un d’entre eux m’était rentré dedans avec sa Mercedes et son van. Nous étions d’accord de ne pas faire marcher l’assurance pour une pareille bagatelle ! « On va régler ça entre nous ! » J’étais d’accord avec lui. N’ayant pas d’argent sur lui il me donna sa carte et me demanda de passer lundi chez lui. Bien sûr, il resta injoignable et ses sous aussi !
En tout cas ici les marchands d’animaux semblaient préférer une vie insouciante aux affaires. Avant d’arriver, Jean-Paul m’avait soufflé quel prix maximal payer. Et après une brève discussion nous nous mîmes d’accord. Entre-temps, Yvonne, la compagne du « maquignon », comme on appelle ici ces marchands, avait commencé à poser les assiettes sur la table. Et elle obligea tous ceux qui voulaient s’en aller à rester. Et nous aussi. Tard dans la nuit, je rentrai à la maison où tout le monde dormait déjà. Nous allâmes chercher les chèvres le lendemain.
*
Nous avions donc les chèvres. Nous les attachâmes avec de longues chaînes à des piquets dans les prés. Ainsi au moins elles ne pouvaient pas faire de bêtises et étaient obligées de bien nettoyer le terrain ! Parfois en les récupérant le soir pour les enfermer, elles avaient tellement enroulé leurs chaînes autour des arbres ou des ronciers, qu’elles étaient à court de souffle ! Est-ce qu’elles tournaient toujours dans le même sens, comme l’eau, quand on tire la bonde de la baignoire ? Ce serait un bon sujet de doctorat ! A la foire de Saint Girons, qui avait lieu chaque deuxième et quatrième lundi du mois, nous achetâmes quelques poules pondeuses pour nos futurs œufs, des pintades, parce qu’elles étaient si belles, et deux jeunes oies comme gardiennes. Car celles-ci avaient sauvé Rome à l’époque et allaient nous avertir des visites de Jean-Paul à l’avenir ! Il nous manquait encore une vache.
Une fois de plus, ce fut notre pot-de-colle de livreur de lait qui nous conseilla. Deux villages plus bas que Bourguiba, un autre paysan exerçait le même commerce. Les marchands d’animaux semblaient ne pas manquer dans la région, comme l’attestaient les costumes et manteaux noirs à la foire ! On se sentait presque comme à Rome sur la place St. Pierre ! Jean-Paul nous avait expliqué que ce maquignon avait une jambe en bois. Cela l’empêchait de marcher, mais nullement de conduire une voiture ! Comme il nous l’avait dit, il avait la vache qu’il nous fallait. Petite, jeune et habituée à être menée à la corde comme un chien, ou à brouter en étant attachée à un piquet. Ça sonnait plutôt bien ! En plus elle venait de mettre au monde une petite vêle. Quand nous la regardâmes et qu’elle nous observa avec ses yeux entourés de longs cils, nous donnâmes raison au marchand. C’était notre vache ! Il ne restait qu’à se mettre d’accord sur le prix. Jean-Paul m’avait soufflé un nombre dans le dos du maquignon. Est-ce qu’il s’y connaissait vraiment aussi bien en vaches ou avait-il auparavant fixé un prix avec le marchand incluant un pourboire pour lui ? J’étais convaincu qu’il allait avoir sa part ! Après une demi-heure de marchandage au cours de laquelle le maquignon trouvait de plus en plus de qualités à la bête, qui auraient justifié un prix beaucoup plus élevé, nous nous mîmes d’accord. Nous fîmes d’abord monter la petite, puis la mère dans le fourgon du marchand, qui nous suivit jusqu’à la côte en bas de chez nous. Nous payâmes les animaux, on nous donna les papiers de la vache, puis nous les montâmes chez nous. Il fallut du temps, car la vache trouvait de l’herbe appétissante en bordure du chemin, ou alors elle attendait sa vêle qui contemplait des fleurs ou un premier papillon.
*
Au-dessus de la maison au milieu d’un pré se trouvait un grand parc clôturé avec du grillage qui avait sans doute servi à l’ancien propriétaire pour y enfermer ses brebis la nuit. A l’intérieur l’herbe était plus haute que dehors, sans doute à cause du bon engrais. Nous y enfermâmes la vache, gardant la petite dans l’étable afin qu’elle ne puisse pas téter. Nous la trayions deux fois par jour en gardant un peu de lait pour nous. Avec le reste nous faisions téter le veau dans une bouteille, afin que plus tard, quand il sortirait, il ne tête plus au pis de sa mère. Au début nous enfermions la vache la nuit. Les nuits étaient encore froides et le temps assez souvent maussade. Sur un côté de l’étable il y avait encore un râtelier. Il manquait quelques barreaux que nous remplaçâmes par des tiges de noisetiers. Le vieux foin du fenil était apprécié par notre « Marie » - comme nous l’avions baptisée - les jours où elle ne pouvait pas sortir.
Entre-temps le travail à la maison continuait. Heureusement, les travaux que nous avions au départ considérés comme urgents ne l’étaient pas tous. Car la bâtisse avait déjà tenu des siècles et ne s’écroulerait pas dans les quinze jours à venir. Elle avait même survécu à un autre tremblement de terre ! Nous étions tous en train de dormir quand un gémissement venant des profondeurs de la terre m’arracha du sommeil. Je réveillai tout le monde et les poussai à descendre dans la cour rapidement. Doris était tellement fatiguée qu’elle dit « Tiens-moi au courant quand tout sera fini ! » Mais face à notre insistance elle finit par descendre.
Ce qui s’avérait être très urgent, c’était de clôturer les terres. Car après deux jours notre Marie avait mangé toute l’herbe du parc. Ne trouvant plus rien à l’intérieur elle avait passé sa tête par-dessus le grillage et continué de brouter. Sans vraiment s’en rendre compte, en avançant elle avait plié la clôture vermoulue et était sortie. Maintenant elle allait là où l’herbe était la plus verte. Mais il s’agissait des prés où nous avions prévu de faire du foin plus tard ! Nous l’attachâmes quelques jours à un piquet. Seulement voilà, une vache mange beaucoup plus qu’une chèvre ! Elle a aussi besoin d’eau pour boire. Il nous fallait une clôture électrique ! Alors nous descendîmes en ville, à la coopérative, pour voir ce qu’ils avaient. Ils en avaient qui fonctionnaient sur batterie non rechargeable. Une fois vide, celle-ci devait être jetée. Ce n’était pas pour nous ! Il y avait encore les vieux modèles qui fonctionnaient avec une batterie de voiture, avec un condensateur à l’intérieur et un disque en métal oscillant qui rythmait l’impulsion des décharges. Ça existait déjà quand j’étais enfant. Cet appareil avait donc fait ses preuves ! Ceci nous permettrait de charger la batterie dans la voiture, n’ayant pas de courant à la maison. Nous achetâmes également quelques rouleaux de fil de fer galvanisé afin de clôturer un grand morceau de pré. Au début la vache semblait être contente.
*
Mais il ne poussait pas que de l’herbe chez nous. Et en plus, c’était une espèce d’herbe sauvage, très fine avec peu de feuilles, qui avait prospéré ici par manque de fertilisation. Laisser la terre pendant une période en jachère, afin qu’elle puisse se régénérer ? Penses-tu ! Ici en tout cas c’était le contraire qui s’était produit et les prés avaient dégénéré ! Et partout des pousses semblables à des pieds de lièvres sortaient de la terre, beaucoup plus vite que l’herbe. Une fois sorties du sol elles se déroulaient, se transformant en feuilles d’un vert tendre, puis sur une tige de l’épaisseur d’un doigt, tentaient de toucher le ciel. Des fougères ! Quand je les trouvais sur mon chemin je les écrasais avec les pieds ou je les décapitais avec un bâton. Au début c’était facile, elles n’étaient que des masses vertes contenant beaucoup d’eau. Plus tard les plantes devenaient plus fibreuses et il fallait une faux ou la motofaucheuse pour les éliminer. Et il nous fallait les éliminer, car bientôt elles étoufferaient toute herbe sous leurs frondes et obstrueraient toute lumière ! Voyant les fougères prendre possession de nos terres, nous réalisâmes qu’une bataille à long terme venait de commencer. C’était elles ou nous ! Et j’étais sûr que nous allions rester ici. C’était donc à elles de partir ! Dans trois ans des prairies grasses pousseraient de nouveau ici ! « L’hiver, quand elle est sèche, il faut y mettre le feu. C’est comme ça que tu t’en débarrasseras ! », disait Jean-Paul. « Et pour combien de temps ? », voulus-je savoir. « Eh bé, jusqu’au printemps prochain ! », répondit-il. « Alors ce n’est pas la peine de les brûler. Je dois m’en débarrasser l’été ! » Un voile vert-clair recouvrait nos collines. Vu de loin c’était même beau. C’était seulement quand ça nous arrivait jusqu’aux genoux qu’on sentait qu’il fallait agir de suite et je montai la barre de coupe sur la faucheuse. Les faucher au moins deux fois pendant la période de croissance, cela leur fera du ‘bien’ !
*
Nos terres se trouvaient sur deux plans de cadastre distincts. Avec les ciseaux je les avais coupés de manière à ce que les parcelles de notre propriété se joignent et les avais collés de sorte à ce qu’ils ne forment qu’un seul plan. Tout ce qui se trouvait en dehors de nos terres, je le découpais. Muni de ce plan et un pot de peinture à la main, un beau matin je partis à la recherche des limites. Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne un parcours d’escalade avec des obstacles à franchir ! Il y avait non seulement des montées et des descentes raides, mais une multitude d’arbres et broussailles se mettaient en travers mon chemin. Je me rendis compte que les terres étaient reprises par la végétation sauvage en premier par l’extérieur, et en particulier les parcelles les plus pentues ! Il semblait que celles-ci avaient été abandonnées en premier. Très souvent les limites étaient matérialisées par des haies ou des arbres taillés à hauteur de haies. Celles-ci, en raison d’un manque de bras, avaient pris de la hauteur et de la largeur. Puis elles s’étaient ressemées et avaient petit à petit reconquis toute la parcelle. En même temps, sans doute propagées par les oiseaux, les ronces s’étaient installées au milieu des prés formant d’énormes buissons. Les fougères s’étaient sûrement propagées de la même façon, de l’extérieur vers l’intérieur des terres. En tout cas, au milieu des parcelles, elles étaient de taille plus petite. Les talus étaient presque tous couverts de ronciers. Avec la peinture je fis des marques sur les gros troncs, sur des pierres, qui apparemment, avaient été enterrées aux croisements des limites des parcelles. Parfois la végétation était si dense ou les parcelles si petites que je n’arrivais pas à trouver les nôtres avec certitude. Il fallait alors d’abord débroussailler et ensuite, éventuellement réessayer de trouver les limites avec un décamètre.
Pendant cette expédition, je trouvai un fil électrique, souvent pris dans la végétation ou par terre ou accroché à des arbres qui, en poussant, avaient fait éclater la fixation des isolateurs. Il semblait que quelqu’un d’autre avait exploité nos terres ! Jean-Paul savait qui c’était. C’était quelqu’un du village qui travaillait à la papeterie, et ayant peu de terres lui-même, il avait lâché ses vaches ici, car notre propriétaire, approchant la retraite, y montait peu. Alors nous lui avions en quelque sorte « volé » « ses terres » en les achetant ! Ça ne lui avait pas plu. Il me le faisait savoir quand je lui parlai. Le fil électrique ? Il en avait encore besoin ! Il voulait le récupérer. Ou encore, je pouvais le lui acheter ! Il m’annonça une somme astronomique. Je crus d’abord qu’il parlait en ancien francs, comme c’était la coutume ici. « Mais il est fou ! », me dis-je, « encore quelqu’un qui veut profiter du Deutsche Mark ! Qu’il l’enlève son fil ! » Au fur et à mesure que nos bêtes en avaient besoin, je me mis à clôturer les prés.
*
Car entre-temps nous avions acquis une vache de plus avec sa vêle. Grand-mère avait envoyé un peu d’argent et « parrainé » la vache. Doris et moi les trayions deux fois par jour. Le plus souvent les enfants étaient avec nous et se réjouissaient quand ils pouvaient « jouer aux veaux » et nous leur envoyions quelques jets de lait dans la bouche. Nous prenions une partie du lait pour en faire du fromage blanc ou préparer nos mueslis. Le reste était pour les veaux. Les petits des chèvres tétaient directement leur mère. Au début de l’été quelqu’un du village voisin vint nous voir pour nous les acheter. Il avait des chèvres et vendait leurs petits à des citadins ayant une maison secondaire au village, une fois tués et dépecés. Lui-même n’avait pas suffisamment de chevreaux. Son prix étant correct, nous lui cédâmes les mâles. Nous gardâmes les femelles afin d’augmenter le troupeau.
Un beau matin je trouvai des plumes de nos pintades derrière la maison. Les poules rentraient régulièrement au poulailler pour pondre ou passer la nuit. Par contre nos pintades avaient pris la fâcheuse habitude de dormir à la belle étoile. Plus précisément dans les épines noires au-dessus de la maison, comme je pus le constater plus tard en trouvant leurs nids. Le renard en avait profité. Plus bas dans la vallée, à mi-chemin en allant vers le village, à côté du ruisseau, un Toulousain avait construit une cabane pour y passer les vacances. Il était chasseur et pêcheur et vendait des fusils et des vélos. Ayant entendu les mésaventures de nos pintades, il me proposa un fusil avec double canon et diverses cartouches, de la grenaille pour le renard, du gros calibre pour les sangliers. Mais d’abord il fallait créer un champ de tir dégagé. Avec une hache et la tronçonneuse je m’attaquais aux broussailles. Avec peu de succès, car je ne pouvais pas approcher suffisamment des petits troncs et bientôt j’avais des épines partout dans la peau. Quand je voulus les enlever, elles cassèrent. J’essayais alors de les sortir avec une aiguille. En vain. Il y en avait qui étaient rentrées si profondément, qu’il fallut des semaines pour qu’elles finissent par sortir avec plein de pus. Je devais changer de méthode ! A la foire j’avais vu des « débroussailleuses » à moteur proposées par des vendeurs de machines agricoles. J’avais déjà vu un tel engin au travail et j’étais convaincu que c’était la machine idéale pour notre ferme ! Je choisis un modèle qui était aussi transformable en tronçonneuse. Comme couteau je choisis une lame triangulaire pour les ronces, et une lame de scie circulaire pour couper les troncs des épines noires sans difficulté à hauteur du sol. Sous le chant de la machine, les buissons se réduisaient petit à petit et je trouvai même les nids des pintades ! Afin de ne plus attraper d’épines j’entassai les petits troncs à l’aide d’une fourche à fumier. Mais le tas ne voulait pas prendre feu. Alors on décida de tout laisser sécher et de repousser l’incinération à la Saint Jean. Deux des pintades disparues firent leur réapparition. Avaient-elles appris à passer la nuit dans les arbres ? Apparemment le renard n’avait pris que celles qui couvaient ! Je réussis plusieurs fois à les attraper la nuit et à les enfermer au poulailler. Mais elles préféraient dormir à la belle étoile. Comme moi, d’ailleurs, quand j’en avais l’occasion. Rien de plus émouvant que de se réveiller la nuit sous le scintillement de l’infini !
*
Il nous fallait d’urgence un chien ! Comme chien de garde pour la maison, surtout pour nous avertir de l’arrivée de Jean-Paul, contre le renard et comme chien de troupeau. Quand je voyais un bon chien travailler avec un troupeau j’étais envieux. Parfois le père ou la mère de Jean-Paul montait chez nous. Il y avait toujours quelqu'un du clan dans le coin. Bien sûr, ils avaient parfois des bêtes dans les environs. Mais il me semblait que celles-ci leur servaient d’alibi. Nous étions la vraie raison de leur présence ! Ils étaient assis quelque part et nous regardaient, nous scrutaient même avec les jumelles. Souvent c’étaient leurs chiens qui les trahissaient quand ils tournaient autour de leur observatoire. Les parents de Jean-Paul nous apprenaient par bribes plus de détails sur la vie de leur fils. Ça ne tournait pas rond dans sa tête. On l’avait enlevé très tôt à ses parents et mis sous la tutelle d’une tante. Il n’avait jamais fréquenté l’école et avait passé plusieurs années dans une institution psychiatrique. Ils avaient réussi à le faire déclarer irresponsable pour qu’il reçoive une pension. « Quand nous ne serons plus, il n’aura pas besoin de travailler… » Il ne devait pas boire d’alcool, car il prenait des médicaments. Cela expliquait pourquoi on ne le voyait pas souvent au café. Sans doute que l’hôtelier avait reçu des consignes ! Avant de connaître tous ces détails, il ne nous était pas apparu comme l’idiot du village. Bien sûr, on voyait qu’il n’était pas le plus brillant, mais concernant ses connaissances des animaux il était imbattable ! Bientôt nous nous rendîmes compte qu’il possédait assez de ruse paysanne, qu’il était assez malin pour exploiter à son avantage sa réputation d’être le fou du village !
C’était encore lui qui avait entendu dire que dans une vallée en direction de l’Espagne, quelqu’un avait un jeune chien de troupeau à donner. Voulait-il simplement aller se promener ? Car il me dit qu’il avait le temps et m’accompagnerait. Alors nous nous mîmes en route. D’abord par-dessus le Col de Portet d’Aspet, puis, une fois en bas, nous nous dirigeâmes vers le sud et plus tard nous remontâmes une vallée par une route en lacets. En hauteur, une station de ski était en construction. Les panneaux indiquaient « Le Mourtis ». Peu avant, nous bifurquâmes dans une petite vallée, et la route se transforma en un chemin délavé et traversa une forêt de grands hêtres. Au seul endroit un peu large étaient garées quelques voitures et épaves. « Ça devrait être par-là, j’ai déjà été ici ! », dit-il et nous garâmes le combi. Nous montâmes un sentier en zigzag en suivant un câble en acier qui servait comme monte-charge. Au terminus du câble se trouvait une vieille maison. Là vivaient des jeunes gens en communauté. Ils avaient une petite douzaine de vaches suisses et fabriquaient du fromage. Ils possédaient aussi quelques brebis, pour mieux utiliser les terres, comme ils l’expliquèrent. Ils étaient en train de fumer un joint et nous l’offrirent. Nous refusâmes. On commença à parler chiens. Ils nous avaient salués en arrivant, des petites bêtes maladroites et mignonnes, qui essayaient de grignoter nos chaussures.
Nous regardâmes leur téléférique et leur expliquâmes notre système. Derrière la maison le terrain était plus plat. Leur problème majeur était de ne pas avoir accès à la route. Et de ne pas être branchés au réseau d’eau publique. C’était la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas vendre leurs fromages officiellement. « Quelque réglementation européenne, mise en avant par les grandes entreprises ! De mémoire d’homme les gens ont toujours bu aux fontaines. Et tout à coup c’est interdit ! Probablement parce qu’entre-temps ailleurs tout est devenu tellement pollué qu’on ne peut plus boire l’eau de source ! Le grand business de l’avenir ! », expliquèrent-ils. Mais jamais quelqu’un ne viendrait contrôler ça. Les chiots nous avaient suivis pendant notre visite de la ferme. « Choisis-en un ! Cela en fera déjà un de moins ! » Je choisis un mâle, bien que Jean-Paul affirmât qu’une chienne serait mieux. Je leur donnai 50 francs même s’ils ne demandaient rien. Le chiot dans mes bras nous entamâmes la descente.
Dans la voiture je demandai à Jean-Paul ce qu’il pensait du chien. « Tu as vu ses pattes ? Il deviendra bien grand ! En tout cas, les parents sont de bons chiens ! Tu as vu comment ils ont fait avec les vaches ? C’est bien, quand un petit chien n’a pas peur. Je ne sais pas si tu l’as entendu, mais quelqu’un a dit que la mère du petit avait déjà tué des moutons. Ça peut être dans le sang, mais pas obligatoirement. Surveille le bien, afin qu’il n’y aille pas trop fort, surtout qu’il ne goûte jamais de sang ! » « Qu’est-ce que ça veut dire ? » voulus-je savoir. « Eh bé, qu’il ne blesse jamais un animal pendant son travail, de telle sorte qu’il saigne ! Et ne lui donne jamais de la viande crue à manger, surtout pas des animaux qu’il doit garder ! Quand tu tues une brebis ne lui donne jamais les intestins à manger, ni d’autres déchets. Enterre-les toujours assez profond que le chien ne puisse pas les sentir. S’il les déterre une fois pourris, c’est pas grave ! » Certes, pour l’instant il n’était encore qu’une boule de poil innocente avec laquelle les enfants aimaient beaucoup jouer.
*
Tant que les vaches étaient encore dans l’étable pendant la nuit, nous les trayions à l’intérieur. Bien sûr, les enfants étaient toujours avec nous ou quelque part en vue. Ils s’exercèrent aussi aux pis. Heureusement les vaches se laissaient faire ! Notre fils réussit le premier à faire sortir une goutte de lait, bientôt même un petit jet du pis. D’abord il dirigea le jet dans sa bouche, plus exactement en plein dans la figure. Il s’essuya en riant. Ça lui donna l’idée d’asperger sa petite sœur qui décampa vite en pleurant.
Un jour nous avions dû traiter les chèvres contre la gale avec la sulfateuse. Elles perdaient leur poil et nous avions demandé ce qu’il fallait faire au vétérinaire. Il nous avait donné un produit à base de thym. En tout cas il ne sentait pas mauvais. Néanmoins nous ne voulions pas avoir les enfants à proximité et nous les envoyâmes jouer devant la maison. Doris tenait les animaux pendant que je leur passais le produit. Quand, après une demi-heure, ayant fini avec les bêtes, nous passâmes devant la maison, il n’y avait plus qu’Emanuel qui jouait dans le sable. Il ne savait pas où était passée sa petite sœur. Nous eûmes très peur ! Par où pouvions-nous commencer à la chercher ? À ce moment-là Jean-Paul, tout essoufflé, monta la côte en courant. « Votre petite est en bas à côté du pont du ruisseau ! J’ai voulu la monter avec ma mobylette, mais elle n’a pas voulu ! » Nous lui demandâmes de rester avec le gamin, descendîmes la colline en courant et puis nous nous précipitâmes vers la vallée avec le combi. Nous la trouvâmes pas loin du ruisseau, ne sachant plus où elle se trouvait. Voyant le fourgon, elle fit demi-tour et courut vers nous. Nous sautâmes dehors et elle courut droit dans nos bras !
*
A quelques mètres devant l’étable, j’enlevai une partie du talus à la pioche, coulai une dalle armée de 2,5 X 3,5 mètres. J’y construisis un grand bac avec des parpaings, environ 1,50 mètres de haut, que, une fois crépi et sec, j’enduisis avec du goudron pour fondations. Celui-ci allait servir en alternance comme fosse à purin pour les vaches ou comme réserve pour la future turbine. Nous couvrîmes le haut avec une couche d’arbres et entassâmes le fumier des vaches au-dessus. Le purin traversait la cour dans une rigole et se déversait dans le bac. Immédiatement les poules se mirent à tout éparpiller. Devions-nous les enfermer ? Nous préférâmes clôturer le tas de fumier, laissant les poules courir partout pour les serpents. Quand elles en voyaient un, un tressaillement rapide du cou et le serpent se trouvait dans le bec. Puis deux moitiés du serpent tombaient par terre, tout de suite attrapées par les autres poules qui accouraient de partout, et encore coupé en deux… La poule qui avait trouvé le serpent avait du mal à avoir sa part du butin ! Même si la tête du serpent essayait de mordre la poule, cet effort désespéré échouait systématiquement à cause du plumage des poules qui faisait office d’armure. Malheureusement la plupart des reptiles transformés en œufs étaient des orvets de couleur cuivre en non pas des vipères. Parfois nous surprenions au jardin ou sur le terrain des serpents vert clair d’une longueur de 1,50 mètres ou plus. D’après Jean-Paul ceux-ci n’étaient pas dangereux.
Afin de garder les poules un peu éloignées de la maison et de ne pas toujours avoir leur fiente sous les semelles, notre nouveau chien, baptisé Frodo, s’avéra très utile. Il nous démontra qu’il avait hérité de l’instinct du chien de troupeau en poussant les poules devant lui. Mais quand nous le surprîmes en train de mâcher une poule morte avec ses dents de lait, il nous fallut intervenir d’un point de vue éducatif. Jean-Paul qui venait juste de se pointer nous conseilla d’enfermer tout de suite chien et poule dans un sac à patates et de bien taper le sac un bon moment avec un bâton en criant « non ! » Ça corrigera le chien une fois pour toutes ! C’est ce que nous fîmes, en l’absence des enfants bien sûr ! Le chien nous faisait pitié. Mais nous dûmes le faire, tout de suite, sinon il serait trop tard ! Quand enfin nous libérâmes le chien et la poule et posâmes la poule à côté de lui, il détourna la tête. Nous laissâmes la poule un moment dans la cour et observâmes le chien en cachette. Il ignorait la poule et faisait un détour autour d’elle, quand il traversait la cour. Le soir venu nous enterrâmes la poule. Notre méthode « orthodoxe » avait-elle donc fonctionné ?
*
Pour les marchands de bestiaux du coin, il semblait que nous étions une aubaine. Il y en avait un dans chaque village. Souvent il était aussi paysan. Pour les marchés et leurs transactions ils se mettaient une blouse noire et ressemblaient plutôt aux pompes funèbres. Ils étaient joviaux, invitaient à boire un verre et ne parlaient de leurs bêtes qu’en passant. Ne connaissant pas le prix et étant incapables de déterminer l’âge d’une bête, ils croyaient qu’ils auraient la vie facile avec nous. Peut-être était-ce notre méfiance subconsciente qui leur faisait croire que nous nous y connaissions en animaux ! Les chèvres et les brebis n’avaient pas de papiers ou de médailles dans les oreilles. Par contre, les vaches avaient un papier d’accompagnement, le « carton », et une boucle avec un numéro dans une oreille qui fit place, plus tard, à un tatouage d’abord dans une, puis dans les deux oreilles, et qui devait correspondre avec le numéro se trouvant sur le carton. Là, au moins, on pouvait trouver l’âge de la bête. Mais il était possible de tricher, car on pouvait faire faire des papiers pour une vache qui n’en avait pas. Là on pouvait donner n’importe quelle date de naissance. Avec les chevaux c’était pareil. Heureusement, Jean-Paul ou son père Elie étaient souvent avec nous quand nous cherchions des animaux. Ils nous soufflaient à l’oreille quel prix était correct ou quel défaut un animal portait. Car nous en étions conscients : une bonne bête, on ne la vend pas, on la garde !
Maurice, qui habitait le village plus bas, était un de ces maquignons. Il avait dans les 60 ans. Avec des aides européennes accordées à des éleveurs de montagne, il avait fait construire deux grands hangars pouvant contenir facilement 400 brebis. Pour gérer un tel nombre de bêtes, il avait besoin d’un domestique, Claude, qui faisait tout sauf conduire le tracteur. Dans la vallée, on racontait que Claude avait rejoint la police quand il était jeune, afin de sortir de la misère paysanne. Il avait même été muté dans la capitale où il avait été affecté à la circulation. Depuis toujours il aimait la boisson et la convivialité. Un jour, il avait été convoqué chez son supérieur, qui lui reprocha de ne pas rédiger de PV. La police devait vivre de quelque chose, tout de même ! Il fallait que ça change ! Il devait intervenir plus énergiquement et ne plus céder aux discussions ! C’était assez clair et il le prit à cœur.
Le lendemain, alors qu’il réglait la circulation, une limousine noire traversa le carrefour à toute allure sans se soucier de ses instructions et ne s’arrêta même pas quand il siffla. Il nota le numéro et déposa une plainte. Quelques jours plus tard, il fut de nouveau convoqué au bureau du chef. Se réjouissant, il entra dans l’attente de félicitations. Mais son chef était furieux ! Il avait déposé une plainte contre l’ambassadeur d’Allemagne. On lui demanda de retirer immédiatement la plainte ! Il refusa d’après le principe : « Devant la loi, tout le monde est égal ! » Pourquoi accorder des droits spéciaux à l’ambassadeur allemand ? Ce fut la fin de sa carrière dans la police. Bientôt il fut de retour dans son village natal et donnait des coups de main aux voisins. « Paris ? Laisse tomber ! On n’est mieux nulle part ailleurs qu’ici, dans la Belleverte ! »
*
Le maquignon qui nous avait vendu la première vache nous fit savoir par Jean-Paul qu’il avait le cheval idéal pour nous. Jeune, dressé et en plus prêt à faire son petit ! « Calina » était son nom. Nous nous y rendîmes le soir même pour la voir car nous avions besoin d’un animal de trait et de somme afin de ne pas toujours devoir transformer la motofaucheuse en treuil. Elle était de robe baie, de taille moyenne, pas très large. Mais assez forte et surtout calme, ce qui était important à cause des enfants. Dressée était exagéré, mais elle compensait ce manque par son caractère doux et son intelligence. Jamais elle ne s’effarouchait et elle faisait des efforts pour nous satisfaire. Elie nous donna un collier et une barre de trait. J’achetai des chaînes à la foire et nous fîmes les premiers essais de transport. Tout allait à merveille ! Peut-être que mes expériences étant enfant y étaient pour beaucoup, car chez les voisins tous les gros travaux étaient faits avec un cheval. Bientôt elle mit au monde un poulain que nous baptisâmes Claudius.
Mes préoccupations principales étaient les terres et les animaux. Doris, quant elle, s’occupait des enfants, de la maison, du jardin. Ici il y avait un peu plus de terre qu’au champ. Sans doute, dans le passé, il avait été mieux fertilisé, étant situé en contrebas de l’étable. Nous brûlâmes aussi l’immense tas de bois issu de la démolition pour avoir plus de surface disponible. Un malaise nous envahit lorsque les flammes jaillirent dans le ciel, seulement à quelques mètres devant la maison ! Le bois sec brûlait comme une allumette ! Nous avions préparé quelques seaux d’eau et le tuyau d’arrosage. Finalement, la transpiration d’angoisse fut la seule eau que nous fîmes couler ! A cet endroit, le sol se laissait travailler facilement et bientôt, nous y récoltâmes les premiers radis et salades. Nous ramassions du pissenlit et de l’oseille dans les prés. Marcelle, la mère de Jean-Paul nous montra l’ail et les asperges sauvages, qui poussaient à certains endroits. Coupés en petits morceaux, ils amélioraient notre quotidien.
Autour de nous, sur les grises pentes boisées, commençaient à briller les premiers merisiers, semblables à des torches blanches. Suivirent les épines noires et les prunes sauvages avec leurs voiles blancs. Bientôt nous aperçûmes ci et là, comme un souffle, le premier vert tendre des bouleaux. Comme si les autres arbres avaient attendu ce signal, ils commencèrent petit à petit à déplier leurs feuilles de sorte que, après une bonne semaine, les flancs des coteaux autour de nous scintillaient de toutes les nuances de vert. Les oiseaux migrateurs étaient de retour et nous réveillaient à la première lueur du jour. Nous ouvrîmes les fenêtres pour les écouter. Ici leur chant nous semblait plus intense ! Bientôt nous entendîmes le premier coucou, pendant que le vert continuait de se propager vers le haut de la montagne. A quelques endroits, sur le versant nord, persistait la dernière neige. Le printemps était arrivé !
*
L’herbe aussi, motivée par la tiédeur, commença à pousser et nos chèvres avaient les cornes vertes, car elles devaient brouter les feuilles sous les fougères qui se dépêchaient de sortir. La trop longue jachère n’avait pas fait du bien à nos terres. La terre semblait être morte. Les seuls vers de terre, signe de fertilité du sol, se trouvaient dans notre tas de fumier ! Dans la vallée, les gens disaient que leurs bêtes avaient déjà envie de monter sur les estives. Mais nos bêtes à nous avaient plutôt envie de descendre, les terres se trouvant en bas étant beaucoup plus vertes ! Jean-Paul et ses parents lâchaient encore leurs brebis sur nos terres quand nous n’étions pas sur place. « Bientôt elles partiront à la montagne. Puis il faudra faire le foin. Si vous voulez, vous pouvez nous aider et nous vous en donnerons la moitié pour l’hiver ». Ça sonnait bien ! Mais attendons la réalité…
A certains endroits, les fougères s’élevaient à un mètre de haut, empêchant le peu d’herbe maigre de prospérer. Il fallait d’abord les couper sur la grande pente au-dessus de la maison. C’était une surface de presque cinq hectares parsemée d’immenses ronciers et de petits arbres qui y avaient trouvé racine. La motofaucheuse était de marque suisse avec un essieu sans différentiel. Ayant un moteur 4-temps elle consommait peu, même pas deux litres par heure et ne sentait pas mauvais comme les 2-temps. Bientôt je commençai à réussir à la manier et j’arrivais à faire demi-tour. Sur nos pentes raides c’était facile, car le poids de la machine reposait sur la roue du bas. En appuyant sur les manches, la barre de coupe se levait et il était possible de faire pivoter la machine de 180 degrés autour de la roue qui se trouvait côté vallée. Dans ce laps de temps, la machine était presque en apesanteur ou en équilibre sur une roue. Mais il fallait être prudent pour ne pas la renverser. Et c’est ce qui arriva ! Soudain la faucheuse se trouva couchée sur le dos, comme une tortue rouge géante. J’arrêtai immédiatement le moteur et fermai le robinet d’essence. Mais malgré tout, de l’essence s’écoula du carburateur et s’évapora sur le pot d’échappement. Je descendis chercher Doris et ensemble nous réussîmes à la remettre sur pied. Seule la bougie était cassée, mais il s’en trouvait une autre dans la boîte à outils. Suite à cet incident, je commandai un kit d’élargissement chez le concessionnaire à St. Girons.
J’avais rehaussé les patins de la barre de coupe servant à régler la hauteur, afin de laisser l’herbe mais de couper surtout les fougères. D’abord, quand c’était possible et que le terrain n’était pas trop pentu, je fauchais une ou deux largeurs autour du pré. Ainsi il était plus facile de tourner et de couper une nouvelle bande de la parcelle. La largeur de coupe était de 1,50 m. Plus large, ça n’aurait pas été pratique sur ces terres irrégulières. J’attaquai les ronces seulement avec une moitié de la barre de coupe. Les petites furent coupées rapidement et parfois descendaient la côte en boule. Je rentrai dans les plus grands ronciers en avançant, afin d’arriver le plus loin possible en profondeur, avec comme résultat, que les ronces s’accrochaient à la barre ou s’enroulaient autour des roues. J’avais souvent dû libérer ma machine à l’aide de mon couteau de poche Opinel. Même les petits arbres tombaient devant le cliquetis bruyant de la barre de coupe. Bien sûr, à cause de cet usage, des sections de lame triangulaires se brisaient. J’avais toujours trois lames à disposition. Si une lame était émoussée ou abimée, je l’échangeais contre une autre. Le changement était rapide : il fallait mettre le milieu de la barre de coupe sur une cale, pousser la lame vers un côté afin de pouvoir, une fois dévissée, enlever les deux vis de la pièce qui lient le mécanisme d’entraînement à la lame. Puis retirer la lame par un côté. Si possible, mettre un peu de graisse sur les parties glissantes, rentrer la nouvelle lame dans le porte-lame et remonter le tout. Encore quelques coups de pompe à graisse (qui se trouvait dans la caisse à outils) dans le mécanisme d’entraînement, et c’était reparti !
Je remplaçais les sections cassées dans l’appentis en bois servant d’atelier que j’avais monté à côté de la maison : je posai la lame, qui se composait de plusieurs sections triangulaires rivetées sur une barre métallique entre les mâchoires de l’étau, de sorte que la barre de métal repose sur une mâchoire et la section cassée entre les deux. Avec un ou deux coups secs avec le marteau sur le bord de la section, celle-ci coupait les rivets et on pouvait l’enlever et l’échanger. A cause des plaques servant de glissière, on avait besoin de deux longueurs de rivets. Pour aplatir les rivets au marteau, il fallait poser la barre sur l’étau fermé, mieux encore sur un bout de rail de chemin de fer trouvé à la casse qui faisait office d’enclume. Il fallait aussi, surtout après avoir touché une souche d’arbre, lorsque les doigts de la barre étaient tordus ou encore que les lames bougeaient difficilement, redresser ces doigts ou les échanger. Pour cela, il fallait retirer la lame et viser le passage de la lame.