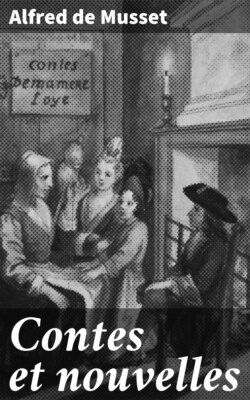Читать книгу Contes et nouvelles - Alfred de Musset - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Au commencement du règne de Louis XV, un jeune homme nommé Croisilles, fils d’un orfèvre, revenait de Paris au Havre, sa ville natale. Il avait été chargé par son père d’une affaire de commerce, et cette affaire s’était terminée à son gré. La joie d’apporter une bonne nouvelle le faisait marcher plus gaiement et plus lestement que de coutume; car, bien qu’il eût dans ses poches une somme d’argent assez considérable, il voyageait à pied pour son plaisir. C’était un garçon de bonne humeur, et qui ne manquait pas d’esprit, mais tellement distrait et étourdi, qu’on le regardait comme un peu fou. Son gilet boutonné de travers, sa perruque au vent, son chapeau sous le bras, il suivait les rives de la Seine, tantôt rêvant, tantôt chantant, levé dès le matin, soupant au cabaret, et charmé de traverser ainsi l’une des plus belles contrées de la France. Tout en dévastant, au passage, les pommiers de la Normandie, il cherchait des rimes dans sa tête (car tout étourdi est un peu poète), et il essayait de faire un madrigal pour une belle demoiselle de son pays; ce n’était pas moins que la fille d’un fermier général, mademoiselle Godeau, la perle du Havre, riche héritière fort courtisée. Croisilles n’était point reçu chez monsieur Godeau autrement que par hasard, c’est-à-dire qu’il y avait porté quelquefois des bijoux achetés chez son père. Monsieur Godeau, dont le nom, tant soit peu commun, soutenait mal une immense fortune, se vengeait par sa morgue du tort de sa naissance, et se montrait, en toute occasion, énormément et impitoyablement riche. Il n’était donc pas homme à laisser entrer dans son salon le fils d’un orfèvre; mais, comme mademoiselle Godeau avait les plus beaux yeux du monde, que Croisilles n’était pas mal tourné, et que rien n’empêche un joli garçon de devenir amoureux d’une belle fille, Croisilles adorait mademoiselle Godeau, qui n’en paraissait pas fâchée. Il pensait donc à elle tout en regagnant le Havre, et, comme il n’avait jamais réfléchi à rien, au lieu de songer aux obstacles invincibles qui le séparaient de sa bien-aimée, il ne s’occupait que de trouver une rime au nom de baptême qu’elle portait. Mademoiselle Godeau s’appelait Julie, et la rime était aisée à trouver. Croisilles, arrivé à Honfleur, s’embarqua, le cœur satisfait, son argent et son madrigal en poche, et, dès qu’il eut touché le rivage, il courut à la maison paternelle.
Il trouva la boutique fermée; il y frappa à plusieurs reprises, non sans étonnement ni sans crainte, car ce n’était point un jour de fête; personne ne venait. Il appela son père, mais en vain. Il entra chez un voisin pour demander ce qui était arrivé; au lieu de lui répondre, le voisin détourna la tête, comme ne voulant pas le reconnaître. Croisilles répéta ses questions; il apprit que son père, depuis longtemps gêné dans ses affaires, venait de faire faillite, et s’était enfui en Amérique, abandonnant à ses créanciers tout ce qu’il possédait.
Avant de sentir tout son malheur, Croisilles fut d’abord frappé de l’idée qu’il ne reverrait peut-être jamais son père. Il lui paraissait impossible de se trouver ainsi abandonné tout à coup; il voulut à toute force entrer dans la boutique, mais on lui fit entendre que les scellés étaient mis; il s’assit sur une borne, et, se livrant à sa douleur, il se mit à pleurer à chaudes larmes, sourd aux consolations de ceux qui l’entouraient, ne pouvant cesser d’appeler son père, quoiqu’il le sût déjà bien loin; enfin il se leva, honteux de voir la foule s’attrouper autour de lui, et, dans le plus profond désespoir, il se dirigea vers le port.
Arrivé sur la jetée, il marcha devant lui comme un homme égaré qui ne sait où il va ni que devenir. Il se voyait perdu sans ressources, n’ayant plus d’asile, aucun moyen de salut, et, bien entendu, plus d’amis. Seul, errant au bord de la mer, il fut tenté de mourir en s’y précipitant. Au moment où, cédant à sa pensée, il s’avançait vers un rempart élevé, un vieux domestique, nommé Jean, qui servait sa famille depuis nombre d’années, s’approcha de lui.
«Ah! mon pauvre Jean! s’écria-t-il, tu sais ce qui s’est passé depuis mon départ. Est-il possible que mon père nous quitte sans avertissement, sans adieu?
–Il est parti, répondit Jean, mais non pas sans vous dire adieu.»
En même temps il tira de sa poche une lettre qu’il donna à son jeune maître. Croisilles reconnut l’écriture de son père, et, avant d’ouvrir la lettre, il la baisa avec transport; mais elle ne renfermait que quelques mots. Au lieu de sentir sa peine adoucie, le jeune homme la trouva confirmée. Honnête jusque-là et connu pour tel, ruiné par un malheur imprévu (la banqueroute d’un associé), le vieil orfèvre n’avait laissé à son fils que quelques paroles banales de consolation, et nul espoir, sinon cet espoir vague, sans but ni raison, le dernier bien, dit-on, qui se perde.
«Jean, mon ami, tu m’as bercé, dit Croisilles après avoir lu la lettre, et tu es certainement aujourd’hui le seul être qui puisse m’aimer un peu: c’est une chose qui m’est bien douce, mais qui est fâcheuse pour toi; car, aussi vrai que mon père s’est embarqué là, je vais me jeter dans cette mer qui le porte, non pas devant toi ni tout de suite, mais un jour ou l’autre, car je suis perdu.
–Que voulez-vous y faire? répliqua Jean, n’ayant point l’air d’avoir entendu, mais retenant Croisilles par le pan de son habit. Que voulez-vous y faire, mon cher maître? Votre père a été trompé; il attendait de l’argent qui n’est pas venu, et ce n’était pas peu de chose. Pouvait-il rester ici? Je l’ai vu, monsieur, gagner sa fortune depuis trente ans que je le sers; je l’ai vu travailler, faire son commerce, et les écus arriver un à un chez vous. C’est un honnête homme, et habile; on a cruellement abusé de lui. Ces jours derniers, j’étais encore là, et comme les écus étaient arrivés, je les ai vus partir du logis. Votre père a payé tout ce qu’il a pu pendant une journée entière, et, lorsque son secrétaire a été vide, il n’a pu s’empêcher de me dire, en me montrant un tiroir où il ne restait que six francs: «Il y avait ici cent mille francs ce matin!!» Ce n’est pas là une banqueroute, monsieur, ce n’est point une chose qui déshonore!
–Je ne doute pas plus de la probité de mon père, répondit Croisilles, que de son malheur. Je ne doute pas non plus de son affection; mais j’aurais voulu l’embrasser, car que veux-tu que je devienne? Je ne suis point fait à la misère, je n’ai pas l’esprit nécessaire pour recommencer ma fortune. Et quand je l’aurais, mon père est parti. S’il a mis trente ans à s’enrichir, combien m’en faudra-t-il pour réparer ce coup? Bien davantage. Et vivra-t-il alors? Non sans doute; il mourra là-bas, et je ne puis pas même l’y aller trouver; je ne puis le rejoindre qu’en mourant aussi.»
Tout désolé qu’était Croisilles, il avait beaucoup de religion; quoique son désespoir lui fît désirer la mort, il hésitait à se la donner. Dès les premiers mots de cet entretien, il s’était appuyé sur le bras de Jean, et tous deux retournaient vers la ville. Lorsqu’ils furent entrés dans les rues, et lorsque la mer ne fut plus si proche:
«Mais, monsieur, dit encore Jean, il me semble qu’un homme de bien a le droit de vivre, et qu’un malheur ne prouve rien. Puisque votre père ne s’est pas tué, Dieu merci, comment pouvez-vous songer à mourir? Puisqu’il n’y a point de déshonneur, et toute la ville le sait, que penserait-on de vous? Que vous n’avez pu supporter la pauvreté. Ce ne serait ni brave ni chrétien; car, au fond, qu’est-ce qui vous effraye? Il y a des gens qui naissent pauvres, et qui n’ont jamais eu ni père ni mère. Je sais bien que tout le monde ne se ressemble pas, mais enfin il n’y a rien d’impossible à Dieu. Qu’est-ce que vous feriez en pareil cas? Votre père n’était pas né riche, tant s’en faut, sans vous offenser, et c’est peut-être ce qui le console. Si vous aviez été ici depuis un mois, cela vous aurait donné du courage. Oui, monsieur, on peut se ruiner, personne n’est à l’abri d’une banqueroute; mais votre père, j’ose le dire, a été un homme, quoiqu’il soit parti un peu vite. Mais que voulez-vous ? on ne trouve pas tous les jours un bâtiment pour l’Amérique. Je l’ai accompagné jusque sur le port, et si vous aviez vu sa tristesse! Comme il m’a recommandé d’avoir soin de vous, de lui donner de vos nouvelles!. Monsieur, c’est une vilaine idée que vous avez de jeter le manche après la cognée. Chacun a son temps d’épreuve ici-bas, et j’ai été soldat avant d’être domestique. J’ai rudement souffert, mais j’étais jeune; j’avais votre âge, monsieur, à cette époque-là, et il me semblait que la Providence ne peut pas dire son dernier mot à un homme de vingt-cinq ans. Pourquoi voulez-vous empêcher le bon Dieu de réparer le mal qu’il vous a fait? Laissez-lui le temps, et tout s’arrangera. S’il m’était permis de vous conseiller, vous attendriez seulement deux ou trois ans, et je gagerais que vous vous en trouveriez bien. Il y a toujours moyen de s’en aller de ce monde. Pourquoi voulez-vous profiter d’un mauvais moment?»
Pendant que Jean s’évertuait à persuader son maître, celui-ci marchait en silence, et, comme font souvent ceux qui souffrent, il regardait de côté et d’autre, comme pour chercher quelque chose qui pût le rattacher à la vie. Le hasard fit que, sur ces entrefaites, mademoiselle Godeau, la fille du fermier général, vint à passer avec sa gouvernante. L’hôtel qu’elle habitait n’était pas éloigné de là; Croisilles la vit entrer chez elle. Cette rencontre produisit sur lui plus d’effet que tous les raisonnements du monde. J’ai dit qu’il était un peu fou, et qu’il cédait presque toujours à un premier mouvement. Sans hésiter plus longtemps et sans s’expliquer, il quitta le bras de son vieux domestique et alla frapper à la porte de monsieur Godeau.