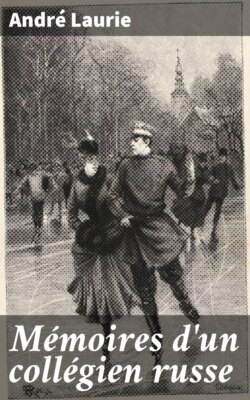Читать книгу Mémoires d'un collégien russe - André Laurie - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’ÉTANG MAUDIT
ОглавлениеL’été de cette année avait été d’une beauté exceptionnelle. Septembre touchait à sa fin; déjà une gelée légère venait le matin poudrer les grands arbres, dont le feuillage roussi s’enlevait en vigueur sur le ciel sans nuage, d’un bleu pâle. Tout était calme et silencieux dans la campagne. On respirait comme un souffle de liberté après les ardeurs brûlantes de l’été, et la mort prochaine de la nature donnait un charme mélancolique à cette beauté qui entourait toutes choses.
Dès le matin, j’étais sorti selon la coutume. J’avais un Projet en tête: il y avait, à plusieurs verstes de Sitovka, plus loin que je n’étais jamais allé, un étang que je désirais visiter depuis longtemps. En marchant bien je pouvais y arriver vers le milieu de la journée; le temps de l’explorer en détail, de me reposer et de revenir au village, et la nuit serait venue depuis longtemps. Je n’eus garde de faire part de mon projet à mon père, d’abord parce que j’étais peu communicatif de ma nature, ne desserrant les dents en général que lorsque la chose était indispensable, et en outre parce que, l’endroit passant pour dangereux, il aurait pu me défendre d’y aller.
Je partis de grand matin, foulant d’un pied léger l’herbe fine qui pousse sur nos routes. J’avais dans ma poche un gros morceau de pain de seigle et un magnifique concombre frais. Un déjeuner de prince! Je trouverais de l’eau en chemin pour étancher ma soif.
En traversant le village, je vis maître Lebewohl sur la porte de l’école:
«Hé ! dis donc, Dmitri! Dmitri Fédorovitch! l’heure a sonné !...»
Je fis la sourde oreille.
«Attends un peu, garnement, si je t’attrape!... Ne m’entends-tu pas? L’heure de la classe a sonné !...
— Je vous entends, Johann Karlowitch! répondis-je en m’arrêtant les mains dans mes poches.
— Viens, alors! cria le magister en agitant son bâton, montrant bonne envie de m’en caresser les épaules.
— Non! répondis-je en me remettant en marche.
— Comment, non! pendard! paresseux! Vas-tu venir ici quand je t’appelle?...»
Mais je me contentai de hausser les épaules et de presser légèrement le pas.
«Ces Niémetz sont tous les mêmes, pensai-je avec dégoût. Ils voudraient nous enfermer tous pour nous rendre aussi bêtes qu’eux!... Mais, Dieu merci! nous sommes Petits-Russiens!...»
Et je continuai mon chemin, enchanté de moi-même et de l’existence.
Je ne tardai pas à pénétrer sous la voûte obscure de la forêt qui borne notre village à l’est. On n’y entendait aucun bruit que celui de la cognée s’attaquant à quelque grand arbre, au loin. J’ai souvent été frappé par l’effet mélancolique de ce bruit à travers les bois; bien que produit par la main de l’homme, il a toujours réveillé dans mon cœur le sentiment de la nature sauvage, dont il me semble être l’écho, et, jointe à cela, une indicible tristesse. Tout en marchant, je suivais ce bruit dans le lointain, et ma rêverie vague se rythmait sur lui. Autour de moi, les frênes et les bouleaux géants dressaient vers le ciel leurs colonnes lisses ou rugueuses. La noirceur des écorces faisait paraître plus légère la verdure déjà dorée par l’automne qui enchevêtrait là-haut ses frondaisons vagabondes. On aurait dit une tente de dentelle filtrant les rayons du calme soleil de septembre. Les oiseaux, toujoursgazouillants, tournoyaient autour des cimes. Dans le sentier, les pinsons et les fauvettes partaient sous mes pieds avec la rapidité d’une flèche. L’écureuil sautait de branche en branche, abrité sous le panache roux de sa queue coquette et touffue. Tout autour de moi, dans les hautes herbes, sous les fougères élégantes, embaumaient encore des fleurs teintes d’un éclat plus riche. Au pied de tous ces grands arbres brillaient, plus que les fleurs mêmes, des champignons roux, jaunes, roses, écarlates, blancs comme la coquille de l’œuf, brûlés comme de l’amadou, verdâtres et empoisonnés comme le dos du crapaud. Et je m’adressais à demi-voix à chacun des mignons habitants de la solitude:
«Oui, frère, disais-je à l’écureuil, amasse, cache, fais-toi un beau tas de noisettes pour l’hiver; il t’en faut pour neuf mois au moins, pauvre bestiole!... Et prends garde, d’ici là, que le loup te croque!... Et vous aussi, chers oiselets, chantez pendant que le beau temps se maintient! Bientôt, peut-être, on trouvera vos petits corps raidis par le froid dans la neige, — et vous ne renaîtrez pas au printemps prochain ainsi que les fleurs, vos sœurs... C’est dur de mourir, pour vous si gais, si vifs, si remuants... Mais du moins, ne savez-vous pas ce qui vous attend!...»
Je humais à pleins poumons cette senteur fraîche et sylvestre des grands bois. J’étais heureux dans mon isolement, et la satisfaction maligne d’avoir échappé au malheureux Porphyre que j’avais entrevu derrière l’izba de son père, occupé à scier du bois, n’ajoutait pas peu à ma belle humeur.
Je marchai sans m’arrêter pendant longtemps: quand enfin j’atteignis la lisière de la forêt, je vis, à la hauteur du soleil dans le ciel, qu’il devait être plus de midi. Je m’assis au bord d’un petit ruisseau qui coulait cristallin dans les mousses, et je dévorai mes provisions à belles dents.
Tout en mangeant, je riais au souvenir de la mine déconfite de Johann Lebewohl en me voyant lui brûler la politesse.
«Ce pauvre diable de Niémetz! pensai-je avec une pitié irrévérencieuse, il ne se doute pas le moins du monde de ce que c’est que se promener librement au loin. Il ne sort de son izba étouffante que pour fumer sa pipe sur sa porte, et, qui plus est, avec un livre à la main! Je voudrais bien savoir ce qu’il trouve de si amusant dans les livres... B, A, BA... B, I, BI... B, 0, BO... On y parle sans doute de ces pays si malheureux, où les infortunés Niémetz n’ont pas d’hiver... où, toute l’année, ils sont grillés par le soleil... Et puis des Frantsouz aussi... Comment sont-ils faits, ces Frantsouz du diable, hein?... Père m’a conté l’histoire de ce Bonapartichko qui vint ici nous démolir nos izbas et nous prendre Moscou la Sainte. Ah! le vilain diable de Bonapartichko! les Roussalkis l’étranglent!... Si j’avais été là de son temps, j’aurais bien voulu lui donner une magistrale rossée... vlin! vlan! avec mon beau bâton noueux... le chien, l’Asiatique... Mais notre brave prince Mikaïlo Ilarionovitch Solénitchef Koutouzof Smolenski l’a fait sans moi, avec l’aide de Dieu! Ah! ah! on lui en a fait voir, au Frantsouz!...»
C’étaient là toutes mes notions en histoire (j’avais environ huit ans à cette époque); mais cet épisode avait laissé sur ma cervelle une impression tenace. Il faut dire aussi que, si mes idées n’étaient pas nombreuses, je m’attachais à celles que j’avais avec un entêtement tout particulier. Celle de Bonapartichko., l’envahisseur de la patrie sainte, était implantée au plus profond de mon âme; souvent j’importunais mon père pour qu’il m’en redît la sombre épopée. A part cela, mes idées étaient élémentaires au possible. L’Espagne, dont on faisait tant de récits, les pays étranges et mystérieux qui n’étaient pas la Russie, les mœurs et coutumes de ces êtres disgraciés qui n’avaient pas le bonheur d’être mes compatriotes... autant d’énigmes que je me souciais fort peu de résoudre.
Mon pauvre père, alors et plus tard, riait souvent de bon cœur de mes ignorances.
«Bah! disait-il au magister, il a le temps d’apprendre tout cela... La tête est bien conformée; le gaillard n’est pas bête, et il est entêté, de sorte que, si jamais la fantaisie lui vient d’étudier, il ne s’en tirera pas plus mal qu’un autre. Pas vrai, Mitia?
— Oui, père.
— Tu seras savant un jour, hé ?
— Oui, père, savant comme toi.
— Et comment te viendra la science? En dormant?
— Hé non! je prendrai tes livres et je les lirai. Et alors je serai savant.
— Mais si tu ne sais pas les lire? Ils sont écrits en français, ou en grec, ou en latin.
— J’en prendrai de russes.
— Et s’il n’en existe pas?
— Je ferai venir un Niémetz de Frantsouz, et je lui dirai: «Bajou, moncié se vous pléïc, enseigne-moi ton bara-« gouin.» Et puis je lui donnerai des coups de bâton s’il rechigne...»
Et mon père de rire, pendant que le pauvre Lebewohl s’éloignait en levant les bras au ciel d’indignation.
«Quels sauvages! Gott im Himmel! quels sauvages!... » disait-il.
Mais, un jour (je les entendis sans avoir l’air d’écouter), mon père lui avait expliqué sa théorie.
«Ne te fâche pas, diédouchka, lui avait-il dit. Tu vois où j’en suis arrivé, moi: j’ai à peine trente ans et je vais mourir épuisé, râlant, toussant pis qu’une vieille chèvre, après avoir perdu ma jeunesse en souffrances lentes et monotones. Pourquoi? En grande partie à cause de l’existence que j’ai menée enfant, j’en suis convaincu. J’étais né faible et maladif; il m’aurait fallu la vie des champs, le grand air, l’espace et la liberté... Au lieu de tout cela, j’ai grandi dans une ville, j’ai étudié dès l’enfance pour m’apercevoir au déclin de ma vie que ce que je sais est peu de chose auprès de ce que j’ignore. Je n’ai pas voulu qu’il en fût de même pour cet enfant; j’ai désiré qu’il sache, au moins pendant les premières années de sa vie, ce que c’est que le bonheur, — purement animal si on veut, — mais le bonheur après tout très réel que peuvent donner la force, la santé, la liberté. J’ai réussi; l’enfant est brave, honnête et fort. Il n’est pas plus bête que beaucoup de petits prodiges, et j’ai la ferme intention, s’il me reste quelques années à vivre, de lui démontrer moi-même combien il serait honteux pour un homme fait, de végéter volontairement dans l’ignorance. Je suis sans craintes pour son avenir; je crois fermement que la santé dont je l’ai doté lui sera du plus grand secours dans ses études futures... Ah! si j’osais espérer le voir à vingt ans!... Je n’aurais pas à rougir de lui, j’en suis convaincu. »
Il me semble l’entendre en ce moment. Mon père chéri! Non, tu n’auras pas à rougir de ton fils, je te le jure!... Etsi tu pouvais lire dans mon cœur, tu n’en rougirais pas maintenant, même dans la position ignominieuse où il se trouve... Je ne t’ai jamais menti. Toi du moins, tu ne douterais pas de ma parole... Tu saurais bien que je suis innocent.
Mais revenons à nos moutons.
Réconforté par mon repas, je me levai, et jetant un regard amical sur la fraîche et ombreuse forêt, je m’engageai résolument dans le steppe inconnu. Il s’agissait de gravir une petite colline que je voyais s’estomper bleuâtre à ma droite, de la redescendre et de trouver sur son versant opposé l’étang dont je rêvais depuis si longtemps.
Cet étang avait un renom sinistre dans le pays. On racontait qu’un voyageur, autrefois, avait été assassiné sur ses bords, puis son corps jeté dans les eaux gluantes, d’où on entendait sa voix par les nuits calmes. Tous ceux qu’il appelait par leur nom devaient s’apprêter à mourir dans l’année. Ses bords étaient dangereux. Le sable s’effondrait sous les pas de l’imprudent qui s’y avançait sans précaution; ses pieds, comme tirés par une main invisible, s’enfonçaient lentement dans la boue noirâtre qui ne tardait pas à se refermer par-dessus sa tête... Il ne servait à rien de s’agiter, de s’accrocher aux roseaux flexibles qui croissaient à profusion autour de l’étang, — sans racines, ils vous venaient à la main, et l’eau traîtresse montait, montait... puis on disparaissait, et de grands cercles à la surface muette de l’eau sombre disaient seuls votre sort affreux... On l’appelait l’Étang maudit, et il jouait un rôle dans toutes les légendes du village.
Depuis longtemps, je brûlais du désir de le voir de mes yeux. Et j’allais être si prudent, avec mon solide bâton pour sonder le terrain avant de m’y aventurer, et mes pieds chaussés de laptis, tout neufs, tressés de la veille, dans lesquels je me sentais la légèreté d’une biche!
Je marchais toujours vers la colline, au milieu des hautes herbes du steppe: la bouriane, l’absintheélancée, les orties piquantes. Mais, chose curieuse, à mesure que je m’avançais, on eût dit qu’elle reculait; si bien que, lorsque j’atteignis enfin le sommet du coteau, j’étais passablement fatigué, et le soleil baissait déjà vers l’horizon.
Je m’arrêtai un instant pour souffler, sur la hauteur, tout en jetant un regard avide sur ce versant inconnu et plein d’attraits que je venais de découvrir! Oui, c’était bien là-bas, au pied du petit mont: un éclair bleuâtre, sous les rayons obliques du soleil... et tout autour une ceinture de pins à la verdure sombre, au tronc lisse et rouge, qui prenait une couleur ensanglantée à la lumière du couchant. C’était l’Étang maudit!... Il fallait me presser si je voulais y arriver, en explorer les bords et rentrer à Sitovka avant que mon père eût le temps de s’inquiéter de mon absence.
Je dévalai la pente en courant. Ce fut l’affaire de quelques minutes, et bientôt je me trouvai au niveau de l’étang.
Je le confesse, le cœur me battait un peu tandis que je m’avançais vers le bouquet d’arbres, sombres et immobiles comme des sentinelles mortes. Mais pour rien au monde je n’aurais voulu reculer, ni m’avouer à moi-même que ce petit frisson désagréable, à la racine des cheveux, était peut-être de la peur... Et, après tout, le poltron qui, bravant ses terreurs, marche droit au danger, n’est-il pas autant digne d’admiration que le héros qui y court sans pâlir, par la bonne raison qu’il ignore jusqu’au sentiment de la peur? Sans m’inquiéter de ces distinctions subtiles, je marchais, sondant de l’œil le point fatal, mais bien assuré de n’y rencontrer personne, car sa réputation sinistre en éloignait quiconque pouvait se trouver dans ces parages... Quand je dis personne, c’est personne de vivant, s’entend. Quant aux autres, noyés, revenants, roussalkis, lééchies, vodanoï et tous les lutins généralement, il ne me restait plus qu’à invoquer contre eux la protection des bienheureux Kozma et Damian, patrons de notre église... Le vin était tiré, il fallait le boire... et si je devais faire quelque mauvaise rencontre, je ne pouvais me fier qu’à mon étoile pour me tirer de là !
Enfin je pénétrai sous les arbres.
Leur cime était agitée d’un frémissement mystérieux, et, tandis que l’air était calme aux alentours, une brise froide et légère circulait sous leurs rameaux. Les eaux de l’étang, immobiles et profondes, paraissaient noires au centre. En levant la tête je vis, haut dans le ciel clair, quelques gros oiseaux de proie tournoyer à grands battements d’ailes.
Mon cœur se serra, et je soupirai oppressé par l’aspect lugubre de ce lieu.
Tout à coup, au milieu du grand silence, et tandis que je me tenais immobile, appuyé contre un tronc d’arbre, contemplant, fasciné, l’eau muette, un gémissement aigu et prolongé, une plainte déchirante de petit enfant éclata non loin de moi...
Mon sang se glaça dans mes veines, mes genoux faillirent se dérober sous moi... C’était le vidianoï ! C’était le noyé qui m’appelait! J’étais perdu! Il allait venir me prendre, m’enlacer de ses longs bras décharnés et me tirer à lui sous les eaux mortes... D’une main frémissante je me signai de la tête aux pieds, et j’allais m’enfuir sans demander mon reste, quand la plainte se répéta plus désolée et j’entendis distinctement une voix frêle dire avec un sanglot:
«Mamouchka! mamouchka?...»
J’eus honte de moi-même. Ma terreur se dissipa subitement; mon cœur se mit à battre à grands coups et je sentis une rougeur monter jusqu’à mes cheveux. Je me précipitai du côté de la voix et, me frayant impétueusement un passage à travers les ronces et les roseaux entremêlés, je me trouvai devant un spectacle navrant.
Une femme, vêtue de misérables habits, était couchée sans mouvement à terre. A côté d’elle, une petite enfant, qui me parut âgée de quatre ou cinq ans au plus, s’efforçait de la réveiller par ses cris. Elle lui tirait les mains, lui soulevait les bras, essayait de relever sa tête inerte, qui retombait lourdement sur le sol dans un flot de cheveux noirs, et, de temps en temps, elle poussait son cri aigu et désolé :
«Mamouchka! mamouchka!...»
Je compris instinctivement que la malheureuse femme était morte. Depuis combien de temps était-elle là ? D’où venait-elle, l’infortunée, avec sa pauvre petite?... Celle-ci était vêtue d’un mauvais sarafane vert tout déchiré et, à travers un mouchoir en lambeaux, ses grands cheveux noirs emmêlés tombaient sur ses yeux et son visage. Elle était si petite, si menue et si brune, avec son visage étroit et ses yeux énormes, que je ne fus pas loin de la prendre derechef pour une enfant de roussalka... Combien, en effet, la chétive créature ressemblait peu au type de beauté en honneur chez nous: une face ronde, vermeille et reluisante, des cheveux de lin, et surtout, oh! surtout de larges et puissants pieds, pour soutenir le corps sur une base solide!...
Au bruit que j’avais fait dans les ronces, l’enfant avait relevé la tête, et ses grands yeux s’étaient fixés sur moi, étincelants et sombres. Je restais immobile à la regarder.
«Mamouchka! dit-elle tout à coup. Viens la réveiller!... Elle dort trop!...»
Elle parlait à peine distinctement et dans un dialecte presque inintelligible. Je ne sais comment il se fit que je la compris cependant. Je m’avançai en hésitant, et bientôt je m’agenouillai auprès de la femme morte. Je pris doucement sa main rigide et glacée, puis je la replaçai sur le sol en silence. Elle était bien morte; on n’en pouvait douter.
«D’où viens-tu? dis-je ensuite à voix basse à l’enfant.
— De là-bas... fit-elle avec un geste vague.
— Où sont les autres?... Vous n’aviez pas de camarades?...
— Non... ils s’en sont allés... avec les chevaux...»
Je remarquai, en effet, que l’herbe était piétinée autour de nous et que des traces de fers étaient marquées dans la boue.
«Ton papa aussi?» repris-je.
L’enfant ne parut pas me comprendre.
«Réveille-la! reprit-elle en pleurant. Réveille-la vite!... Allons-nous-en!...
— Comment t’appelles-tu? Où veux-tu que je t’emmène?» continuai-je.
Mais elle sanglotait sans me répondre. Je restais immobile auprès d’elle, ne sachant, à vrai dire, à quel saint me vouer, lorsque l’enfant se releva d’un trait, et, toujours agenouillé comme je l’étais, jeta ses bras autour de mon cou et me donna un baiser sur la joue.
«Emmène-moi! dit-elle. Allons-nous-en!»
Je restai confondu d’abord; je n’étais pas caressant de ma nature et, sauf au jour de Pâques je n’avais, je crois, de ma vie embrassé personne. Cette caresse spontanée et inattendue de la petite abandonnée fit vibrer subitement en moi une fibre jusqu’alors muette. Sans réfléchir davantage, je la serrai vivement sur mon cœur, et des larmes me montèrent aux yeux.
«Viens! lui dis-je résolument. Tu seras ma sœur. Fédor Illitch sera ton père?»
Je n’étais pas sûr qu’elle me comprit, mais ma promesse ne fut pas moins solennelle pour cela.
«Et mamouchka? fit-elle comme je me relevais en la prenant par la main.
— Nous reviendrons la chercher. Elle dort à présent.
— Réveille-la, réveille-la, bon garçon!...
— Viens toujours, repris-je d’un ton caressant, je te promets que nous reviendrons la chercher.»
Mais l’enfant s’attachait à elle de toute la force de ses petites mains.
Je sentis la nécessité d’une diversion. Après m’être dépouillé de mon touloupe j’en couvris le visage et les mains de la morte. J’assujettis les bords avec de grosses pierres, et, apercevant à quelque distance un amchanik abandonné, j’y courus. Secouant les claies à demi-disjointes qui formaient les parois, je les fis tomber à terre. Avec une force qui me surprit moi-même je les apportai auprès de la morte et je lui en formai un abri; puis, d’une hâte fébrile, j’amoncelai des branchages sur la petite pyramide, et, sûr que ses restes seraient respectés jusqu’à ce qu’on pût leur donner la sépulture, je pris l’enfant par la main.
«Viens, lui dis-je. Il se fait tard.
— Et mamouchka?...
— Suis-moi maintenant, dis-je avec autorité. Nous reviendrons la prendre.»
La petite fille se mit docilement à me suivre, non sans retourner fréquemment la tête avec des larmes silencieuses. Mon cœur saignait pour elle... J’aimais tant mon père aussi, moi! il me semblait partager la douleur de cette enfant en entrevoyant celle que me réservait peut-être un avenir prochain... Un obscur sentiment de sympathie et de dévouement faisait battre mon cœur pour le pauvre petit être dont je tenais la main froide et tremblante... Bientôt elle s’arrêta, ne pouvant plus avancer, accablée de fatigue et d’inanition. Je la pris dans mes bras, elle passa les siens autour de mon cou, et, au bout de quelques instants, elle dormait profondément.
Ah! que la route me parut longue! que le steppe était aride! la forêt lointaine!... Le soleil avait disparu. Une à une, les étoiles s’étaient allumées dans le ciel; sa voûte sombre s’élargissait autour de moi, trébuchant sous mon fardeau. Qu’il me tardait d’arriver!... Parfois je m’arrêtais, essoufflé, hors d’haleine, le front mouillé de sueur. L’enfant dormait toujours.
III
MON PÈRE PARAIT SUR LE SEUIL, SA LAMPE A LA MAIN.
Après deux ou trois minutes de repos, je reprenais courage et je repartais.
Il était minuit au moins quand je sortis enfin de la forêt. Devant moi s’étendait la route, et là-bas je voyais briller une lumière à la fenêtre de notre izba; mon père m’attendait sans doute.
Retrouvant des forces, je traversai le village presque en courant, poursuivi par les abois des chiens indignés de cette promenade nocturne. Enfin j’arrive à notre maison! Je vais frapper lorsque la porte s’ouvre brusquement, et mon père paraît sur le seuil, sa lampe à la main.
«Est-ce toi, Dmitri? demande-t-il d’une voix anxieuse.
— C’est moi, père.
— Le ciel soit loué ! Entre. Tu m’as causé une mortelle inquiétude, enfant. Où es-tu allé ? D’où viens-tu?»
Je m’étais laissé tomber sur le banc qui longeait le mur, comme dans la plupart des habitations villageoises en Russie. Mon père avait posé sa lampe et revenait vers moi, lorsqu’il vit l’enfant dans mes bras.
«Qu’est-ce là ? cria-t-il tout surpris.
— Je l’ai trouvée... sa mère est morte... alors je te l’apporte... » dis-je avec effort, car la fatigue m’accablait.
Mon père s’en aperçut et, sans insister, il remplit de thé additionné de rhum un grand verre qu’il me tendit.
«Bois ceci d’abord, me dit-il, tu parleras ensuite.»
J’obéis, et, ayant épuisé le verre d’un trait, je me sentis renaître.
Mon père, cependant, avait pris dans ses bras l’enfant et l’avait portée près du poêle sans l’éveiller. Je le suivis et je lui racontai les faits en peu de mots. Il m’écouta d’un air pensif, tout en examinant le visage et les vêtements de la petite abandonnée. Ces vêtements étaient d’une coupe inusitée chez nous, et le type même de l’enfant était étrange à mes yeux.
«Elle doit être des Cosaques du Don, dit mon père à demi-voix comme j’achevais mon récit. Tu dis qu’elle a parlé de chevaux?
— J’ai cru du moins entendre un mot qui ressemble à celui-là.
— Des nomades sans doute... La mère sera restée en arrière pour se reposer et sera morte oubliée au bord de l’étang... malheureuse femme... Dieu soit loué, Mitia, que ta promenade t’ait conduit par là aujourd’hui.... sans toi l’enfant serait morte aussi...
— Nous la garderons, père, dis?»
Il inclina la tête avec gravité.
«J’aurai deux enfants au lieu d’un, dit-il. Elle ne t’a pas dit son nom?
— Je crois qu’elle ne m’a pas compris quand je le lui ai demandé.
— Nous l’appellerons Sacha du même nom que ta pauvre mère bien-aimée,» dit mon père d’une voix émue.
Et, à partir de ce jour, j’eus une sœur.