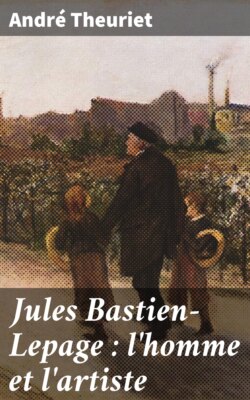Читать книгу Jules Bastien-Lepage : l'homme et l'artiste - André Theuriet - Страница 5
ОглавлениеJules Bastien-Lepage est né à Damvillers, le 1er novembre 1848, dans une maison qui forme l’un des angles de cette place dont je viens de parler; — une simple maison de cultivateurs aisés, à la façade jaunâtre et aux volets gris. On pousse la porte d’entrée et on se trouve de plain-pied dans une cuisine, — la vraie cuisine des villages de la Meuse, avec sa haute cheminée surmontée d’ustensiles de ménage, ses rangées de chaudrons de cuivre, sa maie pour le pain et son vaisselier garni de faïences coloriées. — La chambre contiguë sert à la fois de salon, de salle à manger et même au besoin de chambre à coucher; au-dessus sont les chambres de réserve, puis de vastes greniers aux charpentes touffues. — C’est dans la salle du rez-de-chaussée, gaiement exposée au midi, que le peintre des Foins et de Jeanne d’Arc a ouvert les yeux.
La famille était composée du père, esprit industrieux, sensé et méthodique; de la mère, une femme au cœur d’or et au dévouement infatigable, et du grand-père Lepage, ancien employé des contributions indirectes, qui s’était retiré près de ses enfants. On vivait en commun du modeste produit des champs que les Bastien faisaient valoir eux-mêmes, et de la petite pension de l’aïeul. A cinq ans, Jules commença à manifester son aptitude pour le dessin, et son père s’empressa de cultiver cette disposition naissante. Il avait lui-même le goût des arts d’imitation, employait ses loisirs à de menus travaux exigeant une certaine habileté manuelle, et y apportait l’exactitude scrupuleuse, la consciencieuse attention qui étaient ses qualités dominantes. Dès cette époque, pendant les soirées d’hiver, il exigeait que le marmot, avant de se coucher, copiât au crayon sur le papier un des ustensiles de ménage placés sur la table: la lampe, le broc, l’encrier, etc. Ce fut certainement à cette première éducation de l’œil et de la main que Bastien-Lepage dut cet amour de la sincérité, celte recherche patiente du détail exact qui furent la grande préoccupation de sa vie d’artiste. En poussant son fils à dessiner ainsi chaque jour, le père n’avait pas la moindre idée de faire de lui un peintre. En ce temps-là, et à Damvillers surtout, la peinture n’était pas regardée comme une profession sérieuse. — Le rêve qu’il caressait de compte à demi avec le grand-père, c’était de mettre Jules en état de choisir plus tard une de ces carrières administratives comme les forêts ou les ponts et chaussées, dont l’accès est plus facile à ceux qui possèdent de solides notions de dessin. Aussi, dès qu’il eut onze ans, on songea à lui faire quitter l’école communale et à le placer au collège.
C’était un gros sacrifice, car les ressources de la famille étaient peu considérables, et dans l’intervalle un second garçon était né, mais on redoubla d’économie, et en 1859 Jules put entrer comme pensionnaire au collège de Verdun. La classe de dessin fut celle qu’il suivit avec le plus de zèle. Son professeur fut étonné de la justesse du coup d’œil et de la dextérité de main de son nouvel élève. Quand l’enfant revenait à Damvillers, aux vacances, il dessinait partout: sur les livres, sur les murs, sur les portes. Aujourd’hui encore, les palissades des vergers gardent des traces de ces premiers croquis charbonnés à l’aventure. Sa mère conserve précieusement de petits cahiers pleins de dessins où il avait crayonné dans toutes les poses son frère Émile, alors en bas âge. La pensée de Jules se traduisait constamment par un dessin. Il s’essayait déjà à reproduire à l’aide du crayon certains passages de ses lectures, et sa première composition fut le Sacrifice d’Abraham. Les souvenirs classiques hantaient plus alors son esprit que les scènes rustiques entrevues pendant ses longs vagabondages en plein air.
A cet âge, les milieux dans lesquels nous vivons et que l’accoutumance nous a rendus familiers n’excitent ni notre étonnement ni notre imagination, mais ils entrent dans nos yeux et dans notre mémoire, à notre insu, et s’y gravent profondément. Ce n’est que plus tard, par la comparaison et la réflexion, que nous en sentons le charme puissant et la grâce originale. Pendant ses courses à travers champs, Bastien-Lepage recevait les impressions de la vie campagnarde et se les assimilait inconsciemment, comme une nourriture quotidienne. — Les ramasseurs de fagots cheminant sous bois; les pêcheurs de grenouilles, trempés jusqu’aux genoux et traversant les prés avec leur attirail de pèche sur l’épaule; les laveuses tordant leur linge au bord de la Tinte; les faneuses assoupies au pied d’un saule, à l’heure brûlante où l’on apporte la fromagée aux ouvriers; les jardins du village en avril, au moment où on les bêche et où les arbres sans feuilles étalent leur ombre maigre sur les plates-bandes, que des impériales et des primevères décorent seules de leurs précoces floraisons; les champs de pommes de terre où les feux de fanes desséchées font monter leurs fumées bleues dans les rougeurs des soirs d’octobre: tous ces menus détails de l’existence villageoise entraient dans les yeux de l’enfant, qui les emmagasinait instinctivement dans sa mémoire.
Les études littéraires l’intéressaient peu et il s’était pris, au contraire, d’un goût assez vif pour les mathématiques. Un moment, à l’époque où il achevait sa quatrième, il avait songé à se préparer aux examens de Saint-Cyr. Il n’y a là rien d’étonnant dans un département esssentiellement militaire, dont tous les hommes remarquables ont été des généraux. ou des maréchaux. Ce goût, où l’esprit d’imitation avait plus de part que la vocation véritable, lui passa rapidement, et pendant ses dernières années de collège sa pensée dominante fut constamment tournée vers les arts du dessin. Aussi, quand il en eut fini avec sa classe de philosophie, exprima-t-il à ses parents le désir d’aller à Paris étudier la peinture. — Grande fut la stupéfaction dans la maison de Damvillers. Tout en reconnaissant que son fils était un bon dessinateur, le père Bastien persistait à déclarer que la peinture n’était pas une carrière. — Rien d’assuré, un long apprentissage coûteux, et au bout de tout cela neuf chances d’échouer pour une de réussir. Parlez-moi d’un emploi honorable dans une administration de l’État, où l’on est sûr de toucher chaque mois ses appointements et où l’on a la perspective d’une retraite pour ses vieux jours! — On tint un conseil de famille. Le grand-père lui-même jugeait l’aventure hasardeuse et hochait la tête; la mère était surtout effrayée par les dangers de Paris et la vie de privations à laquelle on y était condamné, mais, vaincue à la fin par la persistance opiniâtre de son fils, elle se hasardait à murmurer timidement: «Pourtant, si c’est l’idée de Jules!...» On trouva un biais qui semblait tout arranger. Un ami de la famille, employé supérieur à l’administration centrale des postes, conseilla à Jules de subir l’examen d’admission dans cette administration, lui promettant, dès qu’il serait reçu, de le faire appeler à Paris, où on l’autoriserait à suivre les cours de l’École des beaux-arts, en dehors des heures de service. On écouta ce conseil, Jules Bastien passa l’examen, fut nommé surnuméraire et partit pour Paris vers la fin de 1867.
Il partageait son temps entre sa besogne de postier et les cours de l’École. Cela n’alla pas sans de nombreux et désagréables tiraillements; les exigences de la vie administrative rendaient difficiles des études suivies et sérieuses. Au bout de six mois, il reconnut que ce travail en partie double était impossible. Il fallait opter entre le bureau et l’École; il n’hésita pas, se fit mettre en disponibilité et, muni d’une lettre d’introduction de M. Bouguereau, il entra à l’atelier Cabanel, après avoir été reçu à l’École avec le numéro 1.
«Tout commencement est douloureux,» a dit Goethe. Bastien-Lepage en fit durement l’expérience. Il avait brûlé ses vaisseaux en quittant l’administration des postes, et il se trouvait seul dans Paris, avec des moyens d’existence très limités. A Damvillers, on s’imposait des privations: la mère, toujours vaillante, allait elle-même travailler aux champs, afin d’économiser de quoi grossir la petite somme qu’on envoyait tous les mois au jeune peintre; le conseil général de la Meuse lui avait voté, je crois, 600 francs de pension; tout cela réuni donnait à peine le vivre et le couvert. Mais Jules était doué d’une foi robuste, d’une volonté tenace, d’une gaieté inaltérable, et ces trois talismans lui aidaient à supporter vaillamment les moments pénibles des années d’apprentissage. En 1870, il envoya au Salon un premier tableau qui passa inaperçu. Je viens de revoir cette toile: c’est le portrait d’un tout jeune homme vêtu d’une redingote gros vert et noyé dans une lumière verdâtre. Il est un peu exécuté dans la manière du portraitiste Ricard; mais la tête, solidement construite, l’expression du regard, indiquent déjà l’artiste qui voit juste et s’applique à pénétrer dans l’intimité de son modèle.
Peu après, la guerre éclata. Jules Bastien s’engagea dans la compagnie de francs-tireurs commandée par le peintre Castellani et fit courageusement son devoir aux avant-postes. Un jour, à la tranchée, un obus en éclatant lui envoya une motte de terre durcie en pleine poitrine. On le conduisit à l’ambulance, où il resta pendant le dernier mois du siège, tandis qu’un autre obus tombait dans son atelier et y trouait la première de ses compositions: une nymphe nue, les bras noués autour de sa tête blonde et baignant ses pieds dans l’eau d’une source. — Dès le rétablissement des communications, il se hâta de regagner son village, où il arriva, comme le pigeon de la fable, fourbu,
Traînant l’aile et tirant le pied.
Il y passa le restant de l’année 1871, retrempant dans l’air natal sa santé délabrée, poussant de lointaines excursions jusque dans la Moselle et exécutant de nombreux portraits de parents et d’amis. Il ne rentra à Paris que dans le courant de 1872.
Alors recommença la vie pénible des débuts. Pour arriver à joindre les deux bouts, il cherchait à placer des dessins dans les journaux illustrés; mais sa manière intransigeante de concevoir l’illustration n’était pas pour séduire les éditeurs, qui cherchaient avant tout à plaire au gros public. De guerre lasse, il se mit à peindre des éventails. Un jour, un fabricant de lait antéphélique lui commanda une sorte de tableau allégorique destiné à servir de réclame à son eau de Jouvence. L’artiste, faisant de nécessité vertu, peignit une toile d’une coloration claire et gaie, dans le goût des paysages de Watteau. On y voyait des groupes de jeunes femmes habillées à la moderne se dirigeant vers une fontaine où gambadaient des amours. La composition terminée, Bastien manifesta au fabricant l’intention de l’envoyer tout d’abord au Salon. Celui-ci ne demandait pas mieux, mais à une condition: au-dessus de la fontaine, on devait lire sur une banderole colorée de toutes les nuances de l’arc-en-ciel, le nom du cosmétique et l’adresse de la maison de vente. Bastien s’y refusa naturellement, et l’industriel, frustré de sa réclame, lui laissa le tableau pour compte. Cette toile figura au Salon de 1873 sous le titre de: Au Printemps, et, perchée très haut, elle n’attira pas l’attention.
Jules ne se décourageait pas; seulement il était en proie à cette indécision inquiète et fiévreuse qui est la maladie des débutants. L’enseignement de l’École le troublait, et, grand admirateur de Puvis de Chavannes, il était tenté de s’essayer à la peinture décorative et allégorique. Sa seconde toile: la Chanson du printemps, exposée en 1874, est conçue et exécutée sous l’empire de cette préoccupation. — Elle représente une jeune paysanne assise à la lisière d’un bois, bordé par une prairie qui descend vers un village meusien dont on aperçoit au loin les toits de tuile rouge; la jeune fille, le bras passé dans l’anse d’un panier rustique où des violettes sont éparses, ouvre de grands yeux, tandis que, derrière elle, des enfants nus à ailes de papillon, soufflant dans des pipeaux, lui murmurent la chanson de l’herbe qui pousse et de la puberté qui s’éveille. Cette peinture claire et printanière, demi-réaliste et demi-symbolique, aurait peut-être, malgré son charme naïf, laissé encore le public indifférent, si elle n’avait été accompagnée d’un autre tableau qui mit tout à coup l’artiste en lumière, et fut un des succès du Salon de 1874.
Pendant ses dernières vacances à Damvillers, Bastien-Lepage avait eu l’idée d’exécuter le portrait de son aïeul, en plein air, au milieu du jardinet que le vieillard cultivait avec amour. — Le grand-père était représenté assis dans un fauteuil de jardin, tenant sur ses genoux sa tabatière de corne et son mouchoir à carreaux bleus. Du fond verdoyant des massifs se détachait franchement son originale figure. Le bonnet de velours noir, crânement penché sur l’oreille, laissait voir à plein son visage socratique à l’expression narquoise; ses yeux bleus pétillaient de malice, le nez large et retroussé avait un accent gouailleur que corrigeaient juste à point deux lèvres gourmandes; sa barbe blanche et fourchue s’étalait sur une vieille veste aux tons feuille-morte, et ses mains vivantes se croisaient sur l’étoffe grise du pantalon. — Devant cette peinture sincère, d’une facture si franche, d’une intensité de vie familière si saisissante, le public s’arrêtait charmé, et le nom de Bastien-Lepage, ignoré encore la veille, figurait le lendemain en belle place dans les articles écrits sur le Salon.